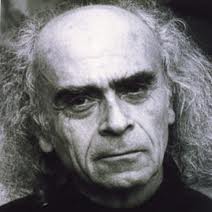(Revue Question De. No 52. Avril-Mai-Juin 1983)
Lorsque les Calvinistes s’emparèrent de Genève et prétendirent régir les coutumes selon des lois rigoristes, la première chose qu’ils décrétèrent fut l’interdiction des spectacles théâtraux. On explique communément ce rejet du théâtre par le souci calviniste de préserver les âmes de toute provocation au péché, le théâtre exposant trop, à entendre les censeurs, les mécanismes pervers de la Passion et de la Sensualité. Ce n’est pourtant pas le seul motif. On pourrait aisément parler du refus absolu et obstiné de ce que Pascal appellera plus tard le « Divertissement ». Tout ce qui nous écarte de la pensée de notre salut, donc tous les spectacles autres que l’assemblée ecclésiale du dimanche, assortie de la lecture de la Bible et de son commentaire, est, au sens étymologique « divertissant », c’est-à-dire nous « détournant » de la voie divine. Et enfin, ce n’est certainement pas la moindre motivation, le théâtre, parce que son origine est sacrée et se perd dans la liturgie des anciens temps, est un rituel que l’on doit rejeter au même titre que la Messe ou les pompeux offices dont le catholicisme s’est chargé au détriment de la méditation. C’est parce que le théâtre était une liturgie que les Calvinistes l’ont maudit et éliminé de la vie chrétienne.
LE JEU SACRIFICIEL
Au début était le sacrifice. Bien entendu, le sacrifice d’un être humain. Le dieu biblique commande à Abraham d’immoler son fils. Abraham obéit, et, au dernier moment, l’Ange intervient, sauve Isaac, et provoque le sacrifice par substitution. Cette anecdote rend fidèlement compte de la véritable révolution religieuse qui a vu le remplacement de la victime humaine par la victime animale. Dans la chronologie biblique, c’est l’événement qui met fin la phase sacrificielle inaugurée par Caïn, lequel, en réalité, n’est autre que le premier prêtre sacrificateur ayant osé offrir à Dieu une victime humaine. Certes, l’histoire de Caïn et Abel est obscure, mais l’interpréter uniquement comme un meurtre relève d’une grande primarité de l’esprit. Il est vrai que l’image du récit, prise à la lettre, invite à cette conclusion. Or, il est question de deux sacrifices offerts à Dieu par les deux frères Abel et Caïn. Le sacrifice d’Abel est agréable à Dieu, parce que la fumée atteint le Ciel. Celui de Caïn ne l’est pas, parce que la fumée qui surgit de son autel stagne et retombe vers la terre. On pourrait ironiser et prétendre qu’il n’y avait pas de tirage ce jour-là, ou encore que Caïn ne savait pas faire du feu correctement. Mais le problème soulevé est plus grave qu’on ne le pense. Caïn et Abel représentant symboliquement deux peuples, ou deux ethnies différentes, il faut supposer que leurs deux sacrifices n’étaient pas de même nature. Il est probable qu’Abel est un pasteur, tandis que Caïn est un agriculteur (comme le prouve sa lignée de forgerons, indispensables aux travailleurs de la terre et aux verriers). Il est probable qu’Abel fait brûler une victime animale, puisqu’il offre à Dieu le produit de son activité. Mais qu’offre donc Caïn, sinon un produit de la terre ? Il est bien connu, dans toutes les religions, que les dieux réclament des victimes vivantes et que le sacrifice doit être sanglant. Caïn doit donc se résoudre à prendre une victime vivante. Et pourquoi pas un être humain, son soi-disant frère, dont le nom signifie d’ailleurs « Fils d’El », c’est-à-dire « Fils de Dieu ». Tout cela est bien étrange. Désormais, chez une partie des Sémites, il y aura des sacrifices humains. Abandonnés chez certains, à partir d’Abraham et d’Isaac, ces sacrifices humains perdureront chez d’autres, comme les Phéniciens, et nous en avons une preuve historique à l’époque romaine : Hannibal n’a survécu que parce que son père Hamilcar lui a substitué un enfant d’esclave, la règle carthaginoise étant que tout premier-né devait être sacrifié. Et que dire du sacrifice de Jésus, victime consentante, mais parfaitement humaine en même temps que divine ? Seul un sacrifice humain sanglant pouvait réconcilier les créatures avec ce Dieu sanguinaire des premiers temps. Car tous les dieux sont sanguinaires. Ce ne sont pas des fruits de la terre, des gerbes de blé, qu’ils réclament, mais des victimes conscientes de leur sort, qui seront tuées selon les règles, dont le sang coulera, et qui seront les substituts de la collectivité dans son ensemble, les délégués de cette collectivité. Victimes humaines d’abord, puis, les mœurs s’adoucissant, victimes animales. Et pour finir dans le rituel catholique, victime divine sous les espèces du pain et du vin. Qu’on pense à la « Diane schythique », devenue l’Artémis grecque, dont le culte sanglant est mis en évidence par les tragédies d’Eschyle et d’Euripide. Qu’on pense à Kali l’indienne, au char de Jaggernaut, au dévorant Quetzalcóatl. Qu’on pense aux mannequins d’osier remplis de victimes et que l’on brûlait, aux dires de César, chez les Gaulois. Qu’on pense au célèbre sanctuaire des Irlandais païens, le Crom Cruaich, qu’aurait connu saint Patrick, et dans lequel les victimes mouraient par centaines. Qu’on pense à certains rituels de meurtres et d’anthropophagie rituelle dans l’Afrique contemporaine. Qu’on pense aussi à la Déesse Patrie qui réclame le sang de ses enfants sur les champs de bataille. Freud a essayé de trouver une explication à tout cela.
LE TOTEM ET LE TABOU
Partant d’un point de vue athée, il imagine, dans Totem et Tabou, le meurtre du Père (c’est-à-dire du chef de Tribu) par les fils pour s’assurer la possession de la Mère – et des sœurs. Ce meurtre du Père, selon Freud, a été suivi de la manducation de la victime par les fils, geste répété symboliquement le jour de la fête solennelle de la Tribu geste ayant donné naissance au totémisme, c’est-là-dire à la sacralisation du Père mangé symboliquement ce jour de fête (alors que sa consommation, sous forme animale, est interdite les autres jours). Freud a vu dans ces événements, à vrai dire plus imaginés que prouvés par les faits, la naissance de la religion, ou tout au moins d’une certaine forme de rituel religieux.
Il n’a peut-être pas tort sur le deuxième point. Certes, il est difficile de se contenter du meurtre du Père —même d’un point de vue mythologique — pour justifier la Religion dans sa totalité. Mais le rapport entre un meurtre et le rituel religieux de n’importe quelle tendance doit nous faire réfléchir. Les Catholiques assistent toujours au Sacrifice de la Messe, reproduction fidèle et réelle, selon le dogme de l’Église, du meurtre de Jésus. Et l’on sait bien que le théâtre de tous les temps, et de toutes les civilisations, sort en droite ligne de certains cultes religieux ayant le sacrifice sanglant pour point de départ. C’est absolument prouvé pour les Grecs : d’ailleurs, le mot tragédie ne veut-il pas dire « sacrifice du bouc » ? C’est également prouvé pour le théâtre médiéval qui dérive des cérémonies de l’église, des lectures de textes sacrés : peu à peu, on en est venu à la psalmodie, puis au mime, à l’interprétation dramatique, et enfin, au déplacement profane, c’est-à-dire, étymologiquement parlant, à l’évacuation du jeu rituel hors de l’église, « devant le temple ».
Il y a donc des certitudes. Dans deux religions repérables historiquement, le théâtre provient d’un ancien jeu sacrificiel. Pourquoi n’en serait-il pas de même pour les autres religions et les autres civilisations ? Nous n’avons pas de tragédies celtiques anciennes, tant en Irlande qu’en Bretagne. Et pourtant, comme nous allons le voir, les traces en subsistent. Et elles sont même très claires.
DU DRAME AU RÉCIT
La civilisation celtique étant de caractère oral, c’est seulement à partir du haut Moyen Age, et dans le contexte chrétien, que l’ancienne tradition a été confiée à l’écriture. D’où, au Pays de Galles et en Irlande, une masse de récits dits mythologiques, dont de nombreux thèmes se retrouvent dans les Romans de la Table Ronde. Or, la structure même des plus anciens de ces récits laisse supposer un état antérieur plus proche du drame liturgique que du conte événementiel. En effet, si le corps du récit est en prose, il est émaillé de fragments en vers, parfois dans une langue si archaïque qu’il est difficile de les comprendre, et d’une façon générale, on a l’impression d’être en présence de la description détaillée d’une cérémonie dont les participants sont des humains intégrant les fonctions divines au cours d’un jeu cosmique où se révèlent les lignes de force de la destinée du monde. La plupart de ces épopées sont centrées autour des principales fêtes religieuses des anciens Celtes, autour de Samain notamment, qui est le 1er novembre, jour de l’an celtique, pivot essentiel de l’année, fête de la communication entre le monde humain et le monde divin, ce qui se reconnaît aisément dans la Toussaint chrétienne et dans les manifestations folklorisées de la Halloween anglo-saxonne. Il y est question de batailles, de meurtres, de disparitions, de réapparitions, de « voyages dans l’Autre Monde », de pillage des trésors de l’Autre Monde, d’histoires d’amour impossibles entre des êtres humains et des êtres féeriques, d’intronisations royales, d’initiations mystérieuses. Et le tout exhale un parfum de violence et de sang. C’est de la tragédie, mais non de l’épopée.
L’ÉPOPÉE CELTIQUE
C’est donc dire que l’épopée celtique telle que nous la connaissons est une forme romancée, narrative, d’une antique liturgie qui n’est plus pratiquée par suite de la conversion des Celtes au christianisme, mais qui perdure dans l’inconscient jusqu’à s’exprimer verbalement dans les aventures et les prouesses des héros. En fait, on s’aperçoit que les héros sont les humains, prêtres et zélateurs de la divinité innommée et incréée, qui ont revêtu, sinon les masques, du moins les multiples fonctions de cette divinité. Les héros sont les acteurs du drame sacré qui oppose la Créature au Créateur par le biais d’une nature tourmentée et non encore réconciliée avec l’un ou avec l’autre. Les héros sont les prêtres. Parfois ils sont les victimes. Parfois, ils sont les sacrificateurs. Et le sang qui coule régénère à la fois la terre c’est-à-dire la vie terrestre et le ciel, c’est-à-dire la force divine toujours omniprésente, immanente, mais qui ne prend sa pleine signification que lorsqu’elle s’incarne, donc lorsqu’elle passe de l’état de l’immanence à l’état de la permanence. À ce compte, on est amené à prétendre que la religion des Celtes, le druidisme, n’est pas un polythéisme, mais un monothéisme : les personnages classés par les historiens comme étant des dieux ne sont en réalité que les incarnations, ou mieux les matérialisations fantasmatiques d’un dieu unique et multiforme.
Tout nous indique donc que l’épopée celtique traduit sur le plan du langage ce qui reste dans l’ancienne liturgie druidique. Son aspect théâtral ne pouvait plus se manifester dans le cadre chrétien dans lequel elle renaissait. Mais la trame recèle les moindres parcelles de son passé dramatique. Il y avait donc, dans l’antique société celtique, un théâtre sacré, et des représentations au cours des principales fêtes. Dans ces représentations, les rapports entre l’humain et le divin étaient étudiés, normalisés, stéréotypés. Ils se reconnaissent dans le récit épique, même si l’intérêt anecdotique paraît l’emporter sur la signification magico-religieuse.
Ce n’est d’ailleurs pas seulement dans la tradition celtique qu’une telle démarche est observable. On pourrait en dire autant de toutes les civilisations qui n’ont pas connu les formes élaborées de la représentation théâtrale. Et même chez les Grecs, lors du passage du drame au récit épique, les repères demeurent : la fin de l’Odyssée, tout entière bâtie sur le culte de l’ancienne déesse de souveraineté Pénélope, en demeure un exemple remarquable, car tous les détails concordent à nous faire vivre un authentique rituel, d’ailleurs sanglant, autour du personnage central de cette reine-déesse, filant et défilant, immobile et omnipotente, qui tisse sa toile arachnéenne afin de capturer son daimôn (Ulysse) après élimination des parasites qui s’efforcent de la contraindre (les prétendants). Triomphe de la Déesse-Mère. Triomphe de la Femme. Triomphe de l’Utérus divin. Sacrifice sanglant de ceux qui se croyaient missionnés, mais qui se révèlent de simples victimes pour étancher la soif de sang inextinguible qui caractérise les divinités, les grecques en particulier.
LA DÉITÉ
Car toute tragédie, c’est-à-dire tout sacrifice sanglant ritualisé et conservé dans la mémoire des peuples sous forme de jeu dramatique organisé et structuré, comporte une confrontation entre la Déité, d’essence féminine, et son Daimôn d‘essence masculine, sans qu’il soit nécessairement question d’un rapport affectif ou sexuel entre ces deux pôles constituant l’Être dans sa totalité. Toute l’histoire du monde, et partant, toute l’histoire de l’humanité, est accrochée au concept de sexualité, au sens le plus strict et le plus étymologique du terme, c’est-à-dire de « coupure », « séparation ». À partir du Chaos grec, l’apparition d’Ouranos et de Gaïa, le Ciel et la Terre, correspond à ce qui est relaté dans la Genèse à propos de la séparation de la Lumière et des Ténèbres. Sur un plan humanisé, la création d’Eve, à partir d’un Adam androgyne, donne pleinement à la sexualité sa valeur de déchirement, de séparation, d’écartèlement, et donc de souffrance, de recherche permanente de l’Autre pour parvenir à l’Unité primordiale perdue. Il y a la même dichotomie entre la Créature et le Créateur, celui qui subit passivement la création et celui qui assume cette création. Que le mythe de Lilith, en fait la première femme, vienne s’interjeter entre l’image adamique et la mystérieuse Figura du Jeu d’Adam ne change rien au problème : l’Être, dans son existence, c’est-à-dire dans son aspect relatif, ressent cruellement la coupure qui le sépare de son aspect absolu. Et cette coupure se traduit par une blessure : c’est le nombril, trace de la séparation d’avec la mère. C’est le sexe, qu’il soit phallus ou vulve, parce qu’il est incomplet, et qu’il ne recherche qu’une seule chose, la réintégration dans ou par l’autre.
LA DÉITÉ ET SON DAIMON
C’est donc le souvenir d’une blessure sanglante qui domine à la fois dans la mémoire traditionnelle exprimée par les épopées et les jeux dramatiques et dans l’inconscient des peuples depuis des millénaires. Cette blessure, qui n’implique aucunement une relation de type purement sexuel se sert souvent du symbole sexuel parce qu’il est le plus latent, le plus sensible, le plus évident. C’est la relation entre l’humain et la divine, comme en témoignent les mythes d’Adonis et de tous les autres amants de la Déesse, aimés et massacrés par un être divin qui lui aussi ressent la même blessure, qui lui aussi ne peut rien sans le contact avec l’Autre, parce que, selon la magnifique formule de Hegel, Dieu en tant qu’absolu, c’est-à-dire sans présence de l’Autre, son contraire, équivaut au néant. Et c’est aussi le symbole fondamental de la Mante Religieuse : la Déité, avec son aspect maternel intimement lié à l’aspect de souveraineté, est une vacuité absolue sans le Daimôn — autrement dit le Héros — qui va la remplir, à l’image du phallus envahissant la vulve, fécondant la matrice. Mais l’écoulement de la semence préfigure l’écoulement du sang. Et la Déité dévore son Daimôn, dont elle s’assure ainsi la force par ingestion. Toute liturgie sacrificielle prend sa source et sa justification sur cette idée fondamentale. Le rapport du non-divin au divin, qui est au centre du débat soulevé par une tragédie, ou n’importe quel drame sacré, s’exprime en termes d’opposition entre sacrificateur et victime. Mais cette opposition n’est pas sans ambiguïté.
En effet, de même que l’école freudienne a pu insister sur les troublantes complicités qui peuvent exister entre le bourreau et sa victime, nous pouvons facilement discerner une impulsion/répulsion de type sadomasochiste entre les protagonistes du drame sacré qui met aux prises les forces divines — voire les forces de la nature — aux forces conscientes de l’humanité prométhéenne. L’Anankê des Grecs, parfois plus accessible sous les traits des trois Moires, régit aussi bien les dieux que les hommes. La Déité et le Daimôn, apparemment contradictoire, sont engagés dans le même processus et convergent vers le même but : un orgasme au goût de mort. Moyennant quoi l’ordre du monde sera maintenu.
DÉSESPOIR ET TRAGÉDIE
Il apparaît que, dans toute dramaturgie tant soit peu nourrie de l’essence religieuse primitive, le schéma est toujours le même : un héros se trouve en conflit avec une divinité, ou la nature, ou la société, ce qui revient au même. Les sources de ce conflit peuvent être très diverses dans leurs formulations, elles se réfèrent cependant à un thème unique : l’ordre du monde est menacé. La dramaturgie a donc pour but essentiel de régénérer l’équilibre, soit en accomplissant des prouesses par lesquelles le héros se haussera au plan divin, soit par le sacrifice d’une victime, qui peut être le héros lui-même, afin de donner à la marche du monde une nouvelle impulsion. En ce sens, une dramaturgie est identique à un rituel religieux, sacrificiel bien entendu, par lequel le monde est régénéré par le sang de la victime. Jésus, en mourant sur la Croix, conduit le monde à un nouvel équilibre. Mais Prométhée enchaîné sur le Caucase, dans la permanence du sacrifice qu’il subit, offre les mêmes garanties. Et toute mémorisation, fût-elle symbolique, de ces deux événements, est une régénération du rapport entre la Déité et le Daimôn : en vertu du principe qui veut que sans Dieu, la créature ne soit rien, et que sans la créature Dieu soit néant, toute action qui met en jeu les deux forces complémentaires bien qu’apparemment antagonistes, débouche sur la constitution d’un monde nouveau, provisoirement équilibré, jusqu’à la prochaine alerte. C’est le fondement même de la religion.
On a souvent insisté sur l’aspect désespéré que revêt l’action du héros engagé dans un combat qui dépasse de beaucoup sa condition humaine. Ce désespoir lui vient de ce qu’il est parfaitement conscient de l’enjeu et du rapport de forces, lequel lui est, à l’origine, défavorable. Mais si le héros avait la curiosité de s’interroger sur la force de l’adversaire, il comprendrait peut-être que cet adversaire est aussi faible que lui. Son seul tort est de ne pas le savoir. Car à ce moment-là, la victime ne serait plus le Daimôn, mais la Déité. Dans la Fable, Apollon combattant et tuant le serpent Python est un simple Daimôn en face de la puissante Déité représentée par le Serpent de Delphes. Le sacrifice a lieu, mais la victime n’était pas celui qu’on croyait. Et Apollon prend la place de sa victime, quitte pour lui, quand le besoin s’en fera sentir, à prendre d’autres victimes et à les sacrifier. Mais les Grecs n’ont jamais osé, dans leurs dramaturgies sacrées, représenter la victoire de la victime désignée sur le sacrificateur qui-va-de-soi. Si Iphinégie est sauvée, au dernier moment, par l’intervention de Diane-Artémis, ce n’est pas par pure gratuité : Iphigénie deviendra une prêtresse d’Artémis, et en tant que telle, elle devra accomplir des sacrifices sanglants, d’où l’imbroglio mythologique d’Iphigénie en Tauride, tout embué de réminiscences archaïques concernant la grande déesse sanguinaire des Scythes.
Comme la dramaturgie a tendance de plus en plus à se déplacer, à sortir du temple et à devenir profane, les éléments psychologiques prennent le dessus sur les rouages mythologiques. Ces derniers n’étant plus perçus au premier degré, le fidèle, qui venait autrefois assister à une liturgie, se retrouve très vite un simple spectateur, davantage préoccupé des états d’âme des héros que de leurs motivations ontologiques. Comme ces héros sont des humains comme lui, il va s’identifier à eux et ressentir encore plus durement le désespoir qu’engendre leur situation. Et l’attitude du spectateur ne sera pas éloignée du blasphème : il considérera les divinités comme des êtres monstrueux assoiffés de sang et profondément injustes. Seul le christianisme apportera quelque adoucissement à cette vision désespérante de l’action humaine. Encore faut-il ne pas trop explorer l’univers racinien, car Racine, tout en s’affirmant chrétien, ne peut oublier que ses maîtres jansénistes lui ont fait découvrir une aveuglante vérité : les humains ne sont sur terre que pour être sacrifiés à la volonté d’un Dieu tout puissant qui ne pense qu’à une chose, reconstituer la dixième légion des Anges grâce à un véritable tri où la notion de justice s’estompe sous la notion de nécessité.
RACINE, OU L’ESSENCE DE LA TRAGÉDIE
Nul n’a en effet mieux témoigné de la valeur liturgique du théâtre que Jean Racine, tout en ayant la suprême habileté de camoufler cette valeur religieuse sous l’apparence du spectacle, ce spectacle étant d’ailleurs du meilleur ton, et de la technique la plus classique qui soit.Certes, une tragédie comme Andromaque ou comme Phèdre peut être interprétée à différents niveaux : il n’en reste pas moins vrai que l’essence même du spectacle est de nature à réveiller en nous le plus féroce déferlement de la passion religieuse.
Prenons Phèdre comme exemple. C’est la plus « noire »de toutes les pièces de Racine. Son échec — relatif — n’a pas été dû au hasard. Elle était trop lourde à supporter, surtout par un public qui voyait dans la tragédie, celle de Corneille en particulier, une glorification du héros et l’encouragement à l’action volontaire. Phèdre nous offre une palette de personnages, présents ou absents, qui sont des victimes désignées ou possibles. Mais ils sont aussi des bourreaux, c’est-à-dire des sacrificateurs potentiels. Et les grands absents sont des Déités : Vénus « tout entière à sa proie attachée », Neptune, dont Thésée n’invoquera pas en vain le nom, et surtout Diane — encore elle, cette Artémis des anciens temps — dont le malheureux Hippolyte est le prêtre plus ou moins inconscient.
DIANE – HIPPOLYTE
La victime désignée est Phèdre. Elle doit être sacrifiée à Vénus. Ce n’est pas forcément son sang que la déesse réclame, mais son acte. Et ne pouvant accomplir son acte, elle opérera une substitution en faisant désigner une autre victime, le jeune Hippolyte. Car peu importe la victime, il faut que l’ordre du monde soit maintenu de gré ou de force. Seulement Hippolyte n’a pas à être sacrifié à Vénus : la déesse réclame des comptes à Phèdre, et Phèdre mourra quand même.
En effet, Hippolyte est lié à Diane. Chez Euripide, il est nettement défini comme prêtre de Diane et donc voué à la virginité, tout au moins à la chasteté. Chez Racine, on ne nous dit pas qu’il est prêtre de Diane, mais tout ce qu’il raconte nous fait comprendre les liens intimes qu’il entretient avec la déesse, ne serait-ce que par sa fréquentation des bois et par son goût pour la chasse. Or l’Hippolyte racinien est amoureux, non de Phèdre, mais d’Aricie. Il trahit donc son serment à Diane. Celle-ci doit donc rétablir la situation, se venger, au premier degré, l’absorber dans la mort, au second degré, car il n’est pas admissible que le couple mystique Diane-Hippolyte soit détruit par l’intrusion d’une mortelle.
Or, cette mortelle, c’est Aricie, qui est également une victime désignée. Elle est prisonnière de Thésée, témoin de la vengeance de la famille de Thésée sur les anciens rois d’Athènes. En fait, c’est Aricie qui devrait périr, et tout rentrerait dans l’ordre : Phèdre aimerait Hippolyte sans rivale. Mais cette rivalité, même si Phèdre fait condamner définitivement Hippolyte après avoir appris que le jeune homme aimait Aricie, ne se joue pas dans la dimension humaine. La réalité est une lutte entre Vénus et Diane, lutte métaphysique, cosmique, même, symbole de cet équilibre qui doit être maintenu entre deux forces différentes de la Déité absolue dont Diane et Vénus ne sont que des images. Hippolyte, l’innocent, mais aussi le niais, le trop confiant dans sa pureté, est l’objet de la lutte entre les deux déesses. Et c’est une troisième divinité, Neptune, qui accomplira le sacrifice. Ainsi le monde peut tourner de nouveau : Phèdre n’obscurcira plus les rayons du soleil avec sa mauvaise conscience et sa flamme intérieure, Hippolyte sera éternellement le prêtre fidèle de sa Diane, maîtresse exigeante et tyrannique, Thésée sera débarrassé de son orgueil qui l’aveuglait, mais perdra évidemment tout crédit et tout pouvoir au profit de la « timide » Aricie qui, de victime désignée, accède au rang de grande prêtresse des temps futurs. À bien y réfléchir, le schéma était le même dans Andromaque, où la veuve d’Hector, captive et victime, conquiert, contre toute attente, le pouvoir suprême.
Chez Racine, la tragédie dépasse le spectacle, quand bien même ce spectacle serait le plus réussi, le plus techniquement achevé. Racine projette sur les spectateurs le plus archaïque des sacrifices humains. Liturgie ambiguë s’il en fût, la dramaturgie racinienne étend son ombre au plus profond de l’inconscient humain, dans ce qu’il a de plus primitif, de plus sauvage : l’humanité ne peut survivre que grâce à un accord avec les dieux. Et les Dieux réclament de temps à autre du sang humain. Sinon, l’humanité envahirait l’Olympe et se croirait tout permis. Prométhée suffit. L’équilibre du monde est trop précaire pour se permettre une nouvelle Tour de Babel. Chacun à sa place. Le monde des dieux et celui des hommes se complètent et s’interpénètrent parfois. Mais ils sont aux deux pôles de la vie existentielle : leur confusion serait la néantisation de l’univers relatif dans lequel le divin et l’humain s’affrontent à corps perdus. Seul, l’acte religieux doit servir de passerelle.
PROFANATION OU SACRALISATION ?
En réalité, toute représentation dramatique demeure liée à des racines sacrées. Même ce qu’on appelle « comédie »est redevable à la liturgie ancienne. Ne dit-on pas que la farce médiévale sort directement du drame sacré ? Chez Aristophane, les implications religieuses sont transparentes, même si elles sont parfois transformées en parodies. Dans ce cas, les formules d’exécration remplacent facilement les dévotions. Et l’aspect sacré n’en est pas pour autant diminué. Le Tartuffe ou l’Avare sont plus grinçants que drôles. Don Juan est une immense tragédie où le rire est tantôt une prière, tantôt un blasphème. Il en est de même dans toutes les pièces de Shakespeare, ainsi que dans le drame romantique : le mélange des genres, le « grotesque et le sublime », ne doivent pas nous faire oublier l’intensité des forces mises en jeu. Les essais contemporains dits de « théâtre total » sont également caractéristiques de cette volonté inconsciente d’associer l’être tout entier au spectacle. Au fond, le secret désir des auteurs dramatiques contemporains et des metteurs en scène, c’est celui qu’Antonin Artaud a tant de fois exprimé, aussi bien dans le Théâtre et son Double que dans le Théâtre de la Cruauté : faire participer les spectateurs à une action magico-religieuse dans laquelle, selon la parole d’André Breton, « le communicable et l’incommunicable cessent d’être perçus contradictoirement ».
RÉSURGENCES
On dira qu’il s’agit plus de magie que de religion. Mais la frontière entre la magie et la religion est difficilement repérable. La religion, dans ses cérémonies, utilise des éléments qui se réfèrent davantage à la magie qu’à la prise de conscience claire des phénomènes. La sensibilité, pour ne pas dire la sensualité, fait partie intégrante du cérémonial religieux. C’est pourquoi les Calvinistes, soucieux de rigueur intérieure et persuadés qu’une ascèse rationnelle est possible, ont écarté ces liturgies suspectes, parce qu’ambiguës dont abonde le catholicisme romain ou orthodoxe, à l’imitation de la plupart des religions du monde. Qu’il y ait de la magie dans la messe catholique, c’est incontestable. Mais la magie et la religion font toujours bon ménage. Elles constituent un Sacré vécu dans le quotidien.
À des titres divers, le théâtre participe de ce Sacré. On a voulu écarter toute notion de sacré au nom d’un vague rationalisme. On a profané le théâtre en en faisant un divertissement. Cependant, il ne suffit pas de vouloir écarter le sacré pour l’anéantir. Plus il est refoulé, plus il a tendance à franchir des niveaux de conscience qui devraient demeurer obscurs. Plus on le combat ouvertement, plus il affirme sa plénitude, ne serait-ce que par les biais les plus subtils, les plus innocents en apparence. Huis Clos de Sartre est une tragédie religieuse. Les tentatives du Living Theater sont les balbutiements d’une nouvelle formulation dramatique où le sacré envahit l’univers psycho-social dans lequel on prétendait enfermer l’action humaine. Alors, allons-nous assister, à l’aube du troisième millénaire, à une résurgence de la dramaturgie sacrée ?
Les périodes troublées suscitent le prophétisme. Les guerres remplissent les églises. Et aussi les théâtres.Ce n’est pas par hasard.