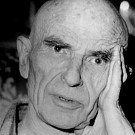(Revue 3e Millénaire. Ancienne série. No 15 Juillet-Août 1984)
2000 ans d’histoire qui ont peu à peu fait la France et soudé un peuple. Vingt siècles de guerres, de soubresauts, de convulsions, d’apathie aussi ont constitué l’essence même d’une population née d’ethnies disparates. Ce qui soude ces hommes et ces femmes que l’on appelle Français, c’est un amour viscéral de la liberté (et non des libertés). Cette particularité fondamentale, que de gouvernements ont négligé d’en tenir compte et l’ont payé de leur disparition. Pour suivre ce destin qui les dépasse, les Français semblent n’avoir qu’un mot d’ordre, qu’une constante, qu’un concept en commun : la Liberté.
Il y a 20 siècles Jules César et Vercingétorix l’avaient amèrement constaté
Je lis sans excessif souci que les jeunes Français sont maintenant toujours aussi ignares en histoire qu’au temps du lycée Papillon. Le temps du lycée Pa-Pa, c’était le mien et je me rappelle fort bien que les adultes riaient plus fort que nous. Dame ! il fallait, parfois, nous expliquer :
Monsieur l’Inspecteur
Je sais tout ça par cœur.
Car si les jeunes Français sont par essence ignorants de leur passé, il est juste de reconnaître que c’est une tradition historique, que Louis XIV se croyait fils des Francs, et que les soldats de l’An Deux ignoraient jusqu’au nom de Vercingétorix, celui-là, même, Monsieur l’Inspecteur, qui battit les Chinois un soir à Roncevaux.
Comme nous le rappelait récemment fort à propos la presse espagnole, les Français sont arrogants, vantards, inconsidérés, fanfarons. C’est vrai, en toute modestie, et nos voisins parlent d’or. Tout Français voyageur rentrant au bercail est consterné de retrouver sa propre image dans le gabelou qui le regarde de travers sur le seuil sacré de la Patrie. Churchill, qui aimait la France, se demanda avec effroi tout au long de la guerre ce qu’elle pourrait encore inventer, la paix revenue, pour embêter le monde. De Gaulle d’ailleurs était là pour entretenir ce souci.
Bien. Tout cela est vrai, y compris le jugement fameux du même de Gaulle sur ses compatriotes. Tout cela est vrai, mais il y a quand même un mystère de la France et des Français.
La passion de diviser
En l’an 59 avant J.-C., César se fait nommer gouverneur de la Gaule Cisalpine, enfourche son cheval et s’en vient, dès l’année suivante, batailler de ce côté-ci des Alpes. Je viens de relire, une fois de plus, le livre génial où il raconte sa conquête. On ne cesse d’y trouver des raisons d’admirer cet homme extraordinaire. Surtout si l’on prend garde de se rappeler qu’il le dicta à toute allure aussitôt Alésia tombée, non point pour les lecteurs des millénaires à venir, mais en guise de manifeste électoral, pour impressionner le Sénat et préparer ses ambitions de l’année suivante.
Les historiens ne manquent jamais de souligner combien il avait intérêt à gonfler l’affaire gauloise, le danger gaulois, les exploits de son armée. Les Gaulois ont été ses ennemis, mais d’un autre côté, il compte sur l’ennemi conquis et rallié pour conquérir le pouvoir à Rome.
Bref, son pamphlet électoral est a priori très suspect. Il faut s’attendre à y trouver n’importe quoi. Si donc la vérité s’y reconnaît, de quel prix, de quel poids doit-on l’évaluer !
Livre IV, chapitre 5 : « Les Gaulois sont versatiles dans leurs décisions, passionnés de changement (…). Ils arrêtent les voyageurs et les retiennent même pour les faire bavarder, pour savoir ce qui se passe ailleurs, et ces rumeurs les passionnent tant qu’ils sont prêts à décider souvent n’importe quoi, quitte à s’en repentir et à changer d’avis… »
Livre III, chapitre 10 : « Ils ont la manie du changement, se laissent entraîner dans les guerres avec la plus grande légèreté (…) et tous ont de nature l’amour de la liberté et l’horreur de l’esclavage… »
Livre VI, chapitre 6 : « En Gaule, je ne dis pas seulement dans chaque province (patio), mais dans tous les cantons, dans les divisions de cantons, et même dans les familles, il y a des partis opposés… », (Suit un exposé qui mériterait bien une amusante exégèse, puis :) « le même système s’applique à l’ensemble de la Gaule, où dans chaque province on est divisé en deux partis ».
Ah, ce régime des partis, cette passion de se diviser, comme leur chef le général de Gaulle, je veux dire Vercingétorix, le leur reproche !
Discours de Vercingétorix, livre VII, chapitre 29. Après avoir expliqué que si les Romains avaient vaincu jusqu’ici ce n’était que grâce à leur supériorité technique (cf. l’Appel du 18 juin) : « Je vais m’appliquer à faire l’unité avec les provinces qui ne se sont pas encore ralliées à la France Libre (pardon) au reste de la Gaule, car, unis, nous sommes invincibles ».
Autre discours remarquable, celui qu’Ambiorix, roi des Éburons (sur la rive gauche de la Meuse), tient à une ambassade de César : il lui explique que la nature même de son pouvoir « est telle que le peuple n’a pas moins d’autorité sur lui que lui sur le peuple ». César, du reste, consacre de nombreux chapitres à expliquer pourquoi et comment il a été obligé d’exterminer intégralement, hommes, femmes et enfants, ces maudits Éburons qui s’obstinaient à refuser l’autorité romaine.
La Gaule déjà coupée en deux
Évoquerai-je encore les fameux chapitres 13 et suivants du Livre VI où est décrite la société gauloise ? Il n’y a que « deux classes qui comptent » : les druides et les « chevaliers ». Druides et chevaliers, clergé et noblesse, rien à voir avec la France moderne. Mais, en fait, quand on scrute au-delà des mots pour voir le rôle social de ces « classes », on voit d’abord que les druides sont les « intellectuels » : sans doute coupent-il le fameux gui, etc., mais ils ont le monopole de l’éducation nationale, non seulement en enseignant mais en faisant l’opinion, en jugeant, en disputant sur la nature des choses, les pays lointains, le temps (le temps qui passe), en « statuant dans presque toutes les contestations publiques ou privées », en désignant publiquement les gens comme il faut et les autres, en tenant des congrès. Ce sont des fonctionnaires, ils ne paient pas d’impôts, et « en général » ne font pas la guerre.
Les « chevaliers » ne se prêtent pas à un parallèle aussi curieux, mais on peut dire que ce sont « les riches », en se souvenant que la richesse dans la France actuelle n’est plus la seule détention du capital. Disons-les « gros ». Ceux-là firent la guerre à César, furent vaincus « par la technique », comme on peut s’en rendre compte au Musée de Saint-Germain-en-Laye et se romanisèrent. Quant aux druides, il fallut, comme les Éburons, les exterminer. Cela prit quand même quelques siècles.
Cela lu, il n’y a pas que César. Sur certains points, nous en savons plus que César sur les Gaulois. En particulier sur leur passé. César paraît croire qu’ils sont une race, nous savons qu’il n’en est rien. Du point de vue ethnique, ils étaient, au moment de Vercingétorix, un amalgame, un melting pot de peuples venus de l’Est au cours des derniers millénaires. Les Gaulois, en fait, c’était les druides, c’était une culture. Cette culture est très postérieure au peuplement de la Gaule. Les mégalithes de Bretagne existaient depuis des milliers d’années quand elle se répandit, venant peut-être d’Europe Centrale. Et il y a là un premier problème : si les Gaulois étaient une culture, comment se peut-il qu’après deux mille ans et plusieurs changements de langue, de religion, d’obédience, tant de régimes politiques, tant d’invasions, de révolutions et de guerres, on trouve encore en de nombreux chapitres de César le sentiment d’une troublante familiarité ?
Le buvard des invasions
Je n’en sais rien, je n’ai jamais là-dessus rien lu de convaincant, mais je vois bien ce qu’est encore la France actuelle : une terre d’asile, un endroit où tout le monde devient Français en quelques générations ou une seule, sans forcément perdre son identité, où même la plus illustre noblesse peut s’appeler Poniatowski, Marc Donald, de Broglie, Turckheim, et cela depuis toujours. Les O’Kelly-Farell, d’origine irlandaise, remontent au XIIe siècle. Les Reinach et Hirtzbach au début du XIIIe siècle, les Schauenburg à 1276, les Mühlenheim-Rechberg à 1337 (je puise cette surprenante érudition dans le Quid), et l’on trouve en France des descendants directs de Gengis Khan et des Empereurs de Byzance tellement bien recyclés qu’ils font comme vous et moi, du moins moi, partie de l’obscure piétaille.
Le lecteur espagnol aura reconnu dans les lignes qui précèdent l’insupportable complaisance française. Eh oui. J’éponge donc mon front et je poursuis.
Les Gaulois, dit César, dit Lucain, dit Pausanias, étaient impitoyables et cruels. Malheur aux vaincus ! ricane Brennus en jetant son épée dans la balance. Ils avaient l’habitude de ficeler leurs prisonniers dans de grands paniers d’osier et de les regarder brûler. Ils aimaient, en guise d’ornement, disposer des têtes coupées sur les piliers des portes. Et sur ce point, l’archéologie confirme, voyez les piliers du portail d’Entremont, le réalisme des yeux et des lèvres en train de pourrir. Comme on voit que le sculpteur avait l’habitude de ce spectacle, qu’il le trouvait noble et joli, ainsi naturellement que tout le peuple et notamment les druides du lieu, ses probables clients ! Ah, n’est-ce pas, là au moins on voit que le temps a passé, que nous ne sommes plus ainsi.
Soit. Cependant, j’ai beau chercher dans les innombrables horreurs dont l’Europe s’est souillée ces derniers siècles, je trouve aisément pire que ces ostentatoires têtes coupées, mais je ne vois nulle part, sauf erreur, ces têtes elles-mêmes, excepté dans la plus belle des Révolutions, la nôtre. Ça ira, ça ira, Monsieur l’Inspecteur. N’est-il pas noble et joli, le geste de ce patriote inclinant vers Marie-Antoinette, au bout de sa pique, la tête fraîchement coupée de son amie de cœur la princesse de Lamballe ? Lisez aussi le dernier livre de Michel Ragon sur la Vendée, ou plus près de nous, pendant la dernière guerre, les hauts faits de la Milice française. Un de mes amis me rappelle parfois le soupir de soulagement qu’il poussa quand, arrêté par celle-ci, il fut transféré à la Gestapo allemande.
Sommes-nous impitoyables et cruels ? Le plus français des idéologues, Voltaire, le croyait sans l’avoir appris de ses yeux quand il prêchait pour la société civilisée, affirmant contre Rousseau que l’homme naît bête et méchant et que la société seule lui enseigne un peu de vertu. Il exagérait. L’homme ne naît pas bête et méchant. Mais la société qui prospérait sur notre terre bénie au temps d’Entremont, plus de cent ans avant César, nourrissait des fantasmes de sang qui ne sont pas encore bien effacés au fond de nos âmes. Dieu merci, elle en nourrissait d’autres aussi, plus présentables.
Jules César avant de Gaulle
Mais enfin, tout de même, César ne dit pas que les Gaulois étaient des veaux ? Si. Il le dit. Et même il l’explique, non sans délectation, cherchant peut-être dans son beau latin, un mot aussi lapidaire et expressif que celui de de Gaulle. Il dit, livre VI, chapitre 13, que le peuple « n’ose rien faire par lui-même », qu’il « ne participe pas aux délibérations », quoiqu’en maint autre passage il reconnaisse sa bravoure et son audace. Seulement, ils « manquent d’obstination » (Livre VII, chapitre 20). On remarquera la contradiction apparente entre les propos d’Ambiorix, cité plus haut, et l’affirmation qu’ils ne font rien par eux-mêmes. Si le pouvoir du chef « n’est pas plus grand sur le peuple que celui du peuple sur lui », on se demande comment César peut penser ou feindre de penser que le peuple ne participe pas aux délibérations. Il faut lire avec attention le discours et les aventures d’Ambiorix pour comprendre, et alors on n’est pas peu surpris. Ambiorix veut dire qu’il ne peut être tenu pour responsable des sottises commises par les siens car tout est toujours remis en question, ses concitoyens se reposent sur lui pour prendre les décisions, mais ces décisions sont aussitôt décriées, oubliées et abandonnées pour n’importe quelle lubie s’il n’est pas là pour garder la barre. Bref, ce que disait plus brièvement de Gaulle, c’est ce que César essaie, mais sans se faire trop d’illusions, de faire comprendre au grave Sénat romain. « Mais enfin, disaient les sujets d’Ambiorix, qu’attend le gouvernement pour faire ci et ça ? » Le gouvernement le faisait-il, aussitôt l’on cherchait autre chose. « Ils ont la passion du changement ».
Épongeons notre front.
Mais du diable alors si j’entrevois pourquoi nous avons traversé ces deux mille ans d’histoire mieux que notre conquérant romain, l’assimilant sur place et après lui les Francs, et depuis les Francs tous ceux qui ont bien voulu venir sur notre sol pour y goûter l’indéfinissable pagaïe gauloise et nous aider à l’entretenir. Qu’est-ce donc qu’être Français ? « Ils sont versatiles », disait César : et voilà, il se trouve que non. Ils sont versatiles sur le court terme et increvables sur le long, tels sont les faits.
Le 18 juin… 1429
Je nie que la raison suffise à expliquer une survie qui ne se perçoit pas à l’aune de la mémoire humaine et que nous ne soupçonnerions pas si les historiens de l’antiquité n’avaient décrit nos ancêtres, précisons : nos ancêtres spirituels ou culturels.
Je nie que la raison y suffise parce que réellement, historiquement, le moment le plus sublime de cette histoire qui n’est pas finie nous invite à regarder plus loin.
Ce moment unique dans notre histoire et peut-être dans l’histoire humaine est très bref, il dure moins d’un mois : de la bataille de Patay, le 18 juin 1429, au sacre de Charles VII, le 17 juillet.
Patay, c’est la première victoire française en rase-campagne de la guerre de Cent-Ans, une petite bataille, à peine une bousculade comparée aux grandes boucheries modernes ou antiques. Seulement, cette petite armée, jusque-là en déroute est animée par une fille de dix-sept ans et sa victoire ne doit rien au hasard. Elle est le fruit d’une tension morale infusée à tout un peuple par cette fille.
Chaque année ou presque paraît en France un livre dont l’auteur a enfin expliqué Jeanne d’Arc. Comme dit Régine Pernoud, c’est, inlassablement, « Jeanne devant les Cauchons ». C’est une manie. Mais bon, admettons une explication, ou l’autre. Restera toujours à dire pourquoi et comment tout d’un coup, d’un bout à l’autre d’un pays épuisé, saigné, résigné à tout, abreuvé d’échecs, la levée du siège d’Orléans, le 29 avril de cette même année 1429, changea les esprits et fit passer sur eux le frisson de la vérité. Soudain, chacun sut ce qu’il fallait faire. Michelet, dans le volume VI de son histoire, a su exprimer ce sentiment fugace et surhumain.
-
L’effet de la délivrance d’Orléans fut prodigieux. Tout le monde y reconnut une puissance surnaturelle (Michelet rapporte alors les discussions qui s’élevèrent du côté français sur ce qu’il fallait faire : « aller à Reims sacrer le roi », dit Jeanne) .
-
La Pucelle était seule de cet avis, et cette folie était la sagesse même. Les politiques, les fortes têtes du Conseil, souriaient : ils voulaient qu’on allât lentement et sûrement, c’est-à-dire qu’on donnât aux Anglais le temps de reprendre courage.
Jeanne l’emporte finalement, et c’est Patay.
-
Les politiques voulaient qu’on restât encore sur la Loire… Ils eurent beau dire cette fois. Les voix timides ne pouvaient plus être écoutées. Chaque jour, affluaient des gens de toutes les provinces qui venaient au bruit des miracles de la Pucelle, ne croyant qu’en elle et, comme elle, avaient hâte de mener le roi à Reims. C’était un irrésistible élan… L’indolent roi lui-même finit par se laisser soulever à cette vague populaire, à cette grande marée qui montait et qui poussait au nord. Roi, courtisans, politiques, enthousiastes, tous ensemble, de gré ou de force, les fois, les sages, ils partirent. Au départ, ils étaient douze mille. Mais le long de la route, la masse allait grossissant. D’autres venaient, et toujours d’autres. Ceux qui n’avaient pas d’armure suivaient la sainte expédition en simples Jacques…
On ne nous fait pas le coup du miracle
Quand je lis les textes de cette époque, souvent modestes, tels que les érudits les établissent, il me semble, oserai-je dire, que les siècles s’effacent et que le mystère dont je parle ici m’apparaît comme le soleil entre deux nuages. Si je le dis ainsi tout bonnement au lieu de construire une phrase, de cafarde objectivité, c’est parce que les Français ont la tête dure, qu’ils sont cyniques et douteurs, qu’on ne leur fait pas le coup du miracle. C’est donc seulement une foi personnelle que j’exprime dans ces pages, certain, subjectivement tant qu’on voudra, qu’elle éclairera un jour notre vieux destin.
Voici donc ce que je crois.
Oui, les Français sont des veaux. Ils le sont dès leur apparition dans l’Histoire sous le nom qu’ils ont perdu. Ils ne cessent depuis lors d’en convaincre le monde et eux-mêmes. Mais ce peuple capricieux et incertain n’a jamais cessé non plus d’accomplir une tâche. Cette tâche le dépasse. Il n’en est pas digne. Même elle échappe à son entendement. Il n’en a pas conscience. Et pourtant, « de gré ou de force » il l’accomplit. « Ils n’aiment que la liberté, dit César, ils ont horreur de l’esclavage ». Qu’avons-nous fait pour cette liberté ? Je n’en sais rien. Mais du moins nous l’avons gardée. Même oppresseurs, nous l’avons répandue. « Nous vous mettons à la porte, me disait un Tunisien, parce que nous avons lu Montesquieu ». Que chantaient les insurgés de Budapest ? La Marseillaise.
Durant ces mois du printemps 1429, si vite passés, si lointains déjà, mais immortels, la foule unanime « qui montait et poussait au nord », vers le Sacre, allait se faire elle-même sacrer en la personne de son débile roi.
Le faible Charles VII conduit à Reims par une mystérieuse et irrésistible force, c’est nous, c’est nous-mêmes. Et la jeune fille héroïque, incarnation de cette force, c’est notre destinée. Qui la comprend ? Pendant un bref instant, la France tout entière. Comme un dormeur enfoncé dans sa nuit se réveille et découvre qu’il est, ainsi les Français pendant ces quelques mois s’identifièrent à leur destinée qu’ils purent voir chevaucher dans son armure blanche.
La blanche vision s’est effacée dans la fumée d’un bûcher. Et depuis ce jour parmi nous des voix se relaient monotonement pour nous persuader que nous avons rêvé. Il faut que ces merveilles n’aient pas eu lieu, il le faut pour légitimer nos défaillances et nos manques. Cela aussi est prévu dans le mythe fondateur, mythe de sang vraiment versé, de malheur héroïquement affronté, mythe par son sens mais vérité de douleur et de chair. En effet, ce n’est pas l’héroïne qui fut sacrée à Reims, mais le faible roi, nous-même en sa personne. Nous n’échapperons pas à ce devoir trop lourd pour nous, et duquel depuis nous nous acquittons en maugréant, sinon à contrecœur mais bel et bien.
J’écris cela, que du fond de mon âme je crois, et que pourtant je ne comprends pas. Si le Grand Artificier de l’Histoire est intervenu dans la nôtre, s’il l’a remise au centre du monde au moment où elle allait s’achever, je me demande bien pourquoi, considérant les siècles ultérieurs.
Dans quel dessein nous a-t-il épargné le sort des Éburons, c’est ce que je ne discerne pas.
Quelle mouche l’a piqué, à quel humour cosmique a-t-il puisé pour choisir comme instrument de sa geste une fille en âge de préparer le bac, lui accordant le génie, le courage et la grâce qui si souvent nous font défaut ?
Je cherche et ne comprends pas.
Tout en m’émerveillant de certaines chose peu croyables que nous avons faites depuis, en dépit de nous et pas plus mal que d’autres, je ne peux croire qu’il fallait pour cela inventer la Pucelle et son fulgurant passage parmi nous.
A moins que l’Histoire de France n’ait pas encore commencé, que le but du Sacre nous attende encore « dans un temps, encore un temps et la moitié d’un temps ».
Nous qui ne croyons à rien serions alors à notre insu chargés d’un devoir prophétique, humour suprême ? Pourquoi pas ?
Il faut une vie déjà longue pour envisager cette folie, puis y reconnaître le souffle d’une tempête que nos oreilles ne veulent pas entendre.
Mais Dieu me garde de prêcher. Buvons plutôt ensemble, voulez-vous ? Les temps sont longs, le parti qui n’est pas le mien fait tant de sottises que si l’on ne se soigne pas, on risque de faire un eczéma. Je ne vous demande rien sur le parti que vous n’aimez pas. Il ne peut guère être meilleur. Santé !