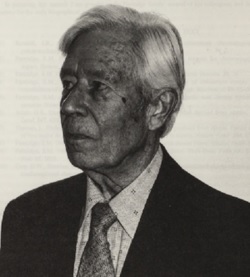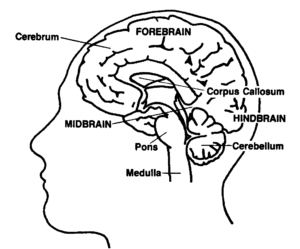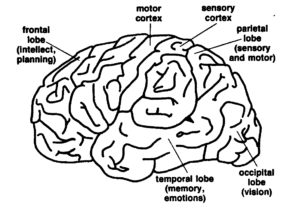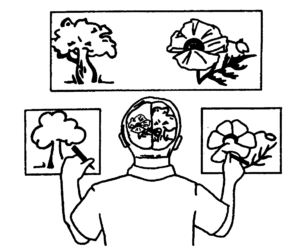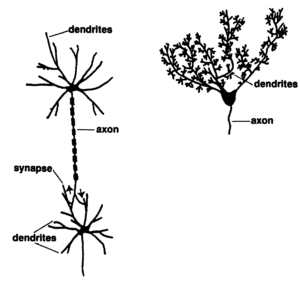De grands progrès ont été réalisés dans la compréhension du fonctionnement du système nerveux, et nous avons même une idée approximative de la façon dont cet ordinateur le plus subtil et le plus élaboré de tous, le cerveau humain, accomplit ses fonctions. La conception des codes moléculaires et du stockage chimique de l’information, issus des travaux sur la reproduction, ont stimulé des spéculations fascinantes sur le mécanisme de la mémoire et même sur l’ancien mystère des rêves.
Mais ce qui reste totalement incompréhensible est comment et pourquoi le cerveau devient le véhicule de la conscience… Certains philosophes ont voulu écarter le problème esprit-matière comme une simple confusion verbale. Je soupçonne qu’au fond, ils n’attachent simplement aucune importance à la description scientifique des choses et sont donc indifférents à toute rupture entre celle-ci et le langage qui décrit le monde de l’expérience consciente. Si tel est le cas, ils ont bien sûr le droit de rester indifférents ; mais les hommes de science, eux, ne le peuvent sans doute pas.
Sir Cyril Hinshelwood
Le cerveau humain est l’objet le plus merveilleux de tout l’univers. C’est l’organe le plus complexe et le plus polyvalent. La façon la plus simple de décrire son organisation tridimensionnelle élaborée est probablement de commencer par le bas et l’arrière, là où le cerveau rejoint la moelle épinière, et de progresser étape par étape vers le haut et l’avant. Cette séquence est également logique puisqu’elle suit approximativement le développement évolutif.
Nous rencontrons d’abord l’ancien cerveau reptilien et le cerveau mammalien, bien que ceux-ci aient en partie reçu de nouvelles fonctions pour répondre aux besoins humains. Par exemple, l’odorat est beaucoup plus important pour les animaux que pour nous ; ils avaient besoin d’une plus grande proportion du cerveau pour traiter et distinguer les impressions olfactives. Dans le cerveau humain, la majeure partie de la région olfactive est utilisée à d’autres fins. Néanmoins, nous en avons davantage que ce que la plupart d’entre nous utilisent. Le sens olfactif peut être grandement cultivé, et c’est ce que font, par exemple, certains chimistes, les dégustateurs de vin et surtout les parfumeurs. À mesure que nos besoins se sont accrus, de nouvelles parties du cerveau se sont développées, ont augmenté en taille et se sont entassées dans un crâne déjà aussi grand que le permet l’anatomie.
Le cerveau est subdivisé de diverses manières pour faciliter la description, mais la nomenclature est quelque peu confuse. Des racines latines et grecques ont été utilisées, tandis que certaines zones portent le nom de leurs découvreurs. On peut commencer par une simple division en trois parties : 1) le cerveau postérieur ; 2) le mésencéphale ; et 3) le cerveau antérieur ou le cerveau proprement dit. Le cerveau postérieur et le mésencéphale occupent ensemble environ 1/6 du volume total, tandis que le cerveau antérieur occupe le reste.
SUBDIVISIONS DU CERVEAU
Le cerveau postérieur (ou rhombencéphale, contenant le cervelet et le bulbe rachidien) est principalement impliqué dans les mouvements corporels. Le pont de Varol relie le cerveau postérieur au cerveau moyen. Le cerveau moyen (ou mésencéphale), qui mesure à peine un pouce de large, est impliqué par les réponses à la lumière et au son, ainsi que dans le sommeil. Le cerveau postérieur et le mésencéphale réunis sont appelés le tronc cérébral ou cerveau ancien (animal). Ce sont ces parties du cerveau qui nous permettent d’exécuter des mouvements habituels et des compétences acquises sans pensée consciente, comme le vélo, la natation ou taper à l’ordinateur.
Reliant le mésencéphale à l’avant-cerveau se trouve le diencéphale. Celui-ci contient des régions d’une grande importance fonctionnelle : le thalamus, une sorte de carrefour d’échanges par lequel passent presque tous les influx nerveux du cerveau ; l’épithalamus, une petite région qui inclut la glande pinéale ; le subthalamus ; et enfin l’hypothalamus, très petit, mais vital, puisqu’il est le principal contrôleur du système nerveux autonome, et est également concerné par la régulation de la température et les émotions. (Voir Figure 1).
Fig. 1. Coupe transversale du cerveau à l’intérieur du crâne. Le cerveau postérieur et le mésencéphale forment ensemble le tronc cérébral. Le cervelet et bulbe rachidien se trouvent dans le cerveau postérieur. Le cerveau antérieur ou cerveau est divisé en deux hémisphères reliés par le corps calleux.
Le cerveau antérieur (prosencéphale ou cerveau) est de loin la plus grande région du cerveau humain. Il est divisé en huit parties. La division principale est entre les deux hémisphères cérébraux, le « cerveau gauche » et le « cerveau droit », comme on les appelle couramment (Figure 2). Bien que physiquement presque complètement séparés et dotés de fonctions distinctes, ils sont intimement liés par le corps calleux, un épais faisceau de fibres nerveuses à travers lequel ils communiquent entre eux. Ainsi, leurs fonctions sont pleinement intégrées dans le cerveau normal ; ce n’est que lorsque le corps calleux est sectionné, dans une tentative désespérée de contrôler l’épilepsie, que les fonctions séparées des deux hémisphères peuvent être étudiées en détail (Figure 3).
Chaque hémisphère est à son tour subdivisé en quatre parties : 1) les lobes frontaux derrière le front, liés à l’intellect et à la planification ; 2) les lobes pariétaux à l’arrière du sommet de la tête, les zones sensorielles et motrices ; 3) les lobes temporaux, en position inférieure et centrale, liés à la mémoire et aux émotions ; et 4) les lobes occipitaux, en bas à l’arrière, qui incluent les régions visuelles. Le télencéphale et les noyaux gris centraux se trouvent également dans le cerveau.
Fig. 2. L’hémisphère gauche du cerveau. Chaque hémisphère est divisé en quatre lobes : frontal, pariétal, occipital et temporal. Les lobes ont des fonctions spécialisées.
Fig. 3. Un patient au cerveau scindé dessinant avec les deux mains. Les informations du champ visuel gauche sont transmises au cerveau droit, qui contrôle la main gauche. Ainsi, le patient peut copier l’arbre seulement avec sa main gauche, pas avec la droite, puisque le cerveau gauche ignore les informations du cerveau droit. La main droite du patient ne peut copier que la fleur, pas l’arbre.
Enfin, l’ensemble du cerveau est enveloppé dans une membrane résistante, les méninges, et est soutenu, comme une gelée dans un moule, à l’intérieur du crâne. Curieusement, les méninges sont la seule partie du cerveau qui éprouve de la douleur lorsqu’elle est coupée ou autrement blessée. Mais le cerveau répond bien sûr par la sensation de douleur aux blessures infligées à d’autres parties du corps ; de plus, il peut générer des douleurs internes — maux de tête et migraines, par exemple.
À certains égards, la partie la plus importante des deux hémisphères est la couche externe, le cortex cérébral, avec ses six couches distinctes de cellules. On peut le comparer à un écran de télévision, ou plus étroitement à l’écran d’un ordinateur. Sur « l’écran » s’affichent toutes les informations recueillies par les organes sensoriels, afin d’être évaluées par l’esprit conscient. Mais c’est une interface bidirectionnelle ; l’esprit peut initier une action en réponse aux informations affichées.
Poussant un peu plus loin l’analogie avec l’ordinateur, c’est comme si le penseur pouvait manipuler le clavier pour faire appel à ses souvenirs et demander des informations supplémentaires à ses sens. Il peut ensuite commander au corps d’exécuter ce qui est approprié. Mais l’analogie ne doit pas être poussée trop loin. La relation esprit-cerveau-corps est beaucoup plus intime que ne le suggère un tel mécanisme. De plus, elle est si familière et banale que l’analyse est difficile, surtout pour le matérialiste. Elle ne devient signifiante que lorsque nous nous reconnaissons comme des êtres spirituels non matériels, dotés d’un corps et d’un cerveau matériels.
La caractéristique quasi miraculeuse de cet ensemble est le cortex cérébral par lequel peut se produire l’interaction entre les deux royaumes. Certains scientifiques ont été confrontés à cette situation et sont néanmoins restés matérialistes. D’autres ont trouvé impossible de maintenir cette position, et d’autres encore ont hésité. Par exemple, Anthony Smith, qui n’utilise le mot « esprit » que pour désigner le cerveau et ses fonctions, a écrit à propos de l’évolution du cerveau : « Il y a une telle logique dans l’histoire qu’elle semble prédéterminée, comme une évolution avec un but, la destination prédestinée dès le tout début ».
SYSTÈME NERVEUX : BIOCHIMIE DU CERVEAU
Ce chapitre a pour but de ne présenter que les grandes divisions du cerveau. Le fonctionnement du cortex cérébral sera détaillé dans un autre chapitre. Mais à ce stade, il est nécessaire de dire quelques mots à propos des nerfs et du système nerveux, ainsi que sur la biochimie du cerveau.
Le cerveau est extrêmement actif dans son métabolisme. Bien qu’il ne représente qu’environ 2 % du poids total du corps, il consomme environ 20 % de l’oxygène et du glucose disponibles dans le sang circulant ; autrement dit, il fonctionne dix fois plus vite que le reste du corps. Une privation d’oxygène de seulement quatre minutes peut entraîner des lésions cérébrales irréparables. En termes électriques, le cerveau consomme environ 20 watts d’énergie en continu, soit de quoi alimenter une ampoule de faible puissance.
Fig. 4 (gauche). Une cellule nerveuse ou neurone. La longue fibre nerveuse ou axone se ramifie à son extrémité en multiples dendrites. À l’autre extrémité, il existe un espace ou synapse entre l’axone et les dendrites d’un neurone voisin.
Fig. 5 (ci-dessus). Un neurone du cervelet. Remarquez la multiplicité des dendrites et la complexité des ramifications.
À l’échelle microscopique, la caractéristique la plus remarquable du cerveau est constituée par les neurones, au moins 15?000 millions (1,5 x 10¹?). Chaque neurone est associé à son axone, certains relativement courts, d’autres remarquablement longs (jusqu’à plusieurs pieds) ; chaque axone porte de nombreuses ramifications dendritiques, jusqu’à 10?000 ou plus ; chaque dendrite se termine en une synapse, par laquelle il communique avec un autre neurone (Figures 4 et 5).
Le nombre total d’interconnexions dans le cerveau est très difficile à évaluer ; il a été estimé à des valeurs variant entre 10¹³ et 10¹?. Il est difficile de saisir le sens de telles grandeurs. Denton (1985) a tenté de donner une impression de ce nombre par l’analogie suivante : imaginez une vaste forêt d’un million de milles carrés, plantée d’arbres à raison de 10?000 par mille carré ; supposons ensuite que chaque arbre porte 100?000 feuilles. Le nombre total de feuilles de la forêt correspond à 10¹?, soit le même ordre de grandeur que les interconnexions du cerveau humain. Les corps cellulaires des neurones constituent la « matière grise » du cerveau ; les axones et les dendrites constituent la « matière blanche ». Pour des recherches plus récentes sur les réseaux neuronaux, voir la revue de Georgiana Ferry (1987).
Les nerfs sont enveloppés dans une membrane graisseuse de myéline qui assure l’isolation, mais ils ne sont pas l’équivalent biologique de fils conducteurs d’électricité, comme on le croyait autrefois. Des potentiels électriques, des tensions, sont certes impliqués, mais les influx nerveux parcourant les axones à environ 100 mètres par seconde (250 milles à l’heure) résultent d’un phénomène biologique complexe. La fibre nerveuse ou axone n’est pas librement perméable aux ions sodium et potassium. À l’état de repos, la concentration de potassium à l’intérieur du nerf est plus élevée qu’à l’extérieur, et la concentration de sodium est inversement plus faible à l’intérieur de l’axone. Ce déséquilibre ionique crée un potentiel électrique à travers la membrane, de l’ordre de -70 microvolts. Un long axone contient environ un million de « pompes ioniques », capables de transférer activement les ions potassium et sodium dans un sens ou dans l’autre à travers la membrane. Ainsi, lorsqu’un neurone « s’active », la première pompe expulse une partie du potassium et admet une partie du sodium, réduisant le potentiel à -40 microvolts. La seconde pompe fait de même, et ainsi de suite le long de l’axone. Derrière cette vague rapide de transferts ioniques, les pompes inversent à leur tour les transferts pour revenir à la condition normale. C’est cette vague incroyablement rapide de transferts sodium-potassium, aller et retour, qui constitue l’influx nerveux lorsqu’un neurone s’active.
Lorsqu’il atteint une synapse, l’influx est transmis à une synapse voisine d’un autre dendrite par un mécanisme complètement différent. La synapse émettrice libère une infime quantité d’une substance chimique appelée neurotransmetteur. Celle-ci est captée par une molécule réceptrice protéique de la synapse réceptrice, déclenchant ainsi l’activation du deuxième neurone. Un message du cerveau à un muscle, par exemple, peut passer par plusieurs de ces jonctions synaptiques. La séquence des opérations peut paraître incroyablement complexe, mais la souplesse du système est en réalité plus grande que ne le laisse entendre cette description préliminaire. Le nombre de substances neurotransmettrices n’est pas limité à une ou deux : au moins trente sont déjà connues, et d’autres seront probablement découvertes. Chimiquement, ce sont des hormones, des acides aminés ou de petits peptides (composés formés d’une courte chaîne d’acides aminés liés chimiquement). Probablement, un seul est libéré au niveau d’une synapse spécifique, mais ensemble, ils semblent transmettre des messages subtilement différents. De plus, la fibre nerveuse réceptrice peut être inhibée, c’est-à-dire que son activité est réduite plutôt que stimulée. D’autres détails seront donnés dans les chapitres suivants.
Le système nerveux est classé de diverses manières qui se chevauchent. Il existe un ensemble de nerfs crâniens reliés aux organes sensoriels ; ils comprennent non seulement des nerfs sensoriels, mais aussi moteurs, contrôlant par exemple les mouvements des yeux. Les nerfs spinaux contrôlent les mouvements du corps ; ils se regroupent en plexus à des endroits particuliers. Le système nerveux central et le système nerveux périphérique sont évidemment définis par leur localisation. Le système nerveux autonome est défini et subdivisé par fonction. Il contrôle tous les mouvements qui se produisent sans pensée consciente. Les exemples évidents sont la respiration, les battements du cœur et le fonctionnement de nombreux autres organes. Mais le système autonome prend aussi en charge tous les mouvements corporels habituels et acquis, comme marcher, pédaler, trouver les touches du clavier, jouer du piano, ou encore effectuer des coups standard dans des sports comme le tennis.
Le système autonome comporte deux divisions principales. Le système sympathique (contrôlé principalement par l’hypothalamus et son bulbe rachidien) a des fonctions protagonistes ou excitatrices. Le système parasympathique (contrôlé principalement par le pont et le bulbe rachidien du mésencéphale) a des fonctions antagonistes ou calmantes. Par exemple, le sympathique peut accélérer le rythme cardiaque, tandis que le parasympathique le ralentit. On suppose généralement que ces activités échappent au contrôle cérébral conscient. Mais, comme nous le verrons plus loin, il existe des techniques permettant de reprendre un certain contrôle conscient des fonctions autonomes. Cela peut s’avérer utile dans le traitement de maladies et la modification des humeurs.
Chaque jour, un grand nombre de nos neurones s’usent et cessent de fonctionner. Le cerveau humain semble dépourvu de la capacité de remplacer ces neurones défectueux. On a dit de façon dramatique que notre cerveau commence à mourir très lentement dès notre naissance. Des recherches récentes ont montré que la régénération neuronale se produisait chez certains oiseaux ; mais des travaux ultérieurs ont révélé que ce n’était pas le cas chez les primates ni, vraisemblablement, chez l’homme. Toutefois, il semble que le cerveau, comme d’autres organes et muscles, puisse être maintenu en bon état par l’utilisation et l’exercice. L’homme qui prend sa retraite sans intérêts sérieux en dehors du travail et du divertissement a tendance à s’affaler avec gratitude dans son fauteuil devant la télévision et à se complaire dans l’oisiveté ; il se détériore alors rapidement, tant sur le plan corporel que mental, et risque de mourir dans les quelques années qui suivent. Le lent déclin de l’énergie et de la vivacité d’esprit est inévitable avec l’âge, mais le processus de vieillissement peut être largement tenu en échec par la pratique d’activités adaptées, par un exercice approprié, et surtout par la culture de l’esprit à travers des lectures sérieuses et une pensée active.
RÉSUMÉ
Des informations de base sont fournies concernant les nombreux compartiments distincts du cerveau humain et leurs fonctions. Les 1,5 x 10¹? neurones communiquent entre eux ainsi qu’avec les organes sensoriels, les muscles et toutes les parties du corps par des influx nerveux. Dans les nerfs, ceux-ci consistent en des vagues de changements de potentiel électrique impliquant des transferts d’ions sodium et potassium. Entre les terminaisons nerveuses synaptiques, les messages passent par la décharge et la réception de neurotransmetteurs chimiques. Il peut y avoir jusqu’à 10¹? de ces jonctions nerveuses. L’activité cérébrale consomme environ 20 % de l’énergie totale dérivée de l’alimentation. Les subdivisions des deux grands systèmes nerveux sont décrites.
Extrait du livre Inner Adventures 1988 : chapitre 2.