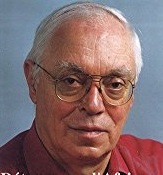(Revue Le chant de la Licorne. No 19. 1987)
L’Occident, aveuglé par son matérialisme, commence à redécouvrir timidement la mort et ses enseignements. C’est pour lui l’occasion de reprendre contact avec ses propres traditions et de découvrir le point de vue des autres civilisations, passées et présentes. C’est la possibilité d’être concrètement plus utile auprès de ceux qui franchissent le seuil. C’est l’espoir de réintégrer la réalité de la mort dans la conscience collective.
On redécouvre aujourd’hui une très vieille vérité la mort est un passage progressif, graduel, par étapes. Cela est vrai même au plan purement biologique, et on est devenu très prudent dans l’appréciation exacte du moment où il y a mort. Les différents organes s’arrêtent de vivre à des vitesses variables. Il peut y avoir des états de vie ralentie, des morts locales, partielles, relatives, avant qu’il n’y ait mort absolue. Le grand public a été très attentif au fait que les techniques actuelles de réanimation ont repoussé, et d’une certaine façon brouillé les critères de la mort. On peut rester « légalement » vivant tout en ayant perdu de manière irréversible tout contact avec la réalité. Même un tracé nul à électroencéphalogramme ne prouve pas l’inactivité des structures subcorticales. Nous avons mis neuf mois à venir au monde. Il serait étonnant que nous le quittions en un instant. Tout n’est pas fini quand le cœur s’arrête et quand le mourant rend son « dernier soupir ». Aux yeux de toutes les anciennes traditions, le détachement de « l’âme » se présente comme un processus long, complexe, souvent laborieux, parfois dangereux. Il y a des étapes à franchir aussi bien sur le plan physique que psychique.
Le problème de l’accompagnement des mourants se pose alors tout normalement, aujourd’hui comme autrefois. La mort est le grand passage ; l’initiation suprême ; le moment où enfin nous saurons ce qu’il y a de l’autre côté, où nous serons fixés sur notre propre être, sa nature et sa destinée ; la plongée définitive dans le mystère. Pour opérer ce passage l’homme est irrémédiablement seul. Mais comme pour un voyageur qui s’en va, on peut faire avec lui un bout de chemin pour lui rendre le départ moins douloureux. Il semble d’ailleurs qu’à l’origine, c’est ce que signifiait le mot thérapie. Le thérapeute est celui qui accompagne un autre sur une route difficile, indique la voie à suivre et prévient des embûches à éviter.
On parle beaucoup, depuis plusieurs années, de cet accompagnement des mourants, surtout dans la presse destinée aux professionnels de la santé. Le grand public lui-même est sensibilisé à cette question et des revendications se font jour de divers côtés : on veut « choisir sa mort », « changer la mort », « pouvoir vivre sa mort », etc. Des ouvrages publiés sur ces questions sont devenus des best-sellers. Une science nouvelle est née : La thanatologie. De plus en plus généralement, on meurt à l’hôpital. Or l’hôpital tel que nous le connaissons, n’a pas été conçu pour remplir correctement cette mission, et le personnel, médecins compris, n’est à aucun moment formé pour l’assumer. Le mourant est sans doute un malade qu’il faut accompagner médicalement, techniquement : il faut l’hydrater, le minéraliser, lui permettre de respirer librement, atténuer ses douleurs, etc. Mais c’est aussi tout simplement un homme placé en face de lui-même, avec ses anxiétés, ses liens familiaux et sociaux, ses attaches, ses problèmes non réglés, ses besoins psychologiques, relationnels et spirituels. L’accompagnement des mourants se situe donc nécessairement sur plusieurs plans nettement différenciés et exige la mise en œuvre de fonctions diverses qui ne se recoupent nullement.
Chez ceux qui savent
Une des caractéristiques de notre civilisation est de prétendre ne rien savoir sur la mort et les états auxquels la mort introduit. Le plus souvent d’ailleurs, à ses yeux, on ne sait rien tout simplement parce qu’il n’y a rien à savoir.
Une telle attitude aurait été totalement incompréhensible pour les hommes de l’Égypte ancienne, par exemple, eux qui semblent n’avoir eu qu’une seule préoccupation dominante : l’au-delà, et un au-delà parfaitement exploré et jalonné. Les livres des morts égyptiens sont autant de recueils de recettes pour permettre à l’âme de surmonter telle difficulté précise à tel moment de son voyage dans l’autre monde.
Chez la plupart des peuples d’Asie, jusqu’à nos jours, il existe un spécialiste du monde invisible dont l’une des principales fonctions est précisément de conduire l’âme dans sa pérégrination post-mortem : le chaman.
C’est probablement dans un tel contexte chamanistique qu’est né le bardo Thodol ou Livre des morts tibétain, publié pour la première fois en 1927. Les Tibétains appellent bardo l’état intermédiaire par lequel passe l’âme du défunt. Ce texte est récité durant l’agonie et après le décès pour guider la personne qui reste consciente, et entend lui éviter d’être prise de panique devant les apparitions effrayantes de l’autre monde, en lui rappelant qu’elles ne sont que des produits de son esprit, des projections de ses résistances et de ses angoisses, mais surtout afin qu’elle ne rate pas les occasions qui lui sont offertes d’arriver à la libération définitive. C’est là que nous trouvons la doctrine bouddhique. L’homme, soucieux de son Éveil, s’est préparé à la mort durant toute son existence par la méditation, en suivant les enseignements de son maître spirituel, en pratiquant des exercices très précis de « transfert de conscience », et en renonçant à son moi superficiel ; il sait ce qui va se passer et comment il convient de réagir, et, à la limite, la lecture du Bardo Thodol à son chevet est inutile. L’Éveil s’offrira à lui comme une lumière éclatante, une vision grandiose, une suprême béatitude, dont il n’a jusque là expérimenté que la promesse. C’est surtout à celui qui est encore empêtré dans ses illusions, aveuglé par ses passions, et dont les yeux ne se sont pas ouverts de son vivant que le Livre des morts est destiné. Il risque de prendre pour réelle la fantasmagorie cauchemardesque à laquelle il est confronté, et surtout d’être épouvanté et repoussé par une lumière dont il ne peut supporter l’éclat. S’il passe à côté des occasions de libération qui se présentent, il n’a plus d’autre issue que de se réfugier dans la matrice d’une femme et de recommencer une nouvelle existence.
Le déni de la mort
L’atmosphère dans laquelle nous nous nous mouvons est évidemment aux antipodes de celle qu’ont connue Égyptiens et Tibétains. Pourtant, dans notre propre histoire, il y a eu des époques où comme en Asie, comme en Afrique, la mort était apprivoisée, selon l’expression de Philippe Ariès, intégrée à la vie, acceptée sans drame comme une phase nécessaire du cycle cosmique et communautaire, indispensable au renouvellement social, réglée, fortement ritualisée ; le défunt, enterré à côté de l’église au centre du village, continuait d’appartenir au groupe comme intercesseur, conseiller, protecteur, acteur invisible, voire futur réincarné. Mais à mesure que l’homme a pris conscience de son individualité et s’est dégagé de la gangue collective, les attitudes et les représentations vis-à-vis de la mort ont évolué. La destinée personnelle devient plus préoccupante que le destin commun ; apparaît une théologie des fins dernières, avec mesures concrètes pour assurer à l’individu une éternité bienheureuse ; l’heure même de la mort revêt un caractère pathétique, puisqu’elle est censée fixer à jamais le sort d’une âme ; un phénomène considéré jusque là comme naturel devient un drame éthique qui se joue entre le péché, le repentir et la grâce ; la sépulture elle-même s’individualise comme pour perpétuer le soi du trépassé et son attachement aux choses ; le macabre apparaît dans les arts et les cérémonies ; les tourments du Dies irae viennent s’ajouter aux mélodies si apaisées et si lumineuses de l’office des morts. Puis, à l’âge dit « des lumières », la mort est perçue comme une violence de la nature, comme une attaque sauvage et sournoise, comme un défi de l’irrationnel à la raison.
Avec la libération de l’affectivité au temps du romantisme et le cule de l’amour-passion, l’intolérable, ce n’est plus de mourir soi-même, mais de se trouver séparé de l’être aimé ; la mort devient alors le lieu de retrouvailles où se rejoignent des élans sentimentaux nés sur terre. Après une cosmologie, une éthique, une dialectique, on voit éclore une esthétique de la « belle mort ».
Cette évolution trouve une sorte d’aboutissement extrême en notre siècle. La dimension transcendantale et spirituelle de l’homme étant escamotée, tout étant axé sur un salut terrestre qui ne peut venir que d’une science et d’une technique qu’on imagine toutes-puissantes, ou encore d’un « grand soir » tout aussi mythique, la mort devient honteuse car elle vient signer un échec que l’on ne peut admettre. Elle quitte la rue et la famille, se réfugie à l’hôpital, dans les mouroirs construits exprès pour ne plus voir les vieux mourir, dans des cimetières établis à la périphérie des villes. Le deuil n’a plus de sens ; le jeu des symboles, si prenant autrefois, s’écroule dans l’insignifiance. La mort est médicalisée, banalisée, occultée, évacuée, interdite. On la traite comme un objet d’études biologiques, psychologiques, statistiques, etc., comme si elle était étrangère au sujet. On ne supporte plus l’émotion qu’elle provoque et on prétend éviter celle-ci à la société et aux familles. Le mourant abandonne ses droits de « maître de sa mort » à des professionnels qui, pour mieux le prendre en charge, lui dissimulent systématiquement la vérité. On ne meurt plus parce que la mort est naturelle, ontologiquement nécessaire ; on meurt seulement de quelque chose. Comme dit Ionesco : « J’ai fini par comprendre que l’on mourait parce que l’on avait eu une maladie, parce que l’on avait eu un accident, que de toute façon la mort était accidentelle, et qu’en faisant bien attention à ne pas être malade, en étant sage, en mettant son cache-nez, en prenant bien les médicaments, en faisant attention aux voitures, on ne mourrait jamais ». La mort est assimilée à une panne, ou alors à une anomalie, à une forme de déviance, voire de délinquance, à une sorte d’attentat à la pudeur ou d’acte pornographique.
Très curieusement, une société qui se dit et se veut sans tabous, finit par ériger la mort en tabou suprême. Parler de mort à propos d’un moribond devient répréhensible. On prolongera son existence, mais on ne l’aidera pas à mourir. « Il n’est plus écouté comme un être de raison, écrit Ph. Ariès, il est seulement observé comme un sujet clinique, isolé, quand on peut, comme un mauvais exemple, et traité comme un enfant irresponsable dont la parole n’a ni sens ni autorité… Les mourants n’ont plus de statut et par conséquent plus de dignité ! Ils sont des clandestins ». une fois le décès constaté, on se débarrasse au plus vite du cadavre et on s’efforce d’oublier. Il est malséant d’afficher sa peine, de laisser entendre qu’on peut en éprouver. Les enfants voient la mort sans cesse, dans les films, à la télévision ou dans les bandes dessinées, mais pour leur éviter tout traumatisme, ils se verront interdire la vue d’une grand-mère défunte ou l’assistance à ses funérailles. La mort est mise en scène à tout moment dans les moyens d’information : guerres, catastrophes, meurtres, prises d’otages, hold-ups, accidents (sauf ceux du travail, curieusement) : le fait d’en parler sans cesse, n’importe comment et surtout à la troisième personne, est après tout le moyen le plus efficace pour la banaliser. On bavarde indéfiniment autour de la mort, mais on ne parle pas de la mort. Elle disparaît de la prédication religieuse, dont elle constituait autrefois un des thèmes majeurs, en même temps que des exercices de piété. L’extrême-onction est transformé en sacrement des malades. On est gêné d’appeler un prêtre au chevet d’un mourant et lui-même ne sait plus parler de manière vraie. A la limite, il devient un officier de pompes funèbres parmi d’autres. Un puissant courant théologique tend à enlever à la vie dans l’au-delà toute réalité : l’éternité, paraît-il, ne peut être vécue que dans l’instant présent. Et de fait, dans les sondages, une forte proportion de personnes qui se déclarent chrétiennes affirment ne pas croire en une survie.
L’image ainsi donnée par les sociologues de nos attitudes face à la mort a incontestablement un caractère caricatural mais elle indique une tendance. C’est vraiment d’une sorte de déni ou de refoulement de la mort qu’il faut parler. On fait comme si elle n’existait pas. On se tait. On ment. On se ment. Mais, comme malgré tout elle existe, elle parasite l’existence des individus et des sociétés de manière souterraine, sauvage, non contrôlée et non contrôlable, non intégrée, non assumée, autant dire non humaine. On espère mourir dans l’inconscience, sans s’en rendre compte. Pour J. Baudrillart, les villes modernes sont des villes mortes et des villes de mort, et comme elles sont caractéristiques de notre culture, c’est bien d’une civilisation de mort qu’il faut parler. N’oublions pas que le déni de la réalité est un des signes les plus typiques d’une attitude psychotique. La civilisation de l’ancienne Égypte, toute entière tendue vers une domestication de la mort et son intégration à la vie, étonne, par contraste par son équilibre et sa joie de vivre ; la mort y est tout ce qu’on voudra, sauf la fin absurde d’une vie dénuée de sens.
Retrouver un sens
Depuis quelques années, on semble vouloir réagir de différents côtés contre un tel état de choses, qui ne peut qu’engendrer angoisse, inadaptation et insatisfaction profonde. Plusieurs livres ont fait sensation. Arrêtons-nous à ce celui qu’un médecin américain, le Dr Moody, a publié sous le titre malheureusement fallacieux de La vie après la vie en 1975, suivi en 1978 par Lumières nouvelles sur la vie après la vie. L’auteur étudie des témoignages de personnes qui sont passées par des états de mort apparente plus ou moins prolongés, mais ont pu être ranimées. Ces souvenirs ne prouvent évidemment en aucune façon une permanence de la conscience après la mort du corps, puisqu’il n’y a pas eu véritablement mort du corps. Ils montrent seulement qu’il y a un vécu très particulier au cours de ces états-limite, auquel il convient d’être très attentif, car, contrairement aux apparences, l’individu se rend très bien compte de ce qui se passe autour de lui, voit, entend, est présent même s’il paraît absent et inconscient, et devrait donc encore, d’une certaine façon, pouvoir être guidé. Il existe d’autres études, menées bien avant celle de Moody et parfois avec plus de méthode et de compétence, mais elles n’ont eu d’impact ni sur les spécialistes, ni sur le grand public. Celle de Moody est devenue un best-seller parce qu’elle a paru au moment précis où l’opinion redevenait sensible à ces questions.
Le vécu tel qu’il est décrit par ces anciens comateux n’a dans l’ensemble rien d’effrayant ni de douloureux. Les récits suivent en gros le schéma suivant : Un homme est sur le point de mourir. Il entend le diagnostic fatal prononcé par le médecin. Après quoi, il perçoit une sorte de bourdonnement ou de cloches lointaines. Puis il se sent comme emporté à travers un conduit sombre, un tunnel, une vallée obscure. Il se trouve soudain comme flottant hors de son corps matériel. Il assiste en spectateur aux efforts du personnel hospitalier qui s’emploie à le réanimer ; il sera capable par la suite de décrire les méthodes employées par les équipes de réanimation, de dire qui des fermiers ou des médecins était présent, de répéter ce qui a été dit pendant qu’il se trouvait en catalepsie. A sa grande surprise, le moribond constate qu’il possède un corps dont la nature et les propriétés diffèrent sensiblement de celles du corps physique. Il lui semble entrevoir des figures qui font mine de vouloir l’accueillir et croit reconnaître des parents ou des amis décédés avant lui. Il est enfin confronté à une grande lumière blanche qui se présente comme un être doué de personnalité, débordant d’amour, et qui fait défiler devant lui les principaux événements de sa vie passée en un panorama rapide, tout en suscitant chez lui une interrogation sur la valeur de ses actions. Mais en fin de compte, le mourant se sent comme contraint de rebrousser chemin et de revenir à la vie en retrouvant son corps de chair, ce à quoi il ne se résigne en général qu’à regret. Les témoins insistent sur le caractère inexprimable de leur expérience en des termes du genre : « Je ne sais comment m’exprimer », « Je ne sais comment dire », « il n’y a pas de mots pour communiquer ce que j’ai ressenti ».
Il semble que les personnes qui de par leurs fonctions ont l’habitude de côtoyer les mourants, les comateux, les malades sous anesthésie générale, rencontrent assez souvent de tels propos. Mais il était quelque peu ridicule ou malséant d’en parler, d’une part aux tenants d’une attitude rationaliste qui ont le sourire facile, d’autre part à des orthodoxies théologico-anthropologiques qui se méfient de ces notions de dédoublement et de corps subtils. Moody a eu pour heureuse influence de lever un tabou. Il a rendu espoir à beaucoup de malades par l’image fintalement réconfortante qu’il a donnée de la mort. On retrouve avec lui des choses que la sagesse des nations a toujours affirmées et qui ne sont pas étrangères aux données des Livres des morts égyptiens et tibétains. Sans doute faut-il élargir le cadre dans lequel les phénomènes ainsi évoqués apparaissent : ils débordent largement les états de mort apparente et d’agonie et peuvent se retrouver aussi bien sous l’effet de drogues qu’avec certaines méthodes de méditation. En tout cas, l’idée d’un accompagnement, même par delà les premiers signes de décès, est moins absurde qu’au premier abord il n’apparaît à une mentalité scientiste ; et la coutume de veiller le mort, de prier pour lui, de procéder à des rites longs et significatifs, voire certains usages plus ponctuels qu’on a qualifiés de superstitions, peuvent sans doute être fondés psychologiquement, et non seulement sur le plan spirituel. Quand des affirmations traditionnelles se retrouvent avec une impressionnante unanimité dans le monde entier, il est difficile de penser qu’elles ne reposent pas sur une certaine expérience. Or c’est surtout autour de la mort que les croyances et les pratiques populaires se rejoignent le mieux.
Le travail de mourir
Comme il y a un travail de la naissance, il y a aussi. un travail de la mort, et chez ceux qui restent un travail du deuil. Un autre auteur, Élisabeth Kübler-Ross, une psychiatre suisse travaillant aux États-Unis, a sensibilisé le grand public à cette question au travers de ses ouvrages, en particulier Les derniers instants de la vie en 1976. C’est à la demande d’étudiants en théologie et de futurs pasteurs qu’elle entreprit des recherches à long terme sur la manière dont on mourait, puis passa de la psychothérapie proprement dite à la formation adéquate d’équipes médicales qui au départ refusaient de voir la mort en face.
Le Dr Kübler-Ross distingue plusieurs étapes que l’on retrouve habituellement sous des formes diverses, non seulement face à la mort, mais aussi face à toute autre forme de perte :
-
le stade de prise de conscience et du choc, d’autant plus douloureux qu’il a été moins préparé ;
-
le stade du refus, de la dénégation : « c’est impossible », « ils se trompent », « il doit y avoir un moyen d’y échapper » ; la simulation à laquelle on se livre de part et d’autre atténue peut-être les émotions et les embarras, mais elle dresse aussi une barrière entre le malade et son entourage ; peu à peu ce refus s’effrite et il est rare qu’on nie l’inévitable jusqu’à la fin ;
-
le stade de la colère et de la révolte : « pourquoi moi ? » et à un moment plus avancé : « pourquoi maintenant ? » Souvent les relations se détériorent alors avec le personnel soignant : le malade se plaint, se perd en récriminations, dévient agressif, non coopérant, hostile ; au terme de cette étape, il peut se mettre à marchander avec Dieu une trêve, une rémission, un délai ;
-
le stade de la dépression, du regret, de l’auto-accusation, du glissement vers le néant : « à quoi bon, il n’y a plus qu’à tirer l’échelle » ; il a le sentiment que tout est sans espoir, qu’il est abandonné et isolé de tous ; cette démarche de « peine préparatoire » permet à la personne d’intégrer le processus de dégradation auquel elle est soumise en la poussant à exprimer tout ce qui la rattache à la vie ;
— le stade de l’acceptation rationalisée, et spiritualisée : le malade renonce à ses rêves, est en paix avec son entourage, prend les choses comme elles viennent ; il profite des joies quotidiennes au jour le jour sans plus faire de projets pour le futur ; il accepte, voire réclame les secours spirituels qui peuvent lui être portés ; il peut ressentir à ce moment-là un grand calme intérieur qui signifie qu’il a atteint une certaine maturité et est prêt.
Chacun de ces stades nécessite un mode d’intervention particulier. D’abord le malade doit savoir qu’il peut parler du problème de la mort avec quelqu’un quand il en sentira le besoin. Quand l’issue apparaît fatale, il est bon que les masques tombent, qu’on ne joue pas la comédie, mais que malade et famille puissent pleurer ensemble, puis veiller aux choses importantes en évitant de le faire sous le coup de l’émotion. Quand le patient accepte de parler de sa mort, il faut l’aider à mettre de l’ordre dans ses affaires ; cela lui permettra de vivre plus sereinement, donc plus pleinement le temps qui lui reste. Il faut essayer de découvrir ses espoirs et ses besoins les plus secrets pour les réaliser si cela est possible. Il faut aider l’entourage à comprendre les moments de révolte, de dépression et de repli sur soi qui ont un rôle dynamique à jouer.
Vis-à-vis des familles aussi, bien des attitudes seraient à réviser. Certes, des installations de haute technicité ne facilitent pas la présence d’un entourage encombrant pour les soignants. Mais il faut se demander si l’accompagnement social, la présence d’amis et de personnes familières ne sont pas finalement plus importantes que des soins purement techniques. Quand c’est un enfant qui se meurt, les parents ont évidemment besoin de le voir et de pouvoir l’approcher et il est fallacieux dans la plupart des cas d’invoquer des raisons médicales pour les en empêcher. Après la mort, ils ont besoin de voir et de toucher le corps : cela les aide considérablement à pouvoir faire face à la réalité. C’est au médecin d’annoncer le décès. Sinon, on risque de voir s’installer dans l’esprit des proches le fantasme que l’enfant n’a pas été traité de manière compétente.
L’angoisse et la douleur devraient pouvoir s’exprimer librement. Mme Kübler-Ross a fait aménager des salles spéciales, insonorisées, où l’on peut crier, pleurer, hurler, donner des coups de pied dans les murs : la souffrance ultérieure en est moins longue que si elle doit être rentrée, dissimulée, maîtrisée ; chez beaucoup de peuples, cela se vit tout-à-fait normalement, et l’expression de la douleur suit des modèles sociaux précis. L’entourage a besoin d’une présence, et non de calmants. Toujours quand il s’agit d’un enfant, il faut laisser les parents revenir sur le lieu de sa mort après un certain temps et poser toutes les questions qui les hantent. L’auteur est allé jusqu’à recommander que ce soient les parents qui fassent la toilette mortuaire de leur enfant, transportent le corps et le déposent dans le cercueil en réitérant le rituel du coucher dont ils avaient l’habitude. A un niveau plus élémentaire, il y aurait sans doute beaucoup à faire dans nos hôpitaux pour que tout ce qui touche à la mort et aux morts soit empreint de dignité et de respect ; heureusement que le grand public ignore ce qui peut se passer dans les coulisses…
Une pédagogie de la mort
Il est bien évident que le travail de mourir est d’autant plus facile que la personne a mieux intégré la mort à sa vie, a reconnu et accepté que son « être pour la vie » est aussi, en fin de compte, un « être pour la mort ». Si l’on se réfère à ce que nous avons dit des attitudes que notre société développe, on comprendra que c’est là que le bât blesse. Dans les sociétés traditionnelles, la mort est omniprésente, son spectacle n’était nullement évacué, mais au contraire canalisé et amplifié par les rites ; croyances, mythes et actions symboliques lui donnaient un sens ; comme les anciennes initiations, le Christianisme tourne tout entier autour du mystère de la mort et de la résurrection, perçu non intellectuellement, abstraitement, mais vécu dans les profondeurs psychiques et spirituelles de l’être au rythme très concret des saisons, des fêtes, du cycle de vie de chacun ; les enfants n’étaient nullement exclus de cette pédagogie existentielle ; les contes merveilleux, qui savent si magistralement monnayer ce mystère de la mort et de la nouvelle vie, leur étaient même préférentiellement destinés. Sur ce plan, il est évident qu’il nous manque quelque chose, à nous autres hommes modernes. Et ce manque est grave, car il nous dessèche et en fin de compte nous fait passer à côté de ce qui peut donner un sens à l’aventure humaine. J’ai l’impression qu’il y a aujourd’hui une attente dans le public et qu’une action de revivification devient possible.
Dans diverses publications, un autre médecin, le Dr Donnars, a décrit comment il intervient auprès de mourants en s’aidant de la sophrologie. Son témoignage me semble dépasser le cadre de cette seule spécialité. Le but du sophrologue est d’apprendre à celui qui souffre à se tourner vers la partie la plus profonde, vers le noyau de sa personne, pour y puiser calme, paix et harmonie. Cela s’obtient grâce à des techniques de décontraction héritées en partie de l’Extrême-Orient : « Se représenter soi-même, écrit l’auteur, comme se regardant du dehors ; pour pouvoir prendre distance par rapport à ce dehors et faire par conséquent évoluer la notion même de représentation de nous-même et du monde, c’est la base de la technique de la préparation à la mort que j’utilise… A partir du moment où les gens qui suivent cet entraînement ont la possibilité de se regarder autrement, du même coup leur peur de la mort disparaît parce qu’ils trouvent quelque chose qu’ils connaissaient depuis toujours comme une évidence « .
Ce qui me paraît intéressant, c’est que la sophrologie développe tout un programme de vie et d’auto-éducation, qui peut se réaliser de bien d’autres manières, mais qui conduit normalement à une attitude saine vis-à-vis de la mort : apprendre à se familiariser avec les différentes parties de son corps et à les unifier, à descendre à des niveaux où d’habitude on ne descend jamais – ceux de la peur, de l’angoisse, du non-dit, jamais regardé en face – à accepter ce qu’on est comme on est, se mettre à l’écoute de son corps, à découvrir les rythmes, les voies, et le goût de son vécu propre, accordés à ceux de l’Univers. A ce moment-là, la mort pourra peut-être apparaître non comme un vide épouvantable que l’on craint au niveau du besoin, mais comme la réalisation d’une sorte d’immense accord. Écoutons encore le Dr Donnars (texte tiré d’une conférence à la Société de Thanatologie) : « Il s’agit de faire accoucher l’être de sa mort naturelle, c’est-à-dire de lui permettre d’aller jusqu’au bout, vers quelque chose qui devient alors une très grande aventure. Je veux affirmer qu’il se passe quelque chose de très extraordinaire. On va voir apparaître une immense curiosité dans l’esprrit de celui qui va partir : « Qu’est-ce qui va bien se pouvoir se passer ? ». Une sorte de détachement se produit, comme s’il s’agissait de la mort d’un autre. Le mourant se met à pouvoir parler de cette mort qui vient ; il se met à pouvoir vivre ses derniers instants avec une incroyable lucidité, un incroyable détachement… Vous savez tous ce qu’on appelle la « petite mort » : c’est l’orgasme. Et bien, je crois qu’on peut en toute vérité dire que la grande mort, lorsqu’elle arrive, a aussi quelque chose de l’orgasme. C’est de cet orgasme terminal qu’il s’agit en définitive de ne pas priver celui qui s’en va… Les derniers moments peuvent être une expérience extraordinaire. Je ne dis pas qu’ils le soient toujours ; je dis qu’ils peuvent l’être ».
Ceux qui ont l’habitude d’assister des mourants savent quel rayonnement tout à fait mystérieux peut dégager le corps de quelqu’un qui est mort en paix. Même les fameuses « odeurs de sainteté » peuvent, paraît-il, être prises à la lettre et s’expliquer physiologiquement. On comprend alors cet humoriste quand il dit que la mort doit être le meilleur moment de la vie puisque nous le réservons pour la fin