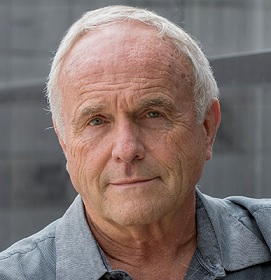Sur notre vulnérabilité compulsive aux images et notre incapacité à relever ce défi. Il y a mille églises, cinq cents lieux de culte majeurs et cinq cents lieux de culte secondaires dans la vieille ville de Prague. Charles IV (1316–1378), roi de Bohême, ainsi que deux autres souverains tchèques, furent empereurs du Saint-Empire romain germanique. Au Moyen Âge, ils ont façonné le paysage religieux, politique et culturel de l’Europe centrale. Mille églises dans la zone relativement restreinte de la vieille Praha laissaient peu de place à autre chose. Architecture gothique majestueuse et imagerie chrétienne éclatante, statues et icônes à chaque coin de rue, à tel point que je me suis mis à me sentir mal.
Exploitant notre vulnérabilité face aux images : L’Église catholique romaine a bâti son empire sur la violence et conservé le contrôle par le biais d’images violentes et grotesques de torture, la menace de damnation éternelle, et renforcé ces menaces par des mises en scène théâtrales, des spectacles publics et des confessions. Les cathédrales et les humbles lieux de culte étaient remplis de représentations vives du paradis, de l’enfer, du martyre et du jugement divin. Il ne s’agissait pas seulement d’expressions artistiques, mais aussi d’outils de manipulation émotionnelle et de contrôle social. De par leur conception, ces images suscitaient la peur, renforçaient l’obéissance et soulignaient le rôle de l’Église en tant que gardienne du salut. (MM : « C’est tellement simple ».
Joseph Chilton Pearce, dans The Death of Religion and Rebirth of Spirit (La mort de la religion et la renaissance de l’esprit), considérait la religion organisée, les images d’église, les reliques et les icônes comme démoniaques. Un affaiblissement de l’humanité contre paiement, une inversion diabolique de ce que Joe croyait être le véritable message de Jésus. À savoir : « Moi et le Père nous sommes un ». — Jean 10:30. « Le royaume de Dieu est en vous ». — Luc 17:21. « Qu’il vous soit fait selon votre foi ». — Matthieu 8:13. « Le Père qui demeure en moi, c’est lui qui fait les œuvres ». — Jean 14:10. « Ta foi t’a guéri ». — Matthieu 9:22. Et non l’Église, ses cathédrales écrasantes, ses faux émissaires, ses vitraux, ses indulgences, et ses illustrations de contes pour enfants. L’unité avec la source divine, l’alignement intérieur avec l’essence céleste, l’esprit intérieur et le pouvoir spirituel sont innés, en attente d’être découverts et développés, quelque chose que chacun doit accomplir par lui-même.
Krishnamurti l’a formulé ainsi : « C’est la responsabilité de chaque individu de provoquer sa propre transformation, laquelle ne dépend ni du savoir ni du temps ».
Le mot « religion », son origine, d’après mes observations et les divers dictionnaires consultés, signifie vraiment rassembler toute son énergie pour découvrir la vérité, ce qui implique la diligence. Un esprit doit être absolument diligent pour découvrir ce qu’est la vérité. S’il y a la moindre négligence, il y a distraction et gaspillage d’énergie.
Quand l’esprit se disperse en futilités, en commérages, en blessures qu’il inflige ou reçoit, en violence, enfermé dans ses propres activités égocentriques, tout cela est de la négligence. Tandis qu’un esprit religieux exige la diligence, la précision, l’exactitude, extérieurement et intérieurement, de sorte qu’il n’y ait aucune illusion, aucune auto-illusion, une intégrité totale. Voilà un esprit religieux.
Mais la religion telle qu’elle existe n’est pas du tout la religion. Toute la propagande, les images en Occident, les images en Orient, les rituels, les accoutrements et tout ce cirque n’ont strictement rien à voir avec la religion.
Quand l’orateur va en Inde et dit que leur religion, leurs superstitions, leurs images, tous leurs rituels absurdes et dénués de sens n’ont strictement rien à voir avec la vérité, beaucoup lui disent : « Tu devrais être brûlé ». Si nous vivions au Moyen Âge, je serais torturé, traité d’hérétique, brûlé au nom de Dieu.
Un esprit religieux n’appartient à aucune société, à aucune nationalité, n’a aucune croyance. Un tel esprit exerce une qualité de doute. Il questionne. Il n’accepte pas. Il n’obéit pas aux édits d’aucune organisation religieuse, secte ou gourou. L’esprit est donc totalement libre d’observer sans l’observateur (l’ego).
Nos esprits ont été profondément conditionnés, captivés, asservis par tous les prêtres du monde. C’est leur affaire. Cela a commencé avec les Égyptiens, en 4500 avant J.-C. Les prêtres étaient les interprètes entre Dieu et l’homme. Ils étaient les intermédiaires, les experts de la vente au détail ! Et cela a perduré jusqu’à aujourd’hui — en Inde, en Asie, et en Occident. Nos esprits, après deux mille ans ou cinq mille ans, ont été conditionnés par cela. On nous dit que nous ne pouvons pas trouver la vérité par nous-mêmes, que quelqu’un doit nous l’indiquer, nous montrer le chemin, parce que nos propres esprits en sont incapables. C’est la chanson qu’on nous chante depuis trois mille ou cinq mille ans.
Si l’on met tout cela de côté, qu’il n’y a ni sauveur, ni gourou, ni secte, ni groupe pour vous y conduire… est-il possible d’avoir un tel esprit ? Lorsque nous parlons de religion, nous parlons d’un esprit religieux, pas d’un concept religieux particulier. Si c’est un esprit religieux particulier, alors ce n’est pas un esprit religieux. J’espère que vous saisissez cela. Un esprit libre de toute négligence, voilà un esprit religieux.
J. Krishnamurti, Brockwood, 1984
Un thème récurrent est la distinction claire entre l’expérience directe et l’expérience créée par les métaphores et leurs images. Rappelons l’affirmation définitive de saint Jean de la Croix : « Si j’ai les mains sur les yeux, je ne peux pas voir le soleil. Si j’ai une image de Dieu, je ne peux pas voir Dieu ». Jean insiste sur le fait que toute image conceptuelle ou attachement sensoriel — même à Dieu — peut devenir un voile qui obscurcit la véritable vision spirituelle. De même que se couvrir les yeux empêche de voir le soleil, s’accrocher à des constructions mentales du divin bloque l’expérience directe du sacré.
John Lamb Lash, dans son œuvre maîtresse Not in His Image, Gnostic Vision, Sacred Ecology, and the Future of Belief (Pas à son image, vision gnostique, écologie sacrée et avenir de la croyance), explore comment un groupe de sectes juives primitives —, notamment celles liées aux manuscrits de la mer Morte, à la communauté de Qumrân — a jeté les bases idéologiques de ce qui allait devenir le christianisme. Dans des textes comme le Document de Damas et la Règle de la communauté, les « fils de Tsadok » sont présentés comme les gardiens de la loi divine, attendant un temple purifié et une restauration messianique. Lash interprète ces sectes sacerdotales comme apocalyptiques et autoritaires, obsédées par la pureté, le jugement et la vengeance divine. Des extrémistes messianiques, qu’il relie aux Esséniens, aux Pharisiens et aux idéologues chrétiens des débuts, en particulier Paul (que Pearce décrit plus loin), tous des perturbateurs psychospirituels, rejetant la nature, la sexualité et la sagesse féminine, aboutissant à une « théologie de l’annihilation ».
John soutient que ces cultes ont détourné les traditions gnostiques et païennes, remplaçant la sagesse expérientielle par le dogme et ses images. Ses thèmes : le Féminin Divin : Gaïa-Sophia comme intelligence vivante de la Terre. La force obscure du Démiurge (Yaldabaoth), entité manipulatrice et quasi extraterrestre derrière le salvationnisme, le christianisme et toutes les croyances théistes. Les gnostiques voyaient Yaldabaoth comme un imposteur cosmique — bloquant l’accès à la véritable gnose, ou à l’intuition spirituelle, connaissance directe et vécue du divin, du cosmos et de sa propre nature — non issue de l’étude livresque ou du dogme. La gnose est souvent décrite comme le moment où l’âme « se souvient » de son origine au-delà du monde matériel. Le salut ne vient pas de l’obéissance au Démiurge (Yaldabaoth), qui est l’Église, image fausse, mais de l’éveil de l’étincelle divine en soi et de la reconnexion avec le Plérôme (le domaine de la véritable divinité). Notre but humain : retrouver la gnose et se reconnecter à Gaïa, éveiller l’étincelle divine intérieure et échapper à l’illusion matérielle. En parlant d’illusion matérielle, ou de notre « mauvais usage de la mémoire ».
Extrait de The Death of Religion and Rebirth of Spirit (La mort de la religion et la renaissance de l’esprit) — Joseph Chilton Pearce
Un esprit enculturé est culture, et la force de la culture dépend directement de notre esprit qui réagit selon notre propre enculturation. En mettant en cause la culture comme notre hubris et notre Némésis, nous nous mettons nous-mêmes en cause, une direction inconfortable et menaçante à suivre, qui nous met immédiatement sur la défensive, car nous détournons automatiquement toute référence négative directe à notre propre sens de l’être. Nous cherchons ainsi à préserver notre propre intégrité, un instinct de survie raisonnable et une manœuvre défensive efficace qui opère largement en dehors de notre conscience, et qui nous pousse souvent à la guerre perpétuelle ou périodique.
Nous voulons changer les effets de la culture, mais, puisque nous nous identifions à elle, la perte de culture équivaut, dans notre esprit, à la mort. C’est notre identité, ce qui rend la cause de la culture et son effet simultanés, chacun donnant naissance à l’autre… paradoxalement, notre tentative de changer la culture et ses effets négatifs sur nous la préserve en réalité.
En fait, rien ne renforce autant l’effet culturel que cette compulsion que nous avons à vouloir le changer. Dans nos tentatives, nous projetons notre maladie intérieure sur des causes extérieures, masquant ainsi notre véritable dilemme. Par notre projection, nous croyons que nos problèmes, nos angoisses et nos frustrations sont causés par les phénomènes ou les événements de notre voisin ou du monde extérieur. C’est notre système défensif de survie lui-même qui nous pousse à apporter le changement nécessaire chez notre voisin ou dans le monde, tout en nous accrochant à notre idéation de peur de sombrer dans le chaos — et cette idéation, c’est la culture.
Le mot tradition vient du latin traducare, « trahir », « calomnier », troquer ou échanger. La tradition est un piège, qui enferme le présent dans une répétition du passé, une dynamique semblable à celle qui a conduit au sort du sanskrit, dont la vitalité a été diminuée et le contenu vivant figé dans une superposition formelle jusqu’à devenir rance, gâté et inutile — sauf pour les irréductibles défenseurs de la tradition, ceux dont l’identité y est enfermée, dont l’ego y est investi, ou dont la fortune en dépend. Tradition et religion vont de pair — deux soutiens culturels qui nous lient à des répliques du passé et bloquent le déploiement de notre avenir dans le présent.
SOCRATE ET JÉSUS
L’intelligence du cœur, que Darwin décrira plus tard, une force supérieure de bienveillance et d’amour s’était manifestée à travers cette figure sacrificielle qui incarnait cette intelligence — peut-être pour la première fois dans l’histoire telle que nous la connaissons — pour se faire crucifier en retour. Cette solution du cœur, présentée par Jésus, aurait pu entraîner la dissolution complète de cet effet de champ accumulé depuis des siècles, que nous avons appelé culture dominatrice — et la culture, en tant qu’entité psychique auto-conservatrice, n’allait pas laisser cela se produire… ni alors ni maintenant.
Ainsi, Jésus est apparu au sommet de la période axiale chaotique, et, comme cela se reproduit encore et encore avec ces grands êtres qui sont « élevés », lorsque tout a été dit et fait, il ne fut pas tant victime des Romains et de cette croix que de son principal chroniqueur et mythographe : Paul. Jésus, en réalité, a disparu dans les inventions de Paul qui, une fois arrivé, a tourné à son avantage (comme le font tant de disciples) tous les recueils rafistolés qui donnaient un peu de contexte à Jésus — malgré le fait que, même si l’ego de Paul en avait besoin, l’événement de Golgotha n’en avait pas besoin. (Note : Golgotha, « le lieu du Crâne », est le site de la crucifixion de Jésus, un moment central dans la théologie chrétienne et la réflexion spirituelle.)
Comme c’est si souvent le cas, ce personnage extraordinaire et gigantesque, Paul lui-même, est devenu le noyau d’une vaste couche mythologique destinée à éclipser éventuellement la figure originelle qu’il exploitait. Comme le développe longuement The Biology of Transcendence, si l’on observe de près ce phénomène paulinien, on peut voir certaines des racines du désordre actuel, et pourquoi nous avons connu deux millénaires de troubles, au lieu de vivre dans la paix et l’harmonie que ce prince du cœur avait essayé — et essaie toujours — d’apporter.
EURÊKA ! Moments et failles
Les fissures dans l’œuf cosmique sont généralement refermées presque immédiatement par l’œuf lui-même, un point que j’ai souligné dans mon premier livre, Crack in the Cosmic Egg, il y a un demi-siècle. La fissure qu’a été l’expérience de Jésus et sa traduction ultérieure, concrétisée pour que tous puissent la voir, aurait pu nous offrir non seulement un nouveau visage de Dieu, mais aussi de nous-mêmes, ainsi qu’une nouvelle compréhension du fonctionnement de ce monde merveilleux. Cette fissure aurait dû être une lumière éclatante dans la caverne mentale de la culture, mais cela aurait effacé cet effet culturel, et a donc été immédiatement contrecarré.
De la même manière que le Eureka ! de Gould (la découverte du laser) a élevé le champ de la physique optique, le Eureka ! de Jésus aurait dû élever le champ dont il est issu (l’ ancien Israël) vers un nouvel ordre de fonctionnement qui, tôt ou tard, se serait répandu dans le monde entier. Cette élévation, cependant, bien que tentée à maintes reprises tout au long de notre histoire, n’a jamais été pleinement réalisée. À la place, nous observons la répétition d’une rupture régressive dans la boucle évolutive. Si l’on considère, comme l’a fait Jaynes, les longs siècles impliqués dans la transition de l’esprit bicaméral* vers l’esprit individuel, la traduction du Eureka ! de Jésus, qui impliquait précisément cette transition, aurait presque certainement nécessité des générations pour s’accomplir, si elle avait été autorisée. Mais c’est l’intervention de Paul qui a brisé la boucle, et l’humanité est retournée à un état d’esprit antérieur sans même se rendre compte que quelque chose avait été perdu.
Ainsi, la christologie de Paul a usurpé le « Dieu dans le cœur » de Jésus, et a réinstauré l’ancien Jéhovah lui-même, ressuscité des Écritures hébraïques. Le Dieu vers lequel Jésus pointait ne se trouve que dans le cœur, cette force créatrice qui fait tomber la pluie sur les justes et les injustes de manière égale, sans jugement. Paul, en revanche, présenta un Jéhovah sous de nouveaux atours, un Dieu prétendant être l’incarnation de l’amour, mais qui fulminait toujours sur les lois, les exigences de sacrifice, la fomentation de guerres de représailles, et la vengeance sans fin. En somme, la synthèse de l’histoire hébraïque à travers Jésus et son cœur a été annulée par Paul et son Christ, et les échecs de l’histoire furent réinstaurés à peu près intacts.
C’est donc Paul l’Apôtre, autorité la plus citée de la chrétienté et sa voix la plus forte, qui a scellé la fissure que Jésus avait ouverte dans l’œuf cosmique.
VOLER LA VEDETTE À JÉSUS
Ainsi naquit la christologie de Paul, dans laquelle Jésus disparut et une figure céleste vaporeuse prit forme comme l’image de cible d’un ailleurs éthéré. C’est vers cette image et vers l’au-delà de cet autre monde que toute l’attention se concentra. Comme Moïse dans l’Antiquité juive, le Christ de Paul était également soutenu par la Loi — celle-là même à laquelle Paul s’était opposé, mais dont il devint ensuite un des principaux promoteurs, sous de nouveaux habits. La Loi d’amour de Paul était censée rendre obsolètes toutes les autres lois (tout comme nous faisons des guerres pour en finir avec les guerres). La Loi elle-même, cependant, est, comme la culture et ses guerres, une erreur primordiale, quelle que soit sa parure, mettant en branle des enchevêtrements sans fin de douleur et de conflits.
La religion, centrée sur Dieu, les nuages et l’au-delà, tend à ignorer la vie comme un don offert dans l’instant présent, qui, pour être accepté, doit être vécu pleinement dans cet instant. Plus encore, la culture nous dit qu’il faut d’abord sortir la vache du fossé, enterrer notre père, s’occuper de ceci et de cela — le tout soutenu par le sinistre « sinon ! » si nous faisons autrement. La culture dit à l’enfant qu’il ne peut pas vivre dans le monde joyeux du jeu, mais qu’il doit plutôt passer ces années magiques et précieuses à se préparer, sombrement, à ce qui n’arrivera jamais. Traiter ce don miraculeux de la vie comme une simple préparation à quelque fantaisie vaporeuse dans l’au-delà est la grande séduction de la culture et de la religion. Mais notre vie n’est pas une répétition générale pour quelque éternité abstraite et insipide. Elle est le grand spectacle lui-même, et notre Terre vivante en est la scène, notre corps, le moyen.
jcp
Comme exploré dans C’est tellement simple, il nous est demandé de contempler et de réconcilier notre usage, mauvais usage et identification à deux ordres de perception complètement différents et donc à deux états de conscience. L’un est direct, et, comme le Tao ou la Vérité selon Krishnamurti, ne peut être capturé ni défini par des mots.
L’autre est constitué des percolations subjectives et incessantes du néocortex avec ses symboles abstraits, ses langues, ses métaphores, et ses images mentales conditionnées. La création, ou la nature, a fait évoluer les deux. Notre défi de développement est de découvrir la véritable nature de chacun, de les équilibrer et de les utiliser de manière appropriée.
M
Note sur L’esprit bicaméral*
Le concept d’esprit bicaméral vient du livre provocateur de 1976 du psychologue Julian Jaynes, The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind (tr fr La Naissance de la Conscience dans L’Effondrement de L’Esprit Bicaméral). Il ne s’agit pas des deux hémisphères du cerveau à proprement parler, mais plutôt d’une structure mentale hypothétique antérieure dans laquelle les humains ne vivaient pas la conscience introspective comme nous la connaissons aujourd’hui. Jaynes a proposé que les humains de l’Antiquité fonctionnaient avec une mentalité bicamérale — littéralement « deux chambres » de l’esprit : une partie du cerveau (souvent associée à l’hémisphère droit) générait des hallucinations auditives. L’autre partie (typiquement l’hémisphère gauche) obéissait à ces voix, les interprétant comme des ordres divins, émanant des dieux, des ancêtres ou des dirigeants. Ce n’était pas métaphorique — c’était une adaptation neurologique et culturelle. Les gens ne « pensaient » pas au sens moderne ; ils entendaient des voix qui guidaient leurs actions. Il soutenait que ce mode de fonctionnement dominait jusqu’il y a environ 3 000 ans, pendant l’effondrement de l’âge du bronze. Jaynes pensait que la conscience moderne — conscience de soi, introspection, pensée métaphorique — était un comportement appris, non une inévitabilité biologique. Elle serait née en réponse à une complexification sociale croissante et à un stress environnemental accru, nécessitant une prise de décision plus flexible. Il croyait que, à mesure que les sociétés devenaient plus complexes, le système bicaméral s’était effondré, donnant naissance à une conscience introspective, égocentrique, et au langage métaphorique.
À l’appui de cela :
The Missing Mind: Contrasting Civilization with Non-Civilization Development and Functioning (L’esprit manquant : Contraster le développement et le fonctionnement de la civilisation et de la non-civilisation) Darcia Narvaez et Mary S. Tarsha
Les petits groupes de chasseurs-cueilleurs passent la majeure partie de leur vie mentale dans la polysémie. La polysémie, dans ce contexte, désigne une conscience qui nage dans un monde en perpétuelle métamorphose — il n’y a pas d’identité fixe des choses (Bram, 2018). La polysémie reflète la capacité à fusionner avec de multiples autres, humains et non humains, et est le fruit de la dé-différenciation, c’est-à-dire la recherche d’unité avec les autres plutôt que la différence et la séparation. Beaucoup de cultures non civilisées pratiquent la dé-différenciation et répondent de manière créative au moment présent, fortement connectées aux autres, y compris au non-humain, aux ancêtres et à d’autres aspects spirituels d’un univers dynamique et fluctuant. C’est dans cet espace créatif inclusif qu’elles vivent, ou ont vécu, l’essentiel de leur existence. Lorsque nécessaire, ces groupes passent dans l’espace mental de résolution de problèmes, celui de l’univocité — pensée logique linéaire utile pour résoudre un problème particulier. Bien qu’ils utilisent les deux modes, polysémie et univocité, avec l’émergence de la civilisation sumérienne et ses suites, il y eut un basculement vers un usage prédominant de l’univocité, provoqué par le stress.
Bram (2018) décrit ce glissement progressif hors de la polysémie dans l’histoire de la civilisation occidentale, dû à de multiples facteurs, dont l’agriculture sédentaire, le travail forcé imposé par les élites, menant à une hiérarchisation accrue, à l’écriture, à la mesure et au contrôle des personnes et des choses, y compris la guerre et l’esclavage. L’univocité dépend de la différenciation : trier, catégoriser, abstraire. La différenciation crée des distinctions, définissant chaque chose comme une chose unique. L’univocité repose sur une logique dualiste, dichotomique (quelque chose est ou n’est pas), soulignant les causes et les effets qui s’appuient sur une pensée linéaire. La conscience du présent est minimale, car les gens tentent de prédire l’avenir à partir de ce qu’ils ont observé du passé. L’obsession de l’ordre, de la précision et de la prévision devient la norme — toutes des préoccupations de l’hémisphère gauche (McGilchrist, 2009)…
Le choc entre ces types de conscience radicalement différents fut évident lorsque les explorateurs, colons et anthropologues européens rencontrèrent des sociétés vivant principalement dans la polysémie, mais aussi dans le paradoxe — c’est-à-dire une combinaison d’attention diffuse ou périphérique avec une vigilance mentale ciblée (Berman, 2000). Les Européens furent déconcertés par l’absence de définitions précises, les récits changeants, les configurations sociales fluides et l’absence de dirigeants. Ils n’étaient pas « logiques » au sens linéaire et univoque. En même temps, les peuples autochtones firent remarquer l’absence d’âme des envahisseurs européens, leur rigidité et leur manque d’ouverture à une Terre sensible (Narvaez, 2019). Montrant des similitudes avec l’analyse de Bram, l’anthropologue E. Richard Sorenson (1998) nota une « conscience préconquête » (par opposition à la conscience postconquête des nations occidentalisées) parmi les différents peuples autochtones avec lesquels il vécut à travers le monde durant des décennies.
Narvaez, D., & Tarsha, M. (2021). The Missing Mind: Contrasting Civilization with Non-Civilization Development and Functioning. In T. Henley & M. Rossano (Eds.), Psychology and Cognitive Archaeology: An Interdisciplinary Approach to the Study of the Human Mind (pp. 55–69). London: Routledge.
Texte original : https://ttfuture.org/wp-content/uploads/Direct-Experience-and-Imagined-Theater.pdf