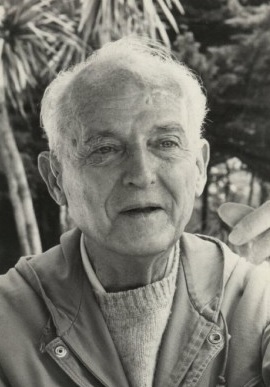(Revue Le Lotus Bleu. Février 1972)
Conférence faite à Paris le 30 septembre 1971.
Ces deux mots résument ce qui s’est présenté devant moi comme un problème et peut-être comme le problème le plus important. Je me suis aperçu plus tard qu’il en était de même pour beaucoup de mes amis. Je voudrais dire ici comment plusieurs parmi nous sont arrivés à lui trouver une solution. Ce n’est sûrement pas la seule, aussi ce qui suit est donné dans l’espoir de servir de point de départ à des recherches personnelles.
**
Comme beaucoup d’européens ayant pris contact depuis peu avec la pensée orientale, j’avais, il y a près d’un demi-siècle, une très grande admiration pour le bouddhisme. Je l’ai conservée sous une forme plus complète. Un de mes meilleurs amis, devenu l’excellent écrivain Claude Aveline, ayant reçu la commande d’un livre sur la vie du Bouddha [1], désirait enrichir son récit de citations ; il m’a demandé de les lui trouver. Ce fut une occasion pour moi de relire bien des pages admirables, notamment dans le « Soutra du Lotus de la Bonne Loi ». Ces lectures avaient une note dominante, une tonique revenant sous mille formes ; la première phrase du premier discours de l’Illuminé : « De même que la vaste mer, ô moines, est pénétrée d’une seule saveur : la saveur du sel ; de même, ma doctrine est pénétrée d’une seule saveur : celle de la libération ».
Et je sentais que si cette affirmation était vraie, rien ne pouvait être plus important que cette libération. Mais libération de quoi ? De la douleur, disent les textes. Et ils précisent : pas seulement des souffrances dues à la maladie et à la vieillesse, mais même de celles qui accompagnent la mort. Et cela non pas après la mort, mais dans cette vie même, sous forme d’une souveraine sérénité. Quel but ! Quelle aventure !
Quant au moyen d’atteindre ce but — ou tout au moins de s’en rapprocher — c’était un mode de vie particulier bien connu hors du bouddhisme : c’était le yoga. On n’a que l’embarras du choix pour en connaître les prescriptions, et ceux qui se sont donné la peine de les mettre en pratique, même seulement par curiosité, ont pu reconnaître leur efficacité, au moins sous leurs formes les plus simples.
Mais c’est à ce moment que surgit le problème : une discipline, n’est-ce pas le contraire de la liberté ? Comment un ensemble de règles, monastiques ou laïques, de prescriptions alimentaires, morales et psychologiques, patiemment répétées pendant des années, peuvent-elles conduire à une libération ?
Elles s’inscriront en nous comme des habitudes artificiellement acquises, feront de nous des automates, peut-être des automates admirables, mais sûrement pas des êtres libres. J’étais devant un mur. Je sentais qu’une solution existait pour ce problème, car je ne doutais pas de la parole du Maître, mais je ne la comprenais pas.
Il me semblait même que la difficulté devenait plus grande à mesure que l’on examinait le but proposé : il était donné par un mot : nirvâna, dont le Bouddha refusait de donner le sens précis. On s’apercevait pourtant qu’il s’agissait d’un détachement suprême, d’une évasion, d’une manière de se mettre hors d’atteinte des souffrances du monde qui nous entoure, tout en continuant — temporairement — à y vivre. Mais on ajoutait que la réussite complète doit nous assurer de ne plus jamais être obligés à renaître en ce monde. Et sur ce point l’unanimité est parfaite entre indous et bouddhistes : nous sommes des prisonniers, condamnés par nos erreurs, résultats de notre ignorance, mais nous pouvons nous évader.
C’est un espoir, mais il n’est pas entièrement satisfaisant, et pour deux raisons. La première est son caractère individuel : je puis me libérer, mais cela ne changera rien à l’action de la nature qui continuera de faire naître des prisonniers de l’ignorance. Ma libération ne changera rien à leur condition et tout ce que je pourrai faire sera de leur prêcher la bonne doctrine pour qu’ils cherchent à s’évader à leur tour. C’est peu, c’est trop peu. Et ce sentiment si pénible d’impuissance relative, mais grande — vient de ce qu’un nouveau problème se cache derrière ce premier résultat.
Ici, je voudrais m’arrêter un instant, car ce même problème se rencontre partout dans le monde actuel, et surtout parmi ceux qui sont à l’aurore de la vie active.
Il s’agit de savoir si notre vie a un sens, une signification, un but, autre que la satisfaction de nos besoins, de nos désirs et de nos idées. Combien de fois n’avons-nous pas entendu ceux que l’on appelle des contestataires demander à leurs aînés :
— Pourquoi suis-je né ? en ajoutant :
— Je n’ai rien fait pour venir vivre dans ce monde cruel, absurde, inhumain, que vous avez fait, et que je refuse.
Bien sûr, les religions ont proposé des solutions : récompense céleste pour une bonne conduite ici-bas, heureuse réincarnation… Théories, hypothèses dont la vérification nous échappe et que toutes les jeunesses refusent de plus en plus.
Il faut avoir le courage d’aborder le problème de front en essayant de répondre à la première, à la seule question importante : notre vie a-t-elle un sens ?
Nous n’avons de choix qu’entre deux chemins pour chercher une réponse :
Le premier est de croire que la vie n’a aucun but et aucun sens. Elle est ce qu’elle est, résultat inévitable des lois de la nature, miraculeux résultat d’une combinaison de hasards et de nécessités dont la complexité nous donne l’illusion d’une évolution et nous fait poser un problème sans signification : l’homme seul donne un sens à ses actes, fait des projets et les réalise, or il n’y a pas d’homme, pas de divinité semblable à nous, derrière l’activité de l’univers, donc il n’y a pas de but à cette vie, pas de signification à notre existence.
C’est une croyance qui séduit un bon nombre de savants, et de non-savants également, parce qu’en niant l’existence d’un but, elle diminue, jusqu’à l’annuler, notre responsabilité. Celle-ci n’est qu’une construction de la société, dont les plus habiles sauront se garder.
Nous n’avons alors aucune raison de ne pas aménager agréablement cette vie sans signification, dans les limites où nous le permettent les lois de la nature et celles que nous fabriquons nous-mêmes avec une inlassable fécondité. Et si cela ne nous satisfait pas, il reste deux solutions possibles, deux évasions : le suicide et le nirvâna.
Je ne plaisante pas. Il y a eu, en France notamment, des dizaines de suicides dus à ce genre de philosophies. Suicides violents parfois, ou suicides par un dégoût de vivre qui conduit parfaitement à la mort. Et d’autre part, en Orient, comme en France au temps des Albigeois, des êtres d’une haute spiritualité se sont laissés mourir pour quitter plus vite un monde où ils ne voyaient aucune sagesse et aucune liberté véritables.
L’attente d’une immersion définitive dans le nirvâna est la forme la plus haute de ces évasions : elle ne donne aucune réponse à la question posée, tout en ne niant pas qu’il puisse y en avoir une. Car s’il est vrai que le bouddhisme n’affirme l’existence d’aucune divinité, il faut noter qu’il refuse aussi de la nier, en se présentant seulement comme une technique positive et vérifiable, ce qui explique le succès qu’il rencontre auprès des athées en occident et en orient, avec des conséquences politiques curieuses, au Vietnam par exemple.
Nous sommes donc laissés ici en parfaite liberté devant un nouveau choix. En effet, si nous admettons qu’une évasion est le seul but offert à nos aspirations, nous sommes obligés à croire que le but de toute la création est de s’en échapper, conclusion difficile à admettre, car il aurait été beaucoup plus simple au créateur de ne pas fabriquer un tel piège… Alors il nous faut prendre un autre chemin.
Cet autre point de départ pour la recherche d’une réponse est l’inverse du premier : il consiste à croire que la vie a un sens. Non seulement notre vie, mais toute vie et même toute existence : la nature toute entière dans son activité constante doit alors être une progression vers un but, une évolution et non une suite de changements.
Quand on accepte cette position de départ, on doit la justifier en trouvant dans la nature des traces certaines de cette direction privilégiée de la vie universelle. C’est parmi les êtres vivants qu’elles sont le plus visibles. Non pas dans leurs formes extérieures, mais dans leur structure.
Au cours des âges, depuis l’aube de la préhistoire, les êtres vivants deviennent plus complexes, plus fragiles, mais surtout plus conscients. Sur la base de la matière s’élèvent les structures de plus en plus variées des êtres vivants où le système nerveux introduit une sensibilité, une possibilité de conscience de plus en plus complète, jusqu’au moment où, devenant capable de réfléchir sur elle-même, ce qui était jusqu’alors une impulsion subie par l’être, devient un mouvement voulu, contrôlé, par ce qui en est la source et la raison d’être. De ce point de vue, nos aspirations plus ou moins confuses prennent le sens d’un besoin d’accomplissement et leur existence est déjà une espérance, car elle n’est que parce que le but pressenti est accessible, latent, mais présent en nous. Quant à ce but, c’est une conscience parfaite, c’est-à-dire capable d’atteindre la Vérité, dont elle est le reflet, et la promesse est de s’unir à elle.
Le moyen de cette ascension, c’est la vie elle-même, ce qui a fait dire à Sri Aurobindo : « Toute vie est yoga ».
Evidemment nous sommes loin du but, et cela nous donne une précieuse leçon d’humilité : nous ne sommes humains qu’en partie. Comme le sphinx égyptien, l’homme porte la tête d’un dieu sur le corps d’un lion : la tête seulement. Notre état actuel n’est qu’une étape : nous ne sommes hommes qu’en partie et nous aspirons à le devenir en entier. C’est dans cette direction que se trouve notre libération.
Le perfectionnement de la conscience est la dynamique même de la vie et sa raison d’être. C’est la base d’un immense espoir. De même que la vie organise la matière, non seulement sans désobéir à ses lois, ni rien leur ajouter, mais en utilisant l’organisation vitale pour se libérer de ses automatismes et du lourd héritage animal du passé.
L’homme éveillé par une prise de conscience profonde de lui-même est semblable au bateau que le pilote conduit au plus près, remontant contre le vent pour atteindre le port de son choix ; il utilise les lois de la nature, il ne les subit plus : il est libre. Libre par son action réfléchie, qui donne toute sa raison à la définition du yoga par la Bhagavad Gîta : « le yoga est l’habileté dans l’action ».
Dans le passé, la nature conduisait l’homme par l’appel du plaisir, désormais il est maître de son chemin, il reconnaît son identité avec Cela qui a librement établi le plan de sa manifestation, avec cette Vérité qui est la source et le but de toute existence et dont l’approche se révèle par ce reflet de la perfection : le bonheur.
Ainsi peut se justifier le lien qui fait du yoga le chemin vers la liberté.
[1] Qui a paru en 1928 sous le titre de « La merveilleuse légende du prince Siddartha, Çakya Muni, Bouddha » (Paris, l’Artisan du livre).