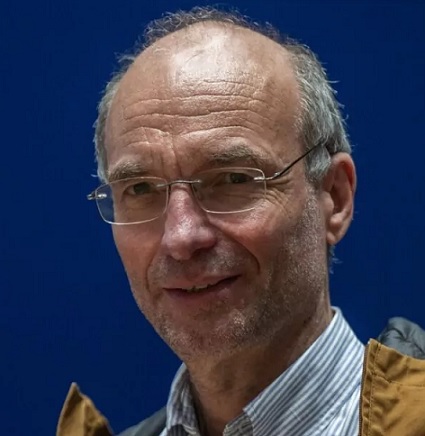La crise de la science qui mine la recherche est largement sous-estimée, en grande partie parce que les résultats non reproductibles, les biais idéologiques, les conflits d’intérêts et la fraude sont généralement discutés isolément — sans reconnaître leur impact cumulatif et leurs racines communes.
Les scientifiques seuls ne peuvent à eux seuls résoudre ce problème. La vigilance des citoyens est essentielle. Mais d’abord, les citoyens doivent en être informés.
La fraude scientifique s’est industrialisée
La fraude est, par nature, insaisissable. Bien que les outils de détection améliorés (par exemple l’analyse de duplication d’images) puissent avoir du mal à détecter les fraudes actuelles, compte tenu de la rapidité avec laquelle les fraudeurs s’adaptent, ils fournissent néanmoins des informations précieuses sur les inconduites passées.
Particulièrement inquiétant est le fait que la fraude n’est plus confinée à des individus isolés, mais est de plus en plus perpétrée par des réseaux organisés (voir Richardson et al., The entities enabling scientific fraud at scale are large, resilient, and growing rapidly ; Les entités permettant la fraude scientifique à grande échelle sont grandes, résilientes et se développent rapidement). La présence de fraudeurs ne doit pas discréditer toute une profession, mais il reste du devoir de chaque profession de les exposer et de les exclure.
La crise de la réplication
De nombreux résultats publiés ne peuvent pas être reproduits : c’est la crise de la réplication. Ce n’est pas nécessairement dû à la fraude. Dans de nombreux domaines, les résultats sont statistiques : ils peuvent aussi être dus au hasard. Par exemple, si l’on veut savoir si un dé est pipé, on le lance de nombreuses fois. Si une face apparaît de façon disproportionnée, on conclut qu’il est biaisé.
Cependant, il n’est pas impossible que le dé soit équilibré et que le résultat soit simplement aléatoire. En général, un résultat est accepté si la probabilité qu’il se soit produit par hasard est inférieure à un seuil arbitrairement choisi de 5 % (bien que dans certains domaines, comme la physique des particules, le seuil soit fixé beaucoup plus bas).
Ainsi, en principe, on s’attendrait à ce que 5 % des résultats statistiques soient faux. En réalité, c’est bien plus élevé, notamment à cause du biais de publication. Les résultats spectaculaires sont plus susceptibles d’être publiés, bien qu’ils soient aussi plus susceptibles d’être des anomalies statistiques.
Dès 2005, John Ioannidis a démontré dans son article fondateur Why Most Published Research Findings Are False (Pourquoi la plupart des résultats de recherche publiés sont faux) que la proportion de résultats statistiques faux est bien supérieure à 5 %. Un projet de réplication à grande échelle en psychologie a confirmé que seule une minorité de résultats pouvait être reproduite. L’oncologie et la recherche biomédicale montrent également des taux élevés d’échec de réplication. Étonnamment, aucune métaétude ne compare les taux d’échec de réplication entre les disciplines. Pourquoi ne pas lancer un vaste projet de réplication dans tous les domaines ?
La crise de la réplication est reconnue depuis des années et n’est toujours pas surmontée. Pourtant, en principe, elle pourrait être drastiquement réduite rapidement. Des solutions existent. Les revues doivent exiger la transparence : divulgation complète des données et de la méthodologie pour permettre la réplication. Les méthodes et hypothèses devraient être préenregistrées pour empêcher la pêche aux hypothèses a posteriori. Les articles devraient être acceptés sur la pertinence de la question et la rigueur méthodologique, non sur les résultats.
Cela réduit l’incitation et la capacité à poursuivre des résultats statistiquement fallacieux. Le Center for Open Science offre des outils pour soutenir cette démarche, mais ils ne sont utilisés que dans une minorité de publications.
Les universités devraient répliquer davantage d’études, en commençant par les plus importantes (pour tester les fondements de la discipline) et de façon aléatoire parmi les résultats nouvellement publiés (afin d’encourager les chercheurs à être plus rigoureux en augmentant le risque que leur étude soit vérifiée). Les étudiants y gagneraient une expérience précieuse tout en rendant un service hautement utile. La réplication est un outil pédagogique puissant.
Des initiatives comme celles du Center for Open Science favorisent la réplication, mais fonctionnent encore à une échelle modeste par rapport à la production mondiale de recherche. Le statut de réplication devrait être facilement accessible lors de la consultation d’une étude, et les journalistes devraient le signaler systématiquement. Des garde-fous doivent également être mis en place pour prévenir la fraude par validation collusoire, où des chercheurs reproduisent complaisamment les résultats les uns des autres. Tout cela doit être mis en œuvre rapidement.
Il est encourageant de voir le nombre croissant d’initiatives visant à s’attaquer à la crise de la réplication. Outre le Center for Open Science mentionné plus haut, on peut citer l’Institute for Replication, Open Science NL et l’Initiative de réplication du NIH. Pourtant, l’impact de ces initiatives reste modeste par rapport à l’ampleur de la crise de la réplication elle-même.
Le manque d’urgence de la communauté scientifique face à la crise de la réplication est encore plus préoccupant que la crise elle-même. Inertie ? Le problème plus profond est que, pour trop de scientifiques, la recherche de la vérité n’est plus la priorité principale. Cela se reflète de manière frappante dans leur soumission croissante aux idéologies autoritaires.
L’emprise idéologique dans les universités révèle une perte de priorité accordée à la recherche de la vérité, qui entrave également les efforts pour surmonter la crise de la réplication. Inversement, l’emprise idéologique s’est installée sur un terrain déjà affaibli — comme l’illustre la crise de la réplication elle-même.
Emprise idéologique
Les grandes universités, surtout aux États-Unis, ont été capturées par des idéologies autoritaires. De gré ou de force, les chercheurs ont souvent répété des affirmations qu’ils savaient fausses. Pour exposer cette emprise idéologique, Peter Boghossian, James Lindsay et Helen Pluckrose ont réussi à publier délibérément des articles absurdes, mais politiquement corrects (ils présentent leur travail dans une vidéo). Boghossian a dû démissionner de son université et a cofondé l’Université d’Austin, qui se présente comme l’une des rares alternatives aux universités capturées par le wokisme.
Une autre alternative est la Peterson Academy, créée par Jordan Peterson. Il a notamment refusé d’utiliser un langage imposé par une loi canadienne, a reçu des lettres de menace de son Université de Toronto et a fini par démissionner. Bret Weinstein, qui s’est opposé à une journée d’absence durant laquelle les Blancs étaient priés de ne pas entrer sur le campus universitaire, a également été contraint de démissionner, ainsi que son épouse. Le wokisme se répand de plus en plus dans les universités européennes également.
Par exemple, la professeure Kathleen Stock a démissionné de son poste à l’Université du Sussex en octobre 2021, après avoir subi un harcèlement intense en raison de ses positions sur le sexe biologique et l’identité de genre. Ce ne sont que quelques exemples illustrant le pouvoir que le wokisme a acquis dans les universités.
Le harcèlement des individus jugés politiquement incorrects découle souvent d’efforts de lobbying conjoints impliquant certains étudiants, membres du personnel administratif et scientifiques. Non seulement le wokisme peut entraîner la démission de chercheurs ou forcer l’embauche de chercheurs incompétents (sélectionnés selon d’autres critères que le mérite), mais il peut aussi imposer ou interdire certains sujets de recherche ou d’enseignement, ou biaiser la manière dont ces sujets sont étudiés (par exemple en interdisant l’exploration de certaines causes potentielles d’un phénomène donné). Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que de nombreux scientifiques préfèrent n’accorder à la recherche de la vérité qu’une priorité seulement secondaire.
Au sein de la communauté scientifique, une résistance émerge. Un chœur de voix académiques s’élève, par exemple, dans The War on Science, édité par Lawrence Krauss (voir aussi une interview avec Krauss présentant le livre : Lawrence Krauss: The new war on science | UnHerd et des conversations entre Krauss et les contributeurs du livre sur le site suivant : The Origins Podcast). Il reste incertain que les universités les plus capturées puissent être restaurées ou qu’elles doivent être remplacées par de nouvelles institutions plus saines.
Une correction de l’emprise idéologique sur les universités américaines est attendue depuis longtemps. Mais l’approche actuelle de l’administration Trump est grossière et indiscriminée. Ce n’est pas un rétablissement de l’équilibre, mais l’ascension d’un autoritarisme de droite, miroir des abus du wokisme. Deux autoritarismes qui se renforcent mutuellement. La science aux États-Unis est prise entre les deux.
La capture idéologique est la plus aiguë en Amérique du Nord, mais elle se propage ailleurs, notamment en Europe (voir, par exemple, la France : Face à l’obscurantisme woke). De plus, compte tenu de la nature mondiale de la science, des résultats biaisés publiés par des universités américaines dans une discipline donnée finissent par contaminer cette discipline dans le monde entier — d’autant plus que nombre des institutions les plus prestigieuses sont situées en Amérique du Nord et sont idéologiquement capturées (selon le 2025 U.S. College Free Speech Rankings de FIRE, l’Université Harvard est cette année l’établissement le plus mal classé en matière de liberté d’expression, pour la deuxième année consécutive).
Conflits d’intérêts
Certains chercheurs privilégient d’une manière particulièrement flagrante leur intérêt personnel à la vérité. Par exemple, 27 scientifiques ont publié une lettre dans The Lancet qualifiant de « complotistes » ceux qui suggéraient que la COVID-19 aurait pu s’échapper d’un laboratoire, censurant ainsi le débat durant la phase initiale de la pandémie.
À l’époque, plusieurs auteurs n’ont pas révélé leurs conflits d’intérêts, notamment Peter Daszak, qui avait travaillé avec l’Institut de virologie de Wuhan (et fut ensuite choisi par l’OMS comme le seul représentant américain dans son équipe chargée d’enquêter sur l’origine de la COVID-19).
Moi, et sans doute la plupart des citoyens, ignorions avant la pandémie que l’on procédait même à des recherches de gain de fonction visant à renforcer artificiellement des virus. Cela soulève une question troublante : existe-t-il d’autres procédures actuellement en cours qui présentent de graves risques, mais qui restent cachées du public ? Quel est le rôle du journalisme scientifique s’il n’informe pas le public de tels dangers ?
Pourquoi est-il important de savoir d’où vient la COVID-19 (voir Bret Weinstein: Why COVID-19 May Have Leaked from a Lab | Joe Rogan Experience et Where Did COVID-19 REALLY Come From? With Matt Ridley | TRIGGERnometry) ?
Premièrement, connaître l’origine de la COVID-19 aurait pu fournir un éclairage crucial sur les propriétés du virus à un moment où il était encore mal compris, ce qui aurait potentiellement permis de mieux orienter les stratégies de prévention précoces.
Deuxièmement, si la COVID-19 provient d’un laboratoire, comprendre les circonstances de l’accident pourrait nous aider à concevoir des garde-fous plus efficaces. Troisièmement, ignorer l’origine de la pandémie risque d’encourager des acteurs malveillants : si la nature est toujours tenue pour responsable, des diffusions délibérées pourraient passer inaperçues et impunies. Quatrièmement, nous devons aux victimes de découvrir ce qui s’est passé.
Pendant la pandémie de COVID-19, la censure et la diabolisation de ceux qui questionnaient les récits officiels ne concernaient pas seulement l’origine du virus, mais aussi l’efficacité et les effets secondaires des mesures prises, qu’il s’agisse des confinements, du port du masque, de la vaccination, des médicaments, etc.
La pandémie de COVID-19 est loin d’être le seul exemple où les conflits d’intérêts entrent en jeu. Ces conflits proviennent souvent de financements privés. Les bailleurs peuvent influencer les chercheurs ou simplement sélectionner ceux qui sont les plus susceptibles de produire les résultats attendus. Les faits ne parlent généralement pas d’eux-mêmes. Une étude a donné des données identiques à différents chercheurs pour tester deux hypothèses : leurs conclusions variaient largement. Ainsi, choisir le bon analyste peut suffire à obtenir le résultat souhaité.
Les chercheurs peuvent souvent faire dire aux données ce qu’ils veulent, motivés par l’idéologie, l’argent ou leur carrière.
Une science brisée a besoin de nous tous : chercheurs, journalistes et citoyens
La crise de la science a de nombreux aspects, mais une cause profonde : la vérité a souvent été reléguée au second plan. Beaucoup de scientifiques continuent de travailler rigoureusement et de maintenir les plus hauts standards, mais de plus en plus privilégient d’autres objectifs au détriment de la quête de vérité. Ceux-là ne sont plus de vrais scientifiques.
Comme les autres humains, les chercheurs répondent aux incitations. Ils savent que leur carrière dépend du nombre d’articles qu’ils publient et de la fréquence à laquelle ils sont cités, plutôt que de leur valeur réelle. Ils jouent le jeu. Lorsqu’ils évaluent un article dans le cadre d’un processus de relecture par les pairs, ils savent qu’ils ne peuvent pas vraiment juger de la validité de ses conclusions, sauf en cas de défauts évidents.
Ils manquent souvent des informations nécessaires pour répliquer l’étude et, de toute façon, ils ont des activités plus gratifiantes à poursuivre. Ils jouent le jeu. Ils se concentrent sur la publication d’articles et se désengagent du fonctionnement de leur université.
Quand une idéologie autoritaire profite de cela pour capturer l’institution, les chercheurs se soumettent à ses exigences. Ils jouent le jeu, comme ils le faisaient déjà lorsqu’ils orientaient leur recherche pour obtenir des financements. Il y a des exceptions, mais la majorité des chercheurs jouent un jeu qui ne tend plus vers la vérité.
Pourtant, nous avons un besoin urgent de la science pour relever de grands défis, tels que le climat, l’énergie et la santé. Mais la science ne peut remplir ce rôle que si elle est restaurée. La recherche de la vérité doit redevenir sa valeur centrale. La méthode scientifique et la liberté d’expression doivent être rétablies.
La science bénéficie encore de son prestige grâce aux réalisations passées. Notre puissance technologique prouve que nous avons compris quelque chose du fonctionnement du monde. Mais ces réalisations passées ne disent rien de l’état actuel de la science ni des disciplines qui ne débouchent pas sur des technologies.
Comment restaurer la science ? Malgré des initiatives prometteuses, la communauté scientifique n’a pas surmonté la crise. Cela suggère un manque de capacité ou de volonté collective. La crise de la réplication persiste malgré les solutions disponibles. Pire, de nombreux scientifiques dans les universités d’élite américaines s’alignent sur des idéologies autoritaires.
Les scientifiques ne sauveront pas la science à moins que les citoyens, qui financent une grande partie de leur recherche et peuvent décider de ne plus se laisser tromper par des études non scientifiques, ne les contraignent à agir. Cette crise ne doit pas être autorisée à perdurer.
Les citoyens doivent être informés. Ils le seront tôt ou tard. Mais plus tôt ce sera, mieux ce sera, afin que les dégâts puissent être réparés rapidement.
Malheureusement, les journalistes minimisent souvent la crise pour protéger la réputation de la science. En tentant de la protéger, ils en retardent la restauration et se discréditent eux-mêmes. Quand l’effondrement ne pourra plus être caché, les citoyens demanderont : « Pourquoi avez-vous caché l’éléphant dans la pièce pendant si longtemps ? » (par exemple, selon une étude, 75 % des Allemands n’ont jamais entendu parler de la crise de la réplication). Et ils ne leur feront plus confiance.
Les journalistes doivent parler maintenant, afin que l’aide arrive tôt et que les vulgarisateurs scientifiques ne soient pas emportés par une vague de discrédit.
Il serait utile d’appliquer la théorie des jeux à la fois à la crise de la réplication et à la capture idéologique des universités. À première vue, il devrait être possible de modifier les règles du jeu de sorte que les incitations s’alignent pour contrer la crise de la réplication.
Contrer la capture idéologique des universités semble toutefois dépendre davantage de rapports de force bruts. Il est important d’identifier les bons leviers. L’un d’eux pourrait consister à briser le cycle de la signalisation vertueuse en démontrant que le wokisme n’est pas une vertu, mais une distorsion performative de celle-ci.
Prendre la parole peut briser le mur du silence et encourager d’autres à en faire de même. La création de nouvelles institutions saines peut aussi déclencher un effet boule de neige.
Éviter le nihilisme
La profondeur de la crise peut donner le vertige, au risque d’un nihilisme. Pourtant, nous avons une boussole : la méthode scientifique fonctionne pour approcher la vérité. Le problème est que les « scientifiques » l’abandonnent trop souvent. Nous savons ce qui doit être fait. Et nous pouvons faire confiance aux disciplines et institutions qui suivent rigoureusement la méthode scientifique.
Les journalistes doivent aider, non seulement en rapportant des résultats, mais aussi en communiquant le degré de rigueur scientifique qui les sous-tend. À cette fin, nous devrions tenter de développer un indice mesurant la rigueur scientifique par discipline et par université dans le monde entier. Toutefois, il faut veiller à ce que le développement de cet indice ne soit pas lui-même capturé. Cette approche différenciée est essentielle, non seulement pour éviter de jeter le bébé avec l’eau du bain, mais aussi pour inciter les disciplines et les universités à revenir à la rigueur scientifique.
Hélas, les domaines les moins rigoureux concernent souvent des questions humaines où le biais est à la fois plus tentant et plus facile à mettre en œuvre. Tentant, car il influence les politiques publiques. Facile, car la complexité laisse plus de marge pour manipuler.
Tant que la science n’est pas restaurée, peut-on encore faire confiance à la science dans les disciplines et institutions à faible rigueur scientifique ? Une réponse pourrait être que peu de rigueur vaut mieux que pas de rigueur du tout. Mais cette rigueur scientifique est parfois tombée si bas qu’elle est surtout trompeuse, et il vaudrait mieux que ces disciplines et universités ne s’abritent plus derrière les vertus de la science.
Le scepticisme de base, qui exige des preuves et veut comprendre comment nous savons ce que nous savons, est fondamentalement sain et même central dans l’approche scientifique. Durant la crise de la science que nous traversons, les citoyens doivent être particulièrement vigilants. Leur confiance ne peut être que conditionnelle et granulaire. Conditionnelle, selon les arguments fournis et la preuve du respect de la méthode scientifique. Granulaire : la confiance doit varier selon la discipline et l’institution. Il ne s’agit pas de faire uniformément confiance ou de se méfier de tout ce qui se prétend science, mais d’accorder la confiance en fonction de la rigueur scientifique de la discipline et de l’université qui présentent les résultats. Et il n’est pas interdit d’utiliser le bon sens.
Quand ceux qui trahissent la méthode scientifique verront qu’ils n’influencent plus l’opinion publique, ils seront poussés à se réformer.
La complaisance empoisonne la science dont nous avons si crucialement besoin. Citoyens, journalistes et scientifiques doivent agir maintenant pour restaurer l’âme même de la science : la recherche intransigeante de la vérité.
Pierre-Alain Bruchez est docteur en économie et a auparavant travaillé à l’Administration fédérale des finances en Suisse. En 2023, il a lancé un référendum en tant que simple citoyen. Il écrit sur la démocratie, la science et la nature. Son dernier livre (en français) est ÉCOLOGIE VITALE –– Protéger la nature hors de nous pour la ranimer en nous.
Texte original publié le 6 septembre 2025 : https://off-guardian.org/2025/09/06/saving-the-science-we-crucially-need/