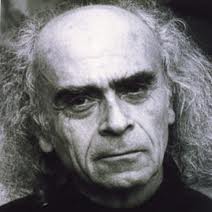(Revue Question De. No 42. Mai 1981)
En cette fin d’hiver où le printemps crève la surface de la terre pour en faire surgir de longues tiges hantées par la chaleur du soleil, la mémoire me revient d’un être qui ne savait pas qu’il était heureux, avant la chute, comme disent certains, avant que le Serpent de la Connaissance ne vînt s’infiltrer entre l’âme et le corps pour dissocier à jamais ce que Dieu avait uni pour l’éternité.
Car la tragédie humaine commence le jour où l’être humain a conscience d’être et un corps et un esprit. La conjonction copulative ne résout aucun problème : au contraire, elle en provoque parce qu’elle est impuissante à traduire l’intense union qu’il y a dans l’existence parallèle de deux entités qui ne sont entités pures que par l’interaction qu’elles exercent l’une sur l’autre. Et aucun système de philosophie, aucun dogme religieux, aucune idéologie sociopolitique ne pourront rendre compte de l’intime simplicité qui est la marque de la Vie : Je suis mon corps en même temps que mon esprit. Or, jusqu’à présent, quelles que soient les données du raisonnement dialectique qui s’opère, l’accent a été mis sur l’Avoir et non sur l’Être, ce qui, amenant l’idée de possession, a naturellement conduit à un conflit entre le Corps et l’Esprit.
Le but à atteindre
Ce conflit, on a tenté de le néantiser. Les religions ont insisté sur le rôle prépondérant de l’Esprit : on sait à quoi cela a pu aboutir, à des aberrations du genre macérations et châtiments, lesquelles ne sont point exemptes de perversités inconscientes. Et l’on en est arrivé, à force d’éliminer le rôle du corps, à ne plus permettre à l’Esprit de s’exprimer, puisque naturellement l’Esprit ne peut se manifester que par l’intermédiaire d’un Corps sain et équilibré, par l’intermédiaire d’un cerveau convenablement nourri et irrigué de façon à fonctionner le mieux possible. Échec retentissant des religions dogmatiques qui reposent sur la notion d’un salut futur à gagner par l’asservissement d’un présent qu’on rejette. Échec des systèmes philosophiques qui, prêchant la Sagesse, ne l’ont définie que comme une réaction spirituelle dirigée contre l’animalité instinctuelle. Échec des idéologies socio-politiques qui, toutes sans exception, se sont contentées de déplacer l’instinct de plaisir du présent vers un futur trop vague et trop lointain pour que n’apparaisse point la notion de profit pour ceux qui mènent le jeu et qui vivent de la crédule patience des « damnés de la Terre ».
En fait l’erreur est dans le but à atteindre. Religions, philosophies et idéologies promettent le bonheur à condition qu’on veuille bien suivre les sacro-saints préceptes émis une fois pour toutes par des illuminés de vocations diverses. Or le bonheur n‘est pas un objet palpable. Il ne peut se définir, parce que, par nature, il n’est pas le même pour chacun des individus qui composent l’Humanité. Quelle stupidité est-ce donc que de dire à quelqu’un : « je travaille à ton bonheur » ! Comment peut-on savoir ce qu’est le bonheur d’un individu autre que soi-même ? D’ailleurs le bonheur est ineffable, indicible. Il n’a pas d’existence autonome puisqu’il découle d’un état, qu’il est inhérent à l’être qui a réussi à abolir la situation conflictuelle primitive, ce que d’aucuns appellent « transcender le Réel ».
Nous y voici en effet : le Réel doit être transcendé, ce qui signifie simplement qu’il faut partir d’un réel apparent, plus ou moins anarchique et distordu dans ses contradictions, pour en arriver à un Réel profond, authentique, débarrassé de toutes les scories culturelles et biologiques qui le défiguraient. On remarquera que l’Alchimie ne propose pas autre chose lorsqu’elle met en évidence les opérations multiples qui conduisent de la Matière Première brute à la Pierre Philosophale élaborée, et parfaitement réelle sur les deux plans de la matière et de l’esprit, résultat de la fusion totale et harmonieuse de ce qui paraissait un complexe oppositionnel.
Or donc, avant de se lancer dans une quelconque recherche sociologique concernant l’épanouissement de l’individu au sein d’une société plus ou moins idéale (et par conséquent sans réalité), il importe d’attirer l’attention sur la maturation même de l’individu. Les sociétés valent ce que valent les individus qui la composent. Une société parfaite ne peut exister si les individus qui l’animent ne sont point parfaits. Et si tant est qu’on ne puisse atteindre la perfection, laquelle, à la limite, serait synonyme d’achèvement et donc de mort, ou plutôt de non-existence, il convient cependant, comme le disait Jean-Jacques Rousseau dans son Contrat Social, d’approcher le plus près possible un état de nature où s’abolissent nécessairement les contradictions.
Une révision déchirante
Il faut bien dire que, dans cette fin de XXe siècle où l’être humain a la possibilité scientifique de détruire la Terre, nous n’en sommes pas arrivés là : les sociétés continuent à fabriquer des individus en fonction de leurs besoins et de leurs structures alors que la sagesse la plus élémentaire consisterait à fabriquer des sociétés en fonction des individus.
Mais pour cela, il est nécessaire de procéder à une « révision déchirante » du comportement. Le modèle actuel, qui est le type urbain, n’est plus qu’une caricature d’être, un fantôme en proie aux diverses hystéries collectives qui se développent dans un environnement artificiel où le rapport de l’être aux choses est impossible. Voulant se protéger des dangers naturels, extirpant toutes ses terreurs ancestrales, sacrifiant à la facilité immédiate, l’être humain se trouve en plein déséquilibre, l’intellectuel et le manuel supportant ensemble le poids d’une technologie avancée qui les étouffe et les empêche de voir la Réalité au-delà des limites définies par les normes socio-économiques en vigueur. Alors apparaissent des problèmes qui semblent insurmontables et qui sont facteurs d’angoisse. Si l’on prend, par exemple, le problème de l’énergie, on va se heurter tout de suite à une incompréhension. Un individu qui, pour se chauffer, ou pour s’éclairer, n’a plus qu’à manœuvrer un commutateur ne sait absolument pas ce qu’est l’énergie : c’est seulement un vague courant électrique, invisible, mystérieux, magique même, dont les effets se font sentir mais dont l’existence réelle n’est pas discernable. En un sens, les dieux on été remplacés par la « Fée Électricité », et peu importe son origine puisque l’essentiel est que ses manifestations soient bienfaisantes. En somme, l’être humain n’a guère évolué depuis qu’il croyait aux fées et aux divinités anthropomorphiques qui font tant rire ceux qui se disent rationalistes. La mentalité de cet être humain serait complètement différente s’il devait aller lui-même couper son bois, le réduire en petits morceaux avant de le mettre dans sa cheminée ou dans son fourneau pour se chauffer. Là, le rapport aux choses, l’effort qu’il ferait, la quantité limitée de combustible dont il disposerait, tout cela lui montrerait l’utilité d’une économie, c’est-à-dire d’une utilisation consciente et raisonnée d’un élément indispensable à sa survie et à son bien-être. Il en serait de même s’il devait extraire l’huile de différents végétaux pour remplir sa lampe et s’éclairer. L’énergie ne serait plus un terme abstrait, mais une réalité tangible, mesurable, pondérable.
L’homme ville
Dans le domaine alimentaire, on assiste à un gaspillage éhonté de la part des sociétés dites nanties alors que les deux tiers de l’humanité souffrent de la malnutrition. Encore y aurait-il beaucoup à dire sur les produits artificiels et carencés (le pain mort, les légumes déminéralisés, la viande pauvre en éléments essentiels, etc.) qui sont livrés à la consommation par un souci de rentabilité et non de service. Mais comment l’Homo Urbanus du XXe siècle pourrait-il comprendre quoi que ce soit à son alimentation ?
Il se nourrit en effet de mets conditionnés ou préparés à l’avance (la maison Untel cuisine pour vous…). S’il veut manger des légumes, ceux-ci sont souvent nettoyés et prêts à cuire. S’il veut manger de la viande, celle-ci est déjà découpée, arrangée, mise sous cellophane ou sous plastique. Sait-il ce que c’est que la viande ? A-t-il le sentiment que la tranche de rôti qu’il achète est un morceau de cadavre découpé dans une bête qu’il a fallu tuer et dépecer ? Et quand bien même il irait s’approvisionner chez un boucher, l’environnement aseptisé et réglementé serait tel qu’il n’aurait pas la moindre idée de la réalité des abattoirs. Et saura-t-il jamais ce que représente de soins une simple carotte, un simple poireau, une simple salade ? L’Homo Urbanus se nourrit d’abstractions. Et le fait que les aliments actuels soient de plus en plus « normalisés », de plus en plus « standardisés », de plus en plus aseptisés et insipides, accentue le fossé qui sépare l’être humain de la source élémentaire qui lui assure sa survie. Il ferait beau voir, du jour au lendemain, cet Homo Urbanus projeté en pleine nature et obligé de se nourrir du produit de sa cueillette, de sa récolte ou de sa chasse ! Il est probable que sa survie serait remise en question, à cause de sa méconnaissance des choses les plus simples et des dangers que la nature recèle et auxquels il n’est pas préparé.
En nous, le miracle
Cela nous conduit à penser que l’Homo Urbanus est, qu’il le veuille ou non, privé d’une part importante de sa personnalité : celle qui concerne son propre devenir. Elle lui échappe fatalement parce qu’il s’en remet, pour cette part, à un système complexe de services socio-économiques qui fonctionne telle une machine infernale mise en route une fois pour toutes, et qui ne peut s’arrêter que dans une gigantesque autodestruction. Abandonné par ce système, l’Homo Urbanus n’est plus qu’une épave. On s’en aperçoit lors des incidents qui affectent la distribution d’énergie électrique de tout un pays : les conséquences frôlent toujours la catastrophe. Et on en a une vague conscience, mêlée d’angoisse, lorsqu’on songe à une pénurie possible de pétrole, monstrueuse source d’une énergie volée pendant tant d’années d’euphorie et de gaspillage.
Or, à ce cancer de la civilisation urbanisée il n’y a aucune parade, encore moins un remède-miracle. Le miracle est en nous, en chacun des individus qui constituent les sociétés contemporaines. Cette révision déchirante du comportement de l’être humain, sur le plan individuel, est la seule possibilité qu’ait l’humanité de faire face aux crises qui la minent et qui sont prêtes à l’engloutir.
Il ne s’agit évidemment pas de revenir à l’Age de la Pierre, encore qu’une telle expérience serait pleine d’enseignements. Il ne s’agit pas non plus de revenir à un soi-disant « état de nature », celui-ci n’existant que dans la pensée délirante de certains philosophes eux-mêmes totalement coupés des choses élémentaires. Il s’agit simplement de rendre à l’être humain cette part de sa personnalité qui lui fait cruellement défaut. Nos citadins la ressentent confusément, eux qui, après une semaine de travail dans un bureau, en position assise, régalés d’air conditionné, abreuvés de lumière artificielle, repus de nourritures chimiques, vont faire, le dimanche matin, du footing dans les bois « pour se maintenir en forme ». Le drame, c’est que ce genre d’activité ne sert strictement à rien. Le sport non plus d’ailleurs, puisqu’il est dévié d’une part vers la compétition à but lucratif, d’autre part vers la récupération politique, étant comme chacun sait un exutoire de l’agressivité. Et je ne parle pas des sports organisés et quasi-obligatoires dont les sociétés totalitaires sont friandes : plus le peuple fera du sport, plus il sera discipliné, plus il sera la victime consentante des manipulations diverses. Les exemples ne manquent pas dans l’Histoire, y compris, très près de nous, les Jeux Olympiques dans l’Allemagne nazie ou dans la Russie stalinienne.
Pour parler franc, cette énergie dépensée par le « bureaucrate » le dimanche matin (avant le bon repas de midi) serait beaucoup mieux utilisée s’il cultivait un carré de légumes. Il est vrai que certains tondent leur gazon.
Jardins
Quelle est donc cette société grotesque qui fait qu’on préfère une pelouse inutile à un jardin profitable ? Autrefois, aux alentours des villes, nombreux étaient les « jardins ouvriers » qui permettaient à une famille de se nourrir en partie d’un travail sain et équilibrant. Je sais bien que ces « jardins ouvriers » étaient la conséquence d’une certaine mentalité « paternaliste », mais c’était peut-être la seule façon de ne pas couper les travailleurs industriels de la terre. Et l’on peut constater que ces « jardins ouvriers » disparaissent tous les uns après les autres aussi bien parce que les travailleurs s’en désintéressent que parce que les pressions économiques s’exercent contre toutes les catégories de travaux d’amateurs. Au fond, le problème n’est pas de savoir si un intellectuel, ou soi-disant tel, a besoin d’une activité physique. Il s’agit plutôt de poser le postulat suivant : tout être humain a une intelligence et un corps capable de travaux manuels. À partir de là, on réussira peut-être à abolir toute distinction entre travailleurs intellectuels et travailleurs manuels. Encore une fois, ce sont, les sociétés de profit qui ont établi cette distinction, parce qu’une société de profit ne peut prospérer que sur une opposition (pour ne pas dire lutte) entre deux catégories d’individus : ceux qui décident et ceux qui obéissent. Et ce n’est pas un hasard si dans la société cubaine, gérée par Fidel Castro, les étudiants et intellectuels doivent se livrer à des travaux agricoles saisonniers. Malheureusement, là encore, les motivations profondes ne sont pas très claires et les résultats pour le moins douteux : un ordre venu d’en-haut, et vecteur d’une idéologie, débouche sur une contrainte et non sur une transformation du comportement.
Voir la réalité
C’est à titre individuel, donc en toute conscience et en toute liberté, que l’être humain doit réapprendre son rapport avec les choses qui l’entourent. Et d’abord, il doit réapprendre qu’il est le maillon d’une chaîne, un relais dans un cycle perpétuel qui va de la dégénérescence à la régénération. Il n’a aucune vergogne à se montrer en train de manger, c’est-à-dire en train d’absorber des aliments qui, une fois digérés, deviendront urine et matière fécale. Mais il ignore délibérément ses fonctions d’excrétion il en a honte, il se cache. D’où un extraordinaire refoulement qui, par suite d’un voisinage naturel, se répercute sur les fonctions sexuelles. Et l’on voudrait que l’Homo Urbanus, qui ne sait plus faire pousser une salade ni faire cuire du pain et qui tire pudiquement une trombe d’eau sur ses déjections, soit un être équilibré ? Dans je ne sais plus lequel de ses romans à succès, San Antonio, alias Frédéric Dard, se demandait avec un humour très corrosif pourquoi on conviait toujours ses amis à manger et non à déféquer. Et d’imaginer aussitôt une toilet party du plus heureux effet… Scatologie ? Sûrement pas. Un cri de révolte et de sagesse. Quand donc l’Homo Urbanus comprendra-t-il que la merde est respectable et qu’elle est source de vie, que c’est l’engrais idéal et naturel grâce auquel le cycle de la germination put se perpétuer. Si le grain ne meurt, assurent les Écritures, la vie nouvelle n’est pas possible. Mais vraiment, comme cette pensée gène notre homo urbanus qui ne tolère plus la vision de la pourriture pas plus que celle de la mort, autrefois parties intégrantes du cours de l’existence. Dans le temps, on mourait en famille et on était enterré dans le cimetière paroissial, autour de l’église en plein milieu du village. Le voisinage de la mort n’avait rien d’effrayant, ni de répugnant, puisque c’était un des aspects d’une réalité unique.
Un nouveau Grand Œuvre
Car l’être humain est un singulier pluriel. Aucun individu n’est identique à un autre, mais son identité lui vient des facteurs qui le composent et qui sont d’une multiplicité infinie. L’être est pluriel même s’il se sent singulier et singulièrement unique, enfermé parfois dans une solitude tragique, puisque son destin est d’être solitaire jusqu’aux extrêmes limites du désespoir. Or cette tragédie de l’être, elle est, bien plus que dans la solitude, dans l’incapacité dans laquelle il se trouve de réaliser la fusion intime des éléments multiples qui le constituent. La transcendance n’est pas, comme on l’a trop répété, de dépasser la condition humaine, c’est bien au contraire de réaliser cette condition où la fusion élimine les antinomies. L’être, pour se transcender, doit se réaliser totalement en tant qu’être humain, c’est-à-dire, au premier chef, prendre conscience de sa multiplicité pour en assumer la plénitude. Malheureusement, les divers systèmes de morale et les dogmes religieux n’ont fait, de tout temps, que contribuer à la fission de l’être primitif, à accentuer son hétérogénéité au lieu de prendre pour but son homogénéité. Et tout se passe comme si les sociétés humaines cherchaient à maintenir l’être humain dans un état permanent d’analyse pour exercer sur une partie de son individu une pression profitable, alors que leur rôle aurait dû être de l’aider à accomplir sa synthèse. Si l’on veut bien admettre l’existence historique du Christ et la réalité de sa résurrection sous forme de corps « glorieux », alors le Christ est l’exemple type de l’être humain ayant réussi à obtenir la synthèse de ses éléments multiples et affaiblis parce que séparés, en une harmonieuse perfection qui se passe de tout commentaire. Le Christ est le symbole de l’Humanité atteignant la transcendance par la fusion parfaite du Corps et de l’Esprit. C’est l’Être réconcilié enfin avec lui-même après une longue histoire où le déchirement et la souffrance avait annihilé son propre pouvoir.
« Vivez dans le Christ », affirment les prêtres catholiques. Mais ils se gardent bien d’expliquer comment on peut réaliser cette performance, se perdant eux-mêmes dans les paradoxes et dans le péché d’analyse qui conduit à la morale de bas étage et à la culpabilisation de l’instinct. Car l’être humain est un animal : et cette animalité, loin d’être un obstacle à son épanouissement, devrait le mener à opérer la fusion entre les éléments instinctuels et les éléments intellectuels que lui provoque son cerveau plus complexe et mieux irrigué que celui des animaux.
On ne peut être que dans la Totalité. Sinon, c’est une caricature d’être qui émerge des profondeurs de la matrice. Là encore, l’exemple de l’Alchimie traditionnelle nous enseigne que c’est à l’intérieur de cette matière première nécessaire à l’œuvre que nous trouverons les éléments permettant l’obtention de la Pierre Philosophale. Mais que de chemin à parcourir ! Il faut d’abord savoir ce qu’est exactement la Matière Première, pourtant bien commune et connue de tous. Il faut ensuite reconnaître en elle les composants hétérogènes pour les isoler, les purifier, les cuire. La règle d’or est alors : solve et coagula. On l’a trop oublié jusqu’à présent, comme on a oublié que le Grand œuvre des Alchimistes concerne en parfaite égalité et la matière extérieure à l’individu et la vie psychique même de cet individu.
Le lien sacré
Voilà pourquoi il importe de redonner à l’être humain ses possibilités de transcendance en mettant l’accent sur les multiples fonctions de l’existant de façon à n’en négliger aucune au détriment d’une autre, ce qui serait parfaitement arbitraire et risquerait de conduire au démantèlement définitif de la personnalité. L’essentiel est de s’assumer pleinement. Intelligence, spiritualité, fonctions organiques, nourriture absorbée, déchets rejetés, sexualité (enfin séparée de la fonction procréative), activité manuelle, affectivité, fantasmes, dons naturels, capacités particulières, force ou faiblesse physique, imagination, tout cela est inhérent à l’être, mais, depuis la Chute, ou plutôt depuis la Connaissance du Bien et du Mal, livré de façon incohérente parce que catalogué et hiérarchisé. Quand comprendrons-nous que, comme il n’y a pas de bonne et de mauvaise littérature, mais une littérature aux multiples aspects, il n’y a ni hauts ni bas instincts : il y a des instincts, c’est tout. Toute tentative pour intégrer les instincts en une échelle de valeur est un acte satanique de destruction de l’être.
Et Satan, le Shatam hébraïque et non pas le Diable qui oblige à se poser des questions, se réjouit plus que jamais : son bal permanent regorge de danseurs. Il est vrai que Satan n’est pas celui qu’on croit. Mais il est de bon ton, en ces temps de triomphe de l’Homo Urbanus, de nier l’existence de Satan, le destructeur, l’analyste, le coupeur de cheveux en quatre, et de sourire à l’évocation de Jésus, l’homme-dieu pourtant « Fils de l’Homme », celui qui unit, celui qui « coagule », celui qui abolit les contradictions, celui qui transcende le Réel et qui enseigne que « ce qui est en haut est comme ce qui est en-bas ». Tomberions-nous dans les pièges de Satan, dont la plus grande ruse, nous disait Baudelaire, est de « faire croire qu’il n’existe pas » ?
Avant la « Chute », il n’y avait ni intellectuel, ni manuel. Il y avait l’Être. Et l’Être vivait dans une Nature qui n’avait pas besoin d’être conciliée puisqu’elle vivait à l’unisson de l’Être. Le mythe de l’Age d’or rejoint celui de l’Éden. Et le roi Saturne n’était pas encore ce qu’il est devenu par contamination de la pensée dichotomique des Grecs, ce Chronos maître du Temps et dévoreur de ses propres enfants, autrement dit Satan. Saturne était le Pourvoyeur et le Distributeur des richesses naturelles. Jésus a tenté de nous le faire comprendre, mais sa prédication a été récupérée par le soi-disant apôtre Paul, tout imbu d’hellénisme et zélé serviteur de l’ordre romain. Les druides celtes l’avaient compris et eux aussi ont tenté de nous transmettre un message : mais comme il était contraire à l’ordre romain, il a été savamment étouffé, enfoui, dispersé. Retrouverons-nous un jour le nemeton, cette clairière sacrée des druides où Viviane entraîne Merlin, le vieil enchanteur désabusé ? C’est pourtant là que s’opère la fantastique fusion du singulier pluriel, et si l’Être humain a encore le désir d’être immortel, il fera bien de chercher l’obscur chemin qui mène, à travers les halliers de Brocéliande, au sanctuaire où s’abolissent les fallacieuses notions de temps et d’espace, de vérité et de mensonge, d’irréalité et de réalité, de bien et de mal, de vie et de mort, de chair et d’esprit…