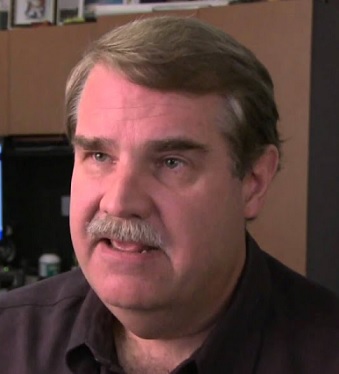Compte rendu de « Why I Cut Ties with Science’s Top Publisher (Pourquoi j’ai rompu mes liens avec le plus grand éditeur scientifique) »
À une époque où beaucoup trop de scientifiques baissent la tête et gardent leurs préoccupations pour eux, la scientifique Anna Krylov a fait quelque chose de rafraîchissant : elle s’est exprimée clairement, publiquement et avec précision. Son récent article, « Why I Cut Ties with Science’s Top Publisher », est un examen lucide de la manière dont l’un des éditeurs scientifiques les plus prestigieux au monde, Nature Portfolio, a dévié de la quête de la vérité vers la poursuite idéologique. Son texte n’est pas seulement courageux — il est cruellement nécessaire. Sur Watts Up With That (WUWT), nous soutenons depuis longtemps que, dès lors que les revues scientifiques commencent à accorder plus de valeur aux récits politiques qu’à la rigueur empirique, la finalité même de la publication scientifique est compromise. Dans une tribune succincte de type « nous vous l’avions bien dit », Krylov offre désormais un témoignage direct de première main illustrant exactement comment cette corruption se déploie en pratique.
Krylov retrace ses plus de trente années de publications, d’évaluations et de participation aux plus hauts niveaux de la science académique, en particulier au sein de la famille des revues Nature. Elle considérait autrefois y publier comme une étape professionnelle importante. Mais elle décrit un changement fondamental : des instructions éditoriales encourageant la « justice en matière de citations », des missions d’évaluation orientées par des objectifs démographiques, et des politiques éditoriales envisageant ouvertement de rejeter une recherche scientifiquement valable si le « préjudice » perçu dépasse le bénéfice de sa publication. Comme elle le note succinctement, choisir quelles études citer « en fonction de qui les a écrites plutôt que de ce qu’elles démontrent, ce n’est pas de la science — c’est de la propagande sous forme de notes de bas de page ». Cette phrase, à elle seule, résume un problème que des observateurs comme nous dénonçons depuis des années : le système d’évaluation par les pairs se plie de plus en plus à une performance idéologique plutôt qu’à une analyse objective.
Elle détaille également l’« engagement en faveur de la diversité » adopté par Nature Portfolio en 2019, qui demande explicitement aux éditeurs de rechercher « intentionnellement » des auteurs et des évaluateurs selon des catégories identitaires. Krylov raconte qu’elle a récemment reçu une demande d’évaluation d’un manuscrit technique et s’est demandé si elle avait été choisie pour son expertise ou pour ses « organes reproducteurs ». C’est une observation incisive, légèrement humoristique, mais profondément révélatrice. Une fois que les listes démographiques comptent davantage que la compétence, l’évaluation par les pairs cesse d’être un mécanisme de contrôle qualité pour devenir un système de quotas décoré d’un langage scientifique. Ce genre de déformation n’a pas été limité à la chimie ou à la psychologie ; ceux d’entre nous qui suivent le paysage des publications en climatologie ont été témoins de distorsions similaires depuis des années, souvent justifiées comme favorisant un « consensus » ou protégeant le public contre une « mauvaise interprétation ».
Particulièrement inquiétante est la tribune de Nature Human Behavior de 2022 qu’elle cite, affirmant qu’une recherche scientifiquement solide pouvait être rejetée si les éditeurs considéraient que ses « dommages » sociétaux potentiels étaient trop importants. Comme le souligne Krylov, les éditeurs n’ont aucune expertise particulière en sociologie, en politique ou en éthique ; leur compétence est censée résider dans l’évaluation de la qualité de la recherche. Pourtant, dès qu’un comité éditorial décide que sa mission inclut une forme de tutelle morale, la littérature devient un récit sélectionné plutôt qu’un compte rendu transparent de la recherche. Nous, à WUWT, avons répété à plusieurs reprises que ce militantisme éditorial — en particulier dans les revues de climatologie — crée une boucle de rétroaction amplifiant les conclusions favorisées et supprimant les résultats sceptiques ou gênants. Krylov a documenté simplement le même processus à l’œuvre dans une partie plus vaste de l’édition scientifique.
Son parcours confère à ses avertissements une gravité particulière. Ayant grandi en Union soviétique, elle comprend ce que deviennent les déclarations idéologiques « facultatives » dès lors qu’une institution signale que cette idéologie est une valeur centrale. Elle note que les déclarations de diversité « facultatives » de Nature ressemblent aux engagements politiques obligatoires qui caractérisaient la vie scientifique soviétique. Ce n’est pas de l’exagération. Quiconque a observé l’évolution des revues universitaires occidentales — en particulier les revues de climatologie — au cours de la dernière décennie peut reconnaître le schéma : ce qui commence comme un encouragement devient une norme, puis une exigence. Soudain, l’absence de langage politique convenu devient la preuve d’une déficience professionnelle.
Ce qui rend l’article de Krylov si irréfutable, c’est qu’il repose sur l’expérience, non sur l’abstraction. Elle n’attaque pas des individus en particulier et ne recourt pas aux grands discours théoriques. Elle décrit simplement comment des politiques qui paraissent bénignes en surface — équilibrage des citations, démarches démographiques, filtrage éditorial des « préjudices » — s’accumulent jusqu’à transformer la culture de la publication scientifique. Lorsque les revues décident que leur mission inclut la défense de priorités idéologiques, le scepticisme n’est plus bienvenu, la dissidence devient menaçante et la littérature commence à s’ossifier autour de thèmes préapprouvés. Sur WUWT, nous soutenons depuis longtemps que cette tendance explique pourquoi la climatologie est devenue si résistante à l’examen critique. Le témoignage de Krylov montre que le problème est désormais plus large et plus profondément enraciné qu’on ne le pensait.
Il apparaît que l’égarement de Nature est révélateur d’un système d’évaluation par les pairs qui a perdu sa voie et, ce faisant, son intégrité.
Vers la fin de son texte, Krylov souligne que restaurer l’intégrité scientifique ne peut se faire par décret politique. Même si les universités et les agences réduisent leurs initiatives DEI, la santé fondamentale de l’entreprise scientifique dépend des scientifiques eux-mêmes : ils doivent exiger l’objectivité, des normes universelles, la critique ouverte et la liberté de suivre les données où elles mènent. « Le pendule ne reviendra pas de lui-même ; nous devons le pousser », écrit-elle. Pour quiconque a observé les revues glisser régulièrement vers l’activisme idéologique, cette phrase sonne juste. Ces institutions ne se corrigeront pas spontanément. Elles ne réagiront que lorsque les scientifiques — et les lecteurs — refuseront de jouer le jeu.
Réflexion finale :
La décision de Krylov de rompre ses liens avec Nature Portfolio est un rare acte d’intégrité professionnelle, et son explication mérite d’être largement diffusée. Son article confirme ce que beaucoup au sein de la communauté scientifique murmurent en privé, mais hésitent à dire publiquement : les revues les plus influentes au monde ont commencé à privilégier le message plutôt que le mérite. Sur WUWT, nous soutenons depuis des années que les revues de climatologie évoluent dans cette direction ; Krylov montre désormais que cette tendance est systémique dans la science, et non isolée à la climatologie.
Au final, son texte est un rappel plein d’espoir que l’entreprise scientifique compte encore des défenseurs prêts à s’exprimer. Si la science doit rester un outil de compréhension du réel — plutôt qu’un moyen d’imposer un consensus politique — il faudra beaucoup plus de voix comme la sienne. Les revues ne peuvent dériver vers l’idéologie que lorsque la communauté scientifique le permet. Le moment où les chercheurs cessent d’accepter les filtres idéologiques comme prix d’entrée à la publication est celui où ces filtres commencent à perdre leur pouvoir.
Texte original publié le 14 novembre 2025 : https://wattsupwiththat.com/2025/11/14/a-scientists-stand-against-ideological-capture-review-of-why-i-cut-ties-with-sciences-top-publisher/