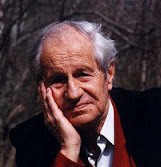(Revue Être. No 1. 1986. 14ème année)
Cette interview, publiée primitivement par la revue Tel Quel, faisait suite à la parution du premier livre de Stephen Jourdain, « Cette vie m’aime ». Les questions étaient posées par les collaborateurs de cette revue.
Pour commencer, je crois qu’on peut vous demander — tout le monde n’a pas lu votre livre « Cette vie m’aime », tout le monde ne l’a peut-être pas lu de la façon dont il aurait fallu le lire — de préciser pourquoi vous l’avez écrit, dans quel esprit, s’il existe une différence sensible entre le ton employé et ce que vous vouliez communiquer, s’il s’agit d’une entreprise de simple communication plus que de description de l’expérience dont vous parlez, et de nous parler justement de cette expérience.
Tout d’abord, si vous le voulez bien, je vais vous poser la question : Qu’est-ce que ce livre ?
« Cette vie m’aime » est une suite de courts textes décrivant différentes expériences que j’ai faites tout au long de ma vie, depuis ma petite enfance. Elles sont très diverses, par leur nature, et par le degré de leur intensité. Il y a la petite impression bizarre minuscule fêlure du niveau normal de conscience : il y a la lueur fugitive, il y a le coup de sonde, il y a une prise de conscience de soi qui domine tout le reste, qui le domine si absolument que lorsqu’elle se produisit, l’idée ne m’effleura pas qu’il pouvait exister une relation entre elle et ce que j’avais connu précédemment. Dans mon livre, je n’ai pas indiqué aussi nettement que j’aurais pu le faire qu’une telle distance existait entre cette prise de conscience et mes autres aventures, je n’ai pas dit en clair, que pour moi elle était l’unique sommet. Ceci est sûrement à l’origine de bon nombre de malentendus qui se sont produits à propos de ce livre.
Cette expérience cruciale, je l’ai faite à brûle-pourpoint quand j’avais seize ans.
C’était le soir, j’étais dans ma chambre, allongé dans l’obscurité, et je tournais et retournais dans ma tête depuis un long moment, probablement depuis une demi-heure, la petite phrase du Cogito de Descartes : « Je pense, donc je suis ». Il m’avait semblé, dans les jours précédents, entrevoir une prodigieuse vérité dans cette petite phrase, et j’essayais de retrouver cette vérité entrevue dans un éclair. Je réfléchissais depuis très longtemps, en me répétant inlassablement : « je pense, donc je suis », et en faisant chaque fois le voyage depuis la réalité vivante qui en moi-même correspondait à « je pense » et « je suis » jusqu’à ces mots, pour les charger, dans la petite phrase, de leur vrai sens. En m’efforçant de penser le Cogito avec ma vie. C’était un travail très difficile, j’étais épuisé, le déclic qui m’aurait révélé la signification mystérieuse et prodigieuse de la phrase ne se produisait pas, mais, à un certain moment, un autre déclic, que je n’attendais pas, dont je ne soupçonnais pas l’existence, a dû jouer, et, en une fraction de seconde, sans que j’aie l’impression d’une césure, dans la foulée, je me suis trouvé dans un arrière-plan impossible et tout à fait inconcevable de ce « je » qui pensait. L’entrée dans cet arrière-plan est l’expérience autour de laquelle gravite Cette Vie m’aime.
Je voudrais que vous tentiez de nous préciser les traits de cette expérience, et que vous nous disiez pourquoi vous la qualifiez de « cruciale ».
Pourquoi je la qualifie de « cruciale » ? Pourquoi est-elle « l’expérience », et non une expérience ? Je sais avoir alors touché l’existence dans sa plus grande profondeur, dans son fond absolu. J’ai trouvé dans cet instant l’évidence que j’étais parvenu là au-delà de quoi il n’y a rien où l’on puisse s’enfoncer, ne serait-ce que de l’épaisseur d’un cheveu. Lorsque j’emploie l’expression « expérience cruciale », je pense peut-être encore à un autre trait de ce jaillissement de conscience de soi, je pense peut-être au sentiment, à l’évidence que je ressens que cette conscience est le commencement, la première chose. Il ne s’agit bien sûr pas d’un commencement dans le temps. Cette précision donnée, j’avoue qu’aussi clair qu’il soit pour mon intuition, le sens ici du mot « commencement » demeure une énigme pour ma pensée.
Vous devez vous douter que ce genre de propos, aujourd’hui, dans la société où nous nous trouvons, provoque presque immédiatement une extrême méfiance et une extrême réticence. Il est évident que, sitôt que vous allez parler comme vous le faites de votre expérience, on va la classer sous des dénominations qui auront un très fort caractère péjoratif. Par exemple, on va lui mettre l’étiquette « spiritualisme ». Comment réagissez-vous à ce genre d’étiquetage ?
Depuis que je parle de ce qui m’est arrivé, j’ai eu rarement à faire autre chose qu’à détruire, à essayer de détruire les idées fausses que l’on se faisait de mon expérience.
D’abord, bien sûr, elle a été confondue avec une expérience religieuse. Il est possible qu’à une certaine époque le mot « religieux » ait eu un sens autre que celui dont il est maintenant chargé, je ne sais pas, mais aujourd’hui il est inadéquat à mon expérience, et même contraire à sa nature. Contraire, comment dirais-je ? Par sa saveur, mais aussi dans son sens : lorsque l’on pense à un Dieu, on conçoit — du moins je le suppose — une chose qui vous est extérieure, qu’il s’agisse d’un « vous », d’un « tu », ou d’un « il ». Or, cette « chose » est le contraire d’un « vous », d’un « tu » et d’un « il », elle se trouve juste dans la direction opposée. Elle est essentiellement la première personne. Ceci me paraît creuser définitivement le fossé entre l’expérience religieuse et mon expérience.
Maintenant, en ce qui concerne l’étiquette « spiritualisme » … Sans nul doute, c’est une expérience spirituelle, puisqu’elle est une expérience de l’esprit, puisqu’elle est l’éveil de la personne intérieure à elle-même, et la naissance de la personne intérieure. Puisque encore, elle est simplement cette expérience : « l’esprit ». Mais chaque fois qu’on me parle de « spirituel », il me semble discerner chez mon interlocuteur une sorte de dédain à l’égard de la personne physique, de mépris pour elle et pour le monde extérieur, pour l’être humain et le monde humain. Comme s’il fallait laisser là ces broutilles si l’on voulait aller vers l’Essentiel, traverser cette forme impure si l’on désirait atteindre l’aristocratique Vérité. Rien, absolument rien, en la chose qui a surgi en moi ne commence de fonder une telle attitude, — qui me paraît même le signe certain du fourvoiement.
Je voudrais retrouver un passage de votre livre dans lequel vous disiez qu’on ne pouvait qualifier le monde de « monde extérieur ». Vous venez d’affirmer que votre expérience n’est pas une expérience spiritualiste, ni une expérience religieuse, au sens courant de ces mots, et j’aimerais savoir si l’on ne vous a pas fait le reproche d’idéalisme. Vous dites, à un moment donné (j’ai retrouvé le passage) : « Si je me considère dans ma nature physique, bien sûr l’arbre m’est extérieur. Mais en tant qu’esprit, croyez-vous que cela ait un sens de dire : il m’est extérieur ? Croyez-vous que cela ait le moindre sens de dire : cette étendue, ce lieu sont extérieurs à cela qui d’aucune façon n’appartient à l’espace ?
Le monde dit « extérieur », dont ma personne physique fait partie, n’est pas extérieur à mon « âme », cela est certain. Il est dans mon « âme » (encore que ce « dans » ne soit pas vraiment satisfaisant). Si je ne disais que ça, l’on pourrait m’accuser d’idéalisme. Mais je dis aussi que le monde — l’arbre — est extérieur à ma personne physique, et je ne conteste pas la réalité de cette autre rive de moi-même. Je sais y être, mystérieusement, présent tout entier, absolument présent, comme je suis tout entier présent et absolument présent en la rive « esprit ». La seule différence, c’est que je suis cette dernière rive avant d’être l’autre, et que si de celle-là j’aperçois la rive « esprit », depuis la rive « esprit » toute autre rive — toute autre demeure de moi-même paraît impossible. En tant que je suis « mon âme », dans laquelle réside toute ma vie, tout le vivant de moi-même, le monde est en moi, en tant que je suis cette personne physique, dans laquelle réside tout le vivant de moi-même, le monde est hors de moi. Il faudrait préciser ce qu’est dans l’expérience, dans le vécu — qui est son seul pays — cette non-extériorité du monde à l’esprit. On s’attendrait à ce qu’elle produise une décoloration, une uniformisation, une dissolution du monde : il n’en est rien. Non seulement pour le moi qui respire le monde acquiert une densité, un relief, une présence, une réalité inimaginables, et sans aucun signe d’estompement de la diversité, mais pour « l’âme », pour la personne intérieure, c’est presque le phénomène contraire de l’uniformisation et de la dissolution qui se produit : une sorte de chape pâle, présente dans l’extérieur depuis si longtemps que l’on avait fini par oublier qu’elle recouvrait quelque chose, se déchire comme un songe, et le ruissellement oublié est là, l’eau dont une sorte de terrible maladie avait fait perdre tout souvenir, et jusqu’au souvenir d’avoir soif, et dont chaque moment, chaque goutte, chaque molécule — chaque paysage, chaque fraction du paysage, chaque fraction de chaque fraction du paysage — constitue, outre une merveille, une joie desquelles la notion avait également cessé d’habiter l’esprit, une chose éloignée de toutes les autres par un infini de différence, éloignée infiniment de toutes les autres par une différence dont on recouvre soudain le sens, et qui est en soi une merveille aussi aiguë que celle que recèlent les choses qu’elle sépare et fait exister. L’élément que l’esprit retrouve comme un amant amnésique le souvenir et la présence de l’amante, comme une personne en train de mourir d’asphyxie, l’oxygène et la vie. Dans les quelques passages de textes orientaux que j’ai lus, et dans les propos que m’ont tenus des gens qui connaissent bien ces textes, j’ai trouvé la trace de cette non-extériorité du monde à la conscience. Mais là, elle semble produire décoloration et dissolution, elle semble signifier que le monde extérieur est illusoire. Ceci est tout à fait contraire à mon expérience. Le monde extérieur n’est pas une illusion. Quand cette conscience jaillit, tout ce qui était mirage et mensonge brûle, et seul demeure « ce qui est vrai ». Le monde demeure. L’illusion, c’est cette sorte de double mental du monde dont je parlais, c’est le rejet du monde hors de l’esprit, meurtre des paysages et agression contre l’être intérieur commis par le souci de « réalisme ».
Je parle d’un moi-esprit et d’un moi-personne physique, et cette distinction n’est pas artificielle. Cependant, il n’est bien sûr qu’un unique et indivisible « moi ».
Je voudrais vous poser une question à propos de cette expérience et de la façon dont elle s’est déclenchée à l’occasion de votre lecture de Descartes. Elle s’est peut-être déclenchée avant… Vous en parlez comme d’un moment ou comme d’une suite de moments… Est-ce qu’elle est vécue constamment, ou est-ce qu’elle est vécue par surgissements ?
C’est une question tout à fait intéressante parce qu’elle va m’obliger à préciser la nature de cette expérience. Non, ce n’est pas un « moment ». Les expériences que j’avais faites auparavant étaient des états, des « moments ». Des états et des « moments » qui ne changeaient pas la nature même de celui qui les vivait. Qui affectaient un esprit dont le moyeu restait inchangé. Alors qu’avec cela qui a éclaté à l’improviste au cours de cette rumination de la phrase de Descartes, c’est le moyeu lui-même, c’est le centre lui-même qui est affecté. Ici, ce qui change, le siège de l’événement, est le centre, le sujet, la première personne. Le siège de l’événement, et l’événement lui-même. « JE ». Je parle d’un changement, et il s’agit d’un changement inouï, d’une inimaginable révolution, et en même temps il n’y a pas l’ombre d’un changement, et ceci provient de la nature de la chose qui apparaît, qui n’est pas un objet, mais la première personne, qui n’est pas non plus une chose parmi les autres choses de l’existence, mais l’existence elle-même, ou son axe, qui n’est point « quelque chose » au sens que l’on donne normalement à ces deux mots, qui existe, qui existe infiniment, mais laisse absolument intact, intouché, vierge, celui de qui elle bouleverse la vie.
Si j’ai bien compris, vous voulez dire que cet événement est en quelque sorte l’intelligence de ce que vous étiez, la compréhension et l’intelligence de votre rapport au monde ?
Cet événement est l’éveil de la personne intérieure à elle-même, l’éveil de l’esprit à lui-même, à son propre fait. Dans la vie intérieure normale, nous sommes tous persuadés —je l’étais non moins que les autres — que notre être intérieur est dans la pleine conscience de lui-même. Certes, nous convenons que nous pourrions parfaire cette lumière, peut-être indéfiniment. Mais nous entendons : de la façon dont on pourrait rendre plus clair un jour qui déjà s’est levé. Ce dont il nous est absolument impossible de douter, ce qui nous paraît assuré au-delà de toute interrogation, c’est que nous connaissions d’ores et déjà le jour, que nous soyons dans la vision authentique de notre être intérieur — quand bien même cette vision pourrait être aiguisée —, que nous connaissions la réalité de nous-mêmes. Mon expérience m’a appris que sur ces points, nous nous trompions, et que tout au long de la vie, alors que nous avons la conviction d’étreindre notre vrai moi, en réalité nous n’embrassons qu’un moi-postiche, qu’un carton-pâte qui usurpe notre identité.
Est-ce que vous ne croyez pas qu’il y a une ressemblance entre cette chose dont vous nous parlez, et certaines expériences qu’ont pu faire des philosophes et en particulier Descartes Ce n’est peut-être pas un hasard si votre expérience est partie du Cogito de Descartes ? Je me demande si elle ne se résout pas à une sorte d’évidence, d’évidence fondamentale à partir de laquelle une connaissance est rendue possible. En fait, ce que je dessine là est le grand souci des philosophes qui ont recherché une évidence première (il y a Descartes, il y a Husserl…), et qui, à partir de cette évidence, ont…
Je pense qu’en effet il peut très bien exister une parenté entre ce que Descartes touchait dans le Cogito et mon expérience. Il est certain que le Cogito est plus qu’une évidence intellectuelle, c’est une percée. Tout de même, je puis affirmer que l’expérience qui se cache derrière cette phrase n’est pas la mienne. Ne serait-ce que parce que celui qui a vécu mon expérience ne peut plus sérieusement faire œuvre de philosophe, et cela, bien qu’il estime détenir avec cette conscience l’unique point de départ possible de la pensée philosophique (!), et la seule chance de cette pensée. Certes, il est bien libre de tenter de bâtir un système ! — rien là qui soit une offense à son expérience — la véritable offense serait qu’il perde cette liberté. Mais celui qui s’est « éveillé », qui est devenu son moi central, son essence, a touché l’inconsistance fondamentale de la vie psychologique, de la pensée, de la vérité. Et si un jour il est conduit, probablement par la volonté de parvenir à rendre compte de ce qu’il a vécu, à bâtir une philosophie, il ne pourra perdre de vue une seule seconde que la plus haute vérité qu’il peut énoncer est privée de réalité, est exactement aussi irréelle et illusoire que la plus humble ou la plus frivole pensée . Cette particularité de mon expérience de constituer une percée au travers de la pensée, de la vérité, est, par ailleurs, l’un de ses traits essentiels.
Vous avez parlé tout à l’heure de l’activité de l’esprit qui est sûr de se saisir dans la conscience et qui ne saisit que du carton-pâte. Quant à moi, je ne peux laisser passer tout à fait cela. Moi aussi j’ai l’impression lorsque je me saisis consciemment que c’est du carton-pâte. Exactement comme vous, et c’est pour cela que j’écris. A ce moment-là, je quitte cet univers de carton-pâte et me trouve dans la relation réelle de l’esprit avec lui-même. Je crois qu’il y a d’autres expériences qui n’ont peut-être rien de commun avec la vôtre, mais qui ont autant qu’elle le pouvoir de restaurer cette relation et de faire tomber le carton-pâte.
Si je vous comprends bien, ce qui vous contrarie et que vous récusez, c’est la pure nature illusoire de ce qui est vécu hors de cette proximité absolue de soi-même. Peut-être vous paraît-il trop simple de rendre compte de tout ce qui se passe dans une tête en disant qu’il y a d’un côté la réalité, qui serait cette atteinte de la conscience par elle-même, et de l’autre, l’illusion, qui embrasserait tout ce qui peut proliférer hors de ce contact premier et fondamental. Il est possible que vous ayez raison, il est possible qu’il soit trop simple de voir les choses de cette façon. Tout de même, si je suis fidèle à mon expérience, si je viens résider là où je me trouve, si je viens me situer en ce lieu de réalité et de vérité, je ne puis que dire : telle qu’elle est vécue dans l’état habituel de conscience, la vie intérieure est une illusion — qu’affirmer : cette vie recèle une formidable mystification, elle est à tout moment susceptible de s’écrouler comme un château de cartes, elle est à la merci du hasard qui amènera le regard dans la direction du tour de passe-passe. Il y a un mirage de cette vie mentale en déroulement, il y a quelque chose qui va se détruire, s’évanouir pour n’avoir jamais existé.
Non … Ce que je veux dire exactement c’est que moi aussi je crois que cette vie de l’esprit qui semble essentielle aux gens est un château de cartes, et ce qui le fait tomber, pour moi, c’est le fait que j’écrive. Ce que je veux dire, c’est que deux expériences qui sont probablement très différentes et dont je ne vois pas les rapports, sont capables de détruire cette réalité. J’admets que la vôtre est capable de détruire cette espèce de château de cartes de l’esprit dont beaucoup se satisfont, mais simplement je lui retire le privilège d’être la seule à pouvoir le faire.
Ce qui m’empêche d’admettre que des expériences autres aient le pouvoir de démasquer et de réduire en cendre la masse entière des mirages présents dans la conscience, pour ne laisser subsister en cette dernière que « le vrai », c’est que je suis confronté avec la double évidence que ce pouvoir est la conséquence immédiate de la nature particulière de mon expérience, et que cette dernière a l’exclusivité absolue de sa nature. « L’éveil » est l’unique foyer où brûle la nature de « l’éveil », « l’éveil » est unique, et je retrouve avec une grande force le sentiment de cette qualité si je me reporte à ce trait de « l’éveil » de n’être pas un état, de n’être pas une expérience de l’âme, mais l’âme elle-même : une unique expérience peut prétendre à la caractéristique de n’en être pas une.
Je le répète, mon aventure n’est pas quelque chose que vivrait un sujet inchangé : elle est le sujet lui-même. C’est radicalement différent. Mais peut-être cette différence n’est-elle éprouvée comme radicale que par quelqu’un en qui cette « chose » a surgi.
Je voulais vous demander comment vous viviez votre expérience ?
Comment je la vis, comment elle s’inscrit dans la vie quotidienne ? Pour beaucoup de personnes s’intéressant à ce genre d’expérience, il semble qu’il existe, qu’il doive nécessairement exister une contradiction entre ce qu’ils nomment l’« expérience ultime » et la vie quotidienne. Moi je n’ai jamais entrevu, jamais même commencé d’entrevoir cette contradiction. Je n’ai jamais senti la moindre brouille entre le fait de jouer au billard, par exemple, ou le fait d’avoir une activité sexuelle quelconque, et la nécessité de vivre cette « chose ». La nature de cette « chose » exclut une telle contradiction, de la même façon qu’elle n’exige pour briller aucune sorte de sacrifice. Cette opinion que la contradiction existe pourrait provenir du fait que, n’ayant pas l’« ultime expérience », connaissant par ouï-dire ce moi mystérieux de qui elle est l’avènement, les gens se figurent qu’il a perdu la qualité humaine. Alors, tout naturellement, ils sont amenés à imaginer une contradiction entre la vie humaine, la vie quotidienne, et « l’éveil ». Comme je l’ai dit plusieurs fois à Philippe Sollers, cette personne que j’ai, au-dedans de moi-même atteinte, que je suis devenu en me devenant, n’est pas l’espèce de Grand Machin exsangue, le Grand Machin Impersonnel que j’ai si souvent rencontré au cours de conversations qui avaient pour sujet Cela (impersonnalité, anonymat, sont des mots qui ont une place dans une description de mon expérience, mais pas dans le sens que leur donne quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent la personne qui s’intéresse à l’« expérience ultime ») ; elle n’est pas non plus la naïve chauve-souris qui en ce moment prend son essor, parallèlement à l’idée que l’homme n’a peut-être pas dit son dernier mot avec l’homo sapiens. Non, elle n’est pas ces choses. Elle est « la personne humaine ». Et c’est peut-être cela, en vérité, le plus grand miracle présent dans cette expérience, la plus grande merveille : en atteignant à quelque chose qui dépassait l’homme que j’étais, je n’ai point trouvé une chauve-souris, je n’ai point trouvé une entité martienne ; j’ai trouvé, sur cette cime qui dominait inimaginablement l’homme, cette personne humaine que je venais de quitter, cristallisée, éclose, née. Ceci est un autre trait essentiel de mon expérience, et l’une des choses qui me feraient penser que l’expérience des orientaux n’est pas la mienne. Il est vrai que si j’ai beaucoup entendu, je n’ai que très peu lu, il est vrai aussi que l’expérience de l’Orient n’est peut-être pas celle des orientalistes.
A partir du moment où vous prenez conscience de vivre une prise de conscience, cette prise de conscience s’écroule.
Eh bien non, voyez-vous … D’être en train de vivre cette prise de conscience, l’ultime prise de conscience, est l’une des choses qui sont réfléchies à l’infini dans l’ultime prise de conscience. « Je » se sait infiniment, et sait infiniment qu’il se sait de cette façon-là, il a conscience infiniment d’être en train de se savoir infiniment, et de la signification de cette conscience infinie de lui-même, — d’être : vivant l’ultime approfondissement, touchant le fond absolu, connaissant l’achèvement de la vie. « L’éveil » — j’essaierai désormais de me limiter à ce terme quand je me référerai à mon expérience — n’est pas détruit par la conscience de ce qu’il est, cette conscience est naturellement présente en lui, elle est même l’une de ses composantes essentielles. « L’éveil » qui ne saurait pas qu’il est « l’éveil » ne serait pas « l’éveil ». D’autre part, vous avez parlé d’un écroulement de cette prise de conscience. Si cette « chose » était différente de la première personne, elle pourrait passer. Mais elle la première personne et ce fait, sans que je puisse très bien vous expliquer pourquoi, assure sa permanence. De plus, elle n’est pas quelque chose qui m’est donné et qui pourrait m’être retiré, elle est quelque chose que j’engendre, une flamme que je fais brûler, que je sais faire brûler. Dès que cette conscience, il y a seize années, a jailli en moi, je me suis trouvé sachant quel acte je devais accomplir pour qu’elle soit encore en moi, et accomplissant cet acte, librement. Cette conscience est ma perpétuelle création, elle est la perpétuelle créatrice d’elle-même. Qualité qui découle immédiatement de sa nature.
Je voudrais vous poser quelques questions pratiques qui vont peut-être, malheureusement, interrompre votre réflexion. Vous vous référez à une illumination, une révélation que vous avez eue à seize ans. Je voudrais d’abord savoir si vous avez essayé de comprendre les conditions objectives dans lesquelles s’est réalisée cette révélation ? Pour préciser ma question, avez-vous essayé de voir les rapports avec la psychologie, avec, par exemple, les recherches psychanalytiques ? Est-ce que l’érotisme, la vie sexuelle avaient une part dans votre révélation ? Ensuite, quant au résultat de cette révélation, vous dites : « je ne suis pas séparé du monde lorsque je suis dans cet état. Je vois toujours la partie de billard », n’est-ce pas. Bon. Mais lorsque vous donnez des exemples, quelque temps après, vous parlez de moments de la vie qui sont de pures consommations et qui ne sont absolument pas opératoires, ni dans le monde ni dans la société.
Enfin, la dernière question, également d’ordre pratique. Georges Bataille a essayé de donner une sorte de recette pour obtenir ce qu’il appelle l’« extase ». Or, vous, vous parlez de votre expérience, vous parlez de voies longues, de voies directes, vous parlez par métaphores, mais vous ne donnez pas de mode d’emploi pour arriver au but. On pourrait reprendre les questions une à une. D’abord la première, de façon que Jourdain l’ait présente à l’esprit pour répondre, car il ne peut totaliser ses réponses. La première question : Avez-vous essayé de définir les environnements de cette expérience faite à seize ans ? Avez-vous essayé de voir en quoi elle se distinguait de toute espèce de phénomène historique, psychique, etc. ?
Je n’ai jamais étudié ce contexte systématiquement, mais il est évident que j’ai été amené à regarder de ce côté. Je crois en effet que le contexte mental particulier de mon éveil a été important. Je ne pense pas que ce soit par hasard que cette conscience ait surgi alors que j’étais en train de me livrer à un travail intellectuel très défini, cette interminable empoignade avec le Cogito. Je vois deux parties dans le contexte. La première : des circonstances psychologiques précises, très éclairées et facilement analysables ; la deuxième : une sorte de fond beaucoup moins visible, et beaucoup plus difficilement nommable : l’état dans lequel se trouvait, à l’époque, ma vision du monde extérieur. Je vous ai indiqué sommairement les circonstances psychologiques qui ont dû faire jouer le déclic, qui ont dû m’amener dans le voisinage de ce déclic inconnu, qu’à un moment, par hasard, j’ai effleuré. Mais dans quel état se trouvait en ces jours-là ma vision du monde ? Tout d’abord, une chose est certaine : le monde dans lequel je vivais n’était pas celui de la vision ordinaire. Depuis deux années, cela avait commencé de « bouger » du côté de l’extérieur. Quelques mois avant, j’avais lu les poèmes de Rimbaud, et ils avaient précipité et rendu plus profonde l’altération, pour parvenir à un certain monde très défini. Faire l’analyse de ce monde serait trop long. Ce que je puis dire est qu’il était essentiellement dynamique. Un univers arc-bouté, tendu, jaillissant, un univers en acte un univers en marche, un univers qui fuyait comme un grand fleuve en crue. Ce monde particulier devait certainement beaucoup aux mots, au verbe. Je suppose qu’il est un moment, faste, dans la vie de chaque homme où certains mots, certaines grappes de mots, deviennent une sorte de lentille colorée au travers de laquelle il se met à voir l’univers, qui s’imprègne totalement de cette coloration. C’est ce qui s’est passé pour moi quand j’ai lu Rimbaud. Je suis incapable de dire comment les mots imprégnaient le monde, la nature de cette relation entre les mots et le monde. Il faudrait d’ailleurs, pour le dire, savoir ce qu’est un mot.
Vous n’avez pas essayé de contester de l’extérieur cette expérience ? Vous n’avez songé qu’à en profiter, vous n’avez pas essayé…
L’évidence présente dans cette expérience exclut toute contestation. Par ailleurs, pour entreprendre de contester une chose de l’extérieur, il faut croire à la réalité de cette extériorité, dans la réalité d’une position depuis laquelle la chose, qui apparaîtrait alors comme un objet, pourrait être observée et contestée. Or, l’une des natures essentielles de « l’éveil » est la connaissance du caractère illusoire de l’extériorité dans laquelle nous sentons notre personne intérieure (qui, je vous le rappelle, est une même chose que « l’éveil ») immergée au cours de la vie mentale habituelle, d’un « non-moi-esprit » qui en réalité est la création du moi-esprit et se trouve immergé en lui. D’ailleurs, quand bien même cesserais-je de savoir que tout cela qui se présente à moi comme existant par-delà les limites de mon intériorité est une hallucination, cette observation de « l’éveil » depuis l’extérieur continuerait à m’apparaître comme impossible : car « l’éveil » c’est aussi la connaissance du fait, très extraordinaire, que « la personne » n’est pas ce territoire double, physique et spirituel, présenté par l’expérience courante, mais une sorte de point, que toute son existence se trouve, en vérité, concentrée dans le point — dans la simple et insécable note du centre de l’esprit, de l’essence consciente : hors de quoi nous ne pouvons nous situer, et contempler, connaître, qu’en rêve — ce qui est très exactement la mésaventure qui nous arrive dans l’état habituel de conscience.
Je ne puis contester mon expérience de l’extérieur car elle me révèle le caractère illusoire du « moi » qui viendrait occuper une telle position.
De plus, une autre nature de « l’éveil », très voisine de celles que je viens de mentionner, est, elle, la connaissance que « la personne intérieure », unique résidence de la personne, est essentiellement le contraire de ce qui apparaît à la conscience comme un objet, comme étant extérieur à elle-même, est essentiellement le non-objet, le non-« ça » (ce qui revient à dire : la connaissance qu’il existe une pure première personne, et la perception d’un tel « je » comme constituant l’étincelle de ma vie, cela dont le palissement signifierait pour moi la mort). En entreprenant de contester de l’extérieur mon expérience, non seulement donc je verserais dans l’illusion mais, faisant la preuve que je suis capable de perdre de vue un moment la nature de « l’éveil », je ferais surgir la terrible possibilité d’oublier la valeur qui est en lui et qui me commande de me maintenir dans la conscience de sa nature, instrument de sa présence — l’éventualité de perdre « l’éveil » et de mourir.
Vous n’avez pas pu contester l’expérience. Mais vous n’avez songé qu’à en profiter. Avez-vous écrit à ce moment-là ?
Oui. Je voudrais trouver une façon de bien me faire comprendre. Je vais essayer d’expliquer pourquoi je n’ai pas contesté « l’éveil », en considérant une autre nature de « l’éveil », très voisine de celles auxquelles je viens de me référer. Je note en passant qu’une des choses qui rendent si difficile l’élucidation de mon expérience, est cette multiplicité de natures voisines, de natures-sœurs … Si vous voulez, une fois qu’on a reconnu que c’est dans un « ici spirituel » absolu que résident la vérité, la réalité de l’esprit, et le vif de sa propre vie, que de plus cet « ici », qui sans doute est aussi un « déjà », s’est révélé être la résidence de la valeur « divine », eh bien, l’on ne pourra plus se situer dans le « là » d’où « l’éveil » pourrait être aperçu de l’extérieur.
Ai-je écrit à ce moment-là ? Oui, j’essayais d’écrire un livre, mais dans ce livre je ne soufflais mot de ce qui venait de m’arriver. Au début, dans les premiers temps après mon expérience, je n’envisageais absolument pas d’écrire sur mon expérience. Parler de ce qui vivait en moi, écrire sur ce qui vivait en moi, il n’en était pas question. Je crois que ceci tenait d’abord à ce que, venant juste d’émerger de la vie intérieure habituelle, d’une part, et ayant la vision pleine et totale de la nature de cette « chose », d’autre part, j’estimais correctement la vanité d’une tentative de communication. « Communication » avec un petit « c ». Une autre explication est la perfection avec laquelle, à cette époque, je comprenais que cette « chose » ne fait pas partie de l’existence, n’est pas une page du livre de la destinée, qu’elle laisse rouler, absolument intact, le fleuve de toutes les choses, je dis : de toutes les choses. Je ne sentais guère la nécessité d’exprimer une chose qui n’était point dans la création. Il y avait aussi le sentiment, que j’ai toujours eu intensément, — même aux heures où le besoin d’écrire cette « chose » envahit douloureusement ma vie, — du caractère strictement personnel, privé, de mon expérience. Il y avait encore que, si j’étais convaincu de la possibilité d’identifier cette « chose », de l’arracher à l’ombre dans laquelle elle se tenait pour mon intelligence et de la formuler, cette identification me semblait à une hauteur infinie au-dessus de mes forces. Il y avait enfin ceci : je ressentais si profondément que la seule chose importante était de me maintenir dans « l’éveil », de ne pas « décrocher » de cet « ici » et de ce « déjà », de ce présent absolu et de cette vérité de l’esprit, que l’ambition d’exprimer « l’éveil » ne pouvait guère acquérir de consistance. D’ailleurs, si je ressentais « l’éveil » comme étant la prunelle unique de la vie, je le ressentais également comme étant l’unique résidence de la réalité (« donc le monde était une illusion ? », eh bien non, curieusement, absolument pas) : ce qui ôtait une deuxième fois à cette ambition, qui très clairement habitait sous un autre toit, la chance d’être prise au sérieux. Plus tard, bien plus tard, elle a commencé de se développer, mais ceci n’a pu se produire que parce que « l’éveil » vacillait en moi.
(à suivre)
Une unique expérience par Stephen Jourdain
(Revue Être. No 2. 1986. 14ème année)
(Suite et fin)
Ma seconde question était : en quoi cette expérience s’étend-elle à votre vie entière ?
Cette expérience est présente dans toutes les circonstances de ma vie, parce qu’il n’est point de circonstance de la vie qui n’implique cette intuition mystérieuse, cet axe : « moi », et qu’elle-même est exactement cela, « moi ». Si elle était un état, elle pourrait obliger à des sacrifices, exiger certaines conduites. Mais elle n’est pas un état : elle est « moi ». Si le sens de votre question est : votre expérience atteint-elle tous les compartiments de votre vie ?, je vous fais la même réponse. Je disais que toutes les circonstances d’une vie pointent exactement de la même façon vers cette expérience, et qu’aucune circonstance particulière n’a le privilège de lui être nécessaire. Si vous me demandez : est-ce que cette « chose » fait l’unité de votre vie ? votre vie gravite-t-elle tout entière autour d’elle ? Je vous dirai ceci : La circonstance constituée par l’entreprise d’imprégner « d’éveil » toutes les directions de ma vie, et par l’intensité de cette entreprise, pointe vers « l’éveil », mais elle ne lui est sûrement pas nécessaire. Ce qui est vrai, c’est que dans les premières années de la vie éveillée cette omniprésence, passionnément construite et entretenue, de « l’éveil » dans l’aventure humaine, cette affirmation brute, directe, de sa présence au commencement, à la fin, et au milieu de toute activité, cet avènement bizarre sous la peau multiple de la vie d’un monolithe « d’éveil », sont le moyen de lutter contre certains facteurs corrodants, et la voie naturelle vers le règne absolu de « l’éveil ». Cela est très difficile à exprimer, très difficile à appréhender, et ce que je viens de dire n’est qu’une approximation. Aujourd’hui, je n’ai plus besoin de m’appuyer sur ce monolithe.
On en arrive à la dernière question. Georges Bataille a essayé d’écrire une sorte de technique de l’extase. Est-ce que vous-même avez des moyens précis de l’obtenir ?
Je crois que de tels moyens existent. Je crois aussi que le plus grand problème n’est pas de les élaborer. Le plus grand problème est, étant donnée leur apparente monumentale stupidité, de convaincre un autre, déborderait-il de bonne volonté, de les essayer. Comme par un fait exprès, les chemins conduisant à cette « chose » — ou, plus justement, dans le voisinage de son déclic, ont triste allure. Mais doit-on s’étonner de ceci ? Doit-on trouver étonnant que les passes du bien suprême ne disent pas ce qu’elles sont ? Si elles l’avouaient, il y aurait beau temps que chacun les aurait empruntées, et que tout le monde posséderait « l’éveil ». Il faut s’attendre à ce que le vrai chemin ait un air décevant ou même franchement rebutant. Il faut s’attendre à devoir faire des choses stériles, ridicules, sans intérêt, il faut s’attendre à devoir marcher dans le sens contraire de son désir et de son idée, il faudrait presque se demander : quelle est la direction qui ne me dit vraiment rien, qui a le moins l’air d’être une direction ? Et aussitôt emboîter le pas.
Je vous demande un exemple.
Je vais vous en donner un. Je vais essayer. Je crois qu’il n’est pas de projet plus déplaisant pour la conscience humaine que celui de se confronter avec sa solitude fondamentale. Plusieurs fois, j’ai engagé des gens à rejoindre, exhumer de la profondeur de leur non-conscience d’eux-mêmes, le fait de cette solitude. Cela n’a jamais rien donné. Je me l’explique très bien : pour presque tout le monde, une telle prise de conscience équivaudrait à regarder dans les yeux le néant de soi-même. Je dois dire que si j’étais catholique et croyais au diable, je verrais assez bien la présence diabolique dans le fait que la voie qui mène à « Dieu » porte un masque aussi terrifiant. Évidemment, je peux dire aux gens : La solitude dont je vous parle n’est pas l’effroyable isolement auquel vous pensez, l’agonie de l’être intérieur découvrant, touchant, dans l’agencement de sa propre nature, l’évidence monstrueuse que rien, jamais, venant d’un autre, venant de l’Autre, ne parviendra jusqu’à lui, rien, ni sourire, ni chaleur, ni parole, ni regard, autrement que pendant un mirage. Elle est le foudroiement, puis le silence d’un petit songe que nous filons tout au long de la vie intérieure habituelle, et sur quoi se fonde cette construction énorme, dans lequel notre esprit éprouve le sentiment d’être en compagnie, s’éprouve peuplé par une compagnie, et sous le regard d’un spectateur, vu, su par un tiers : et ce songe-là, ce songe de l’Autre, rupture de la conscience, agression contre le vif de soi, est l’illusion qui nous empêche de jouir, dans la réalité, l’indivisibilité et l’intimité de nous-même, du contact direct avec l’Autre, ou du moins d’une complétude, d’une universalité, d’une objectivité semblables à celles qu’apporterait ce contact. » Je peux dire ceci aux gens, et je ne me fais pas faute de le dire. Mais lorsque je tiens ce discours, je vois sur le visage de mon interlocuteur succéder à l’effroi la compréhension, la compréhension de la cause des propos bizarres que je lui tenais avec cette bizarre passion : il a affaire à un fou.
Vous avez longuement parlé, tout à l’heure, du fait que cette expérience était liée au langage, et je me demandais dans quelle mesure, d’une part, vous pensez que cette expérience est communicable, et, d’autre part, dans quelle mesure la nature de cette expérience vous semble liée à la nature du langage.
Dans quelle mesure je crois que cette expérience est communicable ? Si vous le permettez, je vais répondre comme si vous aviez dit : exprimable. Est-elle pour moi exprimable, ou ne l’est-elle pas ? Chez les personnes que j’ai rencontrées qui s’intéressaient à « l’expérience », l’opinion de très loin la plus répandue se trouve être qu’elle est l’Inexprimable. Je crois que c’est vrai, moins la majuscule qui est une offense à l’humour de « l’éveil », je crois qu’ils ont raison, mais une fois encore je pense qu’ils n’ont pas raison pour les raisons qu’ils invoquent, qu’ils n’ont pas raison pour les bonnes raisons. Leurs raisons, c’est que l’outil de l’intelligence est impropre à concevoir cette « chose », que l’outil du langage est impropre à la formuler. Impropres et dérisoires. Moi, je ne sens pas ça du tout. Pour moi, cette « chose » est inexprimable non parce que les moyens de l’exprimer manquent, mais parce que la personne qui pourrait mettre en œuvre ces moyens, le sujet de la volonté et de la pensée de l’entreprise d’exprimer « l’éveil », n’est point née et ne naîtra jamais — ailleurs qu’en un songe. Non parce que les bras manquent, ou parce que le désir de les remuer fait défaut, mais parce qu’il n’y a jamais eu personne. En vous parlant, j’essayais de revivre, en me reportant à la réalité vivante, ce qui est pour moi une vieille vérité, et n’y parvenais pas : ce qui m’emplit toujours de panique. Je dis que cette « chose » est inexprimable, encore parce que je la ressens, intensément, comme étant à l’arrière, en amont de toutes les entreprises possibles de l’esprit, de tous ses vécus possibles, qu’elle engendre et qui s’inscrivent en elle, et qui ne peuvent prétendre venir jamais la dominer, commencer de couler vers elle, commencer de s’adresser à elle, commencer de la toucher…
« Cette « chose » est-elle exprimable ? » Si ma réponse est de niveau avec la « chose » —c’est-à-dire de niveau avec la réalité —, c’est : non. Mais si j’accepte de me situer au niveau de la pensée (et pourquoi n’accepterais-je pas ? Ce niveau est illusoire, c’est vrai, c’est même une vérité très importante, et puisée dans la texture de « l’éveil ». Mais, je vous l’ai dit, « l’éveil » est en amont… en amont… au-delà… au-delà…, il est, dans la direction du cœur de soi-même, au-delà de toutes choses, au-delà de toutes les notions, de toutes les actions, de tous les vécus, de toutes les vérités, au-delà et différent, il est l’infiniment au-delà pour qui tout paysage spirituel, serait-ce celui de la plus haute des vérités le concernant, sonne comme pour vous ce groupe détestable près duquel vous attendez l’autobus, et dans lequel vous êtes certain que moi, qui ne vous connaissais et qui vous regarde, je vous inclus. Il est l’infiniment-au-delà : l’infiniment-libre : l’infiniment-vivant : l’infiniment-jeune et neuf, prédateur d’états civils et de vérités philosophiques) — si j’accepte de me situer au niveau de ma pensée, cette « chose » va me paraître parfaitement exprimable, je vais éprouver puissamment le sentiment qu’il est possible de l’exprimer. Depuis le premier moment, ce sentiment m’a habité. C’est une évidence : la pensée et le langage sont adéquats à cette réalité. Et aujourd’hui je sais que ce que je sens si fortement depuis toujours est bien vrai, et non un mirage comme quinze années d’échecs auraient pu me le faire croire : à trois ou quatre reprises, au cours des dernières années, en trois ou quatre notations, je suis parvenu à « mettre dans le mille », à dire parfaitement « l’éveil »… Donc, pas de précipice infranchissable entre cette « chose » et le langage, absolument rien de tel.
Maintenant, la deuxième partie de votre question. La relation que je vois entre « l’éveil » et le verbe… Le verbe est, je crois, le souci dominant de toutes les personnes présentes ici. Moi aussi je m’intéresse à lui. La raison de cet intérêt est que chaque fois que j’ai essayé de faire mordre ma pensée sur cette « chose » — et cela quelles que soient les dents mentales particulières avec lesquelles j’essayais d’étreindre, ou la nature particulière de cette réalité sur laquelle j’essayais de projeter la lumière —, je me suis buté dans le verbe, ou dans quelque chose que je pouvais rattacher immédiatement à lui. Voici un exemple. Je prends une situation précise : Mon esprit est en train d’accomplir l’acte par lequel il se donne « l’éveil », par lequel il se voit infiniment, la racine consciente de moi-même, une nouvelle fois (une nouvelle première fois : il est toujours la même heure à l’horloge du vrai « moi »), retourne en elle-même, se devient, s’existe. En cette fois particulière, l’entrée en moi-même a eu pour conséquence d’embraser le monde extérieur, de le mettre au diapason de la merveille présente en cette habitation de soi par soi. — Alors, qu’est-ce que c’est, cette transfiguration ? Que s’est-il passé dans le monde ? Car il s’est passé quelque chose de tout à fait précis, et, j’en ai toujours eu le sentiment, de tout à fait nommable. Je crois que le changement réside essentiellement en ceci : dès l’instant où je « m’éveille », le paysage contemplé, quel qu’il soit — cette pièce… un bois… une plage… une crête contre un certain ciel… un fragment de façade… — brusquement se résout en une chose « une » en quelque chose qui ressemble, par sa nature, à une physionomie ou peut-être une mélodie. Auparavant, je voyais des traits, auparavant j’entendais des notes, et brusquement ces traits commencent de former une physionomie, ces notes, de produire une mélodie, quelque chose d’indivisiblement « un » qui concerne directement mon essence et la fait émerger en moi comme le retour de l’endroit ou de l’envers d’une chose ferait émerger l’autre face, devant quoi j’éprouve une émotion peut-être comparable à ce qu’on pourrait ressentir si l’on se trouvait soudain, après des siècles d’amnésie, face à un parent passionnément aimé et que l’on reconnaîtrait.
J’ai employé aussi, pour essayer de décrire ce type de réalité qui surgit dans l’extérieur lorsque mon essence consciente surgit en elle-même, le mot « essence ». Je me mets à voir des physionomies, des mélodies, des « essences ». En général, je suis en train de marcher, et chaque pas fait jaillir autour de moi de nouvelles choses « unes », de nouvelles physionomies. Ce qui est très frappant, quand on vit cette aventure, c’est la présence d’un sens dans le monde. Il y a chaque fois une découverte que je refais avec une stupeur qui ne s’est jamais émoussée, chaque fois un cri que je pousse : « ça signifie ! ça a un sens ! ». Je ne sais pas très bien ce que j’entends par là. Mais ce dont je suis absolument sûr, c’est qu’une réalité est à la source de ces deux affirmations. — Sont-elles synonymes, ou bien se réfèrent-elles à deux faits distincts ? je crois qu’il y a deux faits, indissociables, siamois, mais tout de même deux choses. D’abord : « ça a un sens ! ». Est-ce la découverte que le paysage contemplé, dans sa vérité qui vient d’émerger, s’articule à un contexte, participe d’une structure ? qu’il est le trait d’un visage ? la phrase d’un texte ? Est-ce la soudaine expérience d’un sel dans le paysage jusqu’alors sans vie ? Est-ce le dévoilement d’une raison d’être de ce que je vois ?… Je ne sais si je parviendrai jamais à identifier cet « eurêka ». Ensuite : « ça signifie ! ». je suis face à des significations (je pense que ces « significations » sont une même chose que les choses « unes », les essences dont je parlais, ou une certaine face de ces essences). — Je crois que je veux dire que ce que j’ai sous le regard est un texte, qu’il y a là quelque chose d’inscrit, qui est transparent à mon intuition et que ma pensée pourrait peut-être déchiffrer. C’est justement la question que je me pose à propos de ce texte : est-il déchiffrable, formulable, ou bien appartient-il à une profondeur du réel où il y a du sens, où il y a des sens particuliers, où « cela veut dire », mais où la question si naturelle : « qu’est-ce que cela veut dire ? » n’a plus… de sens.
Je crois que je fais une autre découverte, qui est, ou qui serait que ces choses « unes », ces essences parlent. Énième visage de la « félicité » de ces moments. De cette façon encore je retrouve le verbe. D’abord un texte, ensuite des paroles, un discours. Quelles paroles ? Même question que pour le « texte », et même réponse.
Ce qui est curieux, c’est que votre expérience telle que vous venez de la décrire se situe exactement dans le sein du langage, d’un côté les signes et de l’autre le langage.
Dans tous les propos que l’on a tenus devant moi sur les grandes expériences religieuses d’Occident et sur l’expérience qui serait à la base de la spiritualité orientale, et dans ce que j’ai pu lire sur ces mêmes sujets, je n’ai jamais trouvé trace de deux choses : d’abord, de cette naissance de l’individu qui définit mon expérience. Ensuite, de la présence du verbe.
Un autre renseignement que je puis vous apporter à propos de cette présence — de cette omniprésence du verbe dans mon expérience, est ceci : Nous avons rencontré un texte mystérieux, nous avons rencontré un discours mystérieux, il restait peut-être à retrouver une autre nature du verbe, un autre des grands personnages du langage : la voix. Je me réfère à des expériences que j’ai faites dans ma petite enfance. Ce sont des choses très subtiles qui ont à peine affleuré ma conscience pendant que je les vivais. (Qui n’ont jamais croisé ma pensée : voilà comment de tels ors disparaissent sans qu’on s’en aperçoive.) Quand je m’endormais, j’avais au-dessus de moi, au-dessus de mon esprit, et comme penchée sur lui, une sorte d’immense chape de sable, et cette chape était une voix, et chaque grain de la chape était une voix. C’était un sable qui était en feu, qui était comme des braises, et les pulsations innombrables de cette braise étaient la voix de quelqu’un qui me parlait, disant toujours la même chose.
Un fait très remarquable est que ces « textes », ces paroles sans visage, ces voix apparaissent alors que la création tout entière vient de subir l’épreuve du feu, alors que tout ce qui était illusion s’est avéré tel et que seul subsiste ce qui est. Lorsque tous les mirages ont été dissipés, lorsque tout ce qui était cire a fondu, lorsque tout ce qui pouvait être arrache l’a été et que le roc partout est atteint — le langage est là. Lorsque, venant envisager l’univers depuis l’endroit où je me tiens, je puis dire que je contemple le réel, —je déchiffre des textes, il y a des poudroiements qui sont une parole, il y a des qualités, denses comme la saveur du sel, qui semblent être sœurs du mot. Ceci est tout de même très frappant.
Le rêve est un discours déchiffrable. Mais qui se présente comme anarchique, qui se présente comme bizarre. Je voudrais savoir si, dans ce que vous décrivez, dans ce brusque surgissement des signes et des significations, cette anarchie est présente ?
Absolument pas. Pas plus dans le monde éclairé par « l’éveil » que dans « l’éveil » lui-même. Mais je dois dire que je n’ai jamais non plus éprouvé le sentiment d’un ordre. J’ai l’impression que les concepts d’ordre et de désordre sont inadéquats à cette réalité.
Je voudrais que vous nous disiez dans quel état vous croyez qu’à ce moment-là se trouve la pensée ?
Ah là, il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire. On en revient à la question que vous me posiez tout à l’heure. Vous me demandiez, je crois, de parler d’un événement que j’ai souvent évoqué dans nos conversations, sous le nom de « anéantissement de la pensée. »
S’il y a anéantissement de la pensée, il me semble paradoxal qu’il puisse y avoir ce foisonnement de significations.
Il me faudrait préciser ce que j’entends par « pensée » lorsque je dis que la pensée s’abîme et retourne dans le néant. C’est très difficile.
Essayez. D’abord, qu’est-ce que la pensée selon vous ? Et puis, dans quel état se trouve la pensée dans ce que vous appelez « l’éveil » ?
Ce qu’est la pensée ? en réalité, je suis comme vous : je n’en sais rien. L’acte de penser, dans sa nature, demeure pour ma pensée quelque chose d’essentiellement mystérieux. Par contre, ce dont je suis certain est que lorsque je pense, j’agis. C’est en tant qu’elle est une action que la pensée succombe, c’est en tant qu’elle est une sorte d’étirement absurde de la conscience dans le temps, au long des grains du temps, qu’elle périt. Mais dans sa partie la plus profonde, dans le sens le plus profond qu’on lui donne, qui est : comprendre, non seulement elle ne meurt pas, mais brusquement elle va s’exalter infiniment. Au moment où la reptation intérieure, où la quête mentale vont succomber, où la pensée telle que nous la connaissons va succomber, jamais je n’aurai fait autant l’expérience de comprendre. Un des noms essentiels de « l’éveil » est : « intelligence ». Mais ici l’on bute sur la même difficulté que tout à l’heure, à propos du texte qui affleure dans le paysage et des paroles que prononcent les grains de l’arche en béton entrée en effervescence. — Quel texte ? Quelles paroles ? Intelligence de quoi ? Est-ce que je puis arriver à préciser la chose qui est comprise, ou bien est-ce que je suis parvenu à un degré de profondeur du réel auquel la question ne se pose plus ?
Un autre visage de cette mort de la pensée est quelque chose comme : oubli. Un oubli colossal, un oubli plus vaste et plus profond que les galaxies. Un oubli qui ronge, dévore la pensée et le savoir depuis leurs frondaisons jusqu’à leur racine, qui dévore le savoir dans toutes ses renaissances successives, jusqu’à la couche profonde où se lève l’écho de cette destruction, et dépasse cette couche, qui s’oublie et se dépasse lui-même, poussant vers l’amont sa nuit fabuleuse où commence de poindre le souvenir d’une vérité de soi-même inexplicablement désertée, atteignant, révélant, détruisant d’infects enveloppements, d’infectes réductions, hôtes du premier plan normalement invisible de la conscience, débusquant le « mal » dans le constat même qui en est fait, et volatilisant encore ce songe, pour livrer à l’être intérieur cette vérité de lui-même. Conscience. Bizarre, n’est-ce pas ? La conscience brûle au fond de l’amnésie. Je voudrais essayer de vous donner une image précise de cet oubli. J’ai oublié mon nom, mon âge, le visage de mon présent, mon histoire. J’ai oublié, activement, l’existence d’un passé et d’un avenir, j’ai oublié la notion de temps comme on quitterait le linge souillé d’un autre, comme l’on met un coup de sabre entre soi et la corruption, entre soi et un vieillissement honteux, comme l’on désobéit, comme l’on va vers l’enfance. J’ai oublié qu’il existait des choses telles que le Monde et l’Esprit, telles que l’Être et le Néant, j’ai oublié la pensée, j’ai oublié la notion d’existence personnelle, j’ai traversé les cendres de la notion d’impersonnalité, j’ai traversé les cendres de la pensée de ces cendres. Plusieurs fois j’ai rencontré la notion « d’éveil », et j’ai oublié « l’éveil », cet ultime et subtil mirage, cette ultime et subtile aliénation, avec une violence particulière…
Ce qui ressort de tout ce que vous venez de nous dire, c’est que votre expérience est une consommation, voire une consumation.
Je ne comprends pas très bien…
Je veux dire qu’elle est absolument improductive. Je veux dire qu’elle est une chose qui tourne sur elle-même et qui n’a pour sujet qu’elle-même, et qui s’abîme et s’épuise en elle-même, c’est-à-dire qui se dirige tout droit vers la mort.
Ce n’est absolument pas ça. Elle ne s’épuise pas en elle-même : elle ne cesse de se créer. Je ne la vois orientée vers aucune sorte de destruction. Je vois en elle un « plus » absolu.
Vous parlez d’anéantissement de la pensée. Ce n’est pas un « plus », c’est la fin.
Lorsque vous émergez du rêve, le matin, est-ce que vous avez vraiment l’impression d’une fin ? Moi, j’ai celle d’un commencement. En effet, il y a une fin dans « l’éveil », mais c’est la fin de ce qui n’a jamais existé, et le commencement de la réalité. Ce que vous dites me cabre, mais m’intéresse aussi, parce que j’y reconnais une tendance, une erreur que j’ai rencontrées fréquemment chez des gens intelligents et profonds qui s’intéressaient à « l’éveil ». Pour eux, « l’éveil » équivaut à une sorte de dissolution, d’extinction. Moi, je ne vois pas du tout cela. J’ai connu, avant « l’éveil », certaines expériences qui suggéraient puissamment que la « vérité » était au terme d’une dissolution de l’existence personnelle. Dissolution-impersonnalité-vacuité-néant. Ces expériences ont un niveau très élevé, il est possible que le divin s’y reflète, elles sont une pente sur laquelle il faut se laisser glisser, à condition que l’on soit mû par une soif naturelle, et non par l’idée apprise que tel est le chemin. Mais elles ne sont pas l’expérience ultime, qui les domine d’aussi haut qu’elle domine tous les autres vécus, et leur caractère de profondeur lui-même est un piège pour celui qui cherche, et risque de s’arrêter ici, croyant avoir atteint le but.
Pourtant, il est vrai qu’une négation existe dans « l’éveil ». Il y a en lui, au moins à un moment de la vie éveillée, la négation, le meurtre passionné de tout ce qui n’est pas « l’éveil », « l’éveil » posé, d’avant la raison, directement, comme étant l’unique réalité — « l’Unique ». Cet arbre n’existe pas ! ces murs, ce ciel, cette rue n’existent pas ! ce corps n’existe pas ! tout cela n’existe pas ! cette pensée n’existe pas ! … Seulement, je ne suis pas sûr que ce qui est détruit, sabré, soit la chose elle-même, je me demande si ce n’est pas plutôt quelque chose comme la notion de la chose. De toute façon, il y a une destruction de dimension universelle. Mais si cette destruction, ce « moins » est dans « l’éveil », il n’est pas le tout de « l’éveil », et s’il est vrai qu’il rayonne un « paradis » particulier, je crois qu’il est surtout le serviteur du reste de « l’éveil », des éléments positifs : existence, densité et présence infinies de « moi », félicité, pureté de ce qui se trouve en amont de toute identité.
L’on peut dire qu’il y a dans « l’éveil » une autre négation. Elle est un visage que prend, à un moment de la vie éveillée, un acte qui est dicté directement par l’essence de « l’éveil ». Comment décrire cet acte ? Je le nomme pour moi-même : « je ne suis pas ça ». Si j’additionnais les heures que j’ai consacrées à rechercher ce qu’il y a sous ces mots, le total dépasserait sûrement l’année. Une fois encore, je vais recourir à une image. Imaginons que l’infini numérique existe réellement, qu’il soit une personne. Il est en proie à un rêve dans lequel il se vit comme étant le nombre 1. Mais il a le souvenir de sa vraie nature et de la pureté qui est en elle, il veut passionnément les retrouver. Il commence par dire : « je ne suis pas 1 ! ». Aussitôt, cette action elle-même devient un deuxième nombre, le nombre 2 par exemple, qui va chercher à son tour à faire choir l’infini dans sa finitude particulière : « je ne suis pas 2 ! ». Puis, le rejet de l’étreinte de 2 devenant l’étreinte —l’imposture du nombre 3 : « je ne suis pas 3 ! », et, de la même façon : « je ne suis pas 4 ! »… « je ne suis pas 100 000 ! »… « je ne suis pas 1 000 000 000 ! »… « je ne suis pas… ! ». On peut prendre une autre image. Imaginons qu’il s’agisse de l’univers infini. Il commence par dire : « je ne suis pas le soleil ! ». Puis tout de suite ce rejet devient réduction au système solaire : « je ne suis pas le système solaire ! »… « je ne suis pas cet amas stellaire ! »… « je ne suis pas la galaxie ! »… « je ne suis pas ce groupe de nébuleuses ! »… « je ne suis pas… ! ».
Dans la réalité, qu’est-ce que cette chose que je ne suis pas ? quelle est cette chose qui prétend être moi, qui met autour de moi un cercle, un cerne intolérable, contre nature ? quelle est cette chose que, par un acte de conscience dont seul me semble capable ce que je nomme « l’éveil », je vais aller exhumer, pour m’en dissocier, de l’ombre centrale de mon esprit, là où réside son présent immédiat, là où s’écrit ma pensée vivante ?…