Il y a trente ans, dans une librairie, j’ai acheté une brochure contenant les conférences données par Jean Klein en 1989. J’ai dû être suffisamment intriguée pour l’acheter à ce moment-là, mais le livret est resté sur une étagère pendant des décennies. Je ne l’ai repris en main qu’il y a seulement deux ans, et il est devenu ma lecture matinale.
Il existe de nombreux livres magnifiques et inspirants, mais j’ai rarement eu l’occasion de lire un ouvrage qui contournait mon esprit rationnel pour atteindre un niveau plus mystérieux. Plus tard, j’ai lu le conseil de Klein de ne pas essayer de s’accrocher aux mots, mais plutôt de laisser l’écriture se dissoudre à l’intérieur.
En tant que psychologue, j’ai réfléchi à la signification de la personnalité et de l’ego. Sur le plan psychologique, nos schémas de pensée et de comportement, souvent établis très tôt dans la vie, se renforcent avec le temps. Les êtres humains sont des créatures d’habitudes, prévisibles et obstinées, et ces habitudes s’étendent aux interactions avec les autres et aux schémas de pensée et de sentiment. Notre personnalité nécessite de l’énergie pour se maintenir et encore plus pour changer. Notre ego est une défense de l’image que nous avons de nous-mêmes dans le monde, il nous aide à naviguer dans les stress de la vie et à protéger notre image de nous-mêmes. Ce que nous appelons un ego fort se manifeste dans la résilience d’une personne et dans sa confiance en ses convictions de ce qui est juste et bon.
Pourtant, de nombreux textes spirituels renoncent à la primauté de l’ego et de la personnalité. L’ego obscurcit notre compréhension de notre vraie nature et nous oriente vers la survie du corps et de la personnalité. Dans le langage du yoga, l’ego crée l’avidya : la confusion sur qui nous sommes vraiment. Nous sommes trompés et piégés dans l’idée que nous sommes des créatures d’habitudes qui ont besoin d’être protégées, cultivées et caressées. L’enseignant spirituel Eckhart Tolle l’a bien dit : « Toute la misère sur la planète provient d’un sentiment personnalisé du moi ou du nous. Cela masque l’essence de qui vous êtes. Lorsque vous n’êtes pas conscient de cette essence intérieure, vous finissez toujours par créer de la misère. C’est aussi simple que cela » (Tolle, 52).
Si nous voyons la vérité dans cette caractérisation, comment pouvons-nous nous libérer de ce piège ? Il est impossible de penser pour sortir de la confusion, car la pensée elle-même est au cœur du problème. Les dialogues de Klein tranchent dans ce dilemme. Les habitudes de la personnalité sont des contractions du corps-esprit, une « défense contre le fait de n’être personne » (Klein, Transmission, xxvi).
L’influence de l’Advaita Vedanta imprègne l’œuvre de Klein, et de nombreuses vérités fondamentales de l’Advaita ont trouvé leur place dans la théosophie. Cet article met en lumière certains de ses enseignements en utilisant ses expressions et ses thèmes, notamment la Présence, la pensée, l’orientation sujet-objet et l’intégration par le travail corporel.
Jean Klein
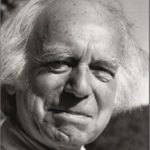 La biographie personnelle de Klein est succincte. Médecin européen né vers 1912, il avait un esprit vif, parlait au moins quatre langues et joua du violon toute sa vie. Il a lu René Guénon, Krishnamurti et Sri Aurobindo et a été initié très tôt à la théosophie. Sa quête spirituelle l’a conduit en Inde dans les années 1950, où un enseignant le guida dans la compréhension de l’Advaita Vedanta, la tradition non duelle de Sri Ramana Maharshi. Il décéda en 1998.
La biographie personnelle de Klein est succincte. Médecin européen né vers 1912, il avait un esprit vif, parlait au moins quatre langues et joua du violon toute sa vie. Il a lu René Guénon, Krishnamurti et Sri Aurobindo et a été initié très tôt à la théosophie. Sa quête spirituelle l’a conduit en Inde dans les années 1950, où un enseignant le guida dans la compréhension de l’Advaita Vedanta, la tradition non duelle de Sri Ramana Maharshi. Il décéda en 1998.
Selon Klein, l’Advaita n’est ni une religion ni une philosophie, mais simplement la vérité. Après avoir quitté l’Inde, il commença à enseigner l’approche directe de la Réalisation, en se concentrant sur l’enquête sur soi et l’expérience immédiate, tant en Europe qu’en Amérique.
Les livres qui lui sont attribués sont des transcriptions de son enseignement. Klein évita résolument de revêtir le manteau ou les attributs d’un gourou. Ce qui peut être enseigné, disait-il, appartient à la personnalité, à l’esprit. Il n’avait aucune technique à vendre ni aucune approche à faire maîtriser aux autres.
Klein ne cherchait pas nécessairement à ce que ses auditeurs se souviennent de ses paroles, mais plutôt à ce qu’ils en saisissent la saveur et remarquent à quel point elles stimulaient leur éveil. Il parlait directement de son expérience et utilisait rarement une terminologie religieuse ou philosophique. Ses étudiants décrivaient une présence joyeuse, aimante et paisible, sans attentes ni agenda, vivant dans l’instant présent et libre de toute personnalité.
Présence
Klein utilise le mot « Présence » pour exprimer la réalité ultime. Nous pouvons accéder à la Présence par l’enquête sur soi, mais nous ne pouvons jamais la connaître à travers notre esprit quotidien. Nous nous reconnaissons en tant que Présence en identifiant ce que nous ne sommes pas, un peu comme un sculpteur qui enlève l’excès de marbre qui cache la création artistique. Sous l’effet de l’investigation, l’esprit finit par s’arrêter, déclenchant une transformation. La libération est la liberté par rapport à la personnalité et à l’image de soi. « C’est une véritable explosion que de voir que l’on n’est rien, et de vivre complètement en accord avec ce rien » (dans Bodian, 7). Beaucoup d’entre nous ont eu un avant-goût de cette expérience qui nous oriente et nous inspire à continuer.
Lorsque la personnalité/l’ego se dissout, on est entièrement dans la Présence, dans le silence. Un esprit accordé à la vérité est alerte, conscient et subtil. Les pensées et les actions se produisent, mais ce sont des outils à utiliser et à ranger une fois qu’ils ont servi. Voici la définition que Klein donne à l’action juste : une action claire et une connaissance fonctionnelle issues du silence de la Présence, ne créant ni pensée ni souvenir. Une personne conserve ses connaissances et ses compétences fonctionnelles, mais sa mémoire personnelle est désengagée. Nous agissons en fonction des circonstances ; il n’y a pas de dialogue intérieur continu. En d’autres termes, la vie est vue sans la projection de la personnalité. Les actions sont pures et naturelles.
Il peut être utile d’envisager le contraire : lorsque nous sommes conscients de nous-mêmes, c’est-à-dire lorsque nous avons des monologues intérieurs sur notre sécurité, notre statut et notre image, nous jugeons sans cesse nos propres actions. Ce jugement incessant sur nous-mêmes génère de la peur, de l’anxiété et davantage de cycles d’activité mentale. Les actions futures sont soit lourdes de critiques, soit impulsives, afin d’éviter les critiques. Les actions restent emmêlées dans l’esprit.
Chaque respiration offre l’occasion de s’approcher de la Présence. Si nous attendons, il y a une pause à la fin de l’expiration avant que l’inspiration ne commence naturellement. Pendant cette pause, si nous y prêtons attention, les mécanismes de l’esprit sont plus calmes. Les enseignants de yoga appellent parfois cette pause un regard vers l’éternité.
Orientation sujet-objet
Dans notre personnalité et notre psychologie, nous sommes des sujets qui perçoivent des objets : des personnes, des choses, des pensées, des aspirations, des objectifs, des souvenirs. Nous sommes fascinés par le désir, mais lorsque nous atteignons notre objectif, le soulagement et la joie sont brefs. Nous pouvons souhaiter être admirés, alors nous concentrons notre désir sur une voiture de luxe, une récompense ou tout autre signe de statut social. Ce faisant, nous devenons liés à cet objet. Nous pouvons même désirer un état de paix ou de tranquillité, mais ces états restent temporaires et constituent toujours des objets de désir. En réponse, Klein pose la question suivante : ne voulons-nous pas vraiment être sans désir ni effort, exister sans désir ?
La réalisation de notre désir, qu’il s’agisse d’une nouvelle voiture ou d’un état de calme, apporte un moment de répit. C’est un moment de détente et de satiété qui reflète l’ouverture et la présence. Cependant, cela ne dure pas ; quelque chose d’autre brille et attire notre attention. Klein suggère de prendre note de ces brefs moments de répit afin de prendre conscience de nos schémas.
Le contraire du cycle de l’ego est l’ouverture sans direction, où l’esprit et le corps sont profondément détendus et libérés de toute cupidité. Cela passe par la compréhension du cycle du désir, qui arrête l’esprit de tourner en boucle. L’énergie est dispersée, elle n’est plus concentrée sur l’objet désiré, et nous nous retrouvons dans l’ouverture et l’espace.
Cette attention est-elle la même chose que la pleine conscience ? Non, car la pleine conscience est attentive à un objet ou à un environnement. La conscience pure n’a pas d’objet et est libre de toute intention. L’attention est libre de toute direction et de tout emplacement ; elle est ouverte et accueillante.
La pensée
À sa juste place, la pensée est un outil à utiliser et à ranger une fois qu’on en a fini avec elle. Notre essence est le Silence, et ce qui émerge du Silence est réel. Tout ce qui surgit de la pensée quotidienne est basé sur l’ego. Ce flux de mots et d’images combine comparaison, jugement, réactions habituelles et mémoire. Il est défensif, défendant l’ego, et agressif. « L’esprit ne cherche pas seulement sans cesse de la nourriture pour la pensée ; il cherche de la nourriture pour son identité, son sens de soi » (Tolle, 27).
La pensée naît de la mémoire, et la mémoire crée notre compréhension du temps. Pourtant, en réalité, un souvenir n’appartient pas au passé. Le souvenir se produit maintenant, au moment où nous y pensons ou le revivons. Les réactions sont automatiques, basées sur des similitudes avec le passé. Nous sommes construits à partir d’habitudes ; nous vivons donc rarement le moment présent.
Une théorie du vieillissement affirme que nous cessons de vivre véritablement le moment présent et que nous ne faisons que nous rappeler nos conclusions ou nos jugements sur un moment ou une expérience similaire. Par exemple, nous mangeons machinalement un aliment que nous « savons » aimer sans vraiment le goûter. Nos pensées sont rarement enracinées sur notre perception actuelle, elles sont fondées sur nos habitudes.
La pensée est principalement une question de jugement, ce que Klein appelle la qualification. Elle commence par nommer et passe instantanément à l’évaluation. Nous aimons ou nous n’aimons pas. Nous critiquons ou nous louons. Nous comparons et nous rivalisons. Que reste-t-il sans analyse, jugement, comparaisons flatteuses pour l’ego ou critique ? William James, psychologue et philosophe américain, a inventé le terme « flux de conscience » pour décrire la manière dont nous relions nos schémas comportementaux pour former notre identité. En supprimant le jugement, les comparaisons, la compétition et la critique, il ne reste plus grand-chose dans le flux ! « Lorsque vous êtes libéré de la pensée, vous trouvez la graine de l’amour » (Klein, Book of Listening, 251).
Klein évite les techniques. Il parle plutôt d’introspection et de compréhension ou d’intuitions qui amènent l’esprit à cesser sa production. En observant nos réactions, nous voyons comment l’esprit passe de la sensation à la dénomination, puis aux jugements, aux comparaisons et aux critiques. Les évaluations sont fréquentes et souvent cohérentes : j’aime ceci, je n’aime pas cela ; c’est mieux ou pire ; c’est bien ou mal ; ils auraient dû ou n’auraient pas dû. Certaines de ces pensées sont manifestes, mais beaucoup sont subtiles, en particulier celles qui concernent notre propre comportement. En observant ce que nous ne sommes pas — les pensées, les contractions et les jugements —, nous retirons les faux voiles de l’esprit.
Le témoin est un intermédiaire qui aide à dissoudre les habitudes. J’ai découvert que, lorsque j’observe l’esprit dans son jugement, je peux dire « pas ça ». Si je commence à me juger pour avoir jugé, c’est « pas ça ». Si je commence à résister parce que l’envie de juger est forte, c’est « pas ça ». L’esprit finit par se fatiguer et l’attention devient plus vaste.
De nombreuses techniques de méditation visent à apaiser l’esprit par la concentration. Pour Klein, il ne s’agit ni de méditation ni d’illumination. La méditation consiste à être dans la présence ou le silence, et non à pratiquer et à créer un objet d’états méditatifs. Dans une conversation, il explique que « Quand on découvre que le méditant, celui qui cherche Dieu, la beauté, la paix n’est qu’un produit du cerveau et qu’il n’y a rien à trouver, il y a un abandon. Ce qui reste, c’est un courant de silence. Vous ne pouvez jamais parvenir à ce silence par la pratique, par l’accomplissement. L’illumination – être la compréhension – est instantanée » (Bodian, 4).
Les Yoga Sutras nous disent que le but du yoga est d’apaiser les fluctuations de l’esprit. Est-ce la même chose que d’arrêter l’esprit ? Je ne le pense pas. Klein pourrait faire remarquer que nous sommes déjà de retour dans l’ego lorsque nous nous fixons comme objectif d’arrêter le flux des pensées. L’approche directe n’est pas progressive ; il n’y a ni hiérarchie ni échelle à gravir. Lorsque nous sommes dans le silence, la structure corps-esprit pense puis retourne au silence. Lorsque nous sommes dans l’ego, arrêter l’esprit revient à construire un barrage ; lorsque la méditation s’arrête, les pensées reviennent en force. La plupart d’entre nous n’ont-ils pas déjà fait l’expérience d’une méditation profonde où le sentiment de paix s’estompe cinq minutes après que la cloche a sonné ?
La psychologie propose plusieurs techniques pour éliminer efficacement les pensées intrusives, qui apportent un peu de paix. Pourtant, l’esprit est toujours à la recherche du prochain objet brillant, et, si nous sommes toujours prisonniers de nos schémas de pensée et d’action, le silence n’est que momentané. J’ai découvert que, sur le plan psychologique, lâcher prise est positif et précieux, mais insuffisant.
Les pensées ont un impact sur le corps. Lorsque nous pensons, il y a une réaction ou une contraction subtile dans le corps. Une relaxation profonde aide à dissoudre les réponses automatiques. Klein suggère que nous pouvons même apprendre à détendre le cerveau. La pensée provient principalement de l’avant du cerveau, les lobes frontaux. Déplacer les pensées vers l’arrière de la tête modifie et réduit considérablement leur production. Que se passe-t-il lorsque vous essayez de détendre votre visage, votre cuir chevelu et votre tête et que vous laissez vos pensées se déplacer vers l’arrière de votre esprit ?
Le Travail corporel
Klein enseignait un travail corporel subtil basé sur le yoga cachemirien, mettant l’accent sur les sensations et les ressentis dans le corps sans les nommer ni les évaluer. L’éveil des énergies subtiles purifie le corps. Ce processus révèle les tensions et les blocages, la structure psychosomatique de la personnalité.
Les contractions et les schémas de notre complexe corps-esprit nous empêchent d’accéder aux sensations pures du corps. De manière subtile, notre mémoire corporelle nous rappelle nos manques, nos blessures et nos désirs. En tant que professeur de yoga, je constate que les débutants ont souvent une échelle de sensations très simple : ceci est mauvais, cela est agréable. Découvrir les connexions et les schémas et apprendre à libérer ces énergies peut mener à une exploration subtile, à une relaxation profonde et à une prise de conscience.
Le corps est un entrepôt de souvenirs, de tensions et de contractions. Si vous détendez votre corps et que vous pensez ensuite à une interaction négative mineure, ressentez-vous une contraction quelque part dans votre corps ? Klein dit que nous devons connaître le corps — comprendre ces contractions — avant de pouvoir comprendre ce que nous ne sommes pas. « On pourrait dire que l’image du moi est une contraction du corps. Sentir l’expansion de votre corps dans l’espace élimine l’emprise du moi » (Klein, Invitation to silence, 5).
Essayez cette expérience : remarquez une partie de votre corps qui vous fait mal ou qui est douloureuse. Remarquez une partie qui vous fait du bien ou qui est neutre. Concentrez-vous sur cette sensation — le sentiment de santé ou de neutralité — et transférez-la à la partie de votre corps qui vous fait mal. Je me suis récemment cassé le poignet, et lorsque j’ai lu cette suggestion, j’ai immédiatement transféré la sensation de mon bras gauche (neutre, vivant) à celle de mon bras droit (douloureux et raide). Essayez votre propre version !
La Finalité
La finalité englobe les mouvements mentaux orientés vers un objectif ou un désir. Sur le plan psychologique, cela peut inclure des objectifs manifestes, tels que « je veux un nouvel emploi », mais même quelque chose d’aussi complexe qu’un nouvel emploi peut comporter plusieurs couches de désir. Je veux un nouvel emploi pour nourrir ma famille, gagner en statut social ou éviter un mauvais patron. Les niveaux de ce que nous voulons ou ne voulons pas, et nos approches pour assouvir ce désir aboutissent à un labyrinthe de pensées et de comportements. Je peux vouloir une nouvelle voiture, mais cette voiture est souvent plus qu’un simple moyen de transport. Elle est liée à la façon dont je perçois ma valeur, ma sécurité et mon estime de moi. « La recherche et le désir d’atteindre quelque chose sont le carburant de l’entité que vous croyez être » (Klein, Invitation to Silence, 14).
La finalité occupe une grande partie de notre activité mentale. Lorsque je réfléchis à ce que je vais porter, j’espère (finalité) obtenir une réaction particulière de la part des autres. D’une certaine manière, j’essaie d’influencer les réactions ou les réponses des autres, de construire une image de moi-même ou d’éviter les jugements négatifs, tout cela simplement en choisissant la chemise que je vais porter ! Nous jouons la finalité dans nos relations, nous dirigeons ou manipulons les conversations, nous nous positionnons pour être remarqués ou évités… La liste est infinie.
Sur le plan psychologique, ces chemins de pensée et de comportement alambiqués et inconscients sont des schémas et des habitudes anciens. Nous aspirons à l’attention, à la sécurité et à l’amour, et nous avons trouvé des stratégies pour nous aider à atteindre ces objectifs. Klein demande souvent : « Qui veut cela ? Qui s’ennuie ? Qui a peur ? »
La quête spirituelle elle-même peut être une forme de finalité. Nous croyons que, si nous en faisons assez, si nous apprenons assez et si nous accomplissons assez, nous gagnerons notre liberté. Cela me frappe comme l’une de mes propres croyances profondément ancrées. Pourtant, tout cela reste une question d’ego et d’esprit, et relève toujours de la psychologie, et non de la liberté.
Impact personnel
Les choses ont changé au cours des deux années de lecture quotidienne de l’œuvre de Klein. J’ai ressenti de la paix et de l’ouverture dans ma vie quotidienne, et je suis amusée par ma propre réactivité. Vraiment, qui est cette personne qui vient de dire ou de faire cela ? En tant que planificatrice par nature, j’ai observé les couches de finalité qui accompagnent même les petites actions. En les remarquant, il est plus facile de prendre du recul, et je trouve un sentiment d’espace et d’amour. Il y a davantage de présence simple ici.
Sources (la majorité des livres cités existent en version française).
Bodian, Stephan. « Soyez qui vous êtes : Un entretien avec Jean Klein » : https://www.revue3emillenaire.com/blog/soyez-qui-vous-etes-un-entretien-avec-jean-klein-par-stephan-bodian/, 1991.
Klein, Jean. The Book of Listening. Salisbury, Royaume-Uni : Non-Duality Press, 2008.
———. Invitation to Silence. Salisbury, Royaume-Uni : New Sarum Press, 2023.
———. Living Truth. Oakland, Californie : Non-Duality Press, 1995.
———. Open to the Unknown: Dialogues in Delphi. Salisbury, Royaume-Uni : New Sarum Press, 2020.
———. Transmission de la flamme. Salisbury, Royaume-Uni : New Sarum Press, 1990.
———. Qui suis-je ? La quête sacrée. Longmead, Royaume-Uni : Element, 1988.
Tolle, Eckhart. Stillness Speaks. Mumbai, Inde : Yogi Impressions, 2003.
Judith Sugg, PhD, est conseillère, professeure de psychologie et professeure de yoga. Elle a fait des études supérieures en psychologie du yoga et du Samkhya, et a rédigé le guide d’étude des Yoga Sutras pour la Société théosophique.
Texte original : https://www.theosophical.org/publications/quest-magazine/open-to-the-unknown-the-teachings-of-jean-klein
