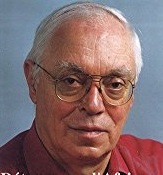(Revue Le chant de la Licorne. No 21. 1988)
Il y a la médecine, et il y a les médecines. L’usage du pluriel est de plus en plus fréquent. Il y a là sans conteste un phénomène significatif qui mérite analyse, surtout quand il est question de médecines « différentes », « autres », « parallèles », « douces », « naturelles », etc. Les malades, certes, ont toujours pris la liberté de jouer sur plusieurs claviers thérapeutiques à la fois. La nouveauté de ces dernières années est que le corps médical lui-même revendique massivement un plus grand droit à la diversité.
***
CATÉGORIES POUR UNE CLASSIFICATION
Le problème de la pluralité des médecines est somme toute très ancien. A la question de savoir si l’on peut guérir à partir de prémisses différentes, Hippocrate semble déjà avoir répondu affirmativement : « Les contraires sont guéris par les contraires… La maladie est produite par les semblables et, par les semblables que l’on fait prendre, le patient revient de la maladie à la santé… La fièvre est supprimée par ce qui la produit, et produite par ce qui la supprime… Ainsi de deux façons opposées la santé se rétablit ». Une fois le diagnostic établi, le médecin, selon Hippocrate, a le choix entre trois attitudes : ou bien laisser faire la nature, cette natura medicatrix qui est à elle-même son meilleur remède, ou bien s’opposer à elle par la loi des contraires, ou bien l’aider en se conformant à la loi des semblables. Tout dépend de la nature du mal et de la constitution du malade. Nous retrouvons très clairement ces trois attitudes aujourd’hui.
C’est en ethnologue intéressé par l’étude des systèmes de pensée que j’aborderai ici cette question, et non en médecin. Je proposerai pour débuter une rapide incursion dans l’ethnologie médicale.
LEÇONS DE L’ETHNOLOGIE
Les sociétés traditionnelles ont leurs médecines à elles, reposant sur des inductions et des déductions qui dépendent de l’image qu’un groupe humain se fait de l’homme et de la place qu’il occupe dans le monde. Les raisonnements, les méthodes et les techniques de médecine populaire révèlent quasiment à chaque fois l’axe principal autour duquel s’organise tout le système mythique, religieux, moral et juridique des peuples concernés. Quand le mal survient, les uns ont tendance à chercher la cause en eux-mêmes, alors que les autres le projettent sur l’entourage visible ou invisible, ce qui est hautement révélateur de l’orientation prise par la personnalité de base de chacun d’eux. C’est ainsi que l’on aura par exemple :
— des peuples où la maladie est expliquée principalement par l’intervention d’esprits qui viennent tourmenter et parfois même posséder les individus que, pour une raison ou une autre, ils ont choisis pour victimes ou dont ils souhaitent faire des médiums ; pour le diagnostic, on privilégiera alors les techniques de voyance qui sont censées donner accès au monde invisible ; quant à la thérapie, elle consistera soit à chasser ces esprits par des exorcismes, soit à les apprivoiser par des rites et des incantations, de manière, à la limite, à les rendre utilisables pour le bien du groupe ;
— des peuples où l’accent est mis plutôt sur l’action de personnes mal intentionnées qui lancent mauvais sorts et malédictions ; dès que quelqu’un tombe malade, on se demande qui de l’entourage agit en mal sur lui ; pour le diagnostic, on privilégie les techniques qui sont censées donner accès au monde invisible interhumain (et non plus suprahumain comme précédemment), donc là encore les techniques de voyance et de divination ; une fois le sorcier détecté, la thérapie consiste à neutraliser son action, à lui renvoyer le mauvais sort par un effet boomerang ou à se réconcilier avec lui ;
— des peuples hantés par la crainte du poison et axés sur la connaissance des antidotes ;
— des peuples où l’on estime que les maladies proviennent surtout du fait que les personnes qui en sont affectées ou leur entourage se sont rendus coupables d’une faute morale ou rituelle, ou de la violation consciente ou non d’un interdit ; le diagnostic consiste en la détermination de cette faute, la thérapie en une déculpabilisation et en une réparation, par exemple au travers d’un rituel de confession et de sacrifice ;
— des peuples où le mal est attribué à des agents pathogènes qui s’introduisent dans le corps, qu’il faut anéantir ou extirper par des procédés de succion, d’aspiration ou d’extraction.
Il est clair que notre médecine scientifique occidentale relève assez nettement de cette dernière orientation, avec ses microbes et ses virus. À ses yeux, cependant, l’introduction de ces agents relève de causes purement physiques, chimiques ou biologiques et le problème du sens de la maladie n’a donc guère lieu d’être posé. Bien entendu, la plupart des médecines reposent sur une combinaison de ces différents aspects, avec cependant la prédominance assez nette de l’un d’entre eux.
Aux yeux de l’ethnologie, qui est la science des diversités humaines, il n’existe donc que des médecines, toujours liées à des sensibilités, à des systèmes de pensée et, en tant qu’institutions, à des systèmes sociaux particuliers. Quand elle considère une culture donnée, tout l’intéresse à priori, en l’occurrence tout ce qui touche de près ou de loin à la maladie, à ses représentations, aux soins, aux agents qui interviennent, officiels ou non, aux techniques et aux produits utilisés, aux manières d’observer et de raisonner, aux émotions et aux attitudes, bref à tout ce, qui se ressent, se dit et se fait. L’ethnologie n’a pas de système normatif ou d’orthodoxie à défendre. Elle étudie ce qui est, tout ce qui est, sans exclusive, et non ce qui devrait être. À partir du moment où il y a pensée et pratiques systématisées face à la maladie, il y a pour elle médecine.
USAGES DU MOT MÉDECINE
On peut classer sous cinq rubriques au moins les usages que le langage courant fait du mot médecine quand celui-ci est employé au pluriel ; il peut en effet recouvrir :
— des secteurs particuliers de la médecine officielle : médecine générale, légale, scolaire, sportive, du travail, etc. ;
— des « médecines » qui en fait se réduisent à des moyens de diagnostic ou à des thérapeutiques privilégiées dont le spectre d’application est particulièrement vaste : l’ostéopathie, la chiropractie, la réflexothérapie, l’acupuncture, l’auriculothérapie, la phytothérapie, l’aromathérapie. l’oligothérapie, la cellulothérapie, l’isothérapie, les biothérapies, l’hydrothérapie, la thalassothérapie, la magnétothérapie, la chronothérapie, l’iridologie, la radiesthésie, l’astrologie médicale, etc. ;
— des médecines reposant sur un raisonnement médical particulier : l’allopathie, l’homéopathie, le néohippocratisme, l’humorisme, le galénisme, la médecine pastorienne, la naturopathie, le naturisme cartonien, la psychosomatique naturelle, les médecines occultistes, etc. ;
— des médecines reposant sur une anthropologie particulière, complète et explicite, telle la médecine anthroposophique ;
— des médecines liées à d’autres cultures et donc à d’autres systèmes de pensée : la siniatrie, la médecine ayurvédique, etc.
Pour s’y retrouver dans ce champ immense des différentes médecines il faut en dégager les structures sous-jacentes. Les catégories sont là : il faut les organiser. Notre tentative reposera sur l’établissement de quelques grandes oppositions autour desquelles tout s’articule.
MÉDECINE OFFICIELLE MÉDECINES PARALLÈLES
Est officiel ce qui émane d’une autorité reconnue, constituée, publique, ce qui est organisé par un pouvoir compétent, ou est notoire, connu de tous. On pourrait dire aussi médecine universitaire, parfois médecine d’État. Quant à l’adjectif parallèle, il désigne des voies qui vont dans la même direction, mais en évoluant côte à côte, sans se rencontrer, sans se recouper ; des voies qui poursuivent le même objet, mais de manière officieuse, à la limite illégale et clandestine. Les médecines parallèles peuvent être pratiquées par des personnes officiellement reconnues (docteurs en médecine ou Heilpraktiker à la manière allemande), elles peuvent même faire l’objet de remboursement de la part des caisses d’assurances maladie, sans pour autant correspondre à ce qui s’enseigne dans les facultés de médecine et se fait dans les hôpitaux publics. On voit ainsi apparaître un certain nombre de contradictions. Les médecins en arrivent à appliquer des thérapeutiques qu’ils n’ont jamais apprises ou sont obligés de se former selon des voies parallèles. Quant à tous ceux qui exercent en marge de la légalité, les poursuites judiciaires dont ils peuvent être l’objet ne les empêchent en général pas de pratiquer leur art. La reconnaissance leur vient en quelque sorte sociologiquement de la part du public, même si la législation ne suit pas.
MÉDECINE SAVANTE MÉDECINE POPULAIRE
Cette opposition ne recouvre nullement la première. La médecine officielle peut aller de pair avec une singulière inculture. « Savant » signifie ici simplement : qui repose sur un savoir, de préférence (mais non obligatoirement) écrit. La médecine livresque du Moyen-Âge était très savante sans pour autant être scientifique au sens où l’entendent nos contemporains. L’adjectif « populaire » est beaucoup plus difficile à cerner : il désigne ce qui est issu du peuple, ce qui appartient en propre au peuple, ce qui est répandu dans le peuple, ce qui plaît au goût du peuple ou ce qui s’adresse aux catégories les moins favorisées de la population. Les ethnologues ont étudié de nombreux systèmes médicaux qui se sont constitués en dehors de toute tradition savante écrite. Dans toute société, il convient de distinguer différents niveaux du savoir : il y a ce que tout le monde sait, puis ce qui relève de la compétence plus particulière de telle personne proche (les vieilles femmes jouent souvent un rôle important), enfin ce qui est du ressort du véritable spécialiste, reconnu comme tel : devin, voyant, chamane, herboriste, magnétiseur, rebouteux, barreur, panseur de secret, exorciste, etc. Dans les sociétés même les plus démunies et apparemment les plus simples il y a toujours un savoir médical spécialisé transmis selon des voies précises, souvent lié à des secrets de famille ou de métier.
On a beaucoup discuté de l’origine du savoir médical dit populaire dans nos cultures où tout passe de longue date par l’écrit. Dans certains villages d’Alsace, les gens avaient l’habitude de faire bénir à l’église, à la Pentecôte ou à la Saint-Jean d’été, des bouquets de plantes soigneusement composés, à usage médicinal. Coutume populaire, dira-t-on à juste titre. Or quand on étudie la composition de ces bouquets, on s’aperçoit qu’ils suivent très exactement certaines énumérations de plantes venues des compilations de l’Antiquité, de Galien ou de Pline l’Ancien, vulgarisées par les monastères du Moyen-Âge ou les herbiers de la Renaissance. Nous sommes donc là en présence d’éléments d’origine savante qui sont redevenus « populaires ». Mais les traités anciens ont eux-mêmes très largement recueilli et systématisé un savoir diffus dans la population. Par quelque bout que l’on prenne la question, on en arrive très vite à des savoirs spécialisés, autrement dit à une médecine qui d’une manière ou d’une autre peut être qualifiée de savante, mais qu’une fraction plus ou moins importante de la population sait intégrer en ses composantes les plus immédiatement utiles, en les réinterprétant et en leur imprimant son cachet propre. Origine populaire et origine savante sont inextricablement entremêlées. Un va-et-vient s’instaure. La science d’une époque prolonge, systématise et parfois renverse le savoir empirique, puis retombe partiellement dans le peuple, se vulgarise et se popularise à nouveau au point de devenir parfois méconnaissable.
MÉDECINE TRADITIONNELLE / MÉDECINE SCIENTIFIQUE
Cette opposition non plus ne recouvre pas les précédentes. Une médecine peut être très savante sans être scientifique, et traditionnelle sans être populaire. Est traditionnel ce qui est fondé sur une transmission par la parole et l’exemple, de génération en génération ou de maître à disciple. Est scientifique au sens large ce qui relève d’une connaissance exacte, raisonnée et approfondie, et dans un sens étroit ce qui relève d’un système de connaissances ayant un objet déterminé et une méthode propre, le tout fondé sur des relations objectives et vérifiables exprimées par des lois.
Une médecine traditionnelle se fonde sur l’ascendant qu’exercent le passé et ses représentants. « Les anciens ont dit », ou plus vulgairement « on a toujours fait ainsi » sont des aphorismes qui régissent toute pratique de ce genre. La médecine scientifique, au contraire, repose sur une remise en cause constante des manières de penser de l’observation et de l’expérimentation. Ce qui compte, c’est l’état présent de la recherche, et non ce qui est hérité du passé. Cela explique, par exemple, que dans la formation médicale telle qu’elle est conçue actuellement, l’étude des auteurs anciens ne joue pratiquement plus aucun rôle et que beaucoup de médecins ont perdu toute notion de l’épaisseur historique de leur pratique.
L’importance que revêt la tradition se fonde en général sur une conception d’ensemble de l’homme et de son histoire, véhiculée par la plupart des mythes anciens. C’est dans ses débuts que selon eux l’humanité a connu l’âge d’or, quand elle vivait dans la familiarité, dans l’intimité du monde divin et recevait de lui la révélation de toutes les choses importantes pour sa vie, y compris ce qu’il faut pour assurer sa santé. Le cours de l’histoire n’a été que dégradation et déchéance, à mesure que l’on s’éloignait des origines. La Tradition, qui a valeur sacrale, est alors la seule voie possible par laquelle puissent nous parvenir des bribes de cette révélation primitive. Cette manière de voir est étrangère à notre mentalité moderne dominée par l’idéologie du progrès. Nos ancêtres trouvaient leurs modèles en arrière, tandis que nous autres sommes tendus en avant. Ces deux orientations en sens contraire de la pensée et de toute la vie se retrouvent logiquement au plan de la médecine.
MÉDECINE EMPIRIQUE, MÉDECINE SYSTÉMATIQUE ET RÉFLEXIVE
L’usage de la notion d’empirisme a été médical avant d’avoir été philosophique. On a traité d’« empiriques » des thérapeutes dont l’art « se réduisait à avoir vu, à se ressouvenir et à comparer » (Encyclopédie de Diderot). Cette expérience commune et spontanée s’oppose évidemment à l’expérimentation scientifique, réflexive et systématique.
Il y aurait énormément à dire sur le caractère soi-disant empirique des médecines populaires ou traditionnelles. Il y a certes toujours eu expérience, voire expérimentation, mais celles-ci sont le plus souvent stériles si elles ne suivent pas un fil conducteur, si elles ne s’organisent pas autour d’un axe, si elles ne se coulent pas dans une structure de pensée. Ce qui étonne dans des médecines traditionnelles comme l’acupuncture, l’Ayurvéda ou la théorie des signatures, c’est précisément leur caractère extraordinairement systématique. Comment supposer un seul instant que des corpus de connaissances aussi vastes, aussi précis et aussi organisés soient le fruit d’un empirisme qui tâtonne au hasard ? A la base de toute médecine il y a une anthropologie, un système de pensée, une logique ; le fait qu’ils soient purement implicites, voire inconscients, n’enlève rien à leur prégnance, bien au contraire. L’observation ethnologique de la manière dont fonctionnent les guérisseurs à travers le monde peut jeter quelque lumière sur la genèse des systèmes médicaux et les mécanismes qui entrent en jeu. Rêve, voyance et phénomènes paranormaux jouent un rôle primordial. Les remèdes sont souvent révélés, reçus d’en-haut d’une manière ou d’une autre, et intégrés ensuite dans la pharmacopée.
MÉDECINE UNIDIMENSIONNELLE / MÉDECINES PLURIDIMENSIONNELLES
Notre médecine actuelle repose essentiellement sur des données à caractère biologique et chimique. La difficulté que la médecine psychosomatique rencontre pour s’imposer est significative ; on ne la reconnaît souvent que du bout des lèvres. Quant à la dimension proprement spirituelle de l’homme, on n’en parle que dans des cercles très étroits, et souvent dans des perspectives fort différentes. Des médecines qui se qualifient parfois elles-mêmes d’occultistes, un terme malheureusement ambigu, discernent en l’homme toute une stratigraphie invisible, des corps subtils ayant leur anatomie et leur physiologie propres, des rayonnements relevant d’autres formes de matérialité, des auras, des organes demandant à être éveillés, des perceptions extra-sensorielles, des liaisons, des correspondances et des influences qui ne peuvent être décelées par un regard ordinaire, mais sur lesquelles on peut agir et que l’on peut exploiter à des fins curatives. Ce qui se passe au plan purement organique et biochimique n’est pas nié, mais ce n’est là qu’un plan parmi plusieurs autres, et pas forcément le plus important pour la recherche des causes. L’attitude du médecin ne sera évidemment pas la même selon qu’il ne voit en l’homme qu’une sorte d’animal plus évolué et plus compliqué que les autres, ou selon qu’il discerne en lui et inhérente à son être une dimension qui relève de l’Absolu et de la Transcendance. On peut certes s’étonner de ce qu’une médecine qui s’est développée depuis si longtemps en milieu chrétien soit une des plus plates et des plus unidimensionnelles que l’humanité ait jamais pu concevoir.
MÉDECINE NATURELLE, CHIMIOTHÉRAPIE
Quand on parle de médecine naturelle, c’est essentiellement pour l’opposer à la chimiothérapie, et secondairement à des techniques telles que la radiothérapie. L’idée majeure est, négativement, qu’il ne convient pas d’introduire dans le corps des substances ou de le soumettre à des influences qui biologiquement lui sont étrangères, et positivement, que l’usage d’éléments qui correspondent à son milieu originel est le plus approprié quand il faut rétablir des équilibres menacés.
L’idée de médecine naturelle était très courante au siècle dernier déjà dans les pays de langue germanique. Mais c’est surtout dans le sillage du mouvement écologiste qu’elle est devenue une idée-force dans l’opinion publique. Des recherches précises, par exemple à partir de la méthode des cristallisations sensibles, ont montré qu’à formule chimique identique, deux substances, l’une extraite d’un être vivant et maintenue en état de vitalité, l’autre obtenue par synthèse chimique, n’ont absolument pas le même spectre d’absorption. On en a conclu que l’organisme intègre avec moins de risques et plus d’efficacité des remèdes d’origine minérale, végétale ou animale proches de leur état de nature, plutôt que des produits morts, rendus inertes ou dénaturés par toutes sortes d’opérations industrielles. Les uns stimulent, vitalisent et rééquilibrent, les autres encombrent, surchargent et intoxiquent. Dans le domaine de l’agriculture et de l’alimentation, on emploie beaucoup, et non sans maladresse, l’adjectif « biologique », en jouant sur l’opposition avec la chimie. L’idée est toujours qu’il ne convient pas de perturber les procès vitaux par des interventions qui relèvent d’un autre ordre de réalité.
MÉDECINES DOUCES, MÉDECINES AGRESSIVES
La mode du moment consiste à célébrer la douceur de certaines médecines. Des recherches précises ont été menées sur l’effet pathogène ou « iatrogène » de nombreux moyens de diagnostic et de traitement et de nombreuses institutions de soins. La boucle est bouclée quand la médecine en arrive à être elle-même source de maladie. On sait bien, mais sans en tirer les conclusions qui s’imposent, que de nombreux moyens utilisés dans la pathologie la plus commune et la plus banale dépassent de très loin les indications qui sont les leurs, un peu comme si on chassait les moustiques à l’artillerie lourde. Les organismes en viennent à ne plus réagir qu’à des doses massives ou, une fois surintoxiqués, à ne plus réagir du tout. Les ravages peuvent être considérables à long terme quand on se laisse fasciner par des résultats spectaculaires immédiats ou quand le médecin craint d’être accusé de ne pas avoir fait le nécessaire selon des normes passe-partout.
Une médecine douce cherche à obtenir un effet curatif réel et adéquat sans mettre l’organisme en état de choc, sans provoquer des réactions secondaires nocives, sans nécessiter des convalescences interminables et installer des asthénies chroniques, sans contrarier les processus de rétablissement contenus dans la maladie elle-même, considérée dans la plupart des cas comme la réaction salutaire d’un organisme qui cherche à se libérer de ses toxines. A la fièvre, par exemple, et plus généralement aux épisodes aigus, on reconnaîtra habituellement une fonction positive qu’il faut respecter. Tout est affaire de discernement : il y a fièvre et fièvre, maladie et maladie, et dans certains cas, il faut à l’évidence employer les gros moyens.
Mais, comme disait déjà Hippocrate, la première préoccupation du médecin doit être de ne pas nuire (primum non nocere). La seconde sera de ne pas violenter la « nature », y compris celle de la maladie elle-même, mais d’utiliser à plein ses ressources.
MÉDECINE PROTHÉSIQUE / MÉDECINE D’AUTODÉFENSE
Cette opposition nous mène au cœur du sujet, là où jouent les raisonnements médicaux. Selon le schéma classique, de nombreuses maladies sont dues à des agressions d’agents pathogènes. Or, face à tout ennemi, on peut réagir de deux manières : ou bien, par une intervention extérieure énergique d’ordre médicamenteux, radiologique ou autre, on cherchera à détruire ces agents et à les rendre inoffensifs ; ou bien, on stimule l’organisme dans ses réactions immunitaires et d’autodéfense afin que de lui-même, il s’oppose à l’agression et parvienne à la neutraliser. Dans le premier cas, l’action est purement palliative : tout se passe comme si on posait une prothèse chimique, comme si on érigeait une barrière artificielle visant à protéger le corps, mais qui lui demeure extérieure et a très souvent pour effet de l’affaiblir du fait que ses réactions ne sont plus sollicitées. La seconde stratégie vise au contraire à fortifier l’organisme, à le mettre en état d’alerte, à augmenter ses ressources internes, à renforcer et à mobiliser ses moyens de dissuasion. L’idéal sera de le maintenir dans un tel état de vitalité et de réactivité que toute agression soit d’avance découragée et vouée à l’échec. Intervient ici la notion de médecine de terrain. On définit le terrain, au sens médical, comme l’état d’un organisme, d’un organe ou d’un tissu quant à sa résistance aux agents pathogènes. On attribue à Claude Bernard le célèbre aphorisme : « Le microbe n’est rien, le terrain est tout ». Il est une manière d’envisager l’art de prévenir et de guérir qui consiste essentiellement à soigner le terrain et à le mettre en état de résistance. Théoriquement, tout le monde est sans doute d’accord avec cela ; mais pratiquement, ce n’est pas ce qu’on fait.
MÉDECINE SYMPTOMATIQUE / MÉDECINE DE FOND
Une maladie s’observe, se décrit et se détermine à partir de ses symptômes. Ceux-ci sont la partie perceptible et observable du mal. Une fois qu’ils ont disparu, on a l’impression, subjectivement, d’être guéri. D’où la tentation de s’attaquer essentiellement au symptôme pour l’éliminer. On a de la fièvre ? on la fait baisser artificiellement. On a mal à la tête ? on prend de l’aspirine. Une éruption apparaît ? on la fait avorter, etc.
Il est une autre manière de voir les choses. Le symptôme, pour elle, n’est qu’un signe, un signal, un langage par lequel le corps cherche à s’exprimer. Mais comme tout est en tout, la cause est à chercher du côté d’un déséquilibre global. Faire taire le symptôme sans plus, c’est débrancher la sonnette d’alarme pour ne plus l’entendre, sans aller voir pourquoi elle a sonné. On appelle traitement de fond, par opposition à traitement symptomatique, celui qui, se laissant guider par les symptômes et attentif à leur langage, s’attaque aux causes profondes et cherche à rétablir les équilibres compromis.
Un médecin qui travaille dans cette optique renverra volontiers son client à une automédication guidée pour la pathologie ordinaire et banale, afin de pouvoir se réserver à un examen approfondi du cas avec anamnèse sérieuse, étude de la biographie et de l’hérédité, examen clinique, morphologique, caractérologique, éventuellement graphologique, iridologique, radiesthésique, chirologique, astrologique, essayant donc par des voies diverses et convergentes de bien situer où sont les points forts et les points faibles, les déséquilibres latents qu’il faut corriger et compenser, les lignes de moindre résistance, les sources potentielles de troubles. « Il importe de savoir vers qu’elle maladie tend chaque constitution », disait déjà Hippocrate. Un homme comme le Dr Carton était passé maître en cet art. On dit des médecins de l’ancienne Chine que leurs clients ne les payaient que tant qu’ils étaient en bonne santé : il est vrai que l’examen traditionnel, des pouls notamment, leur donnait un puissant moyen de déceler les déséquilibres organiques à un stade où ils sont encore purement latents.
Dans ce cas, on ne va pas voir le médecin quand on fait une bronchite ou une crise de foie, mais à date fixe, pour faire avec lui le point sur ce qui s’est passé entre temps et sur l’évolution que l’on a pu observer, pour essayer de comprendre avec lui « ce que cela veut dire », ce que cela révèle, et pour instaurer un traitement qui, par-delà les épisodes mineurs pris comme révélateurs, aille au fond des choses. Le malade se sent alors davantage concerné par ce qui lui arrive, a les moyens de se prendre en main à long terme avec intelligence et sera moins disposé à s’aliéner à une médecine purement extérieure.
MÉDECINE FONCTIONNELLE / MÉDECINE HÉROÏQUE
La médecine universitaire est essentiellement hospitalière, et c’est à l’hôpital que se fait l’apprentissage du praticien. L’accent, par la force des choses, est donc mis sur la pathologique, sur le désordre constitué, sur l’agression caractérisée, sur les troubles lésionnels, en d’autres termes sur les gros cas pour lesquels il faut vraiment utiliser les gros moyens. C’est en ce sens qu’on a pu parler de médecine héroïque.
Cette orientation a laissé dans l’ombre un autre type de troubles, plus fréquents, mais aussi plus diffus : aucune lésion ne peut être décelée, et pourtant les gens sont mal portants, fatigués, « patraques », atteints dans leur moral. Ils s’entendent dire : « Ce n’est rien », « c’est purement fonctionnel », « c’est nerveux », alors qu’ils souffrent réellement et que faute d’être guidés adéquatement et rééduqués, le mal peut affectivement devenir grave.
Face à ces perturbations mineures, mais réelles, à ces diminutions de tonus, à ces comportements psycho-physiologiques dérangés, à ces manifestations pré ou parapathologiques, à ces simples dérèglements, à ces diathèses, la médecine des gros moyens est souvent démunie et impuissante. Pire, si elle intervient sur le mode massif qui lui est habituel, elle risque fort d’aggraver les choses à longue échéance. D’où la nécessité d’une médecine fonctionnelle beaucoup plus fine, plus qualitative, orientée vers la compensation des carences, la régularisation des échanges, la catalyse des fonctions, plus attentive à l’aspect psychologique et social des troubles. La diététique, la phytothérapie, l’homéopathie, l’oligothérapie peuvent ici faire des merveilles. Les oligosols, par exemple, tels que les a mis au point le Dr J. Ménétrier sont essentiellement des catalyseurs, c’est-à-dire des substances qui par leur présence minime sont appelées à régulariser, à faciliter, à exalter, voire à provoquer des échanges ioniques sans s’intégrer directement à la combinaison résultante.
MÉDECINE D’ORGANES MÉDECINE DE LA PERSONNE
La médecine peut être centrée sur les entités abstraites que sont les maladies. On développera alors une nosographie très précise et des méthodes de diagnostic extraordinairement raffinées et coûteuses dans le but de classer un trouble concret dans une catégorie et de lui donner un nom. En regard, la thérapeutique apparaîtra singulièrement pauvre, préétablie et passe-partout, telle entité morbide conduisant automatiquement vers tel type de remèdes. À la limite, le médecin devient inutile et son travail peut tout aussi bien être fait par un ordinateur.
Avec la spécialisation médicale, un autre trait apparaît. Chaque sous-système organique, chaque organe même tend à être examiné et traité à part, pour lui-même, sans prendre en considération l’économie d’ensemble, sans tenir suffisamment compte de ces relations entre organes et points du corps parfois très lointains, que des physiologies plus subtiles, en Inde ou en Chine, ont bien mises en évidence.
À l’autre bout, nous avons l’idée selon laquelle l’homme est un, en lui tout est en tout et tout réagit sur tout. Ce n’est pas la maladie qu’il faut voir, mais la personne malade dans son idiosyncrasie, dans son unicité absolue, dans la particularité de sa constitution, de son histoire, de sa vocation, de son destin. Ce qui compte, ce n’est pas de trouver un nom à son trouble pour lui appliquer un traitement standard, mais de repérer les symptômes dans toute leur finesse pour trouver le remède spécifique que les homéopathes ont appelé le simillimum. Un traitement que l’on applique sans voir l’économie d’ensemble risque de nuire à une fonction voisine. Un trouble que l’on fait disparaître localement risque de ressurgir en plus grave ailleurs. Un trouble que l’on traite sur un plan purement physique était peut-être porteur d’un message urgent relevant d’un autre niveau et qui va ainsi passer inaperçu. En traitant l’homme abstraitement et partiellement, on ne peut obtenir que des guérisons apparentes, à moins que la personne, dans sa triple dimension organique, psychique et spirituelle trouve en elle la force pour rétablir l’équilibre par ses propres moyens, non pas grâce, mais malgré les médications-alibi qu’on lui aura appliquées. Une médecine de la personne est nécessairement une médecine holistique, considérant l’être dans sa totalité.
MÉDECINE POUR LAQUELLE LA MALADIE A UN SENS / MÉDECINE POUR LAQUELLE LA MALADIE N’A PAS DE SENS
Si tomber malade est du même ordre que recevoir une tuile sur la tête, si c’est attraper par hasard, sans qu’on sache pourquoi, un microbe ou un virus, la maladie est évidemment dépourvue de toute signification humaine. Agression gratuite, elle est purement et simplement un mal. Elle fait partie de l’absurde de la vie. Elle est une ennemie qu’il faut combattre implacablement.
Si au contraire, on admet que la maladie, ou du moins certaines maladies, nous apprennent toujours quelque chose sur nous-mêmes, qu’elles sont un langage qu’il faut apprendre à écouter et à décrypter, qu’elles nous renseignent sur la manière dont nous nous traitons nous-mêmes et dont nous sommes insérés dans notre milieu, qu’elles nous révèlent quelque chose de notre destin, qu’elles mettent le doigt sur nos problèmes les plus intimes, ceux dont nous n’avons pas une conscience claire et qui, faute de pouvoir se dire, se somatisent ; si d’autre part, on admet que leurs manifestations extérieures et symptomatiques indiquent qu’un processus positif d’auto-défense, d’auto-régulation et d’auto-équilibration est le plus souvent en cours une fois que l’organisme est trop perturbé ou trop intoxiqué pour se permettre une vie normale, en ce cas les choses prennent un tout autre relief. La maladie n’est plus alors une ennemie à abattre, une intruse à chasser à tout prix, mais une amie, une sorte de maître intérieur dont il faut soutenir et favoriser le travail. Elle ne nous est pas étrangère ; elle fait partie de nous-mêmes. Elle relève peut-être même de la meilleure part de notre être. Elle est indice de vitalité, signe que notre organisme est encore capable de réagir.
On pourrait dire en d’autres termes qu’il y a des médecines qui agissent contre la maladie et il en est qui agissent dans le sens que la maladie nous indique. Contrecarrer un processus curatif qui se met en route naturellement, couper des épisodes aigus qui peuvent être des moyens extrêmement puissants de désintoxication et d’élimination, où le corps en quelque sorte brûle ses déchets, c’est prendre le risque énorme de voir le terrain se dégrader un peu plus, c’est obliger le mal à se trouver d’autres exutoires peut-être beaucoup plus graves ou à envahir sournoisement l’ensemble du corps pour aboutir finalement à ces états de dégénérescence organique que sont la tuberculose, les scléroses, le diabète ou le cancer.
Certes, le problème du sens que la maladie peut revêtir est des plus complexes. Celui-ci n’est pas seulement à chercher sur le plan organique, mais aussi psychologique et spirituel, et souvent sur les trois à la fois. Tout ce qui se passe dans l’âme et dans l’esprit a un répondant et une résonnance physiques. Une question non réglée sur un plan parasite l’ensemble des autres plans, et étouffer une des dimensions de notre être, c’est fatalement nous mutiler. Les causes réelles peuvent se situer ailleurs que là où l’on croit, et prétendre tout régler par des interventions médicamenteuses ne revient alors qu’à dresser un écran de fumée.
La maladie nous saisit dans notre totalité. Elle est un élément déterminant de notre destin. Si ce dernier a un sens, elle doit en avoir un aussi. Si par contre nous pensons que la vie est absurde, il n’y a évidemment aucune raison de penser que la maladie ne le soit pas aussi. Nous sommes là devant un problème de Weltanschauung. Ce n’est pas un hasard si c’est dans notre type de civilisation que la maladie est perçue comme un non-sens et qu’est née, peut-être pour la première fois dans l’histoire, une médecine aux yeux de laquelle, précisément, la recherche du sens n’a pas de sens.
MÉDECINE-ART – MÉDECINE-SCIENCE
Au sens ancien, art désignait un ensemble de connaissances et de règles d’action dans un domaine particulier, ou un métier exigeant des aptitudes précises, et non seulement un savoir, de la part de ceux qui l’exercent. Art pouvait même désigner ces aptitudes elles-mêmes : l’adresse, l’habileté, la perspicacité, le discernement, le tact, l’empathie. Le médecin était « un homme de l’art » qui, se fondant sur tout un ensemble de sciences, savait en faire un usage très personnel et très personnalisé. L’art réside dans le passage à l’application. Le côté « artiste » était plus développé dans certaines spécialités comme la chirurgie. Le médecin était donc bien plus qu’un simple homme de science. Savoir-faire et savoir-être étaient essentiels à sa fonction. Puis est venue une époque où l’on a tellement insisté sur le côté scientifique de la médecine qu’on a prétendu en faire une science pour elle-même. En parler comme d’un art était alors perçu comme dépréciatif. Avec l’irruption de la géographie et de la sociologie médicales sous forme d’épidémiologie, le malade dans son individualité tend à se perdre dans les séries statistiques. Les visages s’effacent devant des analyses biochimiques, des images histologiques, microbiologiques ou radiologiques. Quand la statistique gagne la thérapeutique elle-même, avec ce haut degré de performance que permet l’informatique, l’art médical perd largement sa raison d’être mais n’oublie-t-on pas que toute extension de la technique exige, pour rester humaine, un supplément d’âme, selon la belle expression de Henri Bergson ?
MÉDECINE – ANTIMÉDECINE
Déjà au siècle dernier a existé en médecine un courant que l’on qualifiait de nihiliste, selon lequel seul l’organisme peut se rétablir de lui-même, de sorte que toute intervention était au mieux inutile. La médecine arrivait ainsi à se nier elle-même. On pourrait mentionner diverses résurgences contemporaines de cette opinion. Quand on est malade, dira-t-on, il n’y a rien d’autre à faire sinon à se mettre au repos absolu, au chaud et à la diète. En beaucoup de cas, ce conseil n’a certes rien d’absurde, les malades autant que la Sécurité Sociale n’auraient qu’à y gagner.
Il y a médecine dans la mesure où l’on croit qu’il est possible d’intervenir, soit, selon les uns, pour contrecarrer le processus morbide, soit, selon les autres, pour l’aider dans son travail, le mener à terme et éventuellement le hâter. Sinon, nous sommes sur le terrain de l’antimédecine, un terme qui n’a pas eu le même succès qu’antipsychiatrie, mais qui recouvre un courant de pensée tout à fait réel. Molière l’avait admirablement cerné dans son Malade Imaginaire : « La nature, d’elle-même, quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre où elle est tombée. C’est notre inquiétude, c’est notre impatience qui gâte tout, et presque tous les hommes meurent de leurs remèdes, et non pas de leurs maladies… Lorsqu’un médecin vous parle d’aider, de secourir, de soulager la nature, de lui ôter ce qui lui nuit et lui donner ce qui lui manque…, il vous dit justement le roman de la médecine. Mais quand vous venez à la vérité et à l’expérience, vous ne trouvez rien de tout cela, et il en est comme de ces beaux songes qui ne vous laissent au réveil que le déplaisir de les avoir crus ». (III, 3).
CONCLUSION
Ces quelques oppositions, qu’on pourrait multiplier et qui se recouvrent partiellement, permettent, me semble-t-il, d’introduire un peu de clarté dans un champ d’étude complexe et mouvant, déterminé non seulement par les découvertes de la science et les progrès de la technologie, mais aussi par les pressions de l’économie, les réactions de l’opinion publique et les phénomènes de mode. On pourrait passer en revue les différentes « médecines » pour voir comment ces critères s’appliquent à chacune et dresser ainsi un tableau comparatif. Il s’en dégagerait sans doute la constatation qu’en gros nous sommes en présence de deux grands courants médicaux, de deux tendances majeures, de deux logiques antithétiques.
Nous avons d’une part une médecine non seulement scientifique, mais scientiste, née avec le positivisme il y a deux siècles, grande pourfendeuse de mythes anciens, qui par méthode ne retient que ce qui s’observe et se calcule, qui a profité de l’extraordinaire essor qu’ont connu les sciences positives, qui a envahi l’Université et l’hôpital, qui dispose donc de tous les grands moyens, mais à qui l’État reproche son coût et face à laquelle le public se sent de plus en plus mal à l’aise, alors qu’il ne peut se passer d’elle. Le patient a le sentiment qu’on lui applique des traitements qui ne correspondent pas à sa vraie nature, qui lui demeurent extérieurs, qui ne vont pas au fond des choses, qui ne l’éclairent pas quant au sens de son mal. Évoluant dans un univers dur et agressif de machines et de techniques impersonnelles, il a l’impression qu’on le prend lui-même comme une machine qu’on répare, qui n’a pas voix au chapitre et qu’on considère sous le seul rapport du corps et du rendement.
Nous avons d’autre part des médecines très diversifiées, exigeant de la part du praticien beaucoup d’intuition et de savoir-faire, aux moyens réduits, ne négligeant pas les données récentes de la science et de la technique sans pour autant abandonner les pratiques anciennes souvent peu coûteuses, mais attachées surtout à la détection des causes profondes qui peuvent se situer à des plans très divers, visibles et invisibles, à partir du moment où l’on considère la nature humaine dans toute sa complexité, selon ces images de l’homme que nous transmettent les traditions anciennes, attachées ensuite à déclencher des processus curatifs qui viennent de l’intérieur, qu’il faut soutenir, stimuler, éveiller, hâter, mais auxquels il ne faut jamais se substituer de l’extérieur tant qu’ils ont quelque chance de viabilité. Des médecines donc qui prétendent prendre l’homme malade dans sa totalité pour amener avec finesse, subtilité, douceur, intuition et art la nature qui seule guérit à faire son œuvre.
La juxtaposition et l’interférence de ces différents courants, de ces différentes tendances, pratiques et conceptions, constitue aujourd’hui un fait de société majeur. C’est l’une des expressions sans doute les plus significatives de notre civilisation actuelle et de son pluralisme foncier. Les mentalités s’en accommodent facilement, mais les institutions ne suivent pas toujours. D’où un certain nombre de discordances, de tiraillements, voire de conflits. Qui dit pluralité, et à fortiori pluralisme (qui est la pluralité érigée en système), dit alternatives, donc choix, information, discernement, jugement, liberté, tout un enchaînement d’opérations difficiles. Les choses se compliquent autant pour les malades que pour ceux qui sont chargés de les soigner. On comprend facilement qu’une sorte d’officialisation du pluralisme rencontre des résistances considérables, et puisse être perçue comme dangereuse. La fonction médicale a certes toujours été particulièrement lourde : longueur des études, responsabilités, astreintes de l’exercice quotidien, évolution rapide du savoir et des techniques, contact permanent avec les misères de la condition humaine… L’éclatement de la médecine intervient au moment où sur de multiples plans, son image se dévalue, et les deux phénomènes ne sont pas sans relations l’un avec l’autre. Liberté et pesanteur s’accentuent à la fois. Les temps d’élargissement et de restructuration sont par la force des choses aussi des temps de crise.
Pierre Erny est né en 1933 à Colmar. Il a été professeur d’ethnologie à l’université Marc Bloch de Strasbourg, après avoir enseigné au Burkina Faso, au Congo et au Rwanda. Il est spécialisé en ethnologie de l’éducation et en anthropologie religieuse. Il est l’auteur de plusieurs livres.