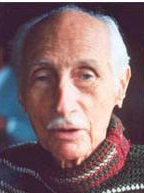Pour comprendre le double aspect du défi lancé à l’Occident, éclairons les raisons qui semblent le motiver.
Abstenons-nous de tout jugement, de toute condamnation, ou approbation, à seule fin de découvrir le noumène du phénomène dont la disparition éviterait, peut-être, un conflit planétaire.
Aussi, faut-il se dépouiller de tout élément passionnel, émotionnel ou réactif, pour être un témoin impartial. Il faut donc éliminer toutes les opinions qui ne sont que des concepts intellectuels basés sur des observations partielles ou sur des clichés résultants d’erreurs accumulées et dont on se contente, à défaut de vérifier leur bien-fondé.
Concentré, sensible aux données non altérées d’un monde qu’on voit tel qu’il est, libre de tout préjugé, on se libère de tout ce qui entrave l’appréciation.
Tel dépouillement entraîne l’emploi de mots limpides et clairs pour ne pas altérer ce qu’on essaye d’exprimer, et comporte une lucide compréhension, ainsi qu’une adéquation aux facteurs mouvants, soit une instantanéité constamment renouvelée.
Détaché du milieu familial ou national, détaché de la notion temporelle qui restreint la perception, on est en mesure de saisir les rapports visibles et invisibles conduisant à la vision lucide apte à faire surgir des solutions qui s’inscrivent dans l’Ordre des Choses.
Ce qui le contredit crée la confusion et le désarroi. Rappelons, à ce titre, que le gaspillage des pays riches, l’épuisement des ressources non renouvelables, la pollution écologique, l’explosion démographique, les méfaits de la faim, les conflits locaux ne sont que des épiphénomènes qui y contribuent.
La révolution psychologique qui s’impose doit aider la science à retrouver sa juste application, et doit conduire aux remèdes très différents de ceux auxquels, par habitude et par conservatisme, on fait appel sans se soucier de la faillite répétée du procédé.
La révolte d’une certaine jeunesse en plein divorce avec la société, dont elle fait pourtant partie, est le propre de la mutation qui s’amorce.
Les marginaux imagent l’excès de cette révolte, mais il n’est pas inutile de sonder leurs motivations pour récolter, à l’arrière-plan de leurs réactions, des idées neuves pouvant un jour trouver leur application.
Ce qui caractérise la jeunesse dite marginale est le dédain de la réussite et de l’argent. Ce dédain est, en fait, bivalent. D’une part, on ne peut plus croire en la valeur du travail en prétendant se moquer du succès mais, d’autre part, on se targue de tout casser pour épurer le monde, pour promouvoir enfin une société laborieuse et honnête.
Le paradoxe est roi. On veut élever la décadence au niveau d’un art et on invente, pour ce faire, une contre-culture, mais on se lance dans le terrorisme, prêt à mourir pour un idéal qu’on imagine élevé.
On justifie ses menus larcins par le besoin de satisfaire ses appétits, en prétendant ne pas en avoir et on s’oppose, par bravade, à l’ordre établi pour trouver une chaleur humaine et une raison d’exister. La camaraderie qui naît de la complicité s’avère précieuse pour combler le vide que créent les liens familiaux rompus. Ils sont remplacés par une appartenance à des clans qui se forment au gré de communes entreprises.
On se drogue parce qu’on s’ennuie, pour faire comme les autres ou pour échapper à une sourde anxiété que génère l’idée de se savoir inutile.
La société se trouve, à vrai dire, devant une crise de conscience collective due à la désintégration progressive de critères contestés. La rentabilité, la logique rationnelle et l’efficacité sont au banc des accusés.
Sociologues et éducateurs se sont penchés sur le problème de la jeunesse, sans pour autant trouver de remèdes efficaces à ce qu’on pourrait appeler le mal du siècle.
Il prend, de nos jours, une importance particulière étant donné les moyens d’autodestruction qui sont plus puissants que jamais. En outre, jamais encore le vice n’a donné lieu à pareille exploitation.
La vocation de l’Occident passe par le dégagement de son âme, voilée par tant d’apparentes contradictions. Il n’est guère possible de le faire sans demander quelles raisons profondes poussent un nombre de jeunes et de moins jeunes à se révolter contre une société à laquelle ils appartiennent.
Rêver d’un âge nouveau n’est pas une explication suffisante. Examinons les faits.
L’époque actuelle manifeste un état psychopathologique généralement observable, un névrotisme devenu de plus en plus envahissant. Il n’est qu’à connaître la quantité considérable de barbituriques et autres produits chimiques absorbés par la population, pour avoir une idée qui se précise par l’observation de récents événements. Ils illustrent une glissade sur les pentes de la barbarie, du sadisme et d’un total mépris de la vie humaine.
L’homme semble vouloir s’avilir et, puisque l’expérience démontre que toute cause doit être recherchée jusque dans les symptômes les moins voyants, ne limitons pas notre quête à la satisfaction éprouvée par la découverte de quelques formules passe-partout.
« Quand l’idée fait défaut, un mot nouveau fait l’affaire ! » a dit Goethe. Évitons cet écueil ! La question est trop sérieuse pour n’être pas profondément fouillée. Les effets reconnus, les causes plus difficilement discernables, car une cause apparente peut être un effet qui n’avait pas été observé ou mal révélé à notre connaissance.
Écoutons, sans nous y arrêter, ce que nous entendons dire par beaucoup de gens qui ont hâte de se donner une explication des faits. Constatons qu’ils tirent de ces faits des conclusions diamétralement opposées, en se basant sur des arguments soi-disant irréfutables.
En voici quelques échantillons : société à raser par la base, ses structures étant trop vieilles. Société de production et de consommation absurde, abolition du profit, retour inconditionnel à la nature, à la carriole à chevaux, à la lampe à pétrole.
Soulignons qu’il est peu parlé de l’homme, de ce qu’il est, pourquoi il est, d’où il vient et où il va.
En revanche, cet homme, qui ne se connaît pas, fait beaucoup état « d’intellections multiples », de pures créations cérébrales, non soumises à la rigueur de réalités physiques et spirituelles.
Le mot civilisation ne se limite pas à la création et à l’usage de moyens techniques, mais comporte la reconnaissance de l’humanisme en tant qu’expression complète de l’homme. Si la civilisation représente l’expression complète de l’homme, alors il y a ou il n’y a pas de civilisation, mais pas de crise, comme on le prétend.
La civilisation ne peut pas être autre chose que la somme des hommes civilisés. Est civilisé celui qui fait de juste façon et de lui-même ce qui doit être fait à un moment précis, sans qu’une loi ne le contraigne, et cela partout où le sort l’a placé.
Il est l’égal de tout autre être humain par la qualité du cœur et de l’esprit, qu’il révèle dans l’accomplissement de son devoir d’homme conscient de sa dignité.
Qu’il soit intellectuel ou manœuvre, riche ou pauvre, il « est ».
Pouvons-nous dire que cet homme existe ? Que nous le voyons devant nous exister ?
Pour « Être », il faudrait que le vieil homme, quel que soit son âge, ait le courage de se débarrasser de fausses notions, de mauvaises habitudes et de complaisantes dégradations. De préjugés, jeunes ou vieux sont fortement nantis. Descartes, en son temps, s’était aperçu « qu’il n’est pas aussi aisé à un homme de se défaire de ses préjugés, que de brûler sa maison ».
Or, tout préjugé obscurcit le bon sens, qu’aucun savoir ne saurait supplanter. Au contraire, souvent le savoir mal digéré l’écarte.
Nous sommes, en ce pays cartésien, sans avoir compris que le cartésianisme postulait pour chaque homme une libération aussi complète que possible de l’esprit de tout ce qu’il n’a pas sagement reconnu comme parfaitement justifié par la raison.
C’est la recherche de l’homme vrai sous l’homme conditionné par des comportements conventionnels, par des doctrines codifiées et structurées, par des habitudes. Parfois, l’homme jeune est plus conditionné que l’homme d’un certain âge, ce dernier ayant dû, en cours de route, se dépouiller passablement de choses erronées. Cependant, il y a lieu de tenir compte qu’une certaine paresse psychologique entrave le dépouillement nécessaire à la libération de l’esprit.
La paresse psychologique est une opposition à l’évolution normale des choses vivantes. Dans une rivière, ce n’est jamais dans la même eau que nous nous baignons. « Tout s’écoule », disait Héraclite.
Il n’empêche que l’homme vrai reconnaît chez autrui l’homme vrai. Pour reconnaître l’homme vrai, il est nécessaire que soient revivifiés le respect des valeurs profondes et leur hiérarchie, terme dont la racine « hieros » veut dire sacré.
Il est donc faux de penser qu’il y a lieu de créer de nouvelles valeurs. Les valeurs sont, dans leur essence, éternelles et universelles. Il est possible d’apporter des changements dans les manifestations de ce qui est éternel et de mettre en place une hiérarchie des valeurs que l’image d’une pyramide symbolise assez parfaitement.
En acceptant son image symbolique, on pourrait dire que la pyramide est un édifice cosmobiologique, qui invite l’adepte admis à connaître ses secrets, à tenter l’ascension pyramidale. Elle conduit du carré de la base à la pointe figurant le point oméga, imageant ainsi la voie qui mène du cadre de l’existence, à la Vie qui le transcende.
Cela précisé, revenons à la hiérarchie des valeurs, qu’il faut comparer à une pyramide avec sa pointe et non à une pyramide tronquée. Ne s’exerce-t-on pas, aujourd’hui, à tout décapiter ?
A quelque étage de la pyramide que l’on s’adresse, la valeur de l’homme physique, psychique et spirituelle est sollicitée.
En soulignant l’importance de structures nouvelles, en invoquant l’impérieuse nécessité d’une plus grande justice sociale – ce que personne ne conteste – il faut néanmoins savoir de quoi on parle.
De même que le corps est constitué de cellules qui lui donne forme et consistance, de même une société est constituée par les mœurs, le mode de vie et la qualité des êtres qui la composent. Vouloir changer la société parce qu’on la trouve mauvaise n’a de sens qu’en reconnaissant la nécessité de retrouver l’homme dans sa vérité. Lui donner un cadre apte à favoriser son évolution présuppose des structures malléables.
Les structures rigides sont la prison qu’il affectionne, à défaut du courage nécessaire à une adaptation contraire au principe d’inertie qui caractérise sa nature.
L’homme se veut créateur de civilisations parfaites et de sociétés idéales, alors qu’il est dévoré par l’ambition, par l’envie et par l’égoïsme ! Peut-il créer autre chose que ce qui est, ou sera, la projection de ce qu’il est ? Est-il capable, avec simplicité, de prendre conscience de ses propres contradictions ?
Il s’élève contre la société écrasante de production et de consommation. Mais il veut jouir de ce que lui offre la technique. Cela l’amène à revendiquer des droits, sans prendre conscience et reconnaître que toute revendication de droits ne peut s’équilibrer que par la reconnaissance de l’accomplissement de devoirs.
Plus l’homme veut de droits, plus l’accomplissement de devoirs s’impose. Il n’y a de droit qu’à partir du moment où le devoir est accepté et effectivement accompli.
Mais si l’homme considère l’accomplissement des devoirs comme un asservissement, qu’il ait la franchise d’admettre que cela découle de ses exigences en continuelle expansion.
Plus il est avide, plus il est exigeant, plus il s’asservit et plus la souffrance sera le tribut qu’il aura à payer, faute d’avoir compris qu’il est le seul responsable du monde qu’il récuse.
Nous attaquons nos gouvernements en condamnant leur incapacité à alléger nos difficultés. Nous les rendons responsables des troubles et guerres qui éclatent un peu partout. Nous nous demandons ce qu’il faut penser de ces événements, en imaginant des solutions aux conflits mais, à défaut de les adopter, nous ne faisons en réalité que nous condamner nous-mêmes.
Si, donc, nous considérons que dans la société tous les hommes sont dans l’obligation de participer à sa bonne marche, à son harmonieux développement, tous les hommes sont dans l’obligation de se reconnaître une responsabilité à la place où ils se trouvent, ou qu’ils occupent. Chacun, sans exception, est responsable de ce qu’il fait, ou est chargé de faire, là où le sort l’appelle.
Être conscient de sa responsabilité, c’est être conscient de sa qualité d’homme, de sa dignité et fier de sa participation à l’œuvre commune, en accomplissant son devoir, avant d’oser revendiquer un droit.
Cette constatation nous ramène au problème que pose la jeunesse, oublieuse du fait qu’elle ne dure que ce que durent les roses, l’espace d’un matin.
Chez les Grecs, l’enfant était confié aux bons soins de la mère jusqu’à l’âge de sept ans. À partir de cet âge, le père le prenait en charge et l’initiait à tout ce qui lui serait utile, conduire une charrue ou conduire un char, et à tout ce qui répondait le mieux à la juste mesure pour le meilleur mode de vie, en harmonie avec les choses, les hommes et les dieux.
Au temps florissant de la Chevalerie, le père emmenait son fils adolescent au combat. Il l’initiait à tout ce qui pouvait lui être utile et à tout ce qui constituait l’idéal de l’époque. Dès que le fils avait fait sa « prouesse », il l’armait chevalier. Il y avait toujours lien de continuité par l’esprit. Le jeune chevalier avait le juste sens de sa dignité, de sa qualité de cœur noble, noble dans la meilleure acception du terme.
Il va sans dire que l’image idéalisée ne traduit pas la réalité de l’époque. Elle a, néanmoins, le mérite de convier l’idée d’une aspiration fondamentale qui, de nos jours, fait cruellement défaut.
Aujourd’hui, un énorme fossé est creusé entre les générations. Le lien n’est pas rompu parce qu’il ne peut pas l’être, mais il est fortement distendu.
Les parents d’un côté, et la société qui a découvert le pouvoir d’achat des « jeunes » de l’autre ont creusé le fossé. Les parents ont négligé d’assumer leurs devoirs à force de vouloir exister. La mère travaillant à l’extérieur, le père, recherchant sa tranquillité, les couples rapidement désunis, passant aux enfants beaucoup de caprices. N’est-il pas regrettable de constater que les moins de quinze ans regardent la télévision un nombre d’heures équivalant à celui de leur fréquentation scolaire ? Inutile de réclamer de meilleurs programmes. Le scintillement des images tue le temps et c’est tout ce qu’on leur demande.
À cela s’ajoute l’exploitation commerciale d’une jeunesse conditionnée par la publicité, laissant croire qu’elle fait partie d’une classe à part. Il s’ensuit que, intoxiqués par des idées politiques avant que ne soit atteint l’âge du discernement, les « jeunes » perdent le sentiment de leurs racines et s’imaginent vivre dans un monde à eux, où ils prétendent ne recevoir aucun aîné.
Les oreilles se ferment à tout ce qui est dit par les parents ou par des membres de la famille.
Ils ignorent une réflexion qu’avait faite la marquise de Sévigné : « Si les hommes sont nés avec deux yeux, deux oreilles et une seule langue, c’est qu’ils doivent regarder et écouter deux fois plus qu’ils ne doivent parler. »
Ils n’écoutent pas, ne voient pas, mais parlent, parlent entre eux, discutent à perdre haleine, font des palabres que le Littré définit par discours longs et inutiles.
Les hommes en place, doyens, recteurs, professeurs, ont oublié — par impuissance — leur véritable vocation d’enseignants et d’éducateurs. En conséquence, ce qui s’inscrivait dans les faits est arrivé. La révolution saine et normale qui aurait dû être faite par la tête est remplacée par une révolte désordonnée et parfois télécommandée.
Il n’y a plus d’union de cœur et d’esprit entre deux générations, dont l’une, cependant, est issue de l’autre.
C’est en donnant un lustre nouveau à des valeurs essentielles auxquelles il faut se référer pour ne pas violer les lois de la Vie, que l’Occident transmettra le flambeau dont il est le gardien. Un flambeau qui symbolise la quintessence de son expérience devait être la plate-forme de ce qui est, pour devenir ce qui sera.
La quintessence est l’essence la plus pure, la plus subtile que dégage l’expérience, et c’est la Tradition qui la véhicule. Lorsqu’elle n’est pas adultérée et lorsque, au-delà des formes qu’elle emprunte, on dégage le sens authentique d’une éternelle sagesse dont elle est le support, elle se mue en Loi qui trace l’itinéraire.
Pour ceux qui le suivent, il n’y aura plus de lien rompu ou distendu. Il y aura lien par le cœur et l’esprit, et sens aigu de la responsabilité librement acceptée.
La participation de tous les hommes à la bonne marche de la société, donc à son économie, dans l’acception exacte du mot, engagera chacun à mesurer la sienne et à observer avec rigueur l’accomplissement de ses devoirs. Ils découlent de la collaboration entre les hommes égaux, mais de capacités différentes, selon les possibilités inhérentes aux facultés de chacun.
La responsabilité ne va pas sans l’acceptation d’un sens critique qui justifie la position apparemment privilégiée de celui qui affirme ses qualités en se plaçant à la pointe de la hiérarchie. Il n’y a pas de véritable privilège sans sacrifice. Lui seul confère à l’homme sa dignité et, dès lors, l’Occident privilégié par les dons de la nature, se doit d’assumer sa vocation et de refuser tout ce qui la dégrade.