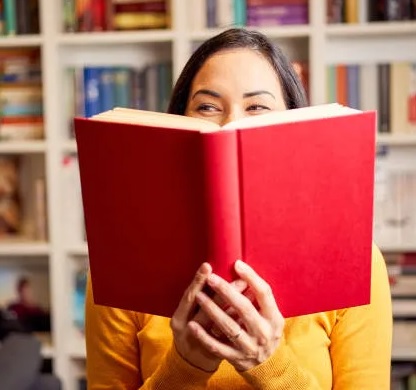En France, la rentrée scolaire en septembre s’accompagne toujours de la rentrée littéraire, avec la publication d’un grand nombre de nouveaux livres. Les gens attendent avec impatience non seulement les prix littéraires qui seront décernés à l’automne, mais aussi les soirées et les week-ends d’hiver qu’ils passeront blottis dans leur fauteuil à lire un nouveau livre. Mais est-ce vraiment le cas ? Cette année, l’édition de rentrée du magazine mensuel conservateur français L’incorrect a publié en une un article intitulé « La mort du livre est-elle inévitable ? », suggérant que la lecture pourrait bien être la dernière chose que beaucoup de Français sont susceptibles de faire.
Pendant ce temps, de ce côté-ci de la Manche, dans un long article publié le mois dernier dans le Telegraph, on nous a rappelé, comme souvent à cette période de l’année, à quel point la lecture de livres a décliné ces dernières années. Dans le cas des adultes, un sondage YouGov réalisé en début d’année a révélé que 40 % d’entre eux déclaraient n’avoir lu ou écouté aucun livre au cours de l’année précédente et 50 % n’en avoir acheté aucun.
Pour les enfants, une enquête menée par le National Literacy Trust a révélé un niveau historiquement bas dans leur goût pour la lecture, seuls 32,7 % d’entre eux déclarant aimer lire pendant leur temps libre.
Au niveau international, nous avons peut-être réussi à maintenir un niveau satisfaisant d’alphabétisation fonctionnelle chez la plupart des enfants, comme le montrent les résultats et le classement de l’Angleterre au PISA, mais nous n’avons pas réussi à inverser la tendance à la baisse de leur intérêt pour la lecture et du temps qu’ils y consacrent. Nous sommes particulièrement en retard par rapport à de nombreux autres pays pour ce qui est de susciter l’enthousiasme des enfants pour la lecture, avec seulement 29 % des enfants anglais déclarant « aimer beaucoup » lire, contre une moyenne internationale de 46 %.
Étant donné que nous avons déjà suffisamment de « crises » à gérer, je ne suis pas sûr qu’il soit judicieux d’ajouter la « crise de la lecture » à la liste, comme le font le National Literacy Trust et la National Reading Agency. Il existe un très petit nombre de personnes qui ne possèdent toujours pas les compétences de base en lecture et écriture, et un nombre beaucoup plus important, estimé à environ 20 %, qui ne possèdent pas les compétences fonctionnelles en lecture et écriture. Ce dernier problème doit être traité et peut être résolu. S’il existe une crise de la lecture, celle-ci est toutefois davantage d’ordre culturel et beaucoup plus difficile à résoudre.
Pendant la majeure partie de notre histoire, depuis l’époque hébraïque et gréco-romaine, le livre (sous toutes ses formes physiques) a été un moyen d’aider à réfléchir aux grandes questions de la vie et une voie vers l’amélioration mentale et morale de soi. Il a été au cœur de la « haute culture » qui nous a apporté le christianisme, la Renaissance, les Lumières, le romantisme, le modernisme et toutes les idéologies postmodernes fondées sur le livre, au sujet desquelles nous nous battons actuellement. Si même nos jeunes les plus brillants ont de plus en plus de mal à lire — comme nous l’entendons même de la part des tuteurs des meilleures universités —, tout cet héritage culturel va-t-il continuer à être étudié, critiqué et transmis aux générations futures et, si ce n’est pas le cas, comment les générations futures pourront-elles construire du nouveau en l’absence de ces fondements ?
C’était le thème de l’ouvrage du sociologue Frank Furedi, Power of Reading. From Socrates to Twitter, qui déplore la façon dont l’importance centrale de la lecture a été supplantée par une approche utilitaire mettant l’accent sur l’alphabétisation fonctionnelle. Il fait remonter cette tendance au XIXe siècle, mais la considère comme de plus en plus dominante depuis les années 1960. Elle a pour effet de transformer les écoles en de simples « lieux de formation professionnelle ». Face à ce défi, il affirme que « redécouvrir les vertus de la lecture » — une lecture qui incite à réfléchir à la manière de vivre sa vie et d’accepter sa mort — constitue l’un des objectifs culturels les plus importants de l’époque moderne.
Tout au long de l’histoire, cette culture de la lecture était surtout l’apanage d’une élite. Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle, avec l’essor de l’édition de masse et l’introduction de l’enseignement primaire public, que l’accès à un niveau élevé d’alphabétisation a commencé à s’étendre à l’ensemble de la population. C’est à cette époque que, suivant l’exemple des classes moyennes et supérieures, les ouvriers et ouvrières de tout le pays ont été incités à acheter des exemplaires de Dickens, de Bunyan, de Ruskin et d’autres auteurs dans le but de s’instruire. Ce qui est si triste aujourd’hui — et, si vous voulez parler de crise, c’en est vraiment une —, c’est notre incapacité à convaincre non seulement la masse de la population, mais aussi une grande partie de l’élite des « vertus de la lecture », comme les décrit Furedi, à une époque où nous disposons de moyens sans précédent pour y parvenir.
La menace qui pèse actuellement sur la littérature et la lecture est le message de rentrée scolaire du magazine français L’incorrect que j’ai mentionné plus tôt. Son article principal est une conversation sur la lecture entre le philosophe Alan Finkielkraut, le critique Éric Naulleau et le romancier Patrice Jean. Leur inquiétude ne porte pas sur le nombre de livres. Il y en a en effet trop, disent-ils, dont 484 nouveaux romans dans la rentrée littéraire actuelle, dont beaucoup, selon L’incorrect, manquent totalement d’ambition littéraire, reprennent tous les clichés du moment et ne méritent que d’être pilonnés.
Ils sont également moins inquiets que nous puissions l’être au sujet des écoles, considérant comme acquis que les élèves retournent ce trimestre dans leur lycée pour lire Balzac, Racine et Montaigne (prenez-en bonne note, Bridget Phillipson). Le problème est que ce qui se passe à l’école n’est pas valorisé en dehors de celle-ci. La plupart des enfants ne rentrent pas chez eux dans un environnement où leurs études sont considérées comme ayant une grande valeur en soi, même parmi les porteurs traditionnels de la transmission culturelle, la bourgeoisie. L’ancienne classe cultivée a cédé la place à une nouvelle élite — que nous ne connaissons que trop bien en Angleterre — qui « se croit rebelle » parce qu’elle n’a que du mépris pour l’héritage des siècles passés et « s’imagine moralement supérieur à tout ce qui l’a précédée ».
Les figures emblématiques de cette élite méprisée sont Jack Lang, ancien ministre de la Culture, qui a transformé ce poste en un poste responsable de « tout ce que vous décidez d’appeler culture » tant que ce n’est pas la « culture » au sens traditionnel du terme, et Emmanuel Macron, qui a proclamé en 2017 qu’il n’existait pas de « culture française », mais qu’il existait « une culture en France, et qu’elle était diverse ». Malgré cela, Finkielkraut considère que les principales menaces qui pèsent sur la lecture, et qui remontent au début du XXe siècle, sont d’ordre économique et technologique plutôt que politique : le cinéma, la radio, la télévision et maintenant Internet et les réseaux sociaux. Tout cela a relégué la lecture sérieuse — celle que le grand critique F.R. Leavis a toujours recherchée, celle où le livre vous aide à appréhender « le sens de l’existence » — à la marge de nos vies, voire hors de celles-ci.
Pour Finkielkraut et ses deux collègues, l’avenir s’annonce sombre. Ils comparent la disparition, livre après livre et auteur après auteur, de la conscience collective d’une partie du patrimoine littéraire français à la perte, à chaque fois, d’une espèce vivante. Ils s’accordent à dire qu’il existe de bons écrivains contemporains, mais estiment que la France a dérivé vers un monde « post-littéraire » et que l’avenir ressemblera de plus en plus aux anciennes dictatures communistes, où, loin des universités, des institutions littéraires et des librairies qui ont succombé au « wokisme », la littérature ne survivra que « dans les catacombes ».
Existe-t-il une alternative à ce pessimisme français plutôt exagéré ? Voici quelques suggestions récentes, de ce côté-ci de la Manche, pour encourager les gens à lire — les petits romans préférés du Reader’s Digest, les romans sur le football, un club de lecture TikTok pour les « curieux morbides », des résumés audio de 15 minutes générés par l’IA (pour terminer « Bleak House pendant que vous promenez votre chien ») — pourraient bien être un moyen de ramener certaines personnes vers les livres, mais le mépris gaulois qu’elles rencontreraient à juste titre n’est que trop facile à imaginer.
Trois mesures pourraient être prises. L’une est immédiate, les deux autres s’inscrivent dans le long terme.
Premièrement, nous devons intensifier la lutte contre les institutions culturelles, les éditeurs, les librairies, les bibliothèques et les universités qui agissent comme des commissaires politiques, limitant notre accès à certains livres — y compris ceux qui sont abandonnés bien avant d’arriver à l’imprimerie — que nous aurions autrement pu lire.
Deuxièmement, nous devons retrouver l’idée — qui subsiste encore dans notre programme scolaire national — que le rôle des écoles est de transmettre des connaissances et un héritage culturel, et non d’endoctriner les enfants sur les questions d’actualité. Nous avons besoin de plus de textes classiques, et non moins, et d’un enseignement de l’histoire pour tous jusqu’à l’âge de 16 ans, comme dans certains autres pays (Bridget Phillipson, veuillez en prendre note).
Troisièmement, nous devons revenir à l’idée originale de l’université comme lieu offrant à tous une « éducation libérale » générale, parallèlement à leur spécialisation, comme le recommandaient John Stuart Mill et le cardinal Newman et, comme le met en pratique, entre autres, la nouvelle université d’Austin, au Texas, où on lit encore les « grands livres ». C’est seulement ainsi que nous pourrons recréer le type d’élite dont nous avons besoin et qui pourrait un jour nous montrer à nouveau comment nous devons lire.
Le Dr Nicholas Tate a été conseiller principal en matière de programmes et d’évaluation auprès des ministres britanniques de l’Éducation de 1994 à 2000 et conseiller auprès des ministres français de l’Éducation de 2001 à 2007. Il est actuellement conseiller auprès du Mathias Corvinus Collegium (MCC) en Hongrie.
Texte original publié le 14 septembre 2025 : https://dailysceptic.org/2025/09/14/are-we-heading-for-the-catacombs-thoughts-for-the-rentree-on-the-future-of-reading/