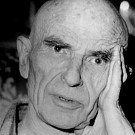(Revue 3e Millénaire. Ancienne série. No 11. 1983)
La dureté de la vie scolaire, ses terribles horaires, l’inhumanité du cadre de vie, les programmes trop chargés, le manque d’éducation physique, etc. la litanie des souffrances des petits enfants est longue… et, malgré bien des réformes qui ont beaucoup changé l’école d’il y a quarante ans pour nous conduire à l’école d’aujourd’hui bien plus accueillante, si bien changée même qu’elle compte de plus en plus d’illettrés ! Aimé Michel plonge dans le passé et nous entraîne sur les bancs d’une école impitoyable (et inimaginable de nos jours) d’où sont sortis une grande partie des plus exceptionnels esprits de notre temps.
L’université, devenue à l’âge de la technique l’organe essentiel du corps social, son sexe pour ainsi dire puisqu’elle est censée assurer sa reproduction et son évolution, l’université n’est plus qu’une grande machine hagarde accusée de tous nos maux. Et en effet, pour ne considérer que le chômage, serions-nous chargés de plus de deux millions d’assistés s’ils avaient reçu des compétences utilisables ? Il plaît à notre vanité de croire que si le Japon échappe à la crise, c’est qu’il accepte des modes de vie inhumains. Mais les Japonais, que j’ai eu l’occasion de voir un peu au travail, ne sont pas plus que nous en acier. En moyenne, je crois qu’ils travaillent moins vite que nous. Je crois même que personne au monde ne travaille aussi vite que nous.
Alors ? Pourquoi l’Université n’a-t-elle pas su donner à nos deux millions de laissés-pour-compte le savoir et l’habileté qu’ils seraient bien aise de vendre très cher aux entreprises ?
Je partirai d’un postulat : il n’y a pas de crise de l’Université ; sa prétendue crise n’est que la traduction criarde de la crise de la société française.
Car d’abord, s’il existait une crise propre à l’Université, qui faudrait-il en accuser ? Ses maîtres ? Mais jamais il n’y eut en son sein tant d’angoisses, tant de déprimes et même de désordres psychiques, manifestations collectives d’une conscience souffrante. Comme on le sait, l’Université a ses hôpitaux psychiatriques spéciaux. Les maîtres sont les premiers à souffrir de leur échec.
Ses règles alors ? Son fonctionnement tel que l’ont fait d’innombrables réformes ?
Mais rappelons-nous que le lycée de 1968 fonctionnait toujours selon les règles du lycée napoléonien lequel n’était qu’une laïcisation du collège jésuite conçu à une époque révolue. J’ai encore porté l’uniforme bleu et la casquette plate à galon d’argent en 6e et en 5e avant la dernière guerre. Ce système fonctionnait parfaitement dans un dédain presque complet des changements de régime. C’est bien qu’il fondait sa force, à vrai dire merveilleuse, sur la stabilité séculaire de la société française profonde et de notre singularité déjà affirmée dans les discours de Vercingétorix !
On cite souvent avec ironie le mot de Georges Pompidou prononcé en 1968 un mois avant les premiers séismes de Nanterre : « s’il est une réussite dont nous pouvons être fiers, c’est l’Université. »
Je prétends que Pompidou avait raison. L’Université présentait encore, au moment où elle allait s’effondrer, tous les caractères de notre grandeur passée. Je me rappelle avoir, un peu avant, assisté à un congrès international de physique. Il y avait là plus de prix Nobel que je n’en vis jamais. Ils parlaient avec admiration de l’école française. Un Allemand qui avait beaucoup voyagé m’affirmait que, « depuis Athènes, on n’avait rien fait de mieux ».
C’était sans doute vrai. Mais cette merveilleuse réussite s’élevait sur un chaos social encore invisible : pour la première fois, le vieux peuple paysan désertait sa campagne et perdait son âme dans des grands ensembles.
*
* *
Mais laissons-là ces généralités improuvables. Je voudrais présenter ici un document, inconnu en France autant que je sache, et qui montre par un cas extrême comment a fonctionné, pendant des siècles, l’école la plus féconde de l’histoire. Cet exemple est un défi aux théoriciens qui ont réussi, en quinze ans, à détruire l’école française.
Ce document est une enquête intitulée « Freeing capacity to learn » (comment libérer la faculté d’apprendre) conduite aux États-Unis à la fin des années cinquante par la psychologue et pédagogue Dorothy Lee à la demande d’une association pédagogique, l’Association for Supervision and Curriculum Development, l’ASCD à Washington.
Les membres de cette association de professeurs avaient, comme tout le monde, été frappés par l’extraordinaire contribution des juifs d’Europe centrale et orientale, au savoir et à la culture du XXe siècle. Il y a d’abord grands noms, Einstein, Bohr, Dirac, Born, Feynman, Kafka, Fermi, Teller, Koestler, Popper… sans parler des champions toutes catégories du prophétisme délirant mais marquant leur siècle : Marx, Freud, Trotsky, Marcuse… Il y a surtout le nombre infini de juifs ashkénazes moins illustres que l’on trouve au palmarès de tous les achèvements intellectuels en musique et autres arts, aux Nobel et d’une façon générale dans n’importe quelle bibliothèque ou répertoire des arts et des sciences. Dorothy Lee proposa de rechercher les facteurs de ce succès en enquêtant sur l’école juive en Europe centrale et orientale jusqu’à la catastrophe nazie.
– Dans la culture des juifs d’Europe orientale, écrit-elle, un puissant désir d’apprendre était absolument nécessaire, ne fût-ce que pour atteindre les premiers degrés de l’éducation. En effet, les enfants allaient à l’école bien avant que leurs yeux mêmes pussent accommoder convenablement sur les minuscules signes du livre ; leur programme était sans attrait et centré sur une langue étrange qu’ils ignoraient, l’hébreu. L’enseignement était pédagogiquement insensé, les instituteurs dénués de toute compassion et compréhension, les salles de classe, sinistres.
« Seuls les garçons allaient à l’école 1. Ils étaient arrachés aux bras de leur mère pratiquement aux langes. Il était assez commun de commencer les études à trois ans, et toujours avant cinq ans. Le Kheder (salle d’école) où le petit garçon était envoyé est décrit comme surpeuplé, bruyant, étouffant, petit, mal éclairé, meublé d’une seule longue table et de bancs durs et sans dossier où les petits garçons restaient assis dix heures par jour, cinq jours et demi par semaine.
« Les premiers livres d’études étaient des livres de prières, sans ornement ni illustration. L’enfant devait, dans ces livres, apprendre d’abord les lettres, puis les mots d’une langue inconnue, ensuite
mémoriser chaque mot par la mécanique d’une répétition inlassable. Ce n’est que plus tard qu’on expliquait le sens, qu’il fallait aussi apprendre par cœur. En dernier lieu, on donnait à l’écolier le sens de la phrase, mais sans l’expliquer.
« En quelques mois, aussitôt qu’il pouvait lire, on le mettait au Pentateuque 2 certes plein d’histoires intéressantes, mais pas pour un garçonnet de quatre ans. Il devait notamment apprendre chaque détail rituel du Lévitique.
« Il n’y avait presque aucune relâche dans cet effort de dix heures. Dans l’après-midi, le maître allait une heure à la synagogue et les enfants pouvaient jouer dans la cour. Quelquefois, l’enfant rentrait à la maison après neuf heures ininterrompues et retournait à la nuit pour encore deux heures d’étude. Un bref moment était prévu à la mi-journée pour un déjeuner composé la plupart du temps de pain sec. Un colporteur venait vendre un peu de soupe chaude aux plus argentés.
« Il n’y avait aucun jeu éducatif pour soulager l’ennui de l’étude, aucun crayon ni papier pour s’amuser à dessiner. L’écriture n’était pas au programme (…) Tout affaiblissement de l’attention était sévèrement puni.
« La plupart des enfants allaient nu-pieds. Ils apportaient une chandelle pour rentrer chez eux à la nuit. (Ici, Dorothy Lee remarque qu’au Yémen l’apprentissage était encore plus dur et que les enfants, à la sortie de l’école, ne savaient lire qu’à l’envers, n’ayant appris que sur l’unique livre du Kheder tourné vers le maître).
« Tout cela, pourrions-nous croire, marchait par l’enthousiasme du maître, son amour de l’enseignement et son dévouement à ses petits élèves. Loin de là ! La plupart du temps, le maître est décrit comme ignorant, repoussant, injuste et cruel. Sholeim Aleichem rapporte que les corrections étaient si ordinaires dans son école que nul n’en avait honte et qu’ils riaient des traces de coups : « Quand je me marierai, on ne les verra plus ». Le maître est le plus souvent décrit comme un bon à rien, tombé dans l’enseignement après avoir tout raté.
« Et cependant – poursuit Dorothy Lee, de ces chiourmes sordides, sortait un peuple dont le plus cher désir était de devenir un savant 3. Comment cela est-il possible ?
« Moi, malheureux ? répondit à la psychologue américaine un juif de Bessarabie qui avait commencé d’étudier à trois ans. Pas du tout, j’apprenais à lire les chants du rituel, ceux de mon père, de mon grand-père, j’étais fier ».
« Car à la maison, le père consacrait beaucoup de temps à l’étude des livres sacrés, et c’est surtout alors qu’il s’occupait de son enfant, le berçant tandis qu’il chantait en suivant du doigt les lignes. Savoir l’hébreu, c’était entrer dans le monde du père 4… C’était aussi mériter le respect et atteindre le statut d’adulte… Depuis la plus tendre enfance, le garçon baignait dans la révérence du savoir. Les berceuses chantées par les mères rêvaient à la science future du garçon et aux fiançailles de la fille avec un savant. »
Puis l’enfant sait son Pentateuque. Alors il passe à l’étude du Talmud et tout change :
– Désormais, il ne s’agit plus d’apprendre aveuglément, mais d’affirmer sa personnalité (searching for one’s self), d’exercer son imagination, de proposer des synthèses originales, de poser des questions neuves, et surtout de ne jamais accepter un mot sans le creuser de toutes ses implications, même contre un rabbi ou la Torah… L’enfant était encouragé à comparer, à contester toutes les interprétations, à trouver la sienne propre. Ce nouveau devoir requérait de l’enfant toute sa personnalité, sa mémoire, son imagination, sa logique, son audace à disputer avec son maître en mobilisant toute sa subtilité et sa perspicacité. Un témoin se rappelle tous ces garçons pressés autour du maître, vociférant des objections, contestant chaque phrase : le professeur encourageait notre ardeur ».
Le rapport de Dorothy Lee n’est pas une apologie de l’éducation ashkenaze au cours des siècles ayant précédé sa destruction par le nazisme puis le communisme, et l’on ne peut qu’être d’accord avec ses critiques : machisme intellectuel, tension mentale insupportable, incertitude sur la santé psychique ultérieure de l’adulte qui a « craqué », d’autres encore qui viennent à l’esprit. Mais à l’opposé, il faut admettre la prodigieuse productivité de ce système quand les portes du ghetto s’ouvrirent sur le vaste monde et que d’innombrables esprits surentraînés commencèrent d’exercer, dans toutes les branches de la culture universelle, la formidable ardeur jusque-là concentrée sur le Talmud.
Combien de fois ai-je discuté de ces choses avec mon vieil et cher ami Jacques Bergier, lui-même juif d’Odessa et petit-fils de rabbin.
Mais non, mais non, répétait-il, les juifs d’Europe centrale n’ont rien de particulier. Seulement, grâce à l’Inquisition et à Hitler, tous les c… sont morts. Aussi beaucoup d’autres mais je parle des survivants. Et surtout vous oubliez le numerus clausus : l’autorisation d’étudier ne leur était délivrée qu’au compte-gouttes. Que feriez-vous si l’on vous interdisait d’étudier ? Vous y consacreriez secrètement douze heures par jour. La seule réforme de l’Université ayant une chance de réussir serait de fermer toutes les écoles, de déporter les professeurs dans les pays du tiers monde désireux de s’instruire et de fusiller tout individu surpris avec un livre en mains. »
Ainsi parlait « Bergier l’Admirable ». Lui-même lisait en moyenne quatre à cinq livres par jour, et de temps à autre en dictait un en quelques après-midi.
Quand je pense à lui, mon vieux frère en esprit, la bestiale imbécillité de l’holocauste et du rideau de fer me serre le cœur. Est-elle à jamais tarie, la misérable et glorieuse source de l’Est ?
Mais plus près de nous, quand pourra-t-on de nouveau comparer l’école française à Athènes ? Ce sera, je crois, quand nous aurons retrouvé la fierté de notre différence. La différence, nous la voyons bien, et sans trop chercher. Mais nous avons quelques raisons de douter qu’il y ait lieu d’être fiers. Pour le moment.
P.S. – Je crois, mais ce serait repartir vers une autre idée, que la folie de notre temps est d’avoir voulu construire des sociétés et accessoirement des écoles adaptées à l’homme et à l’enfant moyens. Or il n’y a ni homme, ni femme, ni enfant « moyens ». Nous sommes tous des exceptions. Toute créature humaine est une exception, ou bien n’est pas humaine. Lieu commun, assommant à la fin, la crise de l’adolescent « en quête de son identité ». Ce n’est pas son identité qu’il cherche, c’est sa différence. Son identité l’accable, et il rue.
– Dans mon enquête, remarque Dorothy Lee, j’ai trouvé des enfants apprenant réellement à lire avant d’y être (selon nos normes) biologiquement prêts, et montrant leur capacité de concentration alors que, dit-on, ils ne sont pas encore en état de se concentrer.
Réduire à la norme est la sinistre lubie de toutes les idéologies de crétinisation, si l’on me permet ce pléonasme. Il faut n’avoir qu’un grelot en tête pour se croire détenteur du futur. Tout lourdaud a le droit de le croire, de l’écrire, même de le prêcher. Mais pour y réduire les hommes, il faudra, pensez-y, les tuer tous.
1 On remarquera que parmi ces juifs ashkénazes, seuls les hommes se sont d’abord singularisés par leur supériorité. A.M.
2 Les cinq premiers livres de la Bible dont le Lévitique et les Nombres, particulièrement rebutants.
3 Non pas « scientist » mais « scholar », homme instruit.
4 J’ai lu en 68 ce graffiti sur un mur de la Sorbonne : « il faut tuer papa ». Peut-être faudrait-il aussi se rappeler le livre de Freud sur Moïse, remarquable parricide culturel.