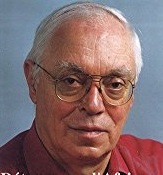(Revue Le chant de la licorne. No 24. 1988)
Les relations entre Orient et Occident et leurs influences réciproques constituent un vaste sujet, qui aujourd’hui nous concerne de près, mais dont les racines sont très anciennes
On oublie parfois un peu trop vite que notre civilisation fait partie du groupe hindo-européen, que nos ancêtres sans doute les plus représentatifs sont venus des régions de la Mer Caspienne, et que nos cousins, au lieu d’aller vers l’Ouest en suivant la trajectoire du soleil, sont partis vers le Sud pour s’installer sur les hauts-plateaux de l’Iran et de l’Afghanistan, ou dans les riches vallées de l’Indus, du Gange ou du Brahmapoutre.
Il ne faut pas oublier non plus que ceux d’entre nous qui se disent chrétiens sont, selon la puissante formule du pape Pie XI, spirituellement des Sémites.
Quand le christianisme s’est implanté dans l’Empire Romain, il était perçu à la fois comme une secte juive et comme un de ces nombreux cultes à mystères qui venaient d’Égypte, de Syrie, d’Asie Mineure, de Chaldée, de Perse… Ces deux stéréotypes contraires n’étaient pas entièrement faux.
Le christianisme est bel et bien une secte juive qui a réussi mieux que les autres en s’universalisant ; mais par sa théologie et ses rites, il est avant tout célébration du mystère de la mort et de la résurrection d’un Dieu fait homme pour le salut du monde. On comprend qu’il ait été difficile aux gens de l’époque de le différencier clairement des autres religions de salut et cultes initiatiques.
Nous constatons, dans notre société actuelle, d’innombrables influences orientales, japonaises, chinoises, indiennes, persanes, arabes, turques, russes, balkaniques, etc. Mais tout ceci est quasiment insignifiant en comparaison de celles qui avaient cours il y a deux mille ans. La religion officielle romaine s’est transformée de fond en comble avec l’hellénisation, puis avec l’instauration du culte du Soleil autour de la personne des empereurs, à l’imitation des souverains orientaux. Alexandrie a fait de plus en plus figure de capitale culturelle et de véritable plaque tournante entre Orient et Occident. Des missionnaires bouddhistes semblent s’y être installés. La Chaldée et la Perse ont exercé une influence déterminante sur le judaïsme postexilique, et donc par ricochet sur le christianisme. L’Inde n’était nullement inconnue. Dans le pythagorisme, qui a exercé une si grande influence sur la pensée hellénistique, platonicienne et hermétique, nous trouvons probablement une incidence directe de la pensée indienne. On pourrait multiplier à l’infini les exemples pour montrer qu’aux origines de ce que nous appelons aujourd’hui l’Occident, nous trouvons massivement des apports orientaux de tout genre. Ils sont devenus la substance même de notre civilisation en ce qu’elle a de plus spécifique, de plus intime.
Lux ex oriente
Il faut se souvenir aussi du fait que le berceau premier du christianisme se trouve en Syrie, en Mésopotamie, en Égypte et en Asie Mineure. L’Italie, la Gaule, l’Espagne, la Germanie, les Bretagne ont fait pendant des siècles encore figure de pays de mission. L’Inde et l’Éthiopie étaient évangélisées en même temps qu’elles, souvent même avant. Les évêques d’Occident étaient quasiment absents des conciles œcuméniques du premier millénaire. Avant saint Augustin (un Berbère), l’élucidation théologique de la foi chrétienne fut presque entièrement affaire d’Orientaux. Il en est parmi nous qui se souviennent de ces grand-messes en latin d’avant le concile : l’Évangile y était proclamé (si l’église était bien orientée, c’est-à-dire le chœur vers le soleil levant) en direction du Nord, parce que celui-ci symbolisait les terres païennes qui devaient encore être évangélisées. Sur le plan liturgique, les habitudes du siège de Rome ne se sont généralisées en Occident qu’avec les Carolingiens. La Gaule a connu pendant plusieurs siècles une très belle liturgie d’origine syrienne. Tout le premier christianisme celtique d’Irlande fut typiquement syrien, égyptien, grec, et nullement romain.
Le tournant carolingien
Le règne de Charlemagne, lui qui a fait la guerre aux Sarrasins, mais a entretenu avec l’Orient byzantin et arabe des relations suivies, représente un tournant tout à fait majeur. Aux yeux des Orientaux, l’empereur chrétien résidait à Constantinople, et il était incompréhensible qu’un autre empire marqué de la croix se constituât dans ces régions du Nord, peuplées de barbares, de païens, ou tout au plus de chrétiens mal dégrossis. La collusion entre Charlemagne et la papauté a d’autre part gonflé le prestige de ces patriarches d’Occident qu’étaient les papes, les a coupés un peu plus des quatre autres patriarcats (Constantinople, Antioche, Jérusalem et Alexandrie), les a habitués à raisonner en termes d’empire et selon des catégories politiques de pouvoir, ce qui va bientôt avoir sur l’évolution de la chrétienté des conséquences incalculables. On sait aussi que Charlemagne avait la malencontreuse tendance à se mêler de théologie, jusqu’à induire l’ajout du Filioque au symbole de Nicée et à contrer la doctrine des images définie au septième concile œcuménique. Toutes les conditions étaient ainsi réunies pour le grand schisme, qui fut consommé sous le pape alsacien Léon IX en 1054. Cette date est d’ailleurs largement arbitraire, car depuis longtemps l’affectio societatis, comme diraient les juristes, n’existait plus. Il est vrai que les querelles théologiques ont le plus souvent servi de manteaux à des rivalités d’un autre ordre. Mais même ce qui ne relève que de l’idéologie et du prétexte a aussi sa réalité, une réalité qui peut se révéler incroyablement pesante.
Durant le second millénaire, les échanges Orient-Occident ont connu des hauts et des bas. Les croisades furent des guerres, étonnamment riches en relations avec l’Islam, et par contre désastreuses pour les rapports avec les chrétiens d’Orient. Les tentatives de réunion, principalement aux conciles de Ferrare et de Florence, se sont soldées par des échecs. Avec la chute de Constantinople et l’emprise turque, le partenaire oriental s’est trouvé dans une situation de totale infériorité. Une masse incroyablement lourde de rancœurs, de méfiances, de préjugés, de malentendus, de suspicions, de ressentiments et de raideurs va désormais peser sur ces relations, et ce jusqu’à nos jours.
Lorsqu’on parle des influences orientales qui s’exercent sur nous et nos contemporains, il faut garder à l’esprit ces données anciennes. De toute façon, et à tout point de vue, culturel, philosophique, religieux, nous sommes littéralement pétris d’apports orientaux depuis les origines de notre civilisation. Si depuis un siècle et demi, les échanges ont repris massivement, ce n’est que la suite d’une très longue tradition.
L’exemple de l’acupuncture
Prenons, en matière de médecine, le cas de l’acupuncture, une technique de siniatrie parmi beaucoup d’autres, connue en Europe d’assez longue date, mais ne correspondant à rien dans notre propre tradition médicale. Parmi les thérapeutes qui utilisent aujourd’hui chez nous cet art des aiguilles, on peut en distinguer trois sortes. Il y a d’abord ceux pour qui l’acupuncture ne doit pas être isolée du reste de la médecine chinoise traditionnelle, ni de la vision du monde taoïste dont elle est imprégnée ; pour l’exercer correctement, il faut donc entrer dans cet univers chinois, si déroutant pour nous, s’initier à la langue et aux auteurs anciens, autrement dit adopter cette médecine telle qu’elle nous est transmise, avec les modes de penser qui lui sont liés.
Il y a ensuite ceux qui, à l’extrême opposé, cherchent à isoler la technique des aiguilles de l’arrière-plan culturel, idéologique, voire religieux qui était le sien, et à lui trouver de nouvelles justifications, de nouvelles explications de type « scientifique », à la manière occidentale; ils refusent de se faire mentalement chinois pour appliquer une technique qui se révèle efficace et qu’ils estiment neutre, et ils revendiquent le droit de rester ce qu’ils sont, à savoir des Occidentaux, ayant leur conception à eux de la science. En Chine même, beaucoup de médecins abondent en ce sens et cherchent à réinterpréter un art ancien en termes nouveaux.
On rencontre enfin des thérapeutes qui renoncent à toute justification anthropologique ou scientifique, et ne voient pragmatiquement en l’acupuncture qu’une technique « qui marche ».
Quand on considère les choses historiquement, on s’aperçoit que la première attitude a prédominé au début. Ceux qui, initialement, ont fait connaître l’acupuncture, ont essayé de la présenter dans sa pertinence traditionnelle, entreprise difficile s’il en est. On peut dire que l’Orient, dans un premier temps, leur est apparu comme un modèle à imiter, dont les leçons devaient être apprises telles quelles. Ce n’est certes pas l’ethnologue que j’essaie d’être qui va contester cette attitude. Tous ceux qui ont fait un effort considérable pour se familiariser avec la vraie médecine ancienne de la Chine pourront sans doute témoigner de l’immense enrichissement qu’ils en ont tiré, bien au-delà du plan de la simple pratique médicale. C’est même la seule attitude qui lui rende véritablement justice et la respecte en ce qu’elle est. À ceux qui pensent pouvoir faire l’économie de cet approfondissement, il manquera toujours quelque chose.
Mais dans un second temps, une fois la technique bien implantée et assimilée, une fois qu’on a vu clairement, avec des yeux d’Occidentaux, quels en sont les apports possibles et les limites, personne ne peut empêcher toutes sortes d’innovations, de réinterprétations, de perfectionnements et d’extensions. On ne comprendrait pas que ceux-ci soient déclarés illégitimes au nom d’une tradition figée. Un élément venu d’Extrême-Orient se trouve ainsi détaché, petit à petit, de son contexte originel et utilisé, jaugé, évalué, expliqué par rapport à un cadre de référence qui n’est pas le sien. Il fait bouger la médecine occidentale et y introduit une nouvelle dimension. Il ne fait plus figure de modèle, mais de ferment.
L’exemple du yoga
Ce qui s’observe à propos de l’acupuncture se retrouve également dans cette technique extraordinaire qu’est le hatha-yoga. Là aussi, nous voyons les uns le prendre avec son contexte hindou, la philosophie qui le sous-tend dans son pays d’origine, les conceptions de l’homme et de sa destinée qui lui ont donné sens, et il devient alors une voie spirituelle, si particulière qu’il est quasiment impossible de l’harmoniser avec une autre vision des choses, chrétienne par exemple; et nous voyons les autres le considérer comme une technique d’éveil en soi, neutre, détachable du fond qui lui a donné naissance, et que l’on peut insérer valablement, en élaguant, en prenant et en laissant, en des contextes totalement différents, de sorte qu’à la limite il ne serait pas déplacé de parler de yoga chrétien.
Quand nous voyons chez nous le yoga utilisé par des maîtres de gymnastique, des médecins, des kinésithérapeutes, des relaxologues, des naturopathes, des religieux, dans le but d’entretenir la forme physique, d’éveiller les glandes endocrines, d’acquérir calme et maîtrise intérieure, d’améliorer son sommeil, ou de se préparer à la méditation ou à la prière, des buts en soi tout à fait légitimes et positifs, nous sommes bien en pleine réinterprétation. On prend dans leur matérialité quelques éléments isolés du hatha-yoga, et on laisse de côté ce qui leur donnait sens en contexte hindou. Mais on peut alors se demander s’il est encore légitime de parler de yoga puisqu’il n’en reste quasiment rien, sinon une gymnastique de postures.
J’ai essayé de pratiquer dans ma jeunesse la méthode de Dom Déchanet, ce Vosgien qui se sentait une vocation de prêtre, mais avait une si mauvaise santé qu’aucun séminaire ne voulait de lui. Devenu bénédictin dans une abbaye missionnaire belge, il s’est patiemment reconstruit une santé de fer, tout seul, à plus de quarante ans, avec un cours de yoga, au point qu’on a pu l’envoyer comme prieur de monastère au Katanga. Son livre, La voie du silence, l’expérience d’un moine, a eu un immense retentissement dans les milieux religieux et m’avait beaucoup séduit ; je n’en ai malheureusement tiré que d’abominables torticolis… Un indianiste qui en fit la recension s’était demandé s’il était encore légitime de parler de yoga, et il proposa d’appeler ces exercices très simples des « yogoïdes ». Dès la page de garde, le Père Déchanet précise son projet : « Christianiser le yoga, tel yoga ? Non ! Faire servir à la vie chrétienne certaines disciplines yogiques. » Et voici son expérience de moine : « Je pris l’habitude de lier la méditation silencieuse aux postures et exercices respiratoires du yoga. Je « m’accrochais » tout de suite, et c’était la plupart du temps au Christ tel qu’il apparaissait dans l’évangile du jour. Un mot tombé de ses lèvres, un geste de ses mains saintes et vénérables me retenaient, ou bien alors un aspect de sa personne ou de son message. Dix minutes, un quart d’heure et plus, je restais ainsi, immobile au mental comme au physique. C’était l’heure ou naguère encore je travaillais à mes livres, à mes articles… Maintenant, c’est le silence, le silence tout plein de Dieu… Or, de cette fidélité – combien facile – à la prière, mon travail ne souffre pas : je n’ai jamais tant écrit » (p. 11).
Ce qui est dit du yoga peut l’être aussi du Zen. L’introduction de la méditation zen en Europe est initialement due à un Jésuite autrichien, le Père Lassalle, et au psychothérapeute allemand Graf Dürckheim. Aujourd’hui, on ne compte plus les religieux catholiques de tous ordres qui non seulement la pratiquent, mais l’enseignent et la promeuvent. Ces éléments hérités d’un Orient non-chrétien ont ainsi provoqué une fermentation considérable dans les milieux chrétiens depuis une bonne quarantaine d’année.
Mises en garde
Pourtant les mises en garde n’ont pas manqué, et elles ne datent pas d’aujourd’hui. Des hommes qui avaient la plus grande admiration et une connaissance particulièrement approfondie des sagesses d’Orient ont mis régulièrement en garde les Occidentaux contre les dangers qu’elles pouvaient représenter pour eux, si on s’y lançait sans discernement. Je voudrais relever trois opinions d’origines tout à fait différentes.
La première est celle du psychiatre zurichois Carl-Gustav Jung, qui a écrit de savants commentaires du Yi King, du Secret de la fleur d’or, expression de la sagesse taoïste, du Bardo Thodol, livre des morts tibétains, un de ses ouvrages de chevet, et qui s’est beaucoup intéressé à la pratique du mandala. Le Yoga, dit Jung, fait partie intégrante de toute une conception du monde dont l’Occidental n’a pas même idée ; qu’il ne s’imagine donc pas « y être » quand il se sera gargarisé de termes exotiques et aura mimé quelques contorsions. Cette imitation du dehors risque fort de mener à une « künstliche Verdummung », à un abêtissement artificiel de notre raison occidentale (« Zur Psychologie des Östlichen Meditation » », 1943). Dans son commentaire du Bardo, il signale les dangers du Kundalini yoga, et n’hésite pas à parler à son propos de « psychose artificiellement provoquée » qui, à la faveur d’un faux pas, peut s’installer comme psychose réelle. Au moment même où Jung expliquait le sens et la valeur du Zen japonais, il concluait : « Les postulats spirituels nécessaires au Zen font défaut à l’Europe. Une transmission directe du Zen n’est, dans la situation où se trouve l’Occident, ni recommandable, ni d’ailleurs, en général, possible » (préface au livre de Suzuki sur le Bouddhisme Zen, 1955).
« C’est une erreur pour les Occidentaux, observe-t-il, de tourner le dos avec dédain à leur science à eux pour singer à la lettre des pratiques orientales. On n’aide pas vraiment un pauvre par une aumône, mais en lui procurant un travail par lequel il peut s’aider lui-même. Or, à l’égard de l’Orient, nous faisons figure de pauvres qui tendent la main. N’avons-nous pas mieux à faire que cela ? Eh bien si : nous avons « à faire », à acquérir par notre travail ce que nous entendons posséder. Et ce travail ne saurait avoir un impact pour nous que sur des bases qui prennent en compte la structure de notre esprit et de notre tradition. »
« Ne soyons pas, écrit-il dans son introduction au Secret de la fleur d’or, de ces apatrides qui délaissent leurs propres rivages pour se jeter sur les côtes étrangères comme des corsaires et des voleurs ».
Et il cite la fière devise de son compatriote Paracelse : « Alterius non sit, qui suus esse potest. »
La seconde personnalité que je voudrais évoquer ici est celle de Rudolf Steiner, le fondateur de l’anthroposophie. Celui-ci a été pendant plusieurs années responsable de la section allemande de la Société théosophique, dont l’apport a été déterminant pour vulgariser en Europe un Hindouisme et un Bouddhisme quelque peu revus et corrigés. L’anthroposophie a elle-même repris plusieurs concepts et idées de l’Inde, en particulier la notion de karma, pour laquelle il n’y a pas de terme adéquat dans nos langues. Or, Steiner s’est montré extrêmement réticent vis-à-vis de l’adoption de pratiques orientales. L’Orient, disait-il, a sa voie, et l’Occident la sienne. Il est vain de vouloir utiliser les incommensurables trésors de la tradition asiatique pour vaincre le matérialisme qui est né au sein de notre propre civilisation. Seule peut y parvenir une force qui s’est elle-même épanouie en Occident. La sagesse orientale offre à l’Européen la tentation de ne pas poursuivre jusqu’au bout la tâche qui lui est dévolue, qui est de maîtriser les vérités spirituelles par un travail méthodique, personnel, scientifique. L’attrait de l’Orient correspond à un désir d’évasion, à la recherche d’une solution de facilité. S’y abandonner serait une régression et une perte. On peut s’enrichir d’emprunts multiples, mais se livrer entièrement à une pensée étrangère, si grandiose soit-elle, ne peut conduire qu’à une aliénation. D’autant plus qu’avec la spiritualité orientale, l’âme humaine peut être saisie d’une sorte de tourbillon, de vertige ou d’ivresse où elle se perd elle-même, et où la conscience s’évanouit avec la personnalité : on s’endort et on meurt dans l’esprit, et ce faisant on abdique sa condition d’homme. Steiner a qualifié les adeptes de la théosophie orientale de « heimatlosen Seelen », d’âmes apatrides et déracinées. « Si l’Occidental voulait devenir yogi, il faudrait qu’il développe un égoïsme raffiné, car la nature lui a déjà octroyé le sentiment de sa personne, que l’Oriental ne possédait que comme un rêve ».
Jung et Steiner sont donc d’accord sur ce point : l’Orient ne peut être pour nous qu’un complément, un apport, une référence, un miroir, un stimulant, un choc salutaire, une source, un lieu d’éveil, et non une solution toute faite. Celle-ci ne peut venir valablement de l’extérieur. Prendre l’Orient pour modèle conduit à des impasses ; le prendre pour ferment peut être extraordinairement enrichissant. On pourrait aussi trouver dans l’œuvre du Père Teilhard de Chardin, quand il médite sur les voies respectives de l’Est et de l’Ouest, des affirmations intéressantes sur ce point, avec une insistance plus grande encore sur l’idée que les chemins de l’avenir passent par l’Occident et sa science.
Je ne ferai qu’évoquer ici un livre récent, inspiré par le Renouveau charismatique : Des bords du Gange aux rives du Jourdain (Ed. Saint Paul, 1983). En comparaison avec les jugements très absolus qu’on professe habituellement dans ce milieu à l’égard des pratiques orientales, l’ensemble de cet ouvrage collectif paraît assez modéré et nuancé, même s’il conduit à un net rejet. Je suis quelque peu indisposé par une foule d’affirmations, y compris de médecins, dont on ne sait pas exactement sur quoi elles reposent : on en dit trop ou on en dit trop peu. Mais il y a là une voix qu’on aurait tort de négliger, même si elle est trop passionnelle pour qu’on puisse la prendre au sérieux, car la passion cache toujours quelque chose peu claire. On trouvera des points de vue en sens contraire dans « Il y a de l’eau vive dans tous les fleuves de la terre » (colloque « yoga et christianisme », la Sainte Baume, 1984, Ed. de l’Ouvert).
Faire la part des choses
Je ne suis nullement mû par le souci illusoire de mettre tout le monde d’accord. Il me semble toutefois que les deux attitudes esquissées aussi bien à propos de la médecine extrême orientale que des techniques de méditation, ne sont pas forcément contradictoires.
Yoga, Zen, Tantra, etc., sont d’abord des techniques du corps et de l’âme. Ils sont de l’ordre des moyens. Ces instruments, puissants comme de la dynamite, peuvent être utilisés pour le meilleur ou le pire, avec intelligence ou stupidité, pour une œuvre utile comme pour une œuvre « diabolique ». Cela ne veut pas dire qu’un moyen soit neutre. Il en est qui sont lourdement entachés, de par leur nature même, et demandent donc un discernement des plus soigneux. Les engouements et les modes sont toujours dangereux, car ils nous obnubilent et affaiblissent notre sens critique. On a toujours tort de céder trop facilement à une mode, car tôt ou tard, il se produira un retour de flamme. On a donc certainement manqué de jugement en mettant du Zen ou du Yoga partout et en y voyant une panacée universelle. D’ici à les rejeter en bloc, il y a une marge que je ne franchirai pas. Quand dans le haut Moyen-Âge sont apparus les chiffres « arabes » (qui sont en fait une invention de l’Inde), on les a aussi considérés et condamnés comme diaboliques durant des siècles. Des témoignages contenus dans Des bords du Gange aux rives du Jourdain montrent avec quelle efficacité le yoga put mener telle personne à la prière dans l’Esprit. Dieu a l’habitude d’écrire droit sur des lignes courbes. « L’Esprit souffle où il veut, tu entends sa voix mais tu ne sais ni d’où il vient, ni où il va ». Le christianisme repose fondamentalement sur une expérience de récapitulation et de transfiguration de tout ce qui est humain. Quant aux cheminements individuels, ils ont toujours quelque chose d’ineffable. Si tout m’est permis, tout ne m’est pas utile, dirait Saint Paul en pareille circonstance.
Dans le langage plus plat de l’ethnologue, je dirai qu’on a toujours grand intérêt à se familiariser avec un système de pensée, une logique ou des pratiques (fussent-elles simplement culinaires ou de mode de vie) autres que les siennes, à sortir de son cocon, à prendre de la distance par rapport à ce qui nous colle à la peau. C’est le seul moyen d’arriver à une certaine ouverture et donc à une certaine objectivité. Je ne pense pas qu’un chrétien puisse prendre conscience de la spécificité de son christianisme, si à un moment ou à un autre, il n’est pas confronté sérieusement, au niveau de l’intellect comme au niveau des tripes, au Judaïsme, à l’Islam, au Bouddhisme ou à l’Athéisme.
Dans l’histoire des missions chrétiennes, il y a tout un ensemble de figures de religieux qui se sont en quelque sorte convertis culturellement pour mieux annoncer l’Évangile, qui sont allés aussi loin qu’un Occidental peut aller pour se faire Chinois avec les Chinois, Indien avec les Indiens, Bantou avec les Bantous. Et ce furent à chaque fois des aventures spirituelles assez extraordinaires. Je pense à un Jésuite comme Matteo Ricci, à un Bénédictin comme Dom le Saux, à un Franciscain comme Placide Tempels, à un Lazarite comme Vincent Lebbe, à l’abbé Monchanin, à Lev Gillet, à Louis Massignon, ou à cet ermite franc-tireur qu’était Charles de Foucauld, qui a produit une œuvre linguistique et ethnographique inestimable sur les Touareg. Ces hommes ont été critiqués, calomniés, traînés dans la boue, et pourtant, avec le recul du temps, on est obligé de reconnaître qu’ils représentaient ce que l’Église a suscité de meilleur en ces temps très ambigus de colonisation religieuse. Ils ont fourni la preuve qu’on pouvait aller loin, très loin dans cette conversion culturelle. Mais Monchanin, qui avait à son âme une corde philosophique, a avoué à la fin de sa vie qu’il ne s’est jamais senti aussi grec dans sa pensée qu’au moment où tout le monde croyait qu’il avait réussi une parfaite assimilation au monde indien. Et quand Tempels a essayé de systématiser ses intuitions sur la philosophie bantoue, c’est tout naturellement le plan d’un manuel scolastique qui a surgi dans son esprit.
S’ouvrir à l’autre, même jusqu’à se laisser envahir par lui, ne signifie pas forcément renoncer à ce qu’on est. Dans le fond, une telle renonciation est tout simplement impossible. Notre façonnement premier s’inscrit au niveau des structures de la personnalité. Les apports culturels ultérieurs seront par contre de l’ordre du contenu. Le vin nouveau, nous le versons sans cesse dans de vieilles outres. Ce n’est qu’au plan spirituel qu’on peut changer d’outres, et non au plan physique ou psychologique. Il faut tenir compte du fait qu’il existe toute une gamme de paliers, en profondeur, et tout dépend de la vitalité des personnalités en question. Nous voyons quotidiennement autour de nous, par exemple dans nos Universités, des Africains ou des Asiatiques qui arrivent à un très haut degré d’assimilation de notre culture, sans cesser en aucune manière d’être ce qu’ils sont au niveau des structures. Il est vrai que nous en connaissons aussi d’autres qui n’ont pas la vitalité ou la solidité intérieures voulues et se trouvent de ce fait dans une situation de tension intenable : l’opposition entre structure et contenus finit alors en névrose.
Quand nous subissons des influences extérieures ou quand délibérément et activement nous les recherchons, nous avons toujours, me semble-t-il, intérêt et profit à voir de près de quoi il s’agit exactement, d’où cela vient, quel sens cela peut avoir dans son contexte d’origine. C’est aussi le meilleur moyen pour exorciser ce que ces influences peuvent véhiculer de maléfique. C’est dans la mesure où je sais ce que représente le yoga par rapport au Védanta ou au Samkhya que je peux juger de la valeur qu’il peut éventuellement avoir pour moi et me mettre au clair quant à l’esprit dans lequel je peux l’utiliser, en fonction de ce que je suis et de mes besoins propres. C’est exactement ainsi qu’a procédé un homme comme Dom Déchanet.
On peut faire siennes quelques postures de yoga sans forcément aller vivre tout nu dans une grotte de l’Himalaya. On peut pratiquer l’assise zazen sans se raser le crâne, manger avec des baguettes ou se mettre face à un mur pendant des heures… Mais il devient forcément abusif, à un moment donné, de parler encore de zen ou de yoga. Les critiques formulées contre l’usage de ces techniques perdent en grande partie leur raison d’être du fait que dans l’immense majorité des cas où ces termes sont employés, il ne s’agit plus du tout ni de yoga, ni de zen, ni de mantras, ni de tantra, ni de soufisme, mais de néo-créations à plus ou moins vague point de départ oriental. Un ferment a agi, et cela a donné des choses plus ou moins appétissantes. Nous le savons bien : les produits de fermentation ne se valent pas. Il y a de bons vins et d’affreuses piquettes : tout dépend de la qualité de la matière première, mais aussi de l’intelligence et du soin qu’on lui accorde. Beaucoup de facteurs peuvent entrer en jeu dans une société aussi pluraliste que la nôtre, où tout est possible, où tout est admis, où l’on peut se montrer très libre dans l’utilisation des éléments les plus divers.
Itinéraires et vocations
Nous sommes là dans un domaine très subtil où il faut, me semble-t-il, rester très nuancé et tolérant. Parfois, des allures un peu extravagantes cachent des vocations vraies, profondes et solides. Pourquoi ne pourrait-on pas se sentir appelé, à tel moment de son existence, à participer à la vie d’un monastère tibétain ou d’un ashram hindou, avec tout ce que cela représente de dépaysement, de conversion culturelle et religieuse, dans les manières de se vêtir, de manger, de parler, de penser, de chanter, de prier ? Je regrette d’ailleurs profondément qu’il ne soit pas plus facile de participer temporairement à la vie d’une communauté bénédictine, cistercienne ou cartusienne, qui elle aussi exige une longue et parfois douloureuse acculturation. Trop de gens se sont réellement réalisés dans l’assimilation d’une manière de vivre, de penser et de sentir qui au départ leur était totalement étrangère, pour qu’il faille suspecter pareille démarche. Elle est exigeante, et peut, certes, comme toute autre, conduire à des impasses.
Il serait d’ailleurs très intéressant de pouvoir suivre la trajectoire de ces personnes, voir d’où elles viennent, quelles sont leurs motivations de départ, quelles sont les crises qu’elles traversent, quelles sont les étapes de leur évolution, et quel est leur point d’aboutissement. On trouverait des trajectoires très rectilignes et sans retour, mais aussi des cas où après un très long détour au travers de l’Autre et de l’Ailleurs, on finit par redécouvrir sa propre tradition, culturelle et religieuse, mais avec des yeux totalement neufs, une expérience et une ouverture d’esprit impensables au départ. Nos existences sont structurées autour de polarités dont nous n’avons pas conscience d’emblée, de sorte que des balancements et des mouvements de va-et-vient sont inévitables. On dit souvent : pourquoi chercher ailleurs ce que la tradition chrétienne contient en surabondance ? Je crois qu’on peut répondre trois choses : d’abord, cette tradition telle qu’elle se présente historiquement, ne contient pas tout, et son visage a souvent été défiguré et rendu méconnaissable; ensuite, ce qui est proche et habituel est souvent mal perçu, ou ne peut être perçu, pour des raisons tout à fait intrinsèques; enfin, dans les premiers âges de la vie spirituelle, il me semble bon et profitable de voir autre chose, de pouvoir mesurer la gamme des possibles, de sorte que les choix puissent se faire en connaissance de cause.
L’Orient chrétien
Mais l’Orient, ce n’est pas seulement l’Inde, la Chine ou le Japon. C’est aussi l’Orient chrétien, ce qui reste de l’époque où l’empire byzantin dominait toute la Méditerranée, de l’époque où l’Église nestorienne s’était répandue en Inde, en Perse, et jusqu’en Chine, en Mongolie et au Tibet, avec ses quatre-vingts millions de fidèles, de l’époque de la Sainte-Russie, ou de l’époque où la vallée du Nil était chrétienne jusqu’en Éthiopie. Quatre types d’Églises composent cet ensemble d’une richesse exubérante, mais désarticulé et terriblement menacé par le communisme, l’intégrisme musulman et certaines formes de nationalisme : les Églises monophysites et nestoriennes d’Égypte, d’Éthiopie, d’Arménie, de Chaldée, de l’Inde, mal connues, mais capitales pour qui s’intéresse aux origines chrétiennes; les Églises dites « orthodoxes » des Balkans ou de Russie; quelques Églises non concernées par les démêlés entre Rome et Byzance; les Églises uniates, revenues à Rome. Et au milieu de ce magma, en porte-à-faux, des îlots d’Église latine.
Il n’est pas difficile de discerner aujourd’hui, dans les chants de nos paroisses, tant catholiques que protestantes, des lambeaux d’airs russes. La prière du cœur s’est vulgarisée dans tous les milieux chrétiens. Partout, on voit des icônes, simples collages, ou peintes le plus souvent, sans que les règles traditionnelles soient respectées. Des paroisses orthodoxes ou orientales s’implantent dans nos villes. À Strasbourg, on compte au moins cinq de ces groupes. Elles s’adressaient au départ à des personnes originaires des pays de l’Est ou du Proche-Orient. Mais face au spectacle d’indigence liturgique et spirituelle que donnent beaucoup de paroisses catholiques et protestantes, il arrive que des gens du lieu sympathisent avec ces groupes et parfois s’y intègrent. De plus en plus, leur clergé lui-même est de souche locale, clergé souvent marié, ce qui facilite son adaptation. Il existe en France, en Allemagne, en Belgique plusieurs monastères orthodoxes, mais aussi plusieurs monastères catholiques ayant adopté le rite byzantin, le plus célèbre étant Chèvetogne, à qui Dom Lambert Bauduin a insufflé la vocation de faire connaître aux Occidentaux les richesses de l’Orient chrétien. Un lieu comme le Mont-Athos exerce jusque dans nos régions un étrange rayonnement. Une des premières et des plus importantes communautés charismatiques, la Théophanie, est passée au rite byzantin et célèbre une liturgie extraordinairement belle.
Nous retrouvons à propos de l’Orient chrétien exactement les mêmes problèmes et les mêmes mécanismes que pour l’Orient tout court. Tant que les gens des pays de l’Est ou du Proche-Orient sont entre eux, il est normal qu’ils vivent ici leur vie religieuse comme s’ils étaient à Bucarest, à Athènes ou à Beyrouth. Les choses se compliquent quand des gens du lieu viennent s’intégrer à certains de ces groupes qui les acceptent et parfois cherchent à les attirer, puis quand ces immigrés ont eux-mêmes des enfants et des petits-enfants élevés à la française et qui ne se sentent plus à l’aise dans une langue et des formes d’expression qui ne sont pas les leurs. Inévitablement, en ce cas, ces groupes soit s’étiolent et dépérissent, soit commencent à fermenter. Là encore, de l’Orient-modèle on passe alors à l’Orient ferment.
J’observe que lorsque des gens commencent à s’intéresser à l’Orient chrétien pour leur propre orientation, il se met en place tout un ensemble de comportements d’imitation qui servent aux intéressés à se démarquer, à s’affirmer et à traduire à l’extérieur une découverte intérieure. On se plaît à émailler sa langue de termes gréco-slaves; on laisse pousser cheveux et barbe ; on cultive sa voix de basse; on s’entraîne à faire des prosternations; on peuple ses rêves d’images du Mont-Athos; on s’enroule les poignets de chapelets de laine ; on allume des lampes à huile partout ; on purifie sa chambre à coucher avec de l’encens ; on se donne des visages d’icônes ; etc. Tout cela sent un peu le néophyte, mais est parfaitement inoffensif. Il arrive certes aussi que des groupuscules développent un mysticisme épais à couper au couteau et prennent des allures de sectes.
Des Occidentaux de plus en plus nombreux se font aujourd’hui moines au Mont-Athos. C’est sans doute aussi dépaysant que d’entrer dans une lamaserie tibétaine… Je crois qu’il faut avoir le plus grand respect pour de tels itinéraires. À quelqu’un qui cherche, il n’y a qu’une chose à souhaiter : qu’il trouve. Des considérations de clocher ou de boutique auraient quelque chose d’indécent en pareil cas. Quand à présent, s’il s’agit du commun des mortels, il est évident qu’une imitation trop simpliste prend des allures naïves et infantiles. Les conseils de prudence valables pour les pratiques héritées de l’Inde, du Tibet ou du Japon, s’appliquent aussi, mutatis mutandis, à celles qui nous viennent des Pères du désert ou des hésychastes. Tout cela exige un solide discernement.
Conclusion
Quand on regarde cette question des influences orientales avec des yeux d’historien, de sociologue ou d’ethnologue, on voit que les mécanismes qui sont en jeu sont des plus classiques. Les civilisations les plus riches sont celles qui ont reçu des apports de toute part et qui se sont les plus métissées, à condition d’avoir été suffisamment fortes et d’avoir eu assez de vitalité pour digérer ces influences. Sur le plan individuel comme sur le plan collectif, il est toujours plus efficace de fortifier l’intérieur, de développer des mécanismes de sélection et d’immunité, que de se battre contre des ennemis extérieurs, mal localisés et qui, dans bien des cas, ne sont que des moulins à vent. Il est vrai que nous avons notre propre tradition et que nous sommes structurés mentalement en Occidentaux. Mais en prendre prétexte pour refuser a priori ce qui vient d’Orient frise le non-sens puisque notre tradition est pour sa plus grande part d’origine orientale et que les influences que nous connaissons aujourd’hui nous invitent précisément à un pèlerinage aux sources.
On constate de manière très générale que des emprunts culturels effectués de manière purement matérielle et passive restent des éléments étrangers qui peuvent se révéler perturbateurs. Les emprunts les plus bénéfiques sont ceux qui excitent la créativité de celui qui reçoit et le font réagir activement. Une nourriture qui nous reste sur l’estomac est sans profit. Elle ne nous est utile que si nous la transformons en notre propre chair et en notre propre sang. Quand la lettre d’une culture est vivifiée par un esprit nouveau, cela va infiniment plus loin que si la lettre change tandis que l’esprit reste le même.
Pierre Erny est né en 1933 à Colmar. Il a été professeur d’ethnologie à l’université Marc Bloch de Strasbourg, après avoir enseigné au Burkina Faso, au Congo et au Rwanda. Il est spécialisé en ethnologie de l’éducation et en anthropologie religieuse. Il est l’auteur de plusieurs livres.