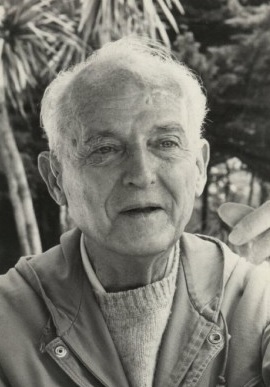(Revue Le lotus Bleu. Novembre-Décembre 1960)
On entend souvent qualifier la science de « Moderne », comme s’il existait une distinction, voire une opposition, entre la science d’aujourd’hui et celle d’hier, or il ne peut pas s’agir de la science du Moyen-âge ou de l’Antiquité, qui étaient l’une et l’autre construites sur des bases différentes de celle de notre science actuelle. Faut-il alors placer la limite entre anciens et modernes au XVIIIe siècle avec Lavoisier, au XIXe avec Pasteur, au XXe avec Planck et Einstein ?
A bien y regarder, je crois que cette question est surtout un problème mal posé. La science actuelle, faite essentiellement d’observations impersonnelles (qui en sont l’ossature permanente) et de théories liant ces faits en vastes ensembles (qui en sont la partie en continuelle évolution), commence au XVIe siècle avec Galilée. Son développement depuis lors est parfaitement continu, ses caractères n’ont pas changé. Les prétendues faillites de la science sont simplement la succession des théories dont chacune, ayant rempli son rôle, cesse d’être l’explication universelle que certains voulaient y voir à sa naissance, pour prendre les proportions d’un point de vue juste dans un certain domaine, mais ne pouvant se prolonger au-delà. Certes les savants eux-mêmes, au cours du XIXe siècle, se sont laissés éblouir par leurs succès, au point de croire, assez naïvement, qu’ils avaient tracé les plans du monde et qu’il ne resterait à leurs successeurs qu’à y préciser des détails… Cette flatteuse croyance s’est écroulée (progressivement, car elle était d’un grand confort intellectuel) à la suite des découvertes fondamentales qui ont été faites dans les dix années qui entourent l’an 1900 : rayons X, radioactivité, quanta, relativité. Je ne cite que le domaine des sciences physiques, mais il faudrait y ajouter, dans le domaine de la conscience, la psychanalyse, qui faisait pénétrer le déterminisme dans le domaine du sentiment et dans celui de l’inconscient.
Si l’on veut distinguer une période moderne de la science, c’est donc à partir de 1890 qu’il faut la faire naître. Dès ce moment, on a commencé à se rendre compte que la science n’est pas la vérité sur le monde extérieur, mais une recherche de la vérité : à chaque instant de son existence, elle est un mélange de vérité et d’erreur qui tend vers plus de vérité. Et ce mouvement se manifeste par l’apparition au premier plan de la science des idées, de théories qui se succèdent comme les vies successives des êtres d’un même groupe. C’est là, assurément, un changement important de point de vue, car en faisant reconnaître le caractère humain des théories, en leur retirant celui d’une expression de vérités naturelles, il réintroduit dans la science un élément subjectif qui est l’aliment essentiel de sa vie et de son évolution : la science n’évolue par enchaînement logique des faits que dans ses parties secondaires : sa création principale, l’image du monde qu’elle propose, évolue parce que la conscience humaine subit une évolution psychologique inéluctable, qui peut être accélérée ou retardée par des événements extérieurs mais n’est pas engendrée par eux.
Cette modification dans la conception même de la science a vivement frappé les philosophes : on a parlé d’abandon du déterminisme, de faillite du matérialisme. C’était aller trop loin, au moins sur le premier point : il n’y a pas, il ne peut y avoir, de science sans croyance à des lois naturelles, donc au déterminisme (et c’est parce que la conscience des chercheurs de l’Antiquité et du Moyen-âge ne possédait pas cette notion qu’il n’y a pas eu de science, telle que nous la concevons à ces époques). Il y a seulement changement dans le mécanisme attribué au déterminisme pour se manifester, quand on passe d’une théorie à une autre.
Quant au matérialisme, sous la forme que lui donnait, par exemple Auguste Comte, il est exact qu’il n’en reste pas grand-chose. Il consistait à croire qu’à partir des lois de la matière alors connues — et surtout de la mécanique — et sous réserve de progrès de détail, on arriverait à « expliquer » la vie et la conscience, voire les ondulations de la politique et de la sociologie. Nous savons aujourd’hui que ni la mécanique (classique et relativiste), ni l’électromagnétisme classique ne peuvent s’appliquer au domaine de l’atome ni à celui de son noyau, sans subir des modifications qui atteignent jusqu’à leurs principes. La Lumière, — qui n’est pas un être « matériel » puisqu’elle ne possède pas de masse au repos, — nous a contraints de créer des sciences nouvelles où matière et lumière révèlent, par leurs actions mutuelles, une merveilleuse richesse de possibilités.
Cela n’a pas désarmé le matérialisme, mais l’a forcé d’évoluer. Car, tout penseur qui, pour des motifs de sentiment, est antispiritualiste, se veut matérialiste, alors qu’en bonne logique l’opposition des deux points de vue n’existe pas. En effet, je lisais récemment cette définition du matérialisme : « la croyance que tout ce qui est (et l’auteur pensait à la vie et à la conscience) est contenu et provient de la matière ». Une telle profession de foi conviendrait parfaitement à un spiritualiste hindou pour qui l’apparition de la vie et de la conscience dans un monde matériel ne s’explique pas par un miracle, mais par l’apparition progressive de ce qui était caché, latent, dans la matière.
***
Il existe pourtant un aspect de la science actuelle qui est nouveau par son importance grandissante et ses conséquences. Je sépare nettement ce que je veux en dire de ce qui précède, car il apparaît comme une contamination de la science objective et désintéressée.
La science a des applications et celles-ci donnent puissance et richesse : leur étude et leur développement forment ses techniques. Peu à peu, on en vient à considérer la science comme n’ayant pour justification que la découverte de techniques nouvelles. Dans certains pays la recherche scientifique est rigoureusement dirigée en vue d’un haut rendement d’applications pratiques. Dans d’autres une certaine liberté subsiste ; mais, pour prendre un exemple, un jeune Français qui demanderait une bourse pour étudier les principes de la physique n’aurait que des chances infimes de se la voir attribuer, mais s’il se révélait capable de faire un stabilisateur de fusée il serait aussitôt comblé à tous points de vue. Devant cette déformation de la science, certains scientifiques alarmés ont voulu une séparation de nos Facultés en Faculté des Sciences et Faculté des Techniques : les premières feraient des professeurs, les secondes des ingénieurs. Rien ne pourrait être plus grave, car la technique aurait vite fait de s’accorder tous les crédits, puis tous les chercheurs, et la recherche désintéressée de la vérité, d’une image plus complète et harmonieuse du Monde, disparaîtrait. Les théosophes n’auront pas de difficultés à reconnaître dans cette tendance les caractéristiques du Kali-Yuga. Nous sommes dans l’âge sombre et beaucoup s’y complaisent. Il est du reste naturel et souhaitable que ce passage développe toutes les possibilités pratiques incluses dans nos idées et nos théories : mais pour que cette nécessité ne retarde pas l’évolution générale de notre connaissance, il faut au contraire réunir Sciences et Techniques dans les mêmes établissements, et confier l’étude à des travailleurs qui unissent leurs efforts dans un même élan vers une connaissance plus large et plus vraie : ainsi se formera ce qui pourra, à bon droit, se dire une Science Moderne et n’est encore que la Science future.
G.E. MONOD-HERZEN