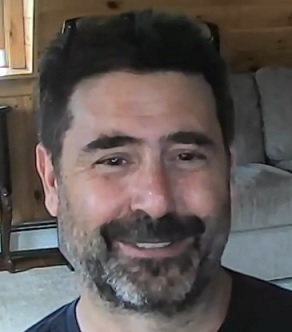Comment les indicateurs de performance corrompent le seuil le plus sacré de la médecine
Le moniteur cardiaque affiche une ligne plate. La famille pleure. Les médecins attendent exactement 75 secondes, puis recommencent la procédure. Dans le monde des greffes d’organes, la notion de « suffisamment mort » est devenue une cible mouvante.
Le New York Times vient de rapporter quelque chose que la plupart des gens ne sont pas prêts à entendre : dans la course au développement des greffes d’organes, les équipes chargées de prélèvement ont parfois commencé trop tôt. Pas après la mort, mais avant qu’elle ne soit pleinement établie.
Ce n’est plus seulement du journalisme d’investigation, c’est officiel. En juillet, le ministère américain de la santé et des services sociaux a publié les résultats d’une enquête fédérale sur le système de transplantation. Ce sont leurs mots, pas les miens : « Les hôpitaux ont autorisé le processus de prélèvement d’organes à commencer alors que les patients montraient des signes de vie, et c’est épouvantable », a déclaré Robert F. Kennedy, Jr., secrétaire du HHS. Le rapport fédéral a révélé qu’au moins 28 patients n’étaient peut-être pas morts lorsque le prélèvement d’organes a commencé.
Ces prélèvements sont effectués dans le cadre d’un protocole appelé « don après décès (ou arrêt) circulatoire » (DCD). Il est fondamentalement différent de la pratique plus répandue, du don après mort cérébrale, où les patients ont irréversiblement perdu toutes leurs fonctions cérébrales et sont maintenus sur des machines uniquement pour conserver leurs organes. Les patients DCD ont encore une certaine activité cérébrale — ils sont mourants, mais pas encore morts. Les médecins déterminent qu’ils sont proches de la mort et qu’ils ne se rétabliront pas, mais il s’agit d’un jugement médical et non d’une certitude biologique.
Le DCD était autrefois rare. Aujourd’hui, il représente une part énorme et croissante des transplantations. Chaque jour, 13 personnes meurent dans l’attente d’organes qui ne viendront jamais. Cette urgence est réelle et explique pourquoi le système se sent poussé à élargir toutes les possibilités de don. Mais sauver des vies en risquant de les voir disparaître prématurément n’est pas un salut, c’est une autre forme de condamnation à mort.
Il ne s’agit pas de savoir si les greffes sauvent des vies — elles le font. Il s’agit de quelque chose de plus fondamental : la frontière entre la vie et la mort est traitée comme une variable de programmation flexible.
Le seuil sacré
La mort a toujours été le mystère le plus grand de l’humanité, la frontière ultime entre l’être et le non-être, la conscience et le vide. La médecine moderne a promis la précision : mort neurologique, arrêt cardiaque, critères cliniques pouvant marquer le moment exact où une personne devient un corps.
Mais lorsque la mort devient un protocole plutôt qu’une réalité ontologique, quelque chose d’essentiel est perdu. Comme l’a affirmé le philosophe Ivan Illich, lorsqu’une culture médicalise toutes les frontières — la naissance, la mort, et même le sens — elle perd sa capacité à naviguer dans ces distinctions sans l’autorisation des institutions.
Nous parlons ici du moment où un être humain cesse d’exister en tant qu’entité consciente et devient, dans le calcul du système, un ensemble de pièces détachées à prélever.
Le problème va plus loin que les simples protocoles. Comme l’observe le bioéthicien Charles Camosy, la médecine contemporaine se trouve dans « une situation intellectuellement embarrassante : les médecins et d’autres personnes qui n’ont pas réfléchi à ces questions et n’ont pratiquement aucune formation en philosophie ou théologie sérieuse inventent leur anthropologie morale au fur et à mesure pour atteindre le résultat souhaité en matière d’organes ». Lorsque les institutions commencent à optimiser les principes fondamentaux, elles perdent tout cadre cohérent pour comprendre ce qu’elles font réellement.
Quand les réflexes deviennent « insignifiants
Si la définition de « suffisamment mort » devient négociable, nous avons déjà perdu le fil. La désignation du donneur sur votre permis de conduire représente plus qu’un consentement médical : c’est un contrat spirituel concernant ce qu’il adviendra du vaisseau qui a transporté votre conscience tout au long de votre vie.
Un patient a ramené ses genoux sur sa poitrine alors qu’on le préparait à un prélèvement d’organe, mais le personnel médical a jugé qu’il s’agissait d’un « simple réflexe insignifiant ». En Alabama, Misty Hawkins a été emmenée en chirurgie après avoir été déclarée morte, mais, lorsque les chirurgiens ont pratiqué leur première incision, ils ont constaté que son cœur bougeait, que sa poitrine se soulevait et s’abaissait avec des « respirations haletantes ». Ils l’ont découpée alors qu’elle était encore en vie.
Sans importance pour qui ? C’est dans ce geste, ce repli involontaire sur soi, dans ce cœur qui bat et que l’on découvre trop tard, que se trouve la question fondamentale : Et si quelque chose d’essentiel habitait encore ce corps ? Et si la frontière entre la vie et la mort n’était pas une ligne nette, mais un espace liminal que nous traversons trop rapidement ?
La machine à inciter
Suivez les incitations, mais aussi la métaphysique. Lorsque les hôpitaux sont évalués en fonction de leur « taux de conversion » — un terme qui ferait rougir à la fois un vendeur de voitures d’occasion et un théologien —, on mesure l’efficacité avec laquelle ils transforment des êtres humains mourants en pièces détachées. Les OPO (organismes de prélèvement d’organes) ont des contrats fédéraux à respecter, leurs performances étant jugées sur le débit.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les dons après arrêt circulatoire ont triplé depuis le décret de 2019 de Trump. Près de 20 % des organes échappent désormais entièrement à la liste d’attente officielle, contre 3 % en 2020. Cinquante-cinq professionnels de santé répartis dans 19 États ont été témoins de cas troublants. Dans le seul Kentucky, les enquêteurs fédéraux ont trouvé 73 patients présentant des « signes neurologiques incompatibles avec le don d’organes » qui étaient pourtant préparés pour le prélèvement.
Lorsque l’on évalue le système de cette manière, « plus et plus vite » devient une vision du monde qui redéfinit le seuil entre la vie et la mort au nom de l’efficacité opérationnelle. Les incitations qui, au départ, visaient à sauver des vies se transforment rapidement en quotas de production.
Le coût humain
Comme l’a déclaré un technicien chirurgical au New York Times après avoir vu une patiente en larmes et réactive être mise sous sédatifs et débranchée de son respirateur artificiel : « J’ai eu l’impression que, si on lui avait laissé plus de temps sous respirateur, elle aurait pu s’en sortir. J’ai eu l’impression de participer à la mort de quelqu’un ». Elle a quitté son emploi par la suite, traumatisée d’avoir participé à ce qui ressemblait à un meurtre institutionnel déguisé en protocole médical.
Le risque n’est plus hypothétique, il est ontologique. Le protocole exige d’abord deux minutes sans pouls. Puis 75 secondes. Ensuite, c’est « suffisamment sans réponse ». Chaque fois que nous réduisons la période d’attente de quelques secondes, nous ne nous contentons pas d’ajuster les protocoles médicaux, nous redéfinissons ce que signifie être mort. Nous traitons le mystère de la conscience comme s’il s’agissait d’un bogue logiciel à optimiser.
Il ne s’agit pas seulement d’un problème de transplantation, mais du système d’exploitation des institutions modernes. Nous l’avons vu pendant le COVID, lorsque les définitions de cas pour les hospitalisations variaient considérablement en fonction de différents critères, générant des chiffres radicalement différents en fonction des paramètres que les institutions choisissaient de mettre en avant. Nous l’avons vu dans les maisons de retraite, où les règles de remboursement de Medicare obligent les familles à choisir entre des soins infirmiers qualifiés et des services de soins palliatifs, poussant les décisions de vie ou de mort vers l’issue la plus commode sur le plan administratif. Nous l’avons vu dans l’approbation des produits pharmaceutiques, où la procédure d’approbation accélérée de la FDA a été critiquée pour avoir approuvé des médicaments sur la base de critères de substitution plutôt que de bénéfices cliniques prouvés, avec des essais de confirmation souvent retardés et des médicaments qui se sont révélés inefficaces par la suite.
L’érosion de la confiance
La confiance ne se construit pas par des communiqués de presse. Elle se construit en honorant le poids immense de ce que nous demandons aux familles de traverser. Une fois que le public croit que ce fossé — cette frontière entre mesure et signification — est traité de manière cavalière, il cesse de s’inscrire comme donneur. Dans l’Arkansas, les défenseurs du don d’organes intentent déjà des poursuites pour bloquer une nouvelle loi qui exige l’autorisation de la famille même lorsqu’une personne est un donneur enregistré — un signe que la confiance du public est déjà en train de se fissurer.
Sans confiance dans le caractère sacré du processus, le système conçu pour sauver des vies s’effondre sous le poids de ses propres raccourcis utilitaires. Tout le monde en pâtit : les personnes qui auraient pu recevoir ces organes, les médecins qui suivent les règles, les familles qui auraient pu choisir le don dans des circonstances respectant à la fois les dimensions cliniques et métaphysiques de la mort.
Ce que cela révèle
Ce ne sont pas des problèmes qui peuvent être résolus dans le cadre du système actuel, car c’est le système actuel qui est le problème. Une fois qu’on a créé des institutions qui mesurent les « taux de conversion » de la mort humaine, on a déjà franchi une ligne qu’aucune régulation ne pourra effacer.
Une telle révérence ne peut pas être bureaucratisée pour revenir à l’existence. Il n’est pas possible de rédiger des protocoles qui restaurent le mystère de la conscience ou de créer des mesures qui honorent le poids métaphysique de la mortalité. La corruption ne réside pas dans la mise en œuvre, mais dans l’idée même que cette division peut être standardisée, optimisée et administrée par des institutions dotées d’objectifs de performance.
Ce dont nous sommes témoins n’est pas une série d’erreurs médicales à corriger, mais la preuve d’un changement de civilisation qui s’est déjà produit. Nous sommes passés d’une culture qui abordait la mortalité avec crainte et incertitude à une culture qui la traite comme un défi opérationnel à gérer efficacement. Le compte à rebours ne fait pas que commencer, il est déjà bien entamé.
La souveraineté du corps comme souveraineté spirituelle
Au fond, il ne s’agit pas d’une question de science de la transplantation. Il s’agit de la souveraineté sur le corps et l’âme au moment le plus vulnérable de tous. La légitimité de l’appareil de transplantation repose entièrement sur la conviction du public que la détermination de la mortalité honore à la fois la réalité biologique et le mystère métaphysique — que le moment de la transition est marqué avec précision, cohérence et absence totale d’intérêt institutionnel.
Chaque signature sur le registre des donneurs représente un dernier acte de confiance — que la médecine honorera la vie et la mort avec la même révérence que la frontière entre l’existence et la non-existence sera traitée comme inviolable plutôt que comme un simple arrangement commode. Si l’on rompt cette confiance, aucune réforme du système de prélèvement ne résoudra la pénurie d’organes. Elle sera résolue par des registres vides et des cercueils fermés.
Cette légitimité est fragile parce qu’elle touche à quelque chose de plus profond que les soins de santé : nos croyances fondamentales sur la conscience, l’identité et ce que signifie être humain. Elle ne s’achète pas à coup de relations publiques. Elle ne peut être gagnée que par la transparence, la responsabilité et un engagement sans faille à honorer le mystère dans lequel nous naviguons.
Si « suffisamment mort » devient une mesure, le compte à rebours a déjà commencé, non seulement pour le patient, mais aussi pour notre foi collective dans la capacité de la médecine à servir quelque chose de plus élevé que sa propre efficacité. Car, une fois que nous acceptons la mort comme une décision de gestion plutôt que comme une réalité spirituelle, nous ne nous contentons plus d’optimiser un cadre, nous reprogrammons le code moral de la civilisation elle-même.
Les civilisations ne survivent pas longtemps lorsqu’elles oublient ce qui compte le plus — et lorsqu’elles l’oublient, la récolte arrive toujours. D’abord pour le corps, puis pour l’âme.
Lorsque le sacré est subordonné au calendrier, ce ne sont pas seulement les corps qui sont récoltés.
Texte original publié le 3 août 2025 : https://stylman.substack.com/p/when-dead-enough-becomes-a-metric