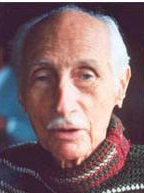Quand un mécontentement continu et généralisé en matière sociale, politique, nationale et internationale persiste et s’amplifie, et que l’enchaînement des événements risque d’entraîner le monde vers une catastrophe, il y a un état de choses à changer et, surtout, un état d’esprit à créer, sans lequel rien de valable ne saurait être accompli.
Promouvoir le changement en fonction d’éléments dégagés par le survol des problèmes de notre monde situe, tant leur complexité que leur imbrication.
La prééminence dont jouissait l’Occident, ces deux derniers millénaires, doit l’inciter à prendre l’initiative du changement, faute de quoi de graves conséquences, aujourd’hui et demain, ne manqueraient pas de surgir, ici et ailleurs.
Comment s’y prendre, comment agir en conciliant la sagesse acquise par l’expérience d’un long passé, avec les impératifs du quotidien envahissant dont il faut tenir compte ? Telle est la première question devant être abordée de front. Elle conduit en droite ligne au problème de l’éducation et sollicite, au départ, la compréhension des parents auxquels il incombe la lourde tâche de former le cerveau de l’enfant sans le déformer.
Cette formation est conditionnée par le milieu, puisque le système nerveux du nouveau-né n’est qu’à l’état d’ébauche, ses cellules cérébrales vierges ne s’ordonnant, en un premier temps, qu’en fonction de pressions sensorielles externes et internes.
Pour participer à la prodigieuse alchymie, que représente l’épanouissement de cet être sur le chemin du devenir, que lui offrent les parents et la société ? Le bruit des disputes, la vision de dérèglements sexuels, l’image des règlements de comptes, le spectacle de la mauvaise foi et la violence des compétitions économiques, sociales, politiques et sportives.
Sommes-nous insensés ou criminels pour projeter sans vergogne nos vices sur les écrans de la télévision, ou pour peupler nos journaux de récits faisant état de nos instincts les plus vils ?
Peut-être sommes-nous tout simplement ignorants des implications qu’entraîne notre incurie. Nous ne voyons que la surface d’un monde en ébullition, sans pénétrer les racines du mal qui ronge les forces vives de la planète.
Nous enseignons à nos enfants moult choses, sans leur apprendre l’essentiel. Ce qu’ils sont, où ils vont, comment mourir non seulement physiquement, un jour lointain, mais à chaque instant aux impressions fausses, nées des projections de nos tourments et de nos craintes.
L’agitation et l’ignorance imprègnent le subconscient de l’adolescent, qui transforme le dérèglement qu’il constate et auquel il veut échapper, en prétention de faire une société idéale, avant de prendre conscience que c’est par soi-même qu’il s’agit de commencer.
Par ignorance, les parents perpétuent le dérèglement en distillant étourdiment les éléments qui attaquent le psychisme de l’enfant.
L’état d’insatisfaction que suscite l’abondance des biens offerts à notre convoitise imprègne les neurones d’un cerveau dont les qualités plastiques sont telles qu’il s’imbibe, à l’instar d’une éponge, de fausses notions.
Trop souvent, on l’oublie, une réaction salutaire se dessine néanmoins. La volonté de se rendre utile prend corps dans l’esprit de jeunes générations. Cette volonté se développe à l’âge du choix que l’adolescent doit faire à la fin de ses études scolaires ou universitaires.
Il se complique du fait des difficultés économiques qui se manifestent périodiquement et cette difficulté se mue en perplexité qu’imagent des propos de ce genre : « Rien ne me tente. Si seulement je savais comment m’y prendre pour concilier mes ambitions et mes aspirations ! » « Je voudrais me rendre utile à mon prochain, mais je sais combien enfantine paraît cette affirmation démunie de toute possibilité de réalisation. »
Ce ne sont que des échantillons parmi d’autres et il n’est guère aisé de faire comprendre à une génération qui se cherche comment sortir de l’impasse et comment découvrir sa réalité profonde et, par voie de conséquence, comment faire usage de ses facultés, moyens et dons, en les développant judicieusement. Se rendre compte de l’intérêt qu’offre une activité plutôt qu’une autre, non comme mode d’existence, mais comme voie de développement, bouscule les idées de facilité, de rentabilité ou de convenances.
La sélection, dans tous les domaines, donnant accès aux postes à pourvoir, devrait tenir compte du dévouement que le candidat saurait montrer à la fonction et de l’intérêt qu’offre pour lui cette fonction.
Une amélioration des conditions d’existence pour l’ensemble de la collectivité en résulterait, augmentant l’attrait qu’offre la fonction. L’amélioration et l’attrait se situeraient non seulement au niveau professionnel, mais aussi et surtout, au niveau des relations humaines. On resterait attaché à son activité, non simplement par nécessité alimentaire et matérielle, mais dans l’idée d’être utile, donc de servir.
L’idée d’être utile est un ressort puissant de l’évolution et, dès lors, se pose le problème du chômage et de l’inutilité apparente qui constitue, pour le chômeur, un poids psychologique redoutable.
Remédier à cet état de fait s’impose d’autant plus que la mécanisation des industries se poursuivra en s’accélérant, libérant l’homme d’un grand nombre de tâches astreignantes, perspective heureuse à condition de lui ménager une voie d’accomplissement. Elle ne peut se concevoir que dans le cadre d’une fonction au niveau de ses compétences, fonction qui doit être d’utilité publique, notion vague qu’il s’agira de définir.
À ce niveau, la responsabilité découlant de cette fonction devra être prise en considération par la collectivité, même si elle ne fait pas l’objet d’un contrat de travail et se trouve, en quelque sorte, auto-assumée.
Surmonter les difficultés inhérentes à cette évocation très succincte d’un problème épineux que l’indemnisation du chômage est incapable de résoudre, n’est pas chose facile.
Nier l’urgence du problème, c’est nier une évidence qui, tôt ou tard, se manifestera impérieuse. L’envisager, même si dans l’immédiat aucune solution valable ne puisse être suggérée, dégagera à la longue la solution qui s’impose.
Avancer certaines considérations, prôner l’humanisme, envisager un changement n’ont de sens qu’en voyant le monde tel qu’il est et les hommes tels qu’ils sont, non en s’imaginant pour les besoins de la cause qu’ils changeront par l’impact d’une quelconque idéologie.
Aussi doit-on tenir compte des expériences du passé, pour envisager les moyens à mettre en œuvre dans l’avenir. Tous les modes de gouvernement pratiqués en Europe ont été essayés, soit en Grèce, soit à Rome.
La diversité des régimes a fait pencher pour un mode ou un autre, suivant les tempéraments des peuples et de leurs dirigeants.
Peu importent les critiques que peuvent soulever tel ou tel régime ! Une leçon peut être tirée de la diversité, même les expériences tentées. Elle se résume en une phrase : « Pour bien gouverner, il doit y avoir une adaptation réelle des gouvernants aux gouvernés. »
Quand Solon établit la République à Athènes, les premières mesures prises avaient pour but de défendre les intérêts des marchands. Ce qui fut nécessaire jadis, peut l’être aujourd’hui, à condition, il est vrai, que les marchands, les commerçants ou les industriels parachèvent leur éducation d’hommes. L’entreprise doit aider à développer le sens des responsabilités et sa direction doit déborder les frontières de son activité professionnelle, pour s’intégrer dans un ensemble harmonieux. Cela suppose de nouvelles relations entre entreprises qu’oppose, apparemment, la concurrence.
Il ne s’agit pas de repenser l’économie. Des esprits éminents se sont penchés sur le problème. Il s’agit de voir les choses telles qu’elles sont. Supprimer la concurrence démobilise les individus et il faut donc admettre qu’elle a un aspect positif.
Se combattre implacablement et employer des moyens discutables est, en revanche, un aspect négatif. Existe-t-il un moyen terme ?
Pour bien faire, il faudrait que les commerçants, les industriels et les financiers soient des hommes d’élite, qualifiés et désintéressés, pour éliminer la rivalité de fonction, de culture ou de milieu, afin que leur compétence soit égalée par leur valeur humaine.
Je vois le doute se dessiner sur les traits du lecteur. Il est fondé, mais il est inutile d’espérer pour entreprendre et inutile de réussir pour persévérer.
À notre époque, on feint de croire qu’un homme d’État doit avoir toutes les qualités, sauf précisément des qualités humaines, ce qui le rendrait vulnérable.
Erreur fondamentale !
L’une des premières qualités humaines est le discernement non entaché d’a priori. Il ne dispense pas, bien au contraire, d’une grande fermeté lorsque la défense des valeurs essentielles l’exige. Définissons, dès lors, un homme d’État, tant par ce qu’il n’est pas, que par ce qu’il devrait être.
Un homme d’État n’est pas un prêtre. Il n’est pas appelé à la tête du pays pour reprocher les torts passés, et non plus pour prophétiser le bonheur dont jouiront ses fidèles. Il doit gouverner, c’est-à-dire faire en sorte que tous les rouages de l’État se relient les uns aux autres de la manière la plus parfaite. Il doit pouvoir prouver que les faits donnent raison à ses initiatives. Il doit donc penser juste. La prévoyance entraîne l’adaptabilité. S’adapter aux circonstances ne doit pas être considéré comme une trahison à une doctrine, quelle qu’elle soit, mais comme une mesure opportune.
L’homme d’État gouvernant est détaché du passé, ne rêve pas de l’avenir, mais il tient compte des expériences qui furent siennes pour agir dans l’immédiat et prévoir le futur. L’homme d’État gouvernant n’a pas d’opinion personnelle qu’il veut mettre en pratique. Il se réfère aux choses existantes. Il tient compte de l’orientation des esprits, des qualités et des vices des hommes et des femmes et des rapports du pays avec le reste du monde. Il ne détruit rien, mais utilise toutes choses aux meilleures fins, pour le bien-Être de ses administrés.
Il saura s’entourer de collaborateurs dont la liberté d’esprit égale la sienne. Il décidera ce qui doit être, en fonction de sa compétence ou, mieux encore, de sa connaissance, certain de voir ses décisions comprises par ses collaborateurs qui s’évertueront de les faire exécuter.
Tableau idyllique sans doute, mais vision non utopique de demain, puisqu’il n’est guère concevable que le monde puisse continuer sur la pente savonneuse qui, à défaut de retournement spectaculaire, le précipitera dans l’abîme d’un cataclysme global. Autrefois, en Grèce, l’homme d’État gouvernant se voulait descendant direct des dieux. C’était commode pour asseoir son autorité mais dangereux, en justifiant ou en camouflant l’incapacité. L’homme d’État doit gouverner avec autorité, mais de manière à laisser libre jeu à la liberté. Paradoxalement, on pourrait dire qu’il devrait imposer avec autorité des mesures qui assurent le maximum de liberté, sans pour autant la confondre avec la licence.
Gouverner, c’est percevoir l’actualité dans sa mouvance. Toute mesure juste dont l’application traîne en longueur peut se révéler fausse par la suite. Les intentions les plus louables paraîtront inadaptées si les circonstances les ayant rendues souhaitables à un certain moment ont changé.
L’homme d’État gouvernant doit être disponible d’esprit pour développer au mieux ce qui doit être développé. Il respectera les coutumes profondes et ne fera pas de son pouvoir une affaire de police ou d’armée, mais son mérite découlera uniquement de sa valeur humaine, de son intelligence.
Elles l’inciteront à suivre les conseils désintéressés d’un homme ou d’un groupe d’hommes, dont il acceptera et la compétence et l’autorité, tout en traduisant les avis sollicités en actes sensés, assumant ainsi sa pleine mesure !