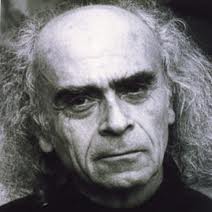(Revue Question De. No 47. Avril-Mai 1982)
La tragédie de ce qu’on appelle l’Occident, en cette fin de vingtième siècle, c’est de n’avoir ni définition de sa spécificité, ni de sources authentiques ou considérées comme telles. En effet, des connotations contestables sont attachées au terme « Occident », d’une part sur le plan politique, avec tout ce que cela comporte d’idéologie raciste, d’autre part sur le plan de la culture, celle-ci étant qualifiée abusivement de latine. Or, il est difficilement soutenable de prétendre que l’Europe du nord et du nord-ouest est latine : c’est pourtant ce que l’on dit, et cette prétention est appuyée sur le fait culturel lui-même, à savoir la quasi hégémonie des « humanités » gréco-latines, et sur le fait religieux, le catholicisme et le protestantisme étant bien évidemment les héritiers d’une tradition spirituelle venue d’Orient mais régurgitée sous un aspect essentiellement romain (même pour les divers protestantismes, qu’on le veuille ou non). En somme, en Occident, tout vient d’ailleurs. Alors, que sont donc ces fameuses « valeurs occidentales » dont les propagandes officielles nous rabattent les oreilles ? Il est plus que probable que, si on grattait en profondeur les éléments du discours socioculturel qui nous est familier, on risquerait de se retrouver dans la position d’un Alfred de Vigny qui, dans le célèbre poème du Mont des Oliviers, par Christ interposé, s’aperçoit que le ciel est vide et ne répond à aucune de ses questions. Cela ne veut pas dire qu’il n’y ait rien dans le ciel, cela signifie simplement que les questions qu’on pose ne sont pas bonnes puisqu’elles ne méritent aucune réponse.
Les trahisons du Christianisme
L’une de ces questions sans réponse semble être celle que pose le Christianisme, aussi bien sous sa forme romaine que sous celle qui est jugée « hérétique ». Pendant les premiers siècles de notre ère, le Christianisme a surtout été vécu dans le quotidien, ce qui explique d’ailleurs pourquoi il a supplanté partout les anciennes religions. Mais c’est aussi parce qu’il les intégrait. L’exemple de l’Irlande, jamais soumise à une quelconque autorité romaine, et passant sans trop de heurts du druidisme au christianisme, est assez éloquent : il s’en est suivi l’apparition d’un Christianisme celtique, très marqué par l’ancien druidisme comme le prouve l’expérience pélagienne, et qui s’est trouvé très vite en butte à l’opposition acharnée des tenants de l’ordre romain.
Car la première trahison du Christianisme se trouve là : par souci d’universalisme, ce qui était louable en soi et conforme à l’esprit évangélique, on a voulu imposer à l’ensemble des Chrétiens un modèle unique, qui n’était pas universel mais romain. Car le Christianisme est devenu la religion officielle de l’Empire romain. De ce fait, il a intégré toute l’idéologie romaine. De plus, aumoment de la disparition politique de cet empire, le Christianisme, dont les structures temporelles étaient calquées sur celles de l’Empire, est demeuré la seule autorité spirituelle et morale pouvant encore se faire entendre et se faire obéir. On conçoit facilement comment ce christianisme est devenu une véritable puissance socio-politique au détriment de la tradition culturelle et spirituelle qu’il était sensé répandre à toutes les nations.
Au contraire ; il est devenu hyper-nationaliste, réduisant à néant toutes les tentatives d’interprétations diverses, niant tout droit à la différence, faisant fi de toutes les composantes culturelles qui avaient assuré sa rapide propagation. La Vérité, une et indivisible venait de Rome. Les bûchers et les prisons de l’Inquisition, un peu plus tard, allaient être le couronnement de cette entreprise hégémoniste.
Depuis, à travers une histoire tourmentée, à force de rénovations et de reniements, le Christianisme s’est maintenu, tant bien que mal, jusqu’au concile de Vatican II. Compromis avec les pouvoirs en place, pour lesquels il assurait une véritable fonction policière, tombé aux mains d’une aristocratie financière plus avide de chiffres que de sermons sur la montagne, il est parvenu à un stade de sénilité avancé d’où le concile de Vatican II a voulu le faire sortir. Mais par quels moyens ? Ceux du renoncement : des pages entières de la Tradition ont été arrachées, et le rituel, si important dans toute transmission, a été simplifié, remis n’importe comment au goût du jour, autrement dit complètement vidé de son sens initiatique et séparé de la composante magique qui l’animait. Et cela au nom de la logique, pour lutter contre la superstition. On aurait pu également dire : par démagogie, par souci de récupérer une clientèle depuis longtemps fatiguée et rebutée.
Le jeu de la liturgie
Mais les choses sont ce qu’elles sont. Cette réforme du catholicisme, qui, en réalité, va beaucoup plus loin que celles des différents protestantismes au XVIe siècle, a conduit à une religion plus intellectuelle que sensible, plus raisonnable que mythologique. C’est oublier que l’esprit humain, chaque fois qu’on le prive d’irrationnel, va le rechercher sous n’importe quelles formes, fussent-elles les plus aberrantes. Et de quel intellectualisme s’agit-il ? Vu l’a-culturation évidente du clergé catholique, les interrogations des fidèles risquent de demeurer aussi dénuées de réponses que la grande question que posait Vigny. La panacée universelle, selon les nouveaux clercs, est la fameuse formule : « vivez dans le Christ ». Elle est commode. Elle évite de répondre. Et surtout, elle ne veut strictement rien dire. La théologie, qui, au cours des siècles, s’est épuisée à vouloir définir Dieu, alors que celui-ci est par essence même indéfinissable, serait-ellesur le point d’avouer son impuissance ? Et devant cette situation, les vrais fidèles, ceux qui veulent vivre la foi jusqu’au bout, et qui savent que les mots sont seulement des jalons sur le chemin de la lumière, ceux-là vont s’enfermer dans le cadre de la vie monastique, laquelle semble encore la voie la plus authentique, du moins au sein de l’Église.
Car le Christianisme s’est confondu malheureusement avec une Église, institution humaine soumise aux tempêtes de l’Histoire et à la valse des idéologies. En réalité, le Christianisme meurt de ses trahisons successives et de ses contradictions. Il n’a pas réussi à surmonter ces dernières parce qu’il est le résultat d’un syncrétisme, et non d’une synthèse. À l’héritage judéo-mosaïque se sont ajoutés le manichéisme persan, l’orphisme grec primitif, l’aristotélisme hellénistique, le juridisme romain et une certaine spiritualité nord-occidentale issue du druidisme. Mais le tout n’a jamais été cohérent, ce qui ne l’a pas empêché d’être le mode de penser et de croire obligatoire pendant près de vingt siècles. Ce qui faisait sa force, c’étaient à la fois son message et sa liturgie. Aujourd’hui, le message disparaît sous les discussions byzantines, et la liturgie n’est plus qu’un jeu destiné à amuser les enfants. Alors, dans ces conditions, que peut devenir la spiritualité occidentale ?
La Chaîne rompue
On sait que l’attrait de plus en plus évident des spiritualistes occidentaux pour les religions vivantes de l’Extrême-Orient, ainsi que pour les divers systèmes de vivre et de penser qui y affèrent, est dû au vide laissé par le Christianisme. L’Extrême-Orient peut en effet proposer des doctrines, des références, des rituels, des techniques et des spéculations dont la cohérence ne fait aucun doute et qui, en plus, sont appuyés sur une longue expérience, sur une tradition authentique remontant très loin dans l’histoire. Qu’on songe, par exemple, que le bouddhisme est plus ancien que le christianisme, et qu’il se porte très bien, du moins dans les pays qui ne le combattent pas.
Or il semble n’y avoir en Occident aucun système, aucune religion de type classique, aucune tradition spiritualiste, qui soient comparables à ce qui se passe en Asie. La religion romaine et la religion grecque sont mortes, toutes deux parce qu’elles étaient devenues le culte dela patrie et de l’État. Les religions germaniques se sont écroulées au XIIe siècle, définitivement, devant les assauts d’un christianisme conquérant. Le druidisme, religion des différents Celtes, s’est évanoui au cours des premiers siècles de notre ère, d’une part parce que l’Empire romain a interdit aux druides de professer leur doctrine, d’autre part parce que la spiritualité celtique s’est fondue en partie dans le christianisme primitif. Il n’y a plus de druides, n’en déplaise à certains personnages qui s’affublent d’une belle robe blanche, se réunissent de temps à autre au milieu des menhirs (parfois en matière plastique), et jargonnent bizarrement. Leur soi-disant rituel n’est qu’un tissu d’affabulations dues à un personnage de génie, Iolo Morganwc, érudit et poète gallois du XVIIIe siècle, qui voulut reconstituer, à partir d’éléments disparates (et parfois authentiques) une tradition druidique disparue. Mais on ne peut nier une évidence : les druides ont toujours interdit l’écriture, pour diverses raisons, et il n’y a pas et il n’y aura jamais, d’enseignement druidique écrit, et donc contrôlable sur le plan de l’authenticité.
Impossibilité de la communication ?
Cette chaîne rompue constitue un manque dont les conséquences sont incalculables sur la spiritualité occidentale moderne. Car tous ceux qui, de bonne foi, désirent s’engager dans une recherche de leurs sources et de leur essence propre se trouvent confrontés à des difficultés insurmontables. D’une part, le charlatanisme, qui s’est emparé du domaine celtique, a suffi à déconsidérer une tradition en la faisant passer pour ce qu’elle n’est pas. D’autre part, privés de ces sources proprement « indigènes », ceux qui sont en recherche spirituelle se sont réfugiés dans l’orientalisme qui lui, au moins, présente une chaîne ininterrompue. Mais il y a des inconvénients : sommes-nous, oui ou non, nous autres, gens de l’Europe du nord et du nord-ouest, capables de pénétrer autrement que par goût de l’exotisme, dans un monde mental et spirituel qui n’est pas le nôtre, et qui, bien souvent, par différence de sensibilité et d’approche logique, se révèle d’un accès difficile ? Personnellement, tout en reconnaissant les louables tentatives de certains esprits éclairés, je crois à l’impossibilité de communication absolue entre l’esprit occidental et l’univers mental de l’hindouisme et du bouddhisme. Et cette impossibilité est pour ainsi dire« naturelle ». Le droit à la différence, sur lequel on s’étend volontiers aujourd’hui, n’est-il pas la reconnaissance de cette différence fondamentale ?
Ces constatations étant faites, il n’est point bon de s’avouer incapable de toute recherche. Car si réellement la chaîne est rompue entre les temps lointains du druidisme celtique occidental et le désir d’une spiritualité indigène moderne, de nombreux maillons de cette chaîne nous restent. Pourquoi ne pas les reconnaître là où ils existent, et surtout quand on les a ignorés et méprisés systématiquement, pourquoi ne pas les recueillir, et pourquoi ne pas tenter de reconstituer ce qui constituait l’âme de nos ancêtres ?
Les archéologues de la Tradition
Cette reconstitution se fait souvent à notre insu et de très nombreux vestiges de la tradition ancienne sont à notre disposition sans que nous soupçonnions leur valeur et leur intérêt. Depuis le XIXe siècle, la plupart des textes irlandais et gallois contenus dans les manuscrits gallois du Moyen-Age ont été traduits et publiés, parfois par des « savants » qui ne le faisaient que par curiosité linguistique, ignorant ou méprisant le contenu au profit de la forme. Mais ces textes ont été tirés de l’oubli. Et ils représentent une portion non négligeable de la tradition orale celtique, du moins ce qui en restait dans les régions demeurées les plus fidèles à l’esprit druidique.
Car rien ne se perd. Les druides ont disparu, certes. Leur enseignement s’est trouvé interrompu. Mais d’une part, leur système de pensée a imprégné le christianisme celtique, et d’autre part, leur héritage a été recueilli parles bardes, les fili, tous ces successeurs de la classe sacerdotale, qui l’ont transmis de générations en générations sous forme de récits, de contes et d’épopées. Évidemment, les développements philosophiques ou théoriques n’y paraissent plus. Mais sous l’aspect de symboles et d’allégories, pour peu qu’on veuille bien les reconnaître à travers les multiples métamorphoses de l’imaginaire, ils existent, et sont à notre portée.
On sait par exemple que le cycle épique irlandais connu sous le nom de cycle ossianique, bien que les récits qui les mémorisent soient assez récents dans leur forme écrite, est un des plus anciens monuments de l’Europe du nord-ouest. Le héros principal Finn (= le Beau, le Blond), dont le nom véritable est Demné (= le Daim),roi d’une troupe de chasseurs et de guerriers itinérants, a épousé une femme, Sadv, qui, par suite d’un enchantement, passe la moitié de sa vie sous forme de biche. Et son fils est Oisin, ou Ossian, dont le nom veut dire « faon ». Et son petit-fils est Oscar, ce qui signifie « qui aime les cerfs ». Ce cycle épique, qui correspond à une très ancienne civilisation de chasseurs nomades dont les caractéristiques religieuses sont indubitablement liées à un culte du dieu cervidé. Or, actuellement, en Écosse comme en Irlande, pays gaéliques, on raconte encore, dans le peuple, des histoires étranges concernant Finn et Ossian. Et quand on réfléchit à la permanence des rites de la chasse, en particulier l’étonnante liturgie de la Chasse à Courre, on ne peut manquer ni de faire des rapprochements, ni de conclure à la transmission d’une tradition qui défie le temps. Il suffit peut-être de voir à travers les figures symboliques la grande ombre d’une métaphysique et même d’une théologie à peine oubliée. Un autre cycle épique irlandais, celui d’Ulster, où se distinguent des héros comme le roi Conchobar (= le Chien Puissant) et Cûchulainn (= le Chien de Culann) concerne une autre civilisation, celle d’éleveurs de bovins sédentaires, et qui se font aider par des chiens : d’où l’importance des razzias de troupeaux dans ce cycle. N’y a-t-il pas là le souvenir d’antiques rituels concernant le dieu Taureau et le dieu Chien ? Ce ne sont pas les spécialistes de la tauromachie qui me contrediront. Ni même certaines femmes qui, dans un contexte très spécial et parfaitement aberrant, manifestent un étrange intérêt pour les chiens et les taureaux : car le mythe s’incarne où il le peut, même sous les aspects les plus pervers ou considérés comme tels.
Cycle épique
Le cycle épique des anciens Gallois – qui, eux, à la différence des Bretons qui parlaient la même langue, ont conservé des manuscrits anciens – se réfère aux mêmes données. Mais il y ajoute très nettement des informations concernant le culte du Sanglier, puis du Porc domestique. C’est un indice d’évolution de la société celtique, sur un plan matériel et quotidien. Mais c’est aussi l’indication précieuse d’une mutation religieuse et philosophique. On pourrait peut-être se demander à quoi correspondent exactement les fêtes rurales qui accompagnent la mort du cochon.
Car il ne s’agit pas seulement de prendre à la lettre ce que nous racontent les belles histoires de l’ancien temps. Le sacrifice du cerf, du taureau et du cochon est certes un rituel qui coïncide avec le quotidien. Mais ce rituel traduit en images des croyances et des dogmes. À nous de les rechercher. À nous de découvrir ce qui se cache derrière les gestes qu’on accomplit aveuglement, en ne sachant plus à quoi ils servent.
Une ténébreuse et profonde unité
Mais les textes issus des manuscrits du Moyen Age, lesquels ne font que recueillir une tradition orale ancienne, ne sont pas isolés sur l’ensemble de l’Europe du nord-ouest. Ce qu’on appelle le « folklore » est la preuve vivante de cette permanence, surtout quand des contes et des récits encore en usage recoupent étroitement les schémas fondamentaux des grandes légendes fixées dans l’écriture depuis déjà longtemps. Un remarquable ouvrage de Claude Lecouteux, Mélusine et le chevalier au cygne (Ed. Payot, Paris, 1982), met en évidence la vitalité des archétypes véhiculés par la voie des contes dits populaires. Car l’étrange figure de Mélusine, à travers les péripéties de sa légende, à travers ses multiples transformations, n’est autre chose que l’image projetée de la grande déesse celtique du jour et de la nuit. Le conte réactualise un mythe, et entraîne avec lui tout un contexte initiatique qu’il n’est pas difficile de distinguer. Il en est de même pour le chevalier au Cygne, autrement dit Lohengrin, pur produit de la mythologie germanique, et lié, un peu artificiellement peut-être, à la quête du saint Graal. D’où vient d’ailleurs que, dans de nombreux contes, les cygnes, qui sont hyperboréens, sont souvent les aspects transitoires d’êtres humains doués de pouvoirs exceptionnels ?
Et il ne s’agit pas seulement d’examiner la tradition populaire des pays de langue celtique ou de langue germanique. Le substrat celtique existe ailleurs, comme je pense l’avoir montré dans le choix de récits suivi de commentaires de mes Contes Occitans (Ed. Stock, Paris1981) : l’Occitanie des bords du Lot, du Limousin et du Massif Central recèle bien souvent d’étranges épopées oùrevivent, sous des noms d’emprunt, les grands héros de la mythologie celtique. Dans un pays qui a vu, à partir du XIe siècle, une incroyable éclosion de troubadours inspirés, il ne peut en être autrement. Mais il n’est venu à l’esprit de personne, jusqu’à présent, que l’un des chefs-d’œuvrede la littérature occitane du Moyen-Age, le Roman de Jaufré, était sinon la version primitive, du moins une version archaïque de la fameuse Quête du saint Graal, tant de fois récupérée par la suite selon des idéologies fort diverses. Il est vrai qu’on a trop longtemps considéré ces vieilles légendes comme des amusements destinés aux enfants et qu’on n’a pas vu que les enfants pouvaient souvent comprendre ce que les adultes, aveuglés par les routines d’une logique trop étroite, n’étaient plus capables de traduire.
On a jugé, par exemple, la poésie des bardes gallois comme étant le résultat de balbutiements poétiques incompréhensibles ou incohérents. Qu’on en juge par ces quelques vers :
« Sur les hauteurs de la montagne,
j’ai été serpent tacheté,
j’ai été vipère dans le lac,
j’ai été étoile au bec recourbé,
j’ai été un vieux prêtre
avec ma chasuble et ma coupe.
Longs et blancs sont mes doigts.
Il y a longtemps que j’étais pasteur.
J’ai erré longtemps sur la terre
avant d’être habile dans les sciences.
J’ai erré, j’ai marché,
j’ai dormi dans cent îles,
je me suis agité dans cent villes… »
Ces paroles attribuées au barde gallois Taliesin, l’un des plus étonnants poètes de la tradition celtique, sont donc des niaiseries à l’usage de sous-développés mentaux ? Lorsque j’ai publié pour la première fois en langue française, avec une préface d’André Breton qui savait reconnaître où se trouvait une authentique tradition, les poèmes des Grands Bardes Gallois, peu de gens ont été sensibles à l’époque au charme magique de Taliesin. Aujourd’hui, ce livre, devenu introuvable, est réédité (Ed. Jean Picollec, Paris, 1981). Est-ce un signe des temps ? Comprendrait-on enfin qu’il nous reste, dans les limites de notre vieille Europe du nord-ouest, des bribes d’un enseignement inconnu ? Mais sait-on que nombreux sont les Japonais qui s’intéressent à la tradition celtique ? Car il y a, entre les textes fondamentaux recueillis par les moines du Moyen Age et les contes populaires orauxune ténébreuse et profonde unité : c’est une tradition permanente, marginale, originale, et qui a échappé, au cours des siècles, à la sclérose d’une culture officielle manipulée au gré des idéologies dominantes. Et comme le disait Henri Gaidoz en 1879, « chassés des temples, les dieux gaulois se sont réfugiés dans nos campagnes ».
La source invisible
Cette tradition qui a survécu serait pourtant vaine si chacun d’entre nous ne prenait pas conscience qu’elle ne peut être comprise et appliquée que dans la mesure où nous changerons notre vie quotidienne. Des signes avant-coureurs montrent que la voie peut être ouverte vers une nouvelle spiritualité, celle-ci à l’image de notre essence et en conformité avec notre mentalité. Les tentatives écologiques ne reposent pas sur rien : elles témoignent du souci de plus en plus avoué de concilier l’Homme et la Nature. Car l’être humain ne peut pas vivre sans la Nature dont il fait partie et qui non seulement nourrit son corps mais permet à son esprit d’évoluer vers les sphères infinies. Le respect des animaux, sur lequel on attire notre attention, est également révélateur : la société idéale est celle de l’Age d’Or, en des temps où les hommes et les animaux parlaient le même langage et ne se faisaient point la guerre. Et puis, la réflexion que l’on fait sur la nourriture, sur la façon de manger, n’est certainement pas inutile, puisque nous sommes ce que nous mangeons.
Le retournement de la situation dépend de la mise en œuvre des éléments d’une tradition perdue et retrouvée. Cette tradition existe : nous la rencontrons partout où nous ouvrons les yeux pour voir. Lorsque les chevaliers partaient à la quête du saint Graal, ils passaient souvent près du château où se trouvait le vase mystérieux. Mais peu d’entre eux étaient capables de le distinguer à travers le brouillard. Comme le dit une inscription de la curieuse église de Tréhorenteuc (Morbihan), haut lieu du Graal et de la Table Ronde, inscription qui se trouve à l’extérieur, au-dessus de la porté du sud : « la porte est en-dedans ». Et cette porte, c’est la célèbre « entrée ouverte au palais fermé du roi » dont l’alchimie traditionnelle a fait un symbole majeur. Certes, dans le récit de la Quête du Saint-Graal, Lancelot du Lac, le meilleur chevalier du monde, mais l’imparfait, le dieu borgne des légendes, tout en étant entré au château mystérieux, a trouvé la porte qui se trouvait en dedans. Il l’a ouverte. Mais il n’a paspu entrer. Il n’a vu que la lumière qui surgissait du plus profond de l’ombre. Nous sommes peut-être tous des Lancelot. Mais nous pouvons quand même essayer, ce n’est pas plus ridicule que de dormir au pied d’un chêne. Dans l’ombre se cache la lumière, et dans la lumière se cache l’ombre. C’est le grand enseignement de cette tradition occidentale bafouée ou niée.
Quand les missionnaires d’une nouvelle religion abordaient des rivages inconnus, ils avaient coutume de frapper le sol de leur bâton de voyageur. Et une source jaillissait sous leurs pieds. Cette fable universelle prouve une chose : l’eau se trouve sous nos pieds ; il n’est point besoin d’aller la chercher ailleurs. Mais il faut une recette, un rite, une liturgie, pour la faire surgir du ventre de laterre.