Qu’est-ce que cette entité insaisissable qu’est la personnalité ? La psychologie propose des explications, telles que les traits de caractère et les schémas cohérents de pensée, de sentiment et de comportement. La personnalité est ce qu’un individu fait systématiquement et ce qu’il fera probablement à l’avenir.
Le yoga nous dit que les vies créent des schémas, voire des nœuds, dans le corps, qu’il faut libérer pour ne pas subir leur influence. Les schémas les plus essentiels sont ceux qui engendrent une mauvaise compréhension de la nature de la réalité, entraînant confusion et douleur. Nous nous considérons comme ce qui est contenu à l’intérieur de notre peau et donc comme séparé et soumis aux souvenirs, aux imaginations, aux peurs et aux désirs de notre esprit et de notre corps en perpétuel changement. Avec de l’intention et de la pratique, nous parvenons à apaiser suffisamment l’esprit pour qu’il devienne ouvert et calme.
Les traditions spirituelles décrivent souvent la personnalité comme quelque chose à abandonner, dissoudre, relâcher ou libérer. J’ai eu un véritable déclic lorsqu’un théosophe avisé a déclaré à propos d’une dispute en cours : « Ce n’est que leur personnalité ». Cette déclaration reconnaissait le conflit, les agents et la distinction entre la personnalité et l’Esprit toujours présent.
Nous croyons que l’entité qui porte notre nom est réelle et particulière. Pour les jeunes enfants, cela fait partie du développement normal et les aide à s’orienter dans le monde. En tant qu’adultes, cette croyance est si profondément ancrée dans notre psyché, si inconsciente, que nous sommes surpris par des événements qui la contredisent.
Bon nombre de nos désirs les plus chers sont liés à la reconnaissance de notre particularité par les autres. Dans notre esprit, que nous soyons heureux ou que nous souffrions, nous sommes le centre, la vedette du spectacle et l’objet d’attention. Être particulier signifie que nous existons par rapport aux autres. Nous ressentons de la joie lorsque nous sommes en avance, de la colère ou de la tristesse lorsque nous sommes en retard. Nous prenons le discours que nous tenons dans notre tête pour la réalité, et nous restons donc isolés.
La personnalité est un concept pratique. Si je connais vos tendances, je peux prédire que vous serez agréable, fiable, susceptible de réussir, ouvert aux idées, craintif, stable ou changeant. Lorsque les autres réagissent à notre personnalité, l’illusion se consolide. Ce sentiment de « c’est bien moi » est un sentiment de sécurité, que nous aimions ce « moi » ou non. Plus nous nous engageons dans ce rôle, plus il nous est cher. Ce que je fais de bien m’appartient. Lorsque je souffre, c’est parce que je suis incompris. Il semble impossible de sortir du drame du rôle et de voir la personnalité pour ce qu’elle est : imaginaire.
Un cours en miracles décrit le sentiment d’être particulier comme la grande illusion de l’existence et le « grand dictateur des décisions fausses ». Pourrions-nous haïr si nous n’étions pas en compétition ? Pourrais-je être particulier si je ne définissais pas « l’autre » comme quelqu’un avec qui rivaliser ? « Estimer la particularité, c’est estimer une volonté étrangère à qui les illusions de toi-même sont plus chères que la vérité » (Un cours en miracles, Texte, 502).
Les enseignements spirituels conseillent souvent de ne pas prendre cette personnalité trop au sérieux : c’est un mensonge, une confusion, une erreur. Nous consacrons du temps et de l’énergie à améliorer notre corps, notre esprit, notre santé et notre situation économique. Parfois, nous cherchons à renforcer nos relations et à nous aligner sur un système spirituel ou philosophique qui semble confirmer nos opinions. Nous construisons ce que nous jugeons bon dans notre caractère. Pourtant, les enseignements spirituels nous invitent également à laisser ces schémas derrière nous. Ils nous invitent à renoncer à notre sentiment d’être spécial et à devenir la lumière que nous avons toujours été, mais que nous n’avons jamais su imaginer. Comment harmoniser ces objectifs apparemment contradictoires ?
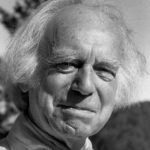 Jean Klein, un enseignant spirituel dans la tradition hindoue de l’Advaita Vedanta, dirait que c’est le devenir qui est le problème. Nous sommes presque toujours dans un mode de devenir ; nous ne sommes jamais simplement ici. Nous recherchons l’expérience et non la vérité. Nous désirons beaucoup de choses, de sentiments et de réussites. Mais lorsque nous obtenons enfin l’objet de notre désir, celui-ci n’a que peu de sens.
Jean Klein, un enseignant spirituel dans la tradition hindoue de l’Advaita Vedanta, dirait que c’est le devenir qui est le problème. Nous sommes presque toujours dans un mode de devenir ; nous ne sommes jamais simplement ici. Nous recherchons l’expérience et non la vérité. Nous désirons beaucoup de choses, de sentiments et de réussites. Mais lorsque nous obtenons enfin l’objet de notre désir, celui-ci n’a que peu de sens.
Une vieille histoire raconte qu’un étudiant demande à son maître combien de temps il faut pour atteindre l’illumination. Le maître répond : « Cinq ans ». L’étudiant demande : « Et si j’essaie vraiment ? » Le maître répond : « Dix ans ». Dans la terminologie de Klein, le fait de fixer un objectif (une illumination plus rapide) met l’étudiant en mode devenir, dans l’attente de la prochaine expérience, et met ainsi en place le schéma qui perpétue la personnalité.
L’expérience n’est pas la réalité. Une expérience peut être incroyable, et le yoga, la méditation, la prière, l’hypnose, le chant, les drogues et bien d’autres pratiques peuvent nous donner une expérience de paix et de joie. Nous aimons cette expérience — j’aime cette expérience. Mais l’expérience est elle aussi mesurée sur l’échelle du plaisir et du déplaisir, et nous ne nous en libérons pas. En fait, nous sommes dépendants de cette expérience. Nous laissons l’expérience d’une émotion positive, comme l’amour, la joie ou la paix, devenir un objet de désir.
En tant que professeur de yoga depuis trente ans, j’aime le bonheur et la libération que la pratique apporte. J’aime aussi voir mes élèves vivre leurs propres expériences de joie et de libération du stress. Aussi merveilleux que cela puisse être, ce n’est pas une libération de l’esprit jugeant. C’est toujours l’agréable contre le désagréable, le bon ou le mauvais, et c’est toujours la tyrannie de la personnalité.
Klein considère le discernement comme « l’unique facteur décisif de la connaissance » (Klein, Sois ce que tu es, 63). Bien qu’il ne propose aucune formule ou prescription, il parle de la discrimination comme d’un acte essentiel. L’esprit peut apprendre à faire la distinction entre l’ego/la personnalité et ce qui ne l’est pas. Ce qui n’est pas la personnalité est impersonnel, présent, transparent, curieux, vivant et ouvert. Le jugement s’appuie sur la mémoire et crée plus de mémoire, plus de combustible. « Le triomphe, c’est ce qui consolide le moi, la défaite c’est ce qui le détruit. Or le moi est une erreur. C’est l’erreur de la séparativité, de la vague qui se croit distincte de l’Océan » (Klein, Sois ce que tu es, 68).
La distinction entre ce qui est réel et ce qui ne l’est pas est au cœur des enseignements du Samkhya, une autre école de philosophie hindoue. Samkhya est généralement traduit par énumération. Le discernement est la raison de l’énumération de tous les aspects qui ne sont pas la pure conscience. Pourquoi les énumérer ? Pour savoir ce qui n’est pas réel. L’étude de ces principes énumérés « implique bien plus qu’une étude ordinaire. Elle implique plutôt un changement fondamental dans l’ancienne orientation de l’homme. Elle implique une sorte de réalisation intuitive ou de discrimination qui sépare la conscience pure de tout ce qui n’est pas la conscience » (Larson, 205).
Klein propose quelques conseils pratiques pour éviter le piège de l’expérience et le cycle mental du jugement. Il préconise l’observation de soi à chaque instant. L’observation de soi implique une séparation psychologique, sortir de soi-même et de ses émotions, et d’être témoin du cycle de réaction et de désir. Tant que nous sommes pris dans ces cycles, nous sommes piégés dans le devenir : chercher le bonheur, rester en sécurité, éviter la douleur, attirer l’attention — tout ce que notre conditionnement implique. Les cycles ne s’arrêtent jamais ; ils créent davantage de réactions, de projections et de désirs.
Finalement, sans intervention ni intention, une « certaine élimination » se produit, et ce qui reste à observer s’évanouit dans le néant. Il y a une perte de fascination pour les désirs de la personnalité. Notre attention n’est plus accaparée par ce qui se présente, et une clarté, une honnêteté et une tranquillité accrues apparaissent. Il y a moins de préférences et d’aversions, moins de bon et de mal, de victoire et d’échec.
La personnalité continue à faire ce qu’elle a toujours fait : comparer, juger, désirer, être déçu, constamment, devenir, obtenir, atteindre. En d’autres termes, nous ne sommes jamais ici et maintenant. Comment est-il possible d’arrêter ce retour à l’ancien moi ?
En tant que société, nous prêtons attention au corps en termes d’apparence et de santé. Nous n’accordons que peu d’attention au lien entre la pensée et le corps. Bien que toute réaction entraîne à la fois une pensée et une contraction du corps, nous négligeons ces signaux corporels et les émotions qui en résultent. Nous interprétons une tension dans le ventre comme de la peur, puis nous nous accrochons à cette peur par des pensées et des images mentales. Quelle est votre manière préférée pour arrêter cette transformation ?
Lorsque nous méditons, les drames se calment. Nous nous sentons élevés, ouverts, libres et compatissants. L’entraînement à la méditation nous permet de ralentir et de sortir de l’habitude de la réaction. Nous remarquons l’espace immense entre la fin d’une respiration et le début de la suivante, et nous nous laissons aller à une plus grande présence. Avec l’aide de la distance et de la perspective, nous prenons le temps d’évaluer ce qui se passe. Nous notons la réaction du corps, et pas seulement de l’esprit, et nous relâchons consciemment la tension et la contraction du corps. Nous revenons au présent.
Klein a passé beaucoup de temps à développer une relaxation profonde et minutieuse au niveau du corps — non pas pour se sentir bien, mais pour permettre au corps de remplir sa fonction. Les pratiques profondes de savasana ou du yoga nidra amorcent ce voyage. Cependant, c’est encore des expériences ; elles ne sont ni complètes ni permanentes.
Imaginez une scène où une autre personne qui est félicitée de manière extravagante en votre présence pour des actions que vous avez accomplies. Notez la pensée qui surgit, peut-être une forme de colère ou de jalousie. Observez la contraction et l’irritation émotionnelle. Utilisez le muscle de la discrimination pour ralentir et remarquer le schéma, le cycle de réactions et la tension. De quoi s’agit-il vraiment ? Quel est le besoin sous-jacent au niveau psychologique ? S’agit-il d’une tentative d’attirer l’attention ? Une autocritique ? De la sécurité ? De paix ? La compréhension psychologique est vitale sur le moment. Nous voulons être remarqués pour nous sentir aimés. Nous voulons assurer notre sécurité et nous sentir complets. Quelles que soient les stratégies complexes que nous utilisons pour nous sentir bien psychologiquement, le fait de reconnaître ce besoin permet de dénouer le cycle et le conditionnement.
L’examen de ces besoins et leur remontée jusqu’à l’origine permettent de se libérer et de trouver la paix. Pourtant, il s’agit toujours d’une expérience de la personnalité. Comment cela se traduit-il dans la discrimination ultime entre le réel et le non réel ? Klein ne donne que des indications subtiles, mais souligne que le détachement de la personnalité signifie l’absence de désir, car nous avons réalisé que ce que nous désirons ne tiendra jamais ses promesses. Le lâcher-prise, instant après instant, du conditionnement, l’abandon des objectifs, la sortie de la comparaison et de la compétition, et l’abandon de la distinction, de la particularité, font tous partie de ce détachement. Lorsque nous lâchons-prise du devenir, nous sommes.
Essayez l’expérience suivante : Souvenez-vous d’une interaction un peu dérangeante avec une personne. En vous la remémorant, imaginez cette personne à votre niveau, à hauteur de vos yeux. Regardez-la directement au niveau des yeux. Il ne s’agit pas d’une question de taille ou de différence réelle, mais de la façon dont nous nous souvenons de quelqu’un comme étant au-dessus ou au-dessous de nous. C’est ainsi que nous déterminons si une personne est supérieure, plus puissante, ou inférieure. Amener cette personne à hauteur des yeux dans notre mémoire est un petit pas vers la libération des habitudes de comparaison.
Lire Klein, c’est comme lire un hologramme : chaque partie contient le tout. Il reflète l’esprit qu’il a apporté à son enseignement, la présence qu’il étend à travers ses mots. Son enseignement le plus important est l’immobilité dans le silence de l’écoute (comme le son intérieur qui tue l’extérieur dans La voix du silence). Klein note que lorsque nos sens sont libres de toute intention, ils n’appartiennent plus au corps. L’attention sans qualification apparaît comme une présence globale : « À la fin, même l’ouïe et la vue se dissolvent dans cette présence et vous ne faites plus qu’un avec elle. Ultimement, il n’y a plus de sujet qui voit ni d’objet qui est vu. Il n’y a que l’unité » (Klein, Ease of Being, 7).
Sources d’information
Un cours en miracles.
Klein, Jean. La Joie sans objet, L’ultime réalité, Sois ce que tu es suivi d’entretiens inédits. Almora.
——. The Book of Listening. Oakland, California: Non-Duality Press, 2008.
——. The Ease of Being. Salisbury, Royaume-Uni : New Sarum Press, 2020.
——. Qui suis-je ? La quête sacrée. Le Relié.
Larson, Gerald. Classical Samkhya. New Delhi: Motilal Banarsidass, 2011.
Judith Sugg, PhD, est conseillère, enseignante en psychologie et professeur de yoga. Ses études supérieures ont porté sur la psychologie du yoga et le Samkhya, et elle a rédigé le guide d’étude des Yoga Sutras pour la Société théosophique.
Texte original : https://www.theosophical.org/publications/quest-magazine/unbecoming
