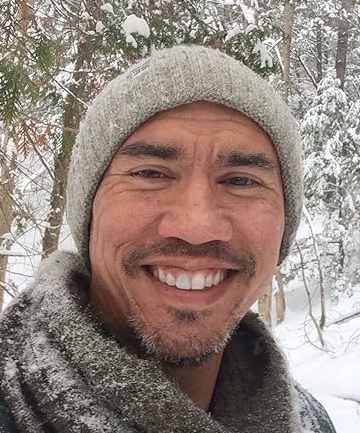Comment les animaux comprennent-ils la mort ? C’est la question qui anime ce récit, lequel, selon la convention, devrait commencer par une anecdote. Mais laquelle choisir ? Pendant que je travaillais sur ce sujet, un ami m’a raconté que son chien avait vu son plus proche compagnon canin se faire écraser ; depuis, le chien devient inconsolable et agité chaque fois qu’ils passent devant la rue où cela s’est produit. Mes algorithmes m’ont fait remonter une histoire à propos d’une oie veuve éplorée qui trouva un nouvel amour. Quelqu’un que je suis sur les réseaux sociaux a soutenu qu’il est éthiquement acceptable de tuer des animaux parce qu’ils ne savent pas ce qu’est la mort. J’ai lu le témoignage d’une primatologue qui dirige un sanctuaire pour animaux au Costa Rica ; chaque année, une guenon qu’elle avait sauvée lui présente son nouveau bébé, mais une année lui a apporté un bébé mort. Peut-être espérait-elle qu’un humain qui l’avait aidée autrefois pourrait l’aider à nouveau. Pourtant, la primatologue ne pouvait rien faire, et après plusieurs heures, la mère singe, semblant admettre sa défaite, s’est mise à hurler.
J’ai lu des dizaines d’articles scientifiques — sur une mère dingo qui a porté son petit mort pendant plusieurs jours, des éléphants qui semblent enterrer leurs morts, des dauphins qui empêchent leur compagnon décédé de sombrer — et des débats sur la façon dont ces comportements doivent être interprétés. Je faisais souvent cela en tenant ma chatte Maya dans mes bras, alors qu’elle mourait d’une insuffisance rénale, et je pensais parfois à Ingmar, mon chat mort l’hiver dernier d’un cancer. La dernière nuit de sa vie, le corps amaigri, elle avait trouvé l’énergie de visiter ses endroits préférés, comme pour leur faire un dernier adieu. Je pensais souvent à la mort inévitable de ceux que j’aime, ce qui me tourmente constamment. Je pensais parfois à ma propre mort, qui, pour l’instant, me préoccupe moins. J’ai assisté à la mort d’un bouc nommé Caramel dans le sanctuaire où je suis bénévole. Les boucs ont des pupilles très grandes, et à la fin, alors qu’il était allongé sur le côté, elles ressemblaient à des galaxies.
Combien de ce qui compte le plus dans notre expérience de la vie se trouvent non pas dans ce qui nous est unique, mais dans ce que nous partageons ?
La sagesse conventionnelle, parmi les scientifiques et une grande partie du public également, affirme que les animaux comprennent peu de choses à la mort. Ils la perçoivent, évidemment, et peuvent distinguer un vivant d’un mort, mais ne la saisissent pas. Lorsqu’un lapin fuit un renard, il fuit donc la douleur plutôt que la fin de l’expérience. Le renard victorieux, quant à lui, sait que sa proie est immobile, non qu’elle a cessé de vivre. Ils n’ont pas de concept de la mort ; elle ne fait pas partie de leurs schémas mentaux, encore moins une source d’angoisse, d’inquiétude ou de motivation. Du moins, c’est ce que l’on pense.
« Sont mortels ceux qui peuvent faire l’expérience de la mort comme mort. Les animaux ne le peuvent pas », a écrit le philosophe Martin Heidegger. « La connaissance de la mort est réflexive et conceptuelle, et les animaux en sont épargnés », affirmait l’anthropologue Ernest Becker dans The Denial of Death. Becker se montrait particulièrement méprisant envers les animaux — « À l’intérieur, ils sont anonymes », écrivait-il. « Ils vivent et disparaissent avec la même indifférence » — mais même Charles Darwin, qui reconnaissait les points communs mentaux entre humains et autres animaux, pensait qu’ils étaient incapables de comprendre qu’ils pouvaient mourir.
Même si l’on apprécie désormais davantage l’esprit des autres animaux, la compréhension de la mort est demeurée une frontière nette. Toutefois, ces dernières années, de plus en plus de scientifiques ont tourné leur attention vers ce sujet. Ils soutiennent que certaines créatures exceptionnellement intelligentes peuvent en effet comprendre la mort. Cette compréhension peut être rudimentaire comparée à celle d’un adulte typique du XXIe siècle, mais elle est suffisamment proche pour brouiller la frontière. Et certains chercheurs et universitaires veulent aller encore plus loin : selon eux, comprendre la mort n’est pas si compliqué, a du sens même sous des formes simples, et pourrait être partagé par de nombreuses créatures et non seulement quelques-unes.
Loin d’être une ligne de partage, la connaissance de la mort pourrait être quelque chose que nous avons en commun avec d’autres animaux. Plutôt que de considérer cela sous l’angle de la ressemblance de leur compréhension avec la nôtre, nous pourrions nous demander en quoi la nôtre ressemble à la leur. Ce faisant, nous sommes confrontés à une question aux implications profondes pour notre relation aux animaux, et même à nous-mêmes : combien de ce qui compte le plus dans notre expérience de la mort se trouvent non pas dans ce qui nous est unique, mais dans ce que nous partageons ?
Fin novembre 2008, Pansy, la matriarche chimpanzé âgée d’un petit groupe vivant dans un parc safari à Stirling, en Écosse, tomba malade d’un virus respiratoire. Elle avait déjà plus de 50 ans — un âge avancé pour un chimpanzé — et n’était pas assez forte pour se rétablir. Pansy se mit à faire son nid au sol au lieu de grimper sur les plateformes où dorment habituellement les chimpanzés. Les autres chimpanzés suivirent son exemple et commencèrent à dormir au sol à ses côtés.
Un après-midi vint où il était clair que Pansy ne vivrait plus longtemps. Elle trouva la force de grimper une dernière fois sur sa plateforme, s’allongeant dans un nid que sa fille avait fait la nuit précédente. Sa respiration était maintenant laborieuse ; la fin était proche. Le gardien des chimpanzés pensa à retirer Pansy du groupe et à l’euthanasier, mais jugea cela traumatisant. Il se rappela aussi des caméras vidéo installées au-dessus des plateformes dans le cadre d’un projet de recherche sur les habitudes de sommeil des chimpanzés. Il les mit en marche, enregistrant ainsi le comportement des chimpanzés à la fin de la vie de Pansy et dans les heures suivant sa mort.
Les morts de chimpanzés avaient déjà été observées à quelques reprises, mais jamais avec un tel niveau de détail intime. « Quand nous avons visionné les enregistrements vidéo, j’ai été stupéfait », se souvient James Anderson, primatologue à l’Université de Kyoto, spécialiste de la cognition des primates. « Personne n’avait jamais vu ce moment précis, et il était clair que les chimpanzés survivants comprenaient qu’un événement capital venait de se produire ».
À la tombée de la nuit, les trois membres du petit groupe de Pansy se montrèrent exceptionnellement attentifs. Ils la toilettaient et la caressèrent avec une fréquence inhabituelle. Ils scrutèrent le visage de Pansy alors que sa respiration ralentissait puis cessait, et à ce moment-là, ils secouèrent doucement son corps. L’un d’eux, nommé Chippie, lui frappa la poitrine — puis, voyant que Pansy ne bougeait pas, s’enfuit. Cette nuit-là, ils dormirent mal ; Rosie, la fille de Pansy, resta éveillée tard puis s’endormit à côté du corps de sa mère, tandis que les deux autres chimpanzés se blottirent l’un contre l’autre et se toilettèrent autant cette nuit-là que durant un mois entier. Chippie « attaqua » Pansy trois autres fois — bien que ces interactions puissent tout aussi bien être interprétées comme un déni, de la colère ou une tentative de la réveiller, écrivirent Anderson et ses collègues dans une analyse de l’événement publiée dans la revue Current Biology.
Le lendemain, les soigneurs retirèrent le corps de Pansy. Les chimpanzés furent « profondément accablés », écrivit l’équipe d’Anderson, et, pendant une semaine, ils évitèrent la plateforme sur laquelle elle était morte. Pendant plusieurs semaines ensuite, les chimpanzés restèrent abattus ; ils étaient léthargiques, mangeaient moins que d’habitude et étaient inhabituellement silencieux. Tout laissait à penser qu’ils faisaient leur deuil — non seulement de l’absence de Pansy, mais de sa mort.
« En l’absence de symboles ou de rituels liés à la mort, les chimpanzés manifestent plusieurs comportements qui rappellent les réactions humaines face à la mort d’un proche », écrivirent les chercheurs. « Les humains sont-ils les seuls à avoir conscience de la mortalité ? Nous proposons que la conscience de la mort chez les chimpanzés ait été sous-estimée ».
Comprendre la mort, c’est savoir que l’on peut mourir ; et que tout le monde mourra.
Le fait même qu’il s’agissait là d’une affirmation prudente et controversée au sujet du parent vivant le plus proche de l’humanité montre à quel point cette idée était radicale dans les cercles scientifiques. Certains scientifiques ont réagi vivement : bien qu’Anderson et ses collègues aient soigneusement formulé que le comportement des chimpanzés pouvait être une preuve de conscience de la mort, sans affirmer qu’il l’était, ils furent accusés de spéculations anthropomorphiques imprudentes.
Aussi controversée soit-elle, l’idée avait toutefois été prise au sérieux. Elle catalysa la naissance du champ de la thanatologie comparative, nom donné à l’étude scientifique des comportements, émotions et cognitions liés à la mort chez les autres animaux. Des dizaines d’études ont été publiées depuis. Nous sommes encore loin de savoir ce qu’ils pensent, mais il est utile de commencer par réfléchir à ce que signifie comprendre la mort.
Ce n’est pas la même chose que reconnaître la mort. Beaucoup de fourmis retirent les congénères mortes de leur colonie, mais ce comportement est réflexe plutôt que réfléchi. Si l’on enduit une fourmi vivante d’acide oléique, un composé produit par la décomposition, ses compagnes la transporteront dehors même si elle se débat. Il n’y a là aucune véritable compréhension. De manière similaire, les opossums et les couleuvres à nez retroussé feignent la mort pour échapper aux prédateurs sans nécessairement réaliser qu’ils simulent la mort. Ils exécutent simplement un comportement instinctif.
Chez les humains, en revanche, les psychologues ont codifié un concept mature de la mort, qui comprend plusieurs composantes : la non-fonctionnalité, l’irréversibilité, la causalité, l’universalité, la mortalité personnelle et l’inévitabilité. Comprendre la mort, c’est savoir qu’elle met fin aux fonctions physiques et mentales ; que les morts ne peuvent revenir à la vie ; que la mort résulte de l’arrêt de processus vitaux ; que tous les êtres vivants peuvent mourir ; que vous pouvez mourir ; et que vous et tous les autres mourrez. Cette compréhension peut comporter des couches supplémentaires, comme la croyance en une vie après la mort, et les compréhensions apparemment immatures que possèdent les enfants sont un sujet auquel nous reviendrons, mais c’est là un cadre fondamental.
La plupart des scientifiques qui étudient le sujet s’accordent à dire qu’aucun animal ne possède ce niveau de compréhension, bien que certaines espèces — certains grands singes, éléphants et cétacés — aient la sophistication cognitive nécessaire pour saisir la non-fonctionnalité, l’irréversibilité, et peut-être la causalité ainsi qu’un sens limité de l’universalité. Au-delà de ces espèces, toute forme de compréhension significative de la mort est jugée rare, voire inexistante. Ce n’est certainement pas quelque chose à quoi l’on s’attendrait.
Pourtant, selon Susana Monsó, philosophe et autrice de Playing Possum: How Animals Understand Death, croire que la mort est difficile à comprendre est une erreur. Cette croyance donne trop d’importance à la compréhension humaine mature de la mort. Monsó propose plutôt que seules deux composantes suffisent pour ce qu’elle appelle un « concept minimal de la mort » : l’irréversibilité et la non-fonctionnalité. Reconnaître qu’un animal ne fait plus ce qu’il faisait, et comprendre que cet état est permanent, constitue l’essence de la compréhension de la mort. C’est à la fois simple et profond, et les exigences cognitives sont basiques.
Les mécanismes permettant de distinguer les entités animées des inanimées sont apparus tôt dans l’histoire évolutive et sont largement répandus parmi les animaux. Il suffit d’ajouter la capacité de formuler des attentes quant à la manière dont un animal devrait se comporter, puis de confronter cela à un corps mort, et voilà : il devient possible de reclassifier ce corps, de celui qui fait ce qu’on attend de lui à celui qui ne le fait plus, et ne le fera plus jamais. Un concept de la mort peut naître.
« De mon point de vue, la mort n’est rien d’autre que des corps brisés », dit Antonio Osuna-Mascaró, chercheur en cognition animale à l’Université de médecine vétérinaire de Vienne. Si l’on écarte les grandes idées et la mythologie, dit-il, « on se retrouve face à la mort telle qu’elle devrait être vue dans la nature. On découvre que comprendre la mort, c’est reconnaître qu’un corps est brisé ».
Ce concept minimal est un fondement, affirment Monsó et Osuna-Mascaró. De nombreux animaux pourraient y ajouter d’autres éléments, comme la causalité et une conscience de leur propre mortalité — pas nécessairement qu’ils vont mourir, mais qu’ils pourraient mourir — ce qui donnerait une conscience encore plus riche. Combien d’espèces en sont capables ? « Il est trop tôt pour donner une réponse solidement étayée à cette question », dit Monsó. « Mais certainement beaucoup plus d’espèces que ce que l’histoire scientifique et philosophique voudrait nous faire croire ».
James Anderson pense que les dauphins et les éléphants sont capables de comprendre la mort à un niveau « à peu près équivalent à celui d’un adolescent humain ». Quand je lui ai demandé ce qu’il pensait des idées de Monsó, il a reconnu que la non-fonctionnalité et l’irréversibilité sont probablement les premières composantes de la mort qu’un animal peut saisir. Mais pour lui, ce concept minimal de la mort offre une image si vague de ce qui est compris qu’il compte à peine comme une véritable compréhension. Pour qu’il soit significatif, il doit inclure quelque chose de plus : une compréhension de la causalité, peut-être de l’universalité.
Alors qu’Anderson me répondait, je me suis souvenu de mes expériences avec la mort étant enfant — d’abord un lapin, plus tard une baby-sitter. Je comprenais ces morts en termes d’irréversibilité et de non-fonctionnalité, avec seulement une faible idée de ce qui les avait causées, et aucune notion de l’universalité de la mort. Selon les critères de la psychologie du développement, ma compréhension était loin d’être mature — et, pourtant, ces expériences étaient puissantes. « Je ne pense pas que l’universalité soit nécessaire. Je ne pense pas que l’inévitabilité soit nécessaire. Il y a tant d’éléments dans le concept de la mort que je considère comme superflus. Ils ne sont pas nécessaires pour avoir un concept de la mort qui ait du sens pour nous », affirme Osuna-Mascaró.

L’AMOUR D’UNE MÈRE : Un macaque et son petit s’enlacent. Ces liens émotionnels profonds expliquent probablement pourquoi de nombreuses mères primates continuent à porter leurs bébés, même après leur mort. Photo de Amil San / Shutterstock.
Fait intéressant, lorsque des chercheurs du début à la moitié du XXe siècle ont étudié la manière dont les enfants comprenaient la mort, ils ont constaté que ceux-ci y pensaient souvent en termes de séparation, où le défunt continuait à vivre, mais ne pouvait revenir pour des raisons pratiques : le paradis était trop éloigné, le cercueil était cloué. Certains enfants voyaient la mort comme un sommeil dont on ne peut se réveiller. Cela ne veut pas dire que certains animaux conçoivent la mort de cette manière — même si je me le demande —, mais cela illustre comment un concept de la mort, même avec une compréhension défectueuse de la non-fonctionnalité et de l’irréversibilité, ces composants les plus élémentaires, peut être puissant.
Anderson m’a recommandé de parler à André Gonçalves, un collègue primatologue de l’université de Kyoto, particulièrement intéressé par la thanatologie comparative. Gonçalves avait des réserves quant à la capacité des animaux à étendre de manière flexible un concept de la mort d’un événement à d’autres situations. Les humains sont particulièrement doués pour ce type de raisonnement, a-t-il dit. Bien que certains animaux présentent les capacités cognitives nécessaires, cela peut être difficile, voire impossible, pour beaucoup d’entre eux.
Nous avons aussi parlé d’anthropocentrisme — cette tendance à considérer les humains comme supérieurs et fondamentalement différents des autres animaux — et de la manière dont cela aurait pu rendre les thanatologues comparatifs réticents à reconnaître une compréhension de la mort chez d’autres animaux. Pour Gonçalves, être ouvert à la possibilité que d’autres animaux puissent comprendre la mort est l’inverse de l’anthropocentrisme. Ses collègues étudient simplement ce phénomène de manière rigoureuse. C’est difficile à mesurer et à interpréter ; même des comportements fortement suggestifs peuvent avoir de nombreuses explications. Ce qui semble être de l’anthropocentrisme est en réalité de la rigueur.
Ce qui me frappe comme anthropocentrique, cependant, ce n’est pas un sentiment de supériorité humaine chez les thanatologues comparatifs, ni une fermeture d’esprit à la richesse de l’expérience animale, mais plutôt le fait que l’hypothèse par défaut soit toujours que les animaux ne comprennent pas la mort. Pourquoi partir de là, plutôt que de la position selon laquelle les animaux pourraient, voire qu’ils la comprennent réellement ?
Un exemple instructif d’une réticence excessive — à mes yeux — à reconnaître une compréhension animale de la mort se trouve dans le discours autour des raisons pour lesquelles les mères mammifères portent parfois leurs petits morts pendant des jours, voire des semaines. Ce comportement a été observé chez de nombreuses espèces, y compris les loutres de mer, les dingos et certains cétacés, mais il est particulièrement bien documenté chez les primates. À première vue, cela semble inadapté : cela fatigue, rend la recherche de nourriture plus difficile, et rend les mères plus vulnérables à la prédation. Qu’est-ce qui pourrait donc l’expliquer ?
De nombreuses hypothèses ont été avancées. La plus évidente est que l’amour d’une mère pour son bébé ne cesse pas avec la mort. Les mères continuent de s’en soucier ; elles sont en deuil. D’autres explications sont toutefois possibles.
Peut-être que porter son bébé mort est une forme d’entraînement qui améliore les soins maternels futurs. Peut-être que, pour les primates vivant dans des sociétés où les femelles bénéficient du statut conféré par la maternité, elles portent le cadavre pour continuer à recevoir plus de toilettage et de soutien. Il a été suggéré que certains primates sont attirés par tout ce qui ressemble à un mammifère, qu’il s’agisse d’un bébé vivant, d’un cadavre ou simplement d’un bâton couvert de poils. En réalité, il se peut que les mères ne reconnaissent même plus leur bébé ; elles pourraient percevoir le cadavre comme un objet en forme de bébé. Ou peut-être que les femelles mammifères sont attirées de manière innée par les bébés et veulent les câliner, morts ou vivants. En fait, les mères peuvent même ne pas se rendre compte que leurs bébés sont morts, surtout lorsque les causes ne sont pas évidentes.
Face à ces incertitudes, où se situer ? Il n’y a pas de réponse scientifique claire. Mon propre pressentiment est que les mères savent que leurs bébés sont morts — peut-être pas immédiatement, mais certainement après quelques jours — et qu’elles ne parviennent pas à les laisser partir, au sens propre comme au figuré. Cela semble être l’explication la plus parcimonieuse ; celle qui correspond le mieux à l’expérience de la maternité. Alecia Carter, anthropologue à l’University College London, privilégie cette explication pour les babouins qu’elle a étudiés. Dans un entretien accordé au podcast Many Minds, elle qualifie le port de cadavres de bébés de « prolongement des soins maternels et d’incapacité à rompre le lien maternel ». Quant à la fonction plus profonde de ce comportement, Carter estime que la meilleure explication « est qu’il s’agit d’une forme de gestion du deuil ».
Comprendre la mort n’est pas nécessaire pour être en deuil, mais cela rend peut-être le deuil plus puissant. La présence du deuil chez les animaux est également débattue, comme le montre le cas célèbre de Tahlequah, l’orque qui a maintenu son petit mort à la surface pendant 17 jours à l’été 2018, nageant plus de 1 600 kilomètres et devenant une célébrité mondiale. Certains scientifiques ont qualifié cela de deuil ; d’autres s’y sont opposés. Ils ont insisté sur le fait qu’il était impossible d’en être certain et que, faute de cette certitude, l’explication par défaut devait être que Tahlequah ne s’était pas rendu compte que son petit était mort et espérait simplement qu’il se réveillerait. Penser autrement relevait de la foi, non de la science.
Ce fut un cas d’école d’anthropocentrisme. Et je proposerais ceci : il est possible d’imaginer que Tahlequah ait à la fois pleuré la mort de son petit et espéré son retour à la vie. Beaucoup d’entre nous se sont déjà tenus près du cercueil d’un être aimé, à la recherche d’un mouvement. Bien sûr, nous savons qu’il est mort. Le souhait désespéré, irrationnel, d’inverser ce qui ne peut l’être fait partie du deuil.
Début 2024, des chercheurs étudiant les éléphants d’Asie dans le nord du Bengale rapportèrent quelque chose d’extraordinaire : cinq cas de bébés éléphants retrouvés enterrés dans des fossés d’irrigation de plantations de thé, les pattes en l’air, pointées vers le ciel. La terre autour d’eux avait été tassée. Des traces de pas et des dépôts de crottes montraient que les enterrements avaient été réalisés par les membres du troupeau des éléphanteaux.
Les enterrements eurent lieu de nuit. Des villageois voisins entendirent de puissants barrissements, mais personne n’assista à la scène. Des autopsies ont ensuite révélé que les éléphanteaux étaient en mauvaise santé et étaient morts de causes naturelles, non de noyade dans les fossés. Les motifs d’ecchymoses sur leurs corps suggéraient qu’ils avaient été transportés sur de longues distances par les pattes et la trompe. Un piège photographique a capturé l’image de deux éléphants marchant ensemble, l’un traînant la silhouette minuscule d’un éléphanteau par la trompe à travers la terre rouge de la plantation.
Les chercheurs — Parveen Kaswan, agent du Service forestier indien, et Akashdeep Roy, écologue politique à l’Institut indien de formation et de recherche en sciences — interprétèrent ces enterrements comme intentionnels. L’enterrement, « reflète l’attention et l’affection du ou des membres du troupeau », écrivirent-ils. Bien que les éléphants soient célèbres pour leur intelligence et leur complexité sociale, rien de tel n’avait jamais été rapporté. Les titres de presse suivirent.
Chez les humains, les pratiques funéraires — rituels et coutumes, comme l’enterrement, pour disposer des défunts — sont apparues il y a environ 100 000 ans. Les anthropologues considèrent cela comme un moment fondateur pour Homo sapiens, où la reconnaissance de la mort s’est alliée à la pensée symbolique pour donner un sens plus profond à la perte, et aussi à la vie. Que les éléphants puissent avoir leurs propres pratiques funéraires avait une puissance viscérale.
Et si un animal comprenait l’inévitabilité de la mort, alors quoi ?
Il existait, bien sûr, d’autres explications. Peut-être que les éléphants avaient effectivement transporté leurs petits morts, mais les avaient lâchés en traversant les fossés, puis déplacé de la terre en essayant de les récupérer. Distinguer ce qui est intentionnel de ce qui est accidentel est difficile « à moins que nous n’observions directement les éléphants transporter une carcasse vers un site spécifique pour l’enterrement », estiment le biologiste des éléphants Nachiketha Sharma de l’université de Kyoto et Sanjeeta Pokharel, écologue comportementale à l’Institut indien des sciences. « Nous ne rejetons pas la possibilité que les éléphants puissent ou veuillent enterrer leurs morts » — mais d’après ce qui a été observé, qui peut le savoir ?
Il y a quelques années, Sharma et Pokharel ont publié trois récits détaillés d’éléphants d’Asie veillant de proches morts ou mourants. Dans un cas, deux femelles adultes ont été vues aux côtés du corps d’une vieille femelle morte de maladie ; lorsque les autorités forestières les ont chassées pour examiner le corps, elles ont découvert des feuilles fanées et des brindilles déposées autour de la tête de l’éléphante morte. Une fois encore, il est tentant d’y voir une signification plus grande, un rituel d’adieu ou un cadeau pour l’au-delà. Et une fois encore, il est impossible de savoir.
« Déposer des brindilles et des feuilles pourrait être un geste symbolique. Cependant, d’autres explications sont possibles », disent Sharma et Pokharel. Peut-être que les éléphants laissèrent-ils tomber ce qu’ils avaient dans la bouche, ou perdirent-ils l’envie de manger, en examinant l’éléphante morte. « Nous ne pouvons que spéculer », disent-ils. Et pourtant, le fait que de telles spéculations soient plausibles témoigne de l’intelligence remarquable des éléphants et soulève la question : jusqu’à quel point leur compréhension de la mort peut-elle aller ? Certains éléphants pourraient-ils comprendre non seulement que la mort est la fin de l’être qu’ils connaissaient, mais aussi qu’elle viendra un jour, pour eux-mêmes comme pour les autres ?
Comprendre que l’on peut mourir n’est sans doute pas très compliqué. Monsó donne l’exemple d’un singe voyant d’autres singes mourir en tombant des arbres ou en se faisant manger par des léopards. Associer la mort à ces événements, puis extrapoler que d’autres singes — y compris soi-même — pourraient connaître le même sort s’ils tombent ou sont attaqués n’est pas si difficile. Cela exige une capacité d’induction et de raisonnement analogique, que l’on retrouve chez de nombreux animaux, ainsi que l’occasion d’apprendre par l’expérience — ce que la nature ne manque pas de fournir. Un certain nombre d’animaux pourraient donc en être capables.
Mais qu’en est-il de comprendre que l’on va mourir ? Que tout le monde va mourir ? Pour Monsó, comprendre l’inévitabilité de la mort et l’étendue de son universalité est probablement un trait propre à l’humain — ou du moins dépendant de la capacité à en parler. Après tout, les humains modernes apprennent à travers des histoires ou des leçons que la mort vient pour tous. Monsó juge peu probable que d’autres systèmes de communication animale disposent de l’abstraction conceptuelle nécessaire pour transmettre cela.
Une compréhension de la mort n’est pas nécessaire pour éprouver du chagrin, mais elle le rend peut-être plus puissant.
Anderson reconnaît que la communication à propos de la mort n’a pas encore été documentée, mais il reste ouvert à cette possibilité. Il est fasciné par la manière dont les chimpanzés et d’autres primates communiquent lorsqu’ils veillent leurs morts. « Ils expriment clairement quelque chose à propos de ce qui s’est passé », dit-il. « Ce que nous n’avons pas encore observé — et ce serait une avancée extraordinaire si cela arrivait —, c’est un signal », tel qu’une vocalisation ou un geste, « qui transmettrait l’idée de mort ». Pokharel et Sharma ont enregistré des barrissements d’éléphants à côté de leurs morts, et pensent qu’il est possible que les éléphants parlent de la mort, mais cela n’a pas encore été étudié.
Anderson pense que les chimpanzés pourraient être capables d’apprendre l’universalité et l’inévitabilité de la mort. Pokharel et Sharma disent la même chose des éléphants, mais « le prouver empiriquement serait extrêmement difficile, voire impossible ».
Encore une fois, nous sommes confrontés à cette tension — au cœur de la thanatologie comparée, et dans l’étude du comportement animal en général — entre ce qui pourrait être possible et ce qui peut être démontré scientifiquement. Il est essentiel que les scientifiques restent prudents dans leurs affirmations empiriques, mais les limites de nos outils de mesure ne devraient pas fixer les limites du possible.
Et si un animal comprenait réellement l’inévitabilité de la mort, que se passerait-il ? Le généticien Danny Brower, aujourd’hui disparu, avait émis l’hypothèse qu’une telle conscience provoque une peur et une anxiété paralysantes, et constitue donc une impasse évolutive. L’humanité aurait survécu à cette prise de conscience grâce à des échappatoires intellectuelles. « L’homme ne peut supporter sa petitesse que s’il peut la traduire en signification », écrivait Ernest Becker dans La Déni de la mort. Dans les années 1980, les travaux de Becker ont inspiré la théorie de la gestion de la terreur, qui propose que beaucoup de comportements humains soient façonnés par une peur profonde de la mort. La théorie distingue également les formes complexes de gestion de cette peur — valeurs transcendantes, cadres religieux — et des formes plus simples, comme contribuer à sa communauté ou prendre soin de ses proches.
Selon le psychologue Tom Pyszczynski, l’un des fondateurs de cette théorie, trois capacités cognitives sont nécessaires : la pensée symbolique, la capacité de se projeter dans l’avenir, et la réflexion sur sa propre vie et son identité. Des formes de ces capacités existent chez de nombreuses espèces.
Je lui ai demandé : certains animaux pourraient-ils s’engager dans des activités mentales proches de ce que décrit sa théorie ? Non pas les formes complexes, mais les plus simples. Un perroquet moine pourrait-il trouver un certain sens à ajouter des brindilles aux nids coloniaux multigénérationnels de la taille d’une voiture dans lesquels ils vivent ? Un gorille pourrait-il toiletter un ami avec plus de soin, sachant que ces moments sont comptés ?
« C’est certainement possible. Je pense que nous ne savons pas », a répondu Pyszczynski. Il est mal à l’aise à l’idée de spéculer sur la vie intérieure d’autres animaux, mais « tous les dix ans environ, on découvre que les choses sont bien plus complexes — et que les animaux sont bien plus sophistiqués et capables — qu’on ne le pensait ».
Il existe des grottes utilisées pendant des milliers d’années par des ours en hibernation. Inévitablement, certains y meurent pendant leur sommeil, et ces grottes se retrouvent remplies de squelettes. Certains ours — dont l’intelligence, encore peu étudiée, pourrait être comparable à celle des grands singes — ne pourraient-ils pas, en contemplant ou en sentant ces restes, ressentir leur ancienneté tout en percevant le passage du temps dans leurs propres os, et deviner ce qui les attend ? Comment un perroquet moine concevrait-il le bien commun ? Ce sont des questions spéculatives, peut-être impossibles à trancher, mais d’autres sont plus concrètes et accessibles.
Dans son laboratoire de l’Université de Médecine Vétérinaire de Vienne, Osuna-Mascaró développe des méthodes pour tester si les cacatoès de Goffin comprennent l’irréversibilité et la non-fonctionnalité. Une autre question est de savoir si cette compréhension peut être appliquée de manière flexible, et à quelle vitesse elle peut être acquise. Si un renard peut en venir à comprendre la mort en chassant des souris, combien doit-il en tuer pour que la leçon s’imprime ? Peut-il tirer des inférences de ses premières chasses aux coléoptères lorsqu’il était renardeau ?
Peut-être que les chercheurs pourraient adapter les méthodes utilisées dans les études sur la gestion de la terreur, dans lesquelles les humains sont exposés à des rappels de la mort pour évaluer si elle est présente dans leur esprit et comment ils y font face. « Exposez l’animal à un congénère mort, puis observez s’il adopte un comportement plus nourricier ou protecteur », suggère Pyszczynski.
Beaucoup d’autres espèces doivent encore être étudiées. La thanatologie comparée s’est concentrée principalement sur les primates, avec également une attention portée aux éléphants et aux cétacés. Peu d’autres animaux ont été étudiés, un déséquilibre qui reflète davantage des circonstances que le réel potentiel. Les perroquets sont des candidats évidents, affirme Osuna-Mascaró. Anderson mentionne les gnous et les oiseaux monogames. Il y a quelques années, un piège photographique installé pour le projet de science d’un garçon de huit ans en Arizona a filmé un troupeau de pécaris à collier veillant une congénère décédée pendant dix jours, dormant près de son corps et la défendant contre les coyotes. C’était la première observation de ce type chez les pécaris, et un témoignage de tout ce qu’il reste à apprendre.

QUESTIONS OUVERTES : Personne n’a encore étudié si les perruches veuves comprennent la mort — mais, en tant qu’animaux à la fois très intelligents, dotés de longues espérances de vie et de relations sociales complexes, leur trajectoire de vie semble propice à cet apprentissage.
Il y aura toujours des limites à ce qui pourra être étudié. Certaines sont éthiques : Gonçalves, par exemple, répugne à faire écouter à la famille d’un chimpanzé défunt des enregistrements de celui-ci afin d’observer leur réaction. D’autres limites sont plus fondamentales. « Il y a certaines questions que nous pouvons poser, mais auxquelles nous ne pourrons pas répondre scientifiquement », dit Monsó. « Et ce n’est pas grave ».
Existe-t-il un moyen de vraiment savoir si ma chatte Ingmar, en revisitant ses anciens repaires lors de sa dernière nuit, savait que la fin approchait ? Ou cherchait-elle simplement un réconfort psychologique dans une période de grande douleur ?
Je ne veux ni certitude ni pesée rigoureuse d’hypothèses concurrentes. Et même ce que nous comprenons reste forcément partiel ; un océan sépare la description scientifique de l’expérience vécue. Il est peut-être vrai que le deuil émerge de la dissonance entre le modèle du monde produit par un cerveau et sa nouvelle réalité — mais ces mots sont incommensurables avec l’expérience elle-même.
Que devrions-nous faire alors de nos connaissances et de nos incertitudes ? « Une question prime sur toutes les autres », dit l’anthropologue Barbara King. « Comment les recherches sur les réponses animales à la mort pourraient-elles nous pousser à être meilleurs et à agir mieux pour les animaux ? »
Certaines implications sont évidentes. Anderson a souligné l’importance de laisser aux chimpanzés en captivité la possibilité de passer du temps auprès d’un congénère décédé, plutôt que de retirer immédiatement le corps, afin qu’ils puissent comprendre ce qui s’est passé et trouver une forme de clôture. Monsó tient un propos similaire à propos des animaux de compagnie.
Mais les implications les plus importantes concernent notre manière de nous relier aux animaux. Dans l’étude des enterrements de petits éléphants dans les plantations de thé en Inde, les chercheurs ont décrit comment les attitudes des populations locales reflétaient une reconnaissance de la sensibilité des éléphants. Croire qu’ils enterrent leurs petits et pleurent leurs morts « renforce le moral de la coexistence », écrivent-ils. Là-bas, les habitants se préoccupent de la conservation des éléphants moins pour leur rôle écologique que pour le respect éthique dû à des êtres intelligents.
Barbara King insiste sur le fait que la compréhension de la mort ne devrait pas servir de critère décisif. Tout être mérite notre respect. Et, étant donné combien d’entre nous vivent dans une relative ignorance de la mort, nous ne devrions pas reprocher aux animaux de ne pas en savoir plus. Mais savoir ce que la mort peut signifier pour d’autres animaux, c’est prendre chaque vie au sérieux, et l’honorer.
Nous sommes appelés, dit King, à réfléchir aux vies que nous traitons avec désinvolture : les animaux maintenus en captivité pour le divertissement, tués pour le savoir ou pour un repas vite oublié, dont la souffrance peut être aggravée par une conscience de la mort et de la perte. Là où ces implications éthiques mèneront chacun variera, mais le fait que des animaux puissent partager avec nous une certaine compréhension de la mort — pas nécessairement identique à la nôtre, mais semblable en certains points, et de façon à toucher profondément notre expérience — constitue une base pour une parenté plus profonde.
Ce qui ne revient pas à nier que certains aspects de la compréhension humaine soient uniques. S’il y a bien quelque chose de propre à notre espèce, je crois que c’est notre capacité à réfracter la mort à travers notre faculté extraordinaire d’imaginer des futurs possibles et des histoires alternatives.
Peut-être qu’aucun autre animal n’est capable de se laisser agacer par l’habitude irritante d’un être cher, puis de ressentir de la tristesse à l’idée que cette habitude sera un jour rappelée avec affection et regret. Peut-être aucun autre animal ne peut-il être hanté par ce qui aurait pu être fait autrement, ou accablé par ce qui aurait pu éviter la mort. Peut-être qu’aucun autre animal ne se juge pour cela ni se pardonne.
Mais qu’est-ce qui importe le plus : les différences entre la manière dont les humains et les autres animaux comprennent la mort, ou bien les similitudes ? Pour moi, ce sont les secondes. L’essence commune de la précieuse fragilité de la vie, et de la finalité de sa perte.
Dans la littérature thanatologique, on accorde beaucoup d’attention aux attributs rituels de la mort : cérémonies, mythes, symboles. On dit qu’ils sont profondément humains. Moi, je pense à la veillée des pécaris, et aux funérailles auxquelles j’ai assisté — et à celles qui viendront.
Longtemps après que les funérailles sont terminées, nous restons debout, au bord de la tombe.
Brandon Keim est journaliste indépendant et rédacteur en chef associé chez Nautilus. Son nouveau livre, Meet the Neighbors, explore ce que la science de l’intelligence animale implique pour notre compréhension et notre manière de vivre avec les créatures sauvages qui nous entourent.
Texte original publié le 28 avril 2025 : https://nautil.us/how-animals-understand-death-1204412/