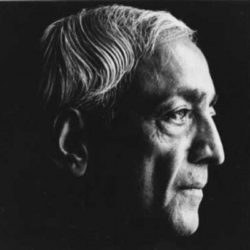(Sélections du personnel de la Krishnamurti Foundation)
La guerre est la projection spectaculaire et sanglante de notre vie quotidienne. Elle est l’expression extérieure de notre état intérieur, un élargissement de nos actions quotidiennes.
Extrait du livre de Krishnamurti, La première et la dernière liberté
Dans cette citation courte, mais puissante, Krishnamurti résume les causes de la guerre, qui est le résultat amplifié de ce qui se passe à l’intérieur de nous-mêmes : les conflits, les divisions et le sentiment que les choses ou les émotions sont autres que nous-mêmes. Nous avons l’impression que la guerre est quelque chose qui se passe « ailleurs », quelque chose que d’autres provoquent, et pourtant nous vivons perpétuellement avec des « guerres » intérieures, même lorsque nous tentons de mener une vie paisible.
Dans cette présentation, nous développons ce que Krishnamurti a à dire au sujet de la guerre, un phénomène qui accompagne l’humanité depuis des millénaires et qui ne nous a jamais quittés, et nous explorons s’il est possible de vivre véritablement en paix, intérieurement et donc extérieurement.
Les problèmes liés à la guerre ont toujours existé, mais la plupart d’entre nous ne s’en sont pas préoccupés, car ils étaient lointains et ne nous touchaient pas personnellement et profondément. Aujourd’hui, cependant, la guerre est à nos portes et semble dominer l’esprit de la plupart des gens.
Peut-être que les événements extérieurs peuvent stimuler notre réflexion non seulement sur les raisons des guerres actuelles, mais aussi sur la cause même des conflits et sur la possibilité pour l’humanité de vivre sans guerre.
Le problème dont nous devons discuter, et qui est omniprésent, est celui de l’individu et de sa relation avec l’autre, c’est-à-dire la société. Si nous parvenons à comprendre ce problème complexe, nous serons peut-être en mesure d’éviter les nombreuses causes qui mènent finalement à la guerre. La guerre est un symptôme, aussi brutal et malsain soit-il, et s’attaquer à ses manifestations extérieures sans tenir compte de ses causes profondes est vain et inutile. En changeant fondamentalement les causes, nous pourrons peut-être instaurer une paix qui ne sera pas détruite par les circonstances extérieures.
Krishnamurti à Ojai, 1940, Conférence 1
Il ne peut y avoir de paix s’il y a division entre nations
Il existe des divisions politiques, idéologiques, religieuses, nationales et entre les hommes. Il existe des divisions entre hindous, bouddhistes, chrétiens et musulmans, avec toutes leurs subdivisions. Partout où il y a division, il y a conflit. Partout où il y a des nationalités, américaines, russes, chinoises, il y a inévitablement diverses formes de luttes économiques, sociales, militaires et politiques. La plupart d’entre nous en sont peut-être conscients, mais nous semblons incapables d’agir. Voyez-vous, là où il y a une division, quelle qu’elle soit, il y a forcément des conflits.
Ces divisions existent, elles sont réelles, elles ne sont pas théoriques. Et ces divisions ont provoqué des guerres. Apparemment, personne ne souhaite mettre fin aux guerres. Personne ne souhaite découvrir les causes de la guerre et savoir si ces causes peuvent être totalement, complètement éliminées. Ni les politiciens ni la hiérarchie religieuse ne souhaitent mettre fin à la guerre. Ils peuvent parler sans fin de paix, mais il ne peut y avoir de paix s’il existe des divisions, telles que les nationalités.
Krishnamurti à New York en 1983, Conférence 1
Vidéo : Nous poursuivons la guerre et parlons de paix
_______________________
L’industrie lourde est peut-être une des causes principales de la guerre. Quand l’industrie et l’économie s’allient à la politique, elles ne peuvent que soutenir une activité séparatiste afin de maintenir leur puissance. Tous les pays le font, les grands comme les petits. Les petits sont armés par les grandes nations. Cela se fait dans la discrétion et la clandestinité pour certains, ouvertement pour d’autres. Toute cette misère, cette souffrance et ce gaspillage énorme pour l’armement, auraient-ils pour cause l’affirmation visible de l’orgueil, du désir de supériorité sur les autres?
Extrait du livre de Krishnamurti, Dernier journal
Effacer la cause de la guerre
L’humanité a probablement évolué depuis environ un million d’années et a toujours réclamé la paix sur terre — Pacem in Terris, selon l’ancienne expression latine. Mais apparemment, il n’y a pas de paix dans le monde ; or, sans paix, nous ne pouvons pas nous épanouir.
Pour voir l’extraordinaire profondeur et la beauté de la vie, l’immensité de tous les êtres vivants, il faut avoir la paix, et cette paix est niée partout où règne la pauvreté. Même dans les pays riches, la pauvreté est très présente. Aucun gouvernement nationaliste ne peut résoudre le problème de la pauvreté, car c’est un problème mondial, qui concerne le monde entier, et non un gouvernement particulier, qu’il soit totalitaire, communiste ou soi-disant démocratique. Les effets de la pauvreté sont la dégradation, l’esclavage absolu, la brutalité. Et il y a aussi la pauvreté de l’esprit, qui ne peut être résolue par les livres, les institutions, les organisations ou les forums — cette pauvreté prend fin lorsque nous comprenons notre entière existence et sa relation au monde en général.
Les religions n’ont pas encouragé ni apporté la paix dans le monde. Elles parlent beaucoup — les chrétiens parlent de paix dans le monde — mais les religions ont divisé l’humanité. Rien que dans cette petite ville, il y a je ne sais combien de groupes religieux, des dizaines, des institutions et des fondations, qui essaient tous de dire aux gens ce qu’ils doivent faire. Les religions ont empêché la paix et ont provoqué des guerres : la guerre de Cent Ans en Europe, la torture et toute la brutalité d’une culture fondée sur des concepts religieux, des dogmes et des croyances. Et les religions à travers le monde ont empêché les relations justes entre les êtres humains. Il y a eu cinq mille ans de guerre et nous continuons encore, nous nous entretuons — au début avec des massues, et maintenant nous sommes capables de vaporiser des millions de personnes. Nous n’avons pas évolué psychologiquement, intérieurement, et tant que nous serons primitifs sur le plan psychologique, notre société sera tout aussi primitive.
Alors, peut-il y avoir la paix sur cette terre ? C’est une question très, très sérieuse. Est-il également possible de vivre en paix avec soi-même, sans conflit, ou sommes-nous condamnés à vivre éternellement dans le conflit, à être en guerre ? Y a-t-il une issue à tout cela ? Certainement pas par le biais des religions telles qu’elles sont ni par le biais d’organisations politiques, qu’elles soient démocratiques, totalitaires ou communistes, ni par le biais de la division en nationalités. Les gouvernements sont créés par ce que nous sommes. Ils ont été structurés, construits selon nos propres exigences. Tant que vous resterez américain, et que d’autres resteront hindous, bouddhistes ou musulmans, nous n’aurons pas la paix sur terre. Ni tant qu’il y aura des divisions raciales ou culturelles. C’est donc une question très importante à se poser, à soi-même, et non aux autres.
Il y a eu cinq mille ans de guerre et nous continuons encore aujourd’hui.
Est-il possible d’avoir la paix sur cette terre ? C’est un cri qui résonne depuis des millénaires. Il y a deux mille cinq cents ans, le Bouddha parlait de paix, bien avant l’avènement du christianisme. Et nous en parlons encore aujourd’hui. Alors, en prenant conscience de tout cela, que pouvons-nous faire ? Les efforts individuels pour vivre en paix n’ont pas d’effet sur le monde entier. Vous pouvez vivre paisiblement dans cette belle vallée, tranquillement, sans trop d’ambition, sans trop de corruption, sans trop de compétition, simplement en vivant ici tranquillement, peut-être en vous entendant bien avec votre femme ou votre mari. Mais cela aura-t-il un impact sur la conscience humaine dans son ensemble ?
Ou bien le problème est-il beaucoup plus vaste, beaucoup plus profond ? Nous devons réfléchir ensemble ; ce n’est pas que l’orateur pense, explique et décrit, mais ensemble, comme deux vieux amis assis à l’ombre des arbres, discutant de tout cela, pas seulement intellectuellement, mais avec un cœur troublé, profondément préoccupés par ce qui se passe dans le monde et ce qui nous arrive. Comme deux vieux amis qui ont une conversation aimable, sans chercher à se convaincre ni à se stimuler l’un l’autre, sans s’en tenir à leurs propres opinions, jugements et conclusions, mais comme deux vieux amis qui ont vécu ensemble, marché ensemble, vu beaucoup de choses dans le monde. Vous et l’orateur êtes ainsi, afin que nous puissions réfléchir ensemble. Pas sur ce qu’il faut penser ou comment penser, mais observer ensemble ; observer le même arbre, le ciel, les oiseaux et la beauté étonnante des montagnes. Et ainsi, ensemble, réellement ensemble, non pas vous écoutant l’orateur, mais ensemble explorant la question de savoir si nous pouvons vivre en paix. Non seulement vous et moi, mais le reste de l’humanité, car cette terre est la nôtre, elle n’est pas américaine, anglaise ou française. C’est notre terre. Nous sommes ses hôtes et nous devons y vivre en paix.
Et un ami dit à l’autre : quelle est la cause de tout cela ? Si l’on peut trouver la cause, alors l’effet, le symptôme, peut prendre fin. La guerre est un symptôme. La cause est très, très profonde et complexe. Tout comme lorsque l’on trouve la cause d’une maladie, celle-ci peut être guérie. Les deux amis qui discutent se demandent donc : quelle est la cause de tout cela ? Pourquoi les êtres humains sont-ils devenus ainsi ? Si inconsidérés, uniquement préoccupés d’eux-mêmes, sans se soucier de rien d’autre que de leurs propres désirs, pulsions, impulsions, de leur ambition, leur réussite, que ce soit dans les affaires ou dans les études. Et aussi, psychologiquement, intérieurement, nous voulons être quelqu’un, devenir quelqu’un.
Alors, s’il te plaît, dit l’un à l’autre, écoute attentivement. Y a-t-il une évolution psychologique ? C’est une question très, très sérieuse. Y a-t-il un devenir, psychologiquement ? Y a-t-il un devenir, une réalisation intérieure, à passer de ce qui est à ce qui devrait être, de la misère à une forme de bonheur, de la confusion à l’illumination ? Passer de ce qui est à ce qui devrait être, c’est cela devenir, et ce devenir implique le temps. Et ce devenir, chacun essayant de devenir quelque chose psychologiquement, peut être le même mouvement que celui, sur le plan physique, d’un prêtre qui devient évêque, d’un employé qui devient cadre. C’est le même mouvement, la même vague, transposée dans le domaine psychologique. L’ami dit à l’autre : « J’espère que je me fais bien comprendre ». Il répond : « Tu n’es pas très clair, expliques un peu plus ».
Dans toutes les religions et dans le monde psychologique, l’idée de changement est celle de devenir. Je suis confus, je dois changer cette confusion pour devenir clair. Je me dispute avec ma femme, mais le changement consiste à mettre fin à la dispute, à passer de la violence à la non-violence. En d’autres termes, il y a toujours la tentative d’être quelque chose que l’on n’est pas. L’ami dit alors : « C’est assez clair — assez, pas complètement clair — mais continuons notre conversation. C’est une belle matinée, nous avons tout notre temps, le soleil est chaud et les ombres sont nombreuses. Et les ombres sont aussi importantes que le soleil. Il y a une grande beauté dans les ombres, mais la plupart d’entre nous s’intéressent à la lumière, à l’illumination, et nous voulons y parvenir. L’idée même de réalisation psychologique peut être l’un des facteurs de conflit dans la vie.
Alors, dit l’ami, examinons cela. Que signifie « devenir » ? Est-ce là la cause fondamentale de la division ? La division doit exister, explique l’autre, tant qu’il y a la psyché, le moi, le « je », l’ego, ce qui nous se sépare de l’autre. Mais l’autre répond qu’il y a une longue histoire de cela?; c’est la condition humaine. Nous avons été formés, éduqués à accepter religieusement et économiquement que nous sommes des individus, séparés du reste de l’humanité, séparés les uns des autres. Et l’ami dit : Est-ce bien ainsi ? Sommes-nous vraiment des individus ? Je sais que c’est la tradition. C’est ce que toutes les religions ont dit : des âmes séparées dans le christianisme, l’hindouisme, etc. Mais ensemble, vous comme ami, et l’orateur comme l’autre, allons examiner si nous sommes vraiment des individus. Soyez patients, s’il vous plaît. Voyez toutes les implications de cela avant de refuser ou d’accepter. Vous acceptez maintenant que vous êtes un individu ; c’est votre conditionnement qui vous fait croire que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et les totalitaires nient cela ; ils disent que vous n’êtes qu’un rouage dans la structure sociale.
Nous remettons donc en question non seulement le fait que le devenir psychologique puisse être une illusion, mais aussi le fait que nous ne soyons pas séparés psychologiquement, que nous soyons réellement des individus ou non. Ou bien nous sommes comme le reste de l’humanité. Le reste de l’humanité est malheureux, rongé par le chagrin, effrayé, croyant à des absurdités romantiques fantastiques ; ils traversent de grandes souffrances et une grande incertitude, tout comme vous. Et notre réaction, qui fait partie de notre conscience, est similaire à celle des autres. C’est un fait absolu. Vous n’aimez peut-être pas y penser, vous préférez peut-être croire que vous êtes totalement séparé des autres, ce qui est tout à fait absurde. Ainsi, votre conscience, qui est vous — ce que vous pensez, ce que vous croyez, vos conclusions, vos préjugés, votre vanité, votre arrogance, votre agressivité, votre douleur, votre chagrin, votre tristesse — est partagée par toute l’humanité. C’est notre conditionnement, que vous soyez catholique, protestant ou ce que vous voulez.
L’idée même de réussite psychologique peut être l’un des facteurs de conflit dans la vie.
Notre conscience est notre essence, ce qu’est notre vie. C’est la vérité. Et donc, vous partagez en fait l’humanité ; vous êtes le reste de l’humanité. Vous êtes l’humanité. C’est une chose formidable à réaliser. Vous pouvez croire en une certaine forme de sauveur et d’autres croient en une certaine idéologie, mais la croyance est commune à tous, la peur est commune à tous. L’angoisse de la solitude est partagée par le reste de l’humanité. Lorsque l’on réalise cette vérité, alors le devenir — c’est-à-dire passer de ce qui est à ce qui devrait être — prend un sens totalement différent. L’ami dit : Je ne comprends pas, que veux-tu dire ? L’autre ami répond : Je ne sais pas trop, examinons cela. Examinons les faits de notre vie, regardons-nous de manière sensée, rationnelle, sans aucune distorsion, voyons les choses telles qu’elles sont, sans avoir peur ni honte, en observant simplement.
Alors l’ami dit : Toute ma vie, j’ai essayé de changer ce qui est en ce qui devrait être. Je connais la violence et le désordre, je les connais très bien. J’ai essayé de changer le désordre et la violence, de passer de la violence à la non-violence, du désordre à l’ordre. Maintenant, l’autre ami demande : la non-violence est-elle un fait, ou simplement une conclusion imaginaire, une réaction au fait de la violence ? Je suis violent et je projette l’idée de non-violence parce que cela fait partie de mon conditionnement. J’ai vécu dans le désordre et j’essaie de rechercher l’ordre, c’est-à-dire d’essayer de changer ce qui est en ce qui devrait être. Cela fait partie du devenir et c’est peut-être la cause du conflit.
Alors l’ami demande : cette violence peut-elle prendre fin ? Non pas devenir non violente. L’envie, la cupidité et la peur peuvent-elles prendre fin ? Non pas devenir courageux, libéré de ceci ou de cela. Telle est la question. Alors l’autre ami dit : je vais te le montrer. Cela est peut-être nouveau pour toi, alors écoute attentivement, s’il te plaît.
Réalisez d’abord ce que nous faisons : passer de ce qui est à ce qui devrait être, l’idéal. L’idéal n’existe pas, ce n’est pas un fait. Mais ce qui est un fait. Comprenons donc ce qui est et non l’idée de la non-violence, qui est absurde et a été prônée par des gens en Inde, par Tolstoï et d’autres. C’est notre tradition, c’est notre conditionnement, c’est notre tentative de devenir quelque chose. Mais nous n’avons jamais rien accompli ; nous ne sommes jamais devenus non-violents. Jamais. Examinons donc attentivement s’il est possible de mettre fin à ce qui est, de mettre fin à ce désordre ou à cette violence. Mettre fin, non pas devenir quelque chose. Le devenir implique le temps. C’est très important à comprendre.
Voyons s’il est possible de mettre fin à ce qui est, et non de changer ce qui est en ce que nous aimerions qu’il soit. Prenons la question de la violence. Et si vous préférez le désordre, c’est la même chose ; peu importe ce que vous choisissez. La violence est héritée depuis des temps immémoriaux, des animaux, des singes jusqu’à nous. Nous l’avons héritée. C’est un fait que nous sommes des êtres violents, sinon nous ne tuerions ni ne blesserions personne, nous ne dirions pas un mot contre qui que ce soit. Mais nous sommes violents par nature. Maintenant, quel est le sens de ce mot ? Retenez ce mot « violence », ressentez son poids, ses complications. Il ne s’agit pas seulement de violence physique : les terroristes qui lancent des bombes pour changer la société n’ont pas changé la société.
La violence doit exister tant qu’il y a division à l’extérieur et à l’intérieur.
La violence n’est pas seulement physique, elle est aussi psychologique, et bien plus encore. La violence, c’est la conformité. Non pas la conformité à la compréhension de ce qui est, mais la conformité à imiter, à se conformer. Et la violence doit exister tant qu’il y a division à l’extérieur et à l’intérieur. Le conflit est la nature même de la violence. L’ami dit oui, je vois cela, c’est assez clair, mais comment y mettre fin ? Comment mettre fin à toute cette question complexe de la violence ? Il dit : Je comprends très bien que devenir non violent fait partie de la violence, car vous avez projeté la non-violence à partir de la violence. Cette projection est une illusion. J’ai donc rejeté ce concept ou cette idée, le sentiment que je dois devenir non violent. Il dit : Je comprends cela très clairement. Il n’y a que ce fait. Maintenant, que dois-je faire ? L’autre ami dit : Ne me demande pas cela, mais examinons cela ensemble. Au moment où tu demandes quoi faire ou comment agir, tu prends l’autre comme guide, tu fais de lui ton autorité. Mais regardons cela ensemble. Tout en étant totalement libre de l’idée de non-violence, observe ce qu’est la violence, regarde-la, prête attention au fait, sans t’en échapper, sans la rationaliser. Ne dis pas pourquoi tu ne devrais pas être violent, ou que la violence fait partie de toi-même. Si cela fait partie de toi-même, tu créeras toujours des guerres de toutes sortes : des guerres entre toi-même et ta femme, des guerres, des meurtres, et ainsi de suite.
Alors, regardez cela sans conflit ; regardez comme si cela n’était pas séparé de vous. Le fait est que vous êtes violent, tout comme vous êtes avide. L’avidité n’est pas séparée de vous. La souffrance n’est pas séparée de vous. L’anxiété, la solitude, la dépression, tout cela, c’est vous. Mais notre tradition et notre éducation font croire que vous êtes séparé de tout cela. Et là où il y a séparation, là où il y a dualité, il doit y avoir conflit. Comme avec les Juifs et les Arabes — vous comprendrez probablement mieux cela — la division et le conflit entre deux grandes puissances, etc. Il en va de même pour vous ; vous êtes cela ; vous n’êtes pas séparé de cela. L’analyste n’est pas différent de l’analysé. L’ami dit : Continue, explique un peu plus.
Vous observez l’arbre ou les montagnes, vous observez votre femme ou votre mari, ou vos enfants. Qui est l’observateur et qui est l’observé ? S’il vous plaît, j’y vais doucement, suivez-moi. L’observateur est-il différent de l’arbre ? Bien sûr qu’il est différent ! L’observateur est différent de cette montagne ; l’observateur est différent de l’ordinateur. Mais l’observateur est-il différent de l’anxiété ? L’anxiété est une réaction, exprimée par le mot « anxiété », mais le sentiment, c’est vous. Le mot est différent, mais le mot n’est jamais la chose. La chose est le sentiment d’anxiété ou de violence. Le mot violence n’est pas cela. Veillez donc à ce que le mot n’entrave pas votre observation. Car votre cerveau est pris dans un réseau de mots.
Votre ami vous dit donc d’observer ce sentiment sans utiliser de mots. Si vous utilisez des mots, vous renforcez les souvenirs passés de ce sentiment particulier. C’est l’acte d’observation dans lequel le mot n’est pas la chose et l’observateur est l’observé. L’observateur qui dit « je suis violent », cet observateur est la violence. L’observateur est l’observé. Le penseur est la pensée. Celui qui fait l’expérience et qui dit « je dois faire l’expérience du nirvana ou du paradis ou quoi que ce soit d’autre » est l’expérience. Observez donc ce sentiment sans le nommer, sans l’analyser, contentez-vous de l’observer. C’est-à-dire, soyez avec lui. Soyez avec cette chose telle qu’elle est. Cela signifie que vous concentrez toute votre attention sur elle. Analyser ou examiner est une perte d’énergie, alors que si vous accordez toute votre attention, c’est-à-dire toute votre énergie, à ce sentiment, alors ce sentiment prend fin.
L’ami dit : Est-ce que tu m’hypnotises en étant si véhément, en étant si passionné à ce sujet ? Je réponds non. Je ne te stimule pas, je ne te dis pas quoi faire. Tu as toi-même réalisé que la non-violence n’est pas un fait, n’est pas réelle. Ce qui est réel, c’est la violence. Tu l’as réalisé toi-même. Tu as toi-même dit : Oui, je suis violent, je ne suis pas séparé de la violence. Le mot sépare, mais le fait du sentiment, c’est moi. Moi, c’est mon nez, mes yeux, mon visage, mon nom, mon caractère… C’est moi ; je ne suis pas séparé de tout cela. Lorsque vous vous séparez, vous essayez d’agir en conséquence, ce qui signifie conflit. Vous avez donc fondamentalement effacé la cause du conflit lorsque vous êtes cela, non séparé de cela. Est-ce clair ?
Les amis ont donc appris quelque chose. Vous avez appris un phénomène important, que vous n’aviez jamais réalisé auparavant. Avant, je séparais mes sentiments comme si j’étais différent de mes sentiments. Maintenant, je réalise la vérité que je suis cela. Par conséquent, vous restez avec cela. Et lorsque vous restez avec cela, que vous le reteniez, cela vous donne une énergie formidable. Et cette énergie dissipe, met complètement fin à cette violence. Pas pour un jour, pas seulement pendant que vous êtes assis ici ; c’est la fin absolue de cela.
Krishnamurti à Ojai en 1983, Conférence 2
Vidéo : Pouvons-nous vivre sans apporter souffrance ou mort ?
_______________________
Nous acceptons la guerre comme mode de vie
Ensuite apparurent sur l’écran des images de la guerre qui, au même moment, faisait rage dans le désert et parmi les monts verdoyants. Énormes tanks et avions volant à basse altitude ; tumulte et massacre organisé. Hommes politiques n’ayant que la paix à la bouche, mais encourageant la guerre dans chaque pays. Femmes en pleurs et blessés agonisants, enfants agitant des drapeaux et prêtres psalmodiant leur bénédiction.
Les larmes de l’humanité n’ont pu mettre fin au désir de tuer qui est en l’homme. Aucune religion n’a mis terme à la guerre. Bien au contraire, toutes l’ont encouragée, bénissant le matériel porteur de mort ; elles ont divisé les peuples. Les gouvernements sont isolés et chérissent leur insularité. Les scientifiques sont soutenus par les gouvernements. Le prédicateur se perd dans ses phrases et ses images.
En dépit de vos propres larmes, vous n’en apprendrez pas moins à vos enfants à tuer et à se faire tuer. Vous acceptez cela comme faisant partie de la vie ; votre engagement ne concerne que votre propre sécurité : voilà votre dieu et votre douleur. Vous dispensez tant de soins, tant de générosité, à l’éducation de vos enfants, tout en acceptant avec enthousiasme qu’ils puissent aller se faire tuer. Des images de bébés phoques aux grands yeux que l’on massacrait occupèrent l’écran.
La culture a pour fonction la transformation totale de l’homme.
Extrait du livre Le Journal de Krishnamurti
Vous devez exiger la paix de tout votre cœur, vous devez trouver la vérité par vous-mêmes, et non à travers des organisations, de la propagande et des arguments intelligents en faveur de la paix et contre la guerre. La paix n’est pas le refus de la guerre. La paix est un état dans lequel tous les conflits et tous les problèmes ont cessé.
Krishnamurti à Bombay en 1950, Conférence 2
Suggestions d’écoute complémentaire : Krishnamurti sur la guerre et le meurtre