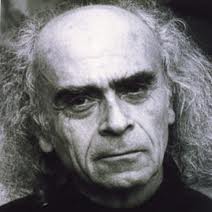(Revue Question De. No 44. Octobre-Novembre 1981)
Dans ce pays de landes et de bocages qui est le mien, le bruit du monde meurt doucement à travers les arbres, comme le vent du nord, mais le monde est là, éternellement présent, avec ses remous, avec ses trous d’ombre et ses éclats de soleil. En fait, le monde bruisse. Et ce bruissement, c’est celui d’une intense activité : les feuilles surgissent des troncs, les tiges sortent de la terre, les oiseaux cherchent leur nourriture, ce qui ne les empêche pas de chanter, les hommes et les femmes vont et viennent. Le silence et l’immobilité, cela n’existe pas, parce que c’est la mort. Là, au contraire, tout est mouvement, et c’est la vie.
C’est dans ce contexte que j’écris. Écrire est mon travail. Écrire est mon but et mon moyen. D’autres labourent la terre ou construisent une maison. Mon voisin coupe du bois et garde ses moutons dans la lande : il est à « la retraite », comme on dit, mais il ne peut s’empêcher d’avoir une activité. Et moi, devant cet instrument qu’on appelle une machine à écrire, je dresse un tableau de ce qui se passe. J’agis. Je suis bien. J’ai le sentiment d’accomplir quelque chose. Et cela déclenche en moi l’affirmation selon laquelle tout travail, toute activité devrais-je dire plutôt, fait partie intégrante de la personnalité humaine. Réflexion bien commune, certes, mais je pense qu’en cette fin de XXe siècle, le cas mérite d’être examiné.
Car je me demande si l’on a encore conscience de la beauté du travail, je me demande si l’on a encore confiance dans le travail. Pendant de longs siècles, le travail a été glorifié, trop souvent d’ailleurs par ceux qui faisaient travailler les autres, et parallèlement, il a été déprécié, considéré qu’il était comme une simple nécessité pour survivre, parfois dans des conditions fort pénibles. D’où cette ambiguïté attachée au mot travail, le terme signifiant aussi bien activité que souffrance. Peut-être alors conviendrait-il d’utiliser le mot œuvre ? Après tout, le verbe œuvrer est quand même plus exaltant que le verbe travailler…
Mais en ces temps d’hésitation où, quelle que soit l’idéologie dans laquelle on s’enferme, la civilisation passe à travers nos doigts comme un flux de sable qu’il n’est point possible de retenir, les concepts traditionnels, calqués sur des images qui sont usées, épuisent irrémédiablement leur contenu. N’est-il point significatif de voir le mot travail en voie d’être remplacé par le terme emploi ? Ainsi donc, l’homme de l’an 2000 ne sera plus un travailleur, mais un employé. Cela peut paraître normal, cela peut sembler couler de source, et pourtant, comme cette mutation, avec toutes les connotations qui surgissent, est lourde de sens et de conséquence !
Cela représente en effet un bouleversement complet, non seulement d’un mode de vie concret, mais également d’un état d’esprit, d’une structure mentale qui était pourtant solidement perpétuée depuis que l’être humain a réalisé cette « fameuse division du travail » à partir de laquelle Jean-Jacques Rousseau et quelques autres ont vu s’instaurer le cycle infernal oppression/esclavage. Cela ne veut pas dire que le rapport oppression/esclavage soit en train de disparaître, bien au contraire, il serait en voie d’aggravation, et sous une forme beaucoup plus sournoise, beaucoup plus hypocrite. En un mot, l’être humain, au lieu de se livrer à un travail de production ou de transformation sur un objet déterminé, pénètre dans un univers organisé, bureaucratisé, où on ne lui demande plus de se consacrer à un objet, mais de payer son droit de vivre par une simple présence dans le cadre d’une fonction. Et, c’est cette présence qui devient la base de toute son activité, non plus l’objet, c’est-à-dire le but vers lequel tendait son activité.
Je me souviens ainsi de mes jeunes années, en particulier d’un séjour de quelques mois que je fis dans une honorable administration. Il y eut des périodes d’intense activité. Mais il y eut aussi un mois entier où, mes collègues et moi n’avions strictement rien à faire. Mais il fallait que nous fussions là, car nous étions payés pour cela. Situation aberrante, on en conviendra, mais qui n’est qu’un exemple entre des millions d’autres. Ainsi, pour avoir le droit de vivre, il faut sacrifier son temps dans un emploi. Mais le travail ? il devient accessoire. Il n’est plus la base du calcul.
Le changement qui s’est opéré est d’importance. Il recouvre une mutation de la société qui, de concrète, devient véritablement abstraite. Si, au départ, l’être humain consacrait toute son activité à se nourrir et qu’en conséquence il œuvrait sur la matière, la division du travail a été la première grande révolution dans les mœurs. À partir de ce moment, l’activité de l’être humain s’est cristallisée sur l’objet : le forgeron fabriquait des armes, le potier des pots, le tisserand des vêtements. Même le chasseur et le pêcheur étaient des artisans puisqu’ils projetaient sur le gibier et le poisson l’essentiel de leur activité. Et, dans l’optique d’une société dite « primitive », reposant sur l’échange des produits et des objets, il n’y avait que spécialisation : plus que jamais l’arc, la flèche, le soc de charrue, le gibier étaient propriété de celui qui l’avait fabriqué ou qui l’avait pris. On comprend alors comment, en vertu du jeu de la concurrence, de l’abondance ou du manque, des disparités ont pu se manifester, faussant la règle de solidarité originelle par laquelle se maintenait la cohésion du groupe. En somme, le « capitalisme » venait de naître dans la mesure où ceux qui détenaient les produits indispensables – et parfois rares – faisaient de la surenchère, pouvaient stocker », et finalement imposaient leur loi à ceux qui ne pouvaient vivre sans leur précieux concours. Le mécanisme était remonté. Il n’a pas fini de fonctionner.
Mais cette seconde révolution dans les mœurs réside dans le fait que la notion de travail n’est plus basée sur l’objet – ou sur tout équivalent de l’objet, exceptions faites des activités artisanales proprement dites, ou des activités purement littéraires et artistiques. À vrai dire, cette seconde révolution est contenue dans la première. C’est ce que dit Jean-Jacques Rousseau dans son Discours sur l’origine de l’Inégalité : « Plus le nombre des ouvriers vint à se multiplier, moins il y eut de mains employées à fournir la subsistance commune, sans qu’il y eût moins de bouches pour la consommer. »
Nous en sommes là. La situation démographique de nos sociétés contemporaines fait que l’activité humaine est intense, mais qu’elle doit se répartir sur l’ensemble des êtres qui composent ces sociétés. En réalité, nous revenons presque à une conception archaïque du groupe social : une partie seulement de la société est en état d’activité, une autre étant dépendante de celle-ci pour sa nourriture ou son bien-être. En quelque sorte, une société contemporaine, quelle que soit la structure politique qu’elle ait choisie, est une société d’assistance mutuelle. Les travailleurs, par le jeu des lois sociales (impôts, sécurité sociale, taxes, retraites, pensions, aides diverses, droit à l’enseignement) entretiennent littéralement toute une population inactive au sens le plus strict. Souvenons-nous que dans les groupes humains les plus « primitifs », seuls les hommes forts se livraient à la chasse pour nourrir l’ensemble de la communauté. Il y a là un curieux retour à une situation antérieure.
Il va de soi que ce système n’est pas mauvais par nature puisqu’il met l’accent sur le fait que l’homme est un animal non seulement raisonnable mais aussi social. La personnalité humaine ne peut se former que dans le contact avec les autres. Par là, un être humain atteint sa dimension véritable. Mais il y a plus : la multiplication des êtres sur la terre, l’accroissement de la population, les progrès de l’hygiène et de la médecine qui ont réduit considérablement la mortalité précoce, tout cela oblige à une répartition non seulement des biens de consommation, mais également de l’activité productrice elle-même. C’est dans ce contexte que s’installe la notion d’emploi: quiconque atteint l’âge de l’activité doit être employé à quelque chose pour avoir le droit de vivre, et aussi pour contribuer à répartir le produit de cette activité sur les autres. D’où la limitation du travail, les congés payés, et l’instauration de loisirs quasi-officiels, ceux-ci étant nécessaires pour faire dépenser le potentiel acquis et le remettre dans le circuit économique.
Car les loisirs, c’est-à-dire les heures de non-travail, et les vacances, ne sont certes pas une charité. La société n’est pas une œuvre philanthropique même si elle se présente comme un mécanisme de solidarité. Si les travailleurs gagnent de l’argent, c’est pour qu’ils puissent ledépenser. Autrement la société serait menacée d’asphyxie. À moins d’envisager le retour pur et simple à un système de troc, d’échanges stricts. Mais cela demanderait une mutation non plus des structures, mais de la mentalité elle-même, et le recours à des philosophies de type épicurien pur (« si tu as soif, bois de l’eau, pourquoi travailler pour boire du vin… »). Or le rapport travail/loisirs est devenu la pierre angulaire de l’édifice social contemporain. Un travailleur se doit de sacrifier une partie de son temps, à la fois pour vivre et pour faire vivre ceux dont il a la charge, et pour bénéficier d’un temps libre, pendant lequel la société récupérera la mise. On comprend que, dans ces conditions, la notion de travail basé sur l’objet, disparaisse au profit de la notion d’emploi, basé sur un temps pendant lequel l’individu accepte d’être aliéné.
Œuvrer ou détruire
Mais en dehors de toutes les considérations socio-économiques qu’on est en droit de faire à ce sujet, le problème soulevé est très grave sur le plan philosophique, car il touche l’essence même de l’être humain.
D’abord la notion de temps dû par l’individu est entièrement négative. Plus que jamais l’aliénation qui en résulte constitue une atteinte à la personnalité de chacun. Un « employé » dans ces conditions ne peut que souffrir d’être prisonnier, d’être aliéné, d’être sacrifié, alors qu’il ne comprend plus pourquoi et comment son activité est justifiée. Lorsque j’étais professeur, je me suis toujours senti mal à l’aise devant les « horaires ». Comment peut-on prétendre répandre la culture, éveiller les intelligences, nourrir les consciences, en un temps fragmenté de façon arbitraire ? Dès le son de la cloche, dès la sonnerie, les élèves n’ont plus qu’une idée en tête : partir, ou changer de tête et de discipline. Que devient donc votre bel enthousiasme, que devient votre belle tirade sur la beauté d’un texte ? Et il en est de même dans les usines, les ateliers, les bureaux. « J’ai fait mon heure ! » Et chacun de se désintéresser de son activité, si tant est qu’on s’y soit jamais intéressé.
Le Temps, c’est la Mort. Certes, le Temps s’écoule et nous mourons. Mais n’est-ce pas parce que nous sommes incapables de maîtriser le Temps ? N’est-ce pas parce que nous sommes esclaves du Temps ? Rabelais, dans son Gargantua, avait soulevé le problème à propos de l’abbaye de Thélème. Dans cette abbaye, au contraire de tous les monastères existants, il n’y aurait pas d’horaires, « car, disait Gargantua, la plus vraie perte de temps qu’il sût était de compter les heures. Quel bien en vient-il ? et la plus grande folie du monde était de gouverner au son d’une cloche, et non au dicté de bon sens et entendement ». Hélas, que dirait Rabelais dans notre fin de XXe siècle prosternée devant le nouveau dieu Horaire ?
Être ou paraître
C’est en effet une désintégration quasi-absolue de l’être humain que d’ordonner son activité sur un temps abstrait et arbitraire. Où est l’Œuvre dans tout cela ? Et, ce qui est encore plus significatif, c’est que ce mode de vie qui s’impose à nous est non seulement contraire à la philosophie naturelle mais encore au marxisme théorique qui affirme que le travail, faisant partie intégrante de la personnalité, est propriété de l’ouvrier. Je voudrais bien voir un ouvrier d’une grande usine, où l’on travaille à la chaîne, conscient d’être le propriétaire de l’objet qu’il contribue à produire ? Je voudrais bien voir un employé d’une quelconque administration conscient d’être le propriétaire du travail qu’il accomplit dans le plus complet aveuglement. Il n’y a plus guère que certains privilégiés, artisans et artistes notamment, à pouvoir affirmer qu’ils sont les propriétaires de leurs œuvres.
L’Œuvre semble absente de notre civilisation. À plus forte raison, le Grand Œuvre, sommet de l’activité créatrice, conscience fulgurante qu’on peut avoir d’être le démiurge transformant la matière et la façonnant à l’image de l’Esprit, n’est plus qu’un lointain souvenir, une curiosité archéologique tout juste bonne à figurer dans un musée. Nous sommes dans le règne de la pacotille, de l’objet de consommation courante, produit à des millions d’exemplaires dans un but utilitaire et marqué de toute part par le signe du profit. Cette rupture de l’Homme et de l’Œuvre, tragique en ses conséquences psycho-affectives, découle d’un choix de société. Mais que deviendra cette société si rien ne vient remettre l’Œuvre à sa véritable place ?
Le progrès humain passe par des creux. Qui dit progrès matériel ne veut pas dire progrès intellectuel, psychologique, spirituel. L’objet de consommation courante, la pacotille, ne peut pas avoir d’âme puisque le ou les producteurs de cet objet n’ont plus la conscience claire d’en être les auteurs. Où est la magie de l’Objet ? Autrefois, le moindre vase de terre cuite, la moindre flèche, la plus petite pièce de monnaie, la plus simple toile de lin étaientdes objets chargés de tout un contenu magique, celui que l’ouvrier, au sens noble du terme, y avait enfermé grâce à son activité créatrice. Maintenant, l’objet est vide. D’ailleurs, inconsciemment, les consommateurs n’en ont point le respect : dès qu’il est usé, dès qu’il est vieilli, les consommateurs le jettent avec mépris parce qu’il ne valait pas la peine d’être réparé, d’être conservé, en un mot d’être aimé.
Car il n’y a plus d’amour entre l’Homme et l’Objet. De même que le rapport entre l’Homme et la Nature est devenu une oppression de l’Homme sur la Nature, le rapport entre l’Homme et l’Objet n’est plus qu’un simple geste d’accaparement. À moins que cet accaparement ne joue dans l’autre sens et que l’Homme soit le jouet de son Objet, ce qui n’est pas incompatible. L’amour qui découlait autrefois de la conscience du travail n’est plus perçu que comme une relation utilitaire. L’Homme est isolé du monde alors qu’il se croit le maître absolu des forces qui gouvernent l’univers. À force de jouer à détruire les simples relations entre les êtres et les choses, le genre humain va se trouver vidé de toute substance : demain le monde sera peuplé de robots qui ne penseront même pas, et surtout qui n’aimeront pas.
Lorsque le travailleur, prisonnier du Temps, dans le cadre d’un emploi octroyé par la Société, se sent aliéné, il n’a pas tort. Mais que fait-il pour éviter l’aliénation ? À force de se conduire au son de la cloche, il perd toute la résonance profonde qui est en lui et qui est un sentiment d’amour. Le Grand Œuvre supposait non seulement la relation entre l’Être et la Chose, mais aussi l’acte d’amour transformateur de l’informel. Car en œuvrant, on fait l’amour. Ne dit-on pas « l’œuvre de chair » en parlant d’une relation sexuelle ? Il n’y a rien de plus beau que d’ouvrer parce qu’en œuvrant, on met tout son amour dans un acte qui transforme la vie.
Les philosophes ont claironné partout qu’il fallait changer la vie. Cette métamorphose, tous les êtres humains l’ont souhaitée depuis que le monde est monde. Il reste douteux qu’ils s’y soient pris de la meilleure façon. Abandonner le Grand Œuvre pour la pacotille est une dégénérescence. Nous sommes tous des ouvriers, aussi avons-nous le pouvoir d’assurer la transformation d’un monde imparfait et qu’il nous appartient peut-être de parfaire. La création n’est jamais ex nihilo : il s’agit en fait d’une action d’amour de l’être pensant sur une matière qu’ilpeut façonner à sa guise. Le merveilleux est d’avoir ce pouvoir, et tous les grands mythes de l’Humanité l’ont intégré dans des récits exemplaires. Aurons-nous ce sursaut, cette nouvelle conscience d’être par notre œuvre ? Le choix est simple : retourner à un point d’asservissement dans lequel nous n’aurons plus la force de nous défendre, ou persévérer dans l’effort de création entrepris depuis des millénaires. L’être humain était d’abord à quatre pattes. Il s’est levé vers le ciel, avec tout ce que cela comporte de divin. Mais l’énigme du Sphinx est là, et avec l’énigme une terrible sentence : lorsque l’homme est vieux, il marche avec un bâton.
Il importe de s’interroger sur le sens symbolique du bâton. Est-ce le signe de cette fameuse dégénérescence ? Ou, au contraire, est-ce le signe de l’Esprit ?
La réponse est en nous, lorsque nous comprendrons qu’à force de nous laisser envahir par le Temps, nous nous faisons dévorer par Kronos. Y aura-t-il un nouveau Zeus pour lever l’étendard de la révolte, comme on dit si bien, pour enchaîner le vieux dieu dévoreur et lui faire régurgiter ses enfants ? La fable est une image par laquelle chaque génération reçoit le message des dieux. Avons-nous la possibilité d’entendre ce message ? Faudra-t-il abandonner notre rêve d’immortalité ?
Le Grand Œuvre était, aux dires des Alchimistes, l’achèvement de toute une vie, la réussite pleine et entière d’une démarche touchant à la fois le spirituel et le matériel. La pacotille, telle que nous la connaissons aujourd’hui n’est qu’une caricature, que dis-je ? un anéantissement de l’être. Lorsque le Dieu primordial créa le monde, il fit une œuvre. Nous avons oublié que nous étions dans l’oeuvre et qu’une œuvre est un mouvement constant par lequel le réel et l’irréel sont confondus, par lequel le communicable et l’incommunicable deviennent une seule et même réalité, par lequel le défini et l’infini sont enfin réconciliés.
Œuvrons donc. Mais par pitié, ne nous laissons pas dévorer par le Temps. Dans l’île d‘Avalon, là où règne la fée Morgane, les pommiers donnent des fruits toute l’année.