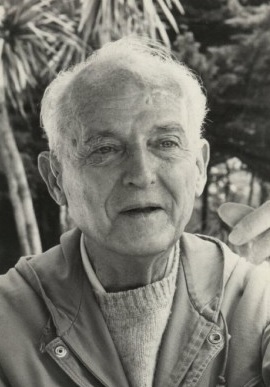(Revue Le lotus Bleu. Novembre-Décembre 1962)
En écrivant, il y a plus de trente ans, des notes sur l’Alchimie, qui furent publiées dans cette même revue, je ne pensais pas qu’il me faudrait attendre si longtemps pour leur donner une suite et une conclusion temporaire. C’est que de nombreuses pièces manquaient encore pour donner au « puzzle » alchimique un début de dessin reconnaissable ; ce sont tout particulièrement les études des arabisants qui ont fourni ces informations. Il est devenu possible de replacer l’Alchimie dans son milieu historique, de préciser les influences qui l’ont fait naître et évoluer et ainsi de faire des suppositions probables sur son but, sa nature et sa technique : le résultat de cette recherche vient de paraître [1] et je voudrais en extraire ce qui montre comment les idées de nos contemporains sur l’Alchimie se sont modifiées au cours de ces derniers trois quarts de siècle ; il y a là un exemple clair et important de la manière dont les enseignements autrefois secrets se « désoccultent » en venant enrichir notre conscience, ce qui est la raison même de son évolution.
Il existe, ou plutôt il existait, un paradoxe alchimique. Depuis le 1ier quart du XVIIIe siècle en France et un peu plus tard en Angleterre, l’Alchimie était scientifiquement et moralement condamnée par les plus hautes autorités intellectuelles comme un tissu de superstition exploitées par des escrocs, et nulle voix ne prenait sa défense. Mais on constatait en même temps que cette doctrine fausse et ses pratiques avaient obtenu, après mûr examen, parfois l’adhésion et en tous cas le respect d’esprits aussi élevés et désintéressés que ceux de Saint Albert le Grand ou d’Arnaud de Villeneuve. En même temps, on voyait les Alchimistes accepter de souffrir la torture plutôt que de révéler leurs secrets : on comprend mal comment une pure supercherie pouvait obtenir de telles preuves d’estime et de dévouement.
C’est un siècle et demi après la condamnation que commença la réhabilitation : en 1884, Marcelin Berthelot, alors considéré comme le plus grand des chimistes et connu pour sa rectitude intellectuelle, déclare avec preuves à l’appui que l’Alchimie méritait le nom de science et représentait une forme embryonnaire de la chimie. Mais ceci ne suffisait pas à supprimer le paradoxe de la ferveur presque religieuse des alchimistes et de leurs adversaires au cas où leurs pratiques n’étaient qu’une innocente chimie élémentaire. Mais le problème changeait pourtant : on admettait que le Grand Œuvre était pour ses Adeptes d’une importance suprême, mais on commençait à douter de sa nature.
Après avoir vu dans la fabrication artificielle de l’or une pure tromperie, on pensait, avec Berthelot, que c’était là une illusion entretenue en toute honnêteté par les disciples d’Hermès. Il a même montré comment cette croyance dérivait logiquement et inévitablement des principes philosophiques admis par les alchimistes. Ceux-ci, du moins ceux qui méritaient ce nom, n’étaient plus des charlatans, mais des illuminés.
Cette opinion est probablement celle qui a le plus de partisans ; elle est facile à soutenir, mais présente une grave faiblesse. L’Alchimie est née aux tout premiers siècles de l’Ère chrétienne ; elle a donc vécu quinze siècles, dont six en Europe, dans un milieu d’une extrême rigueur intellectuelle : c’est une durée bien longue pour qu’une illusion ne se révèle pas pour ce qu’elle est. Illuminés, les Alchimistes ? Oui, mais par quelle Lumière ? Celle d’une brillante erreur ou celle de l’Initiation ? On commençait à soupçonner à l’Alchimie un but spirituel (qui n’excluait pas des applications chimiques).
Deux courants d’opinions se sont alors formés et sont très vivaces aujourd’hui.
Pour le premier, les Alchimistes ont dit vrai : ils ont obtenu, grâce à une technique spéciale, des résultats quasi miraculeux, en tous cas dans le domaine de la conscience humaine et peut-être même dans celui de la chimie. Pour ces fervents, la Philosophie Hermétique est et était une doctrine traditionnelle, révélée par ses Maîtres anciens qui la possédaient dans sa perfection à des disciples plus ou moins capables, dont la lignée se poursuit jusqu’à nous. De ce point de vue, il ne doit exister aucune évolution de l’Alchimie : celle-ci n’est pas une science lentement construite par des chercheurs humains, niais un dogme donné a priori.
Qu’il ait été utilisé pour son expression, un symbolisme entièrement chimique ne s’explique pas de ce point de vue qui considère les praticiens du laboratoire comme d’assez méprisables « souffleurs » en face des métaphysiciens de la pure doctrine. Malheureusement pour les défenseurs de cette position, les textes alchimiques pris dans leur ordre historique ne confirment aucunement leurs affirmations : dès la période alexandrine la doctrine était discutée ; on vit même un véritable congrès se réunir pour cela et son évolution, si elle fut ralentie par les persécutions, n’en a pas moins continué, aboutissant au XIVe siècle à une révolution de la théorie alchimique.
Enfin, une dernière opinion s’est manifestée, d’abord timidement, puis avec beaucoup de force, surtout après la parution de l’ouvrage de C.G. Jung sur « Psychologie et Alchimie ». Pour ces chercheurs, l’élément central de l’Alchimie est psychologique et proche des manifestations du mysticisme religieux. Les textes alchimiques apportent de très nombreuses confirmations de l’importance de la mystique dans l’Alchimie, mais ici non plus, on ne comprend pas pourquoi celle-ci devait éprouver le besoin d’adopter un symbolisme chimique quand les mysticismes religieux lui en offraient un d’une richesse et d’une profondeur inégalées.
Le problème alchimique se trouve ainsi fortement changé. Que les alchimistes les plus célèbres aient pratiqué la chimie est incontestable, qu’ils aient été des mystiques ne l’est pas moins. Qu’ils aient cru en toute bonne foi à la possibilité de la transmutation du plomb en or est extrêmement probable, qu’ils aient réalisé physiquement cette opération l’est extrêmement peu. Mais il est aussi très probable que pour risquer leur vie pour leurs recherches, ils devaient avoir eu en vue un but défini qu’ils affirment avoir été atteint par certains d’entre eux.
Tout le problème se ramène donc à chercher la nature du Grand Œuvre. Je voudrais montrer comment l’étude historique permet de lui entrevoir une réponse.
Dans l’Égypte ancienne, l’or était monopole pharaonique et tout ce qui entourait son travail était par là-même sacré. De Plus, les mines appartenant au domaine souterrain étaient en relation étroite avec les mystères. Ceux-ci poursuivaient, en Égypte comme en Grèce, une théorie de la vie universelle qui s’intéressait avant tout à l’Homme et au Divin, mais pouvait s’appliquer à la Nature. La médecine l’avait amplement utilisée, mais en ne prêtant qu’une attention mineure au cas des minéraux : c’est une science nouvelle qui était nécessaire pour leur étude.
Son fond théorique fut donné par la Grèce qui avait élaboré des notions plus anciennes qu’elle-même (celle des quatre éléments), sous des formes différentes, dont la plus parfaite se trouve dans le Timée de Platon. Mais la Grèce, pays dépourvu d’or, et de pierres précieuses, manquait par là d’un élément essentiel pour concevoir l’évolution minérale depuis les éléments fondamentaux jusqu’aux corps les plus précieux. Au contraire, l’Égypte Alexandrine possédait tout ce qu’il fallait pour cela : verriers et métallurgistes habiles à imiter les pierres et l’or, tout cet Art du Feu dont la forme suprême, l’Art du Travail de l’Or, touchait à la Divinité. A cette époque, toutes les religions présentes dans la Méditerranée orientale se rencontraient en Égypte et offraient l’accès à des états supra-humains et supraterrestres, par des initiations élevant l’homme vers l’état divin. Dans le domaine chrétien, St Clément d’Alexandrie, décrivant cette ascension dans ses Stromates, ne se cachait pas de suivre l’ordre même des initiations païennes. Il y avait là toute une pratique prête à s’unir aux théories helléniques : et c’est ainsi que naquit cet ensemble d’expériences inspirées et de spéculations philosophiques qui, sous le double signe de l’Or et d’Hermès, fut d’abord l’Art du travail de l’Or et fut ensuite baptisée l’Alchimie (l’Égyptienne) par les Arabes.
Elle se développa depuis Alexandrie jusqu’à Byzance et c’est en Syrie que fut rédigé cet extraordinaire Livre du Secret qui contient le premier exposé cohérent de l’évolution minérale et dont le dernier feuillet est formé par la Table d’Émeraude que tous les Alchimistes ont déclaré résumer leur Art.
Nous connaissons ces textes par des versions arabes des IXe et Xe siècles, dont le contenu révèle une origine de deux siècles plus ancienne. Elles présentent entre elles des différences parfois intéressantes ; c’est ainsi que l’une d’elles exprime pour la première fois la possibilité pour l’action humaine d’être semblable à l’action divine, de se substituer au divin pour continuer, faciliter, accomplir l’œuvre du Créateur. Dans le domaine minéral, où l’on estimait que les métaux évoluaient spontanément vers l’état d’or, c’était affirmer la possibilité de faire de l’or en accélérant l’évolution d’un corps moins parfait ; mais ce domaine n’était qu’une des applications possibles du principe et il en était un autre au moins aussi attirant : celui de la perfection spirituelle qui, en vertu de l’unité de toute l’œuvre divine, devait s’atteindre par une vie parallèle et très semblable à celle de l’évolution minérale. Inversement, les livres sacrés traitant de notre salut pouvaient donc être des guides pour le chercheur qui voulait faire de l’or : dans l’ensemble de la recherche humaine, une science nouvelle était née : l’Alchimie.
Le 15 avril 1722, l’Académie Royale des Sciences de Paris le condamnait l’Alchimie, exposant en détail les supercheries dont ses adeptes s’étaient rendus coupables ; personne alors ne prit la défense des condamnés et il fallut attendre cent soixante-deux ans pour les voir réhabiliter, partiellement, par Marcelin Berthelot. Celui-ci était déjà mondialement célèbre pour avoir réalisé les premières synthèses des composés organiques ; sa rectitude de caractère était proverbiale ; ses publications sur « Les Origines de l’Alchimie » eurent un profond retentissement, d’autant plus que leur auteur, devenu ministre de l’Instruction publique, fit publier des textes de précieux manuscrits alchimiques syriaques et grecs conservés à la Bibliothèque Nationale de Paris, qui sont des sources de premier ordre et n’auraient certes pas vu le jour de si tôt en d’autres circonstances.
Mais il s’agissait d’une science du Moyen-âge, donc d’une doctrine toute pénétrée de métaphysique et de religion. Celle-ci était du reste quelconque. Les premiers hermétistes Alexandrins furent indifféremment juifs, païens ou chrétiens et il est bien remarquable que la Table d’Émeraude soit rédigée sans aucune référence à une religion, ni même à une philosophie quelconque ; il est très probable qu’il en était de même du Livre des Secrets. A partir du Xe siècle il y eut une Alchimie arabe, musulmane, et dès le XIIe, une Alchimie européenne, chrétienne, qui suivait la même philosophie fondamentale tirée du Timée, et les préceptes attribués à l’arabe Djabir (latinisé en Géber). La branche arabe s’est maintenue vivante jusqu’à nos jours, car l’historien anglais Holmyard a bien connu un alchimiste pratiquant, vivant en Angleterre comme Mufti de la Mosquée de Woking, qui le présenta à un ami de Fez chez qui Holmyard put voir en pleine activité un laboratoire alchimique souterrain conforme aux descriptions du Moyen-âge. Mais l’Alchimie arabe a fort peu produit après le XIIe siècle, si l’on en croit les œuvres examinées jusqu’à présent.
En Europe, au contraire, il y eut dès la fin du XIIe siècle et le début du XIIIe siècle une floraison d’ouvrages qui, par la suite, se sont extraordinairement multipliés. Mais cette abondance n’est qu’apparente ; la très grande majorité des textes sont de contenu très semblable et répètent avec fort peu de nouveauté cc que les plus anciens traités européens, au nombre de trois ou quatre, avaient déjà publié. Cette uniformité a contribué à faire croire à la transmission d’une doctrine immuable et parfaite. Elle l’était si peu qu’au XVe siècle, l’évolution des idées rendit nécessaire une modification profonde de la théorie fondamentale elle-même. Deux auteurs s’en sont violemment disputé la paternité : l’un était Paracelse et l’autre un groupe d’Alchimistes rhénans se réclamant de Frère Basile Valentin, ce qui n’était probablement qu’un pseudonyme collectif. Jusque-là, on avait admis que les principes des métaux étaient le soufre et le mercure, l’un masculin, l’autre féminin. Les novateurs y ajoutent le sel et mettent cette trinité métallique en parallèle avec l’esprit, l’âme et le corps de l’homme. Grâce à ce symbolisme plus souple, grâce surtout à la réforme qui libérait les chercheurs des rigueurs de l’Inquisition et à l’imprimerie qui multipliait à bas prix les livres, l’Alchimie connut un dernier siècle de popularité. Mais celle-ci fut sa perte. D’innombrables filous se servirent d’elle, la déconsidérant au point d’en détacher tous les chercheurs sérieux qui rallièrent bientôt la chimie naissante.
On trouve donc dans l’Alchimie la même évolution que dans toute science : une recherche dont les résultats modifient la théorie ou la complètent. Ce mouvement fut lent, parce que l’Alchimie, respectée mais terriblement suspecte de liaison avec le Malin, n’a jamais eu en Europe la possibilité de se développer librement ; nos sciences actuelles jouissent au contraire d’une faveur qui les pousse à une transformation accélérée, mais qui ne diffère pas de nature avec celle de l’Alchimie : elle est donc bien une science et non une religion ou une scolastique dogmatique. Du reste, l’affirmation contraire est moderne, les auteurs anciens ne l’ont pas avancée, même lors de la transformation de ses principes au temps de Paracelse.
Si l’Alchimie est une science et non pas une chimie dans l’enfance, quels étaient son but et sa méthode ? Les auteurs du XVIIe siècle sont plus clairs que l’on ne croit sur ce point : la matière première de l’Œuvre est l’Homme lui-même, et sa transmutation étant assimilée au Salut pendant que la Pierre Philosophale est identifiée au Christ, il devient clair que ce but principal (ce n’était probablement pas le seul) de l’Alchimie était de déterminer en ses disciples une révolution intérieure les mettant à même de communier directement avec le Divin. Cette hypothèse réunit tout ce qu’il y a de positif dans les opinions émises sur la valeur de l’Alchimie, et elle prend une force considérable quand on se rappelle que cette science est née sous l’influence directe de l’École d’Alexandrie pénétrée par l’influence de Plotin et le récit des extases qui l’avaient élevé jusqu’aux demeures divines.
Ce serait donc l’extase alexandrine, la connaissance unitive du Divin, qui aurait été le Trésor auquel les Alchimistes ont consacré leur vie et l’ont parfois sacrifiée.
Prof. G. MONOD-HERZEN.
[1] L’Alchimie méditerranéenne : La Table d’Émeraude (éd. Adyar).