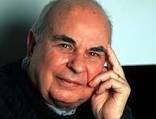Olivier Clément (1921-2009) né dans un milieu déchristianisé, Olivier Clément a reçu, après une longue recherche, le baptême dans l’Église orthodoxe. Il était professeur agrégé de l’université et avait enseigné à l’Institut de théologie orthodoxe Saint Serge et à l’Institut supérieur d’études œcuméniques, à Paris. Il était collaborateur de la revue Contacts, et publia plusieurs ouvrages sur l’histoire et la spiritualité de l’Orient chrétien. La part historique du texte suivant s’arrête au début des années 1970.
L’Église orthodoxes [1], environ 160 millions de baptisés, est l’une des trois expressions majeures du christianisme, celle peut-être qui a gardé la plus grande continuité avec l’Église indivise du premier millénaire. Elle reste pourtant mal connue. A bien des reprises, en effet, des forces hostiles venues de l’est ou de l’ouest ont détruit les formes culturelles où elle s’exprimait ; ainsi l’Islâm arabe au VIIe siècle, l’Occident latin et les Mongols au XIIIe, l’Islâm turc au XVe, le communisme au XXe siècle…
L’Église orthodoxe groupe aujourd’hui les Églises suivantes : le patriarcat œcuménique de Constantinople, dont dépendent la Dispersion grecque et les Églises autonomes de Finlande et de Crète (l’élection de leur primat doit être confirmée par Constantinople) ; les patriarcats apostoliques d’Alexandrie (dont dépendent les communautés noires, de greffe spontanée, puis de mission, qui se trouvent au Kenya, en Ouganda et au Tanganyika), d’Antioche et de Jérusalem ; le patriarcat de Moscou, dont dépend l’Église autonome du Japon (l’Église autonome de Chine est officiellement éteinte) ; les Églises, présidées par des patriarches, de Serbie, de Roumanie et de Bulgarie ; l’Église de Grèce, présidée par un archevêque par déférence envers le patriarcat œcuménique dont elle a longtemps dépendu ; l’Église de Géorgie, présidée par un « catholicos » (titre autrefois donné aux chefs d’Églises qui se trouvaient hors des frontières orientales de l’Empire byzantin) ; les Églises, présidées par des archevêques, de Chypre, d’Albanie (officiellement éteinte), de Pologne, de Tchécoslovaquie et d’Amérique ; celle-ci, première Église autocéphale purement occidentale, a été constituée en 1970 par le patriarcat de Moscou avec des orthodoxes d’origine qui ont largement fait souche dans le Nouveau Monde.
À travers tant de drames, l’orthodoxie s’est souvent contractée en une tradition, transmission rituelle et populaire, qui semble quelque peu figée au regard hâtif du touriste pourtant, elle manifeste périodiquement une tout autre dimension, celle de l’Esprit qui rénove et prophétise. Sans peser du « divino-humanisme » qui s’inscrit dans la « Trinité » de Roublev ou la « Descente aux enfers » de Karyie Cami, la pensée religieuse russe du XXe siècle, qui a fait souche en Occident, a tenté de répondre à la révolte et à l’athéisme du monde moderne. « Dostoïevsky, disait Berdiaeff, a su tout ce que Nietzsche a su, et quelque chose de plus. » Et un jeune théologien grec d’aujourd’hui, Christos Yannaras, range Camus, l’auteur de « l’Homme révolté », parmi ceux qui sont « dignes de l’orthodoxie ». Pour comprendre cette Église aux visages contrastés, nous étudierons d’abord l’héritage de son histoire, histoire étrange faite de véritables « morts-résurrections », puis les certitudes fondamentales dont le roc inébranlable étonne ou irrite souvent les chrétiens d’Occident, plus sensibles aux modes ; enfin, nous ferons un tableau des misères, problèmes et promesses d’aujourd’hui. Sans jamais perdre de vue les deux fils qui, à travers tant de péchés historiques, font la véritable continuité de l’orthodoxie, la rendant, pour paraphraser Pascal, presque uniquement « sensible au cœur » : le fil rouge des martyrs et le fil d’or des transfigurés..
L’HÉRITAGE
L’Église des sept conciles œcuméniques
Individualisée au tournant des deux millénaires de l’ère chrétienne par l’évolution propre de l’Orient méditerranéen et des terres roumaines, caucasiennes et slaves qu’elle évangélise, l’orthodoxie prend conscience d’elle-même par sa profonde continuité avec l’Église du premier millénaire, celle des martyrs, des Pères – qu’ils soient du Désert ou du haut témoignage théologique – et des sept conciles œcuméniques.
Avant tout persiste, surtout aujourd’hui que la chrétienté s’effondre tragiquement, la grande image conductrice de l’Église préconstantinienne ; Église ressentie surtout comme communauté eucharistique., « agapé », où « la vie en Christ » s’exprime dans une expérience réelle de service et de fraternité, où la spiritualité est normalement celle du martyr véritable état mystique où l’homme, s’identifiant au Crucifié éprouve dans une indicible métamorphose, la plénitude de la Résurrection.. « Donne ton sang et reçois l’esprit », dit un adage particulièrement cher à une Église qui, après les martyrs de l’empire païen, a connu ceux des empereurs hérétiques, puis les « néo-martyrs » d’une domination ottomane, qui n’a cessé qu’au XXe siècle, puis ceux, innombrables, de la Russie de l’entre-deux-guerres…
Certes, à partir de Constantin et de Théodose, le risque fut grand de confondre le Royaume de Dieu avec celui de César miraculeusement converti. Les masses conformistes affluaient dans l’Église, les évêques devenaient des personnages officiels La tension vers le Christ qui vient, la transcendance brûlante de l’Esprit furent alors préservées par le monachisme. Dans ses formes premières, farouches, celui-ci est l’« exploit » d’hommes « ivre de Dieu » qui veulent devenir réellement dès ici-bas des « ressuscités » pour consumer l’histoire dans la Parousie. Les « silencieux » (hésychastes, de « hesychia » le silence de l’union avec Dieu) pratiquent dans la solitude, ou quelques disciples autour d’un maître, « l’art des arts et la science des sciences » qui embrasent le cœur et anticipent la transfiguration du corps dans la gloire. Les cénobites, pour équilibrer l’affadissement de la vie paroissiale, créent des communautés fraternelles à l’image de l’Église originelle de Jérusalem où les biens étaient mis en commun, et exercent souvent un service social actif.
Cette grande expérience monastique s’est communiquée au peuple chrétien non seulement par l’exemple, l’accueil et la paternité spirituelle, mais aussi par l’élaboration d’un art total : la grande liturgie « byzantine ». A la veille, puis au lendemain, de la crise du VIIe siècle qui marque, à travers tant d’invasions, le passage d’une civilisation encore romaine à une civilisation déjà byzantine, de grands poètes théologiens [2], presque tous moines et syriens (mais s’exprimant dans l’hellénisme supranational de cette époque), font jaillir dans le cadre des icônes et des mosaïques un véritable fleuve hymnographique où s’unissent le sens grec d’une lumineuse beauté et le sens sémite de la chair et du pathétique. Colossale et légère, la coupole de Sainte-Sophie – la Sagesse divine –, à Constantinople, symbolise « le ciel sur la terre », cette définition orthodoxe de la liturgie.
D’autre part, l’expérience chrétienne vécue dans la spiritualité et la liturgie a permis à la rencontre inévitable du christianisme et des philosophies grecques d’aboutir non à quelque spéculation scolastique (voir Théologie), mais à une théologie de célébration où la pensée s’éclaire dans le mystère. Ici, interviennent les Pères de l’Église dont l’importance reste immense dans la théologie orthodoxe d’aujourd’hui. Certes, il y a eu et il y aura des « Pères » à toutes les époques de l’Église, mais les grands témoins des huit premiers siècles doivent sans doute leur capacité de synthèse au fait d’avoir été à la fois pasteurs, ascètes, exégètes et hommes de pensée. Leur théologie se situe entre le silence de la contemplation, les préoccupations existentielles des grands évêques et la louange liturgique. Elle surmonte le spiritualisme hellénique en montrant que le Dieu vivant transcende aussi bien l’esprit que le corps pour communiquer sa gloire aussi bien au corps qu’à l’esprit.
La règle de foi orthodoxe est définie par les sept conciles œcuméniques
La grande méditation patristique s’inscrit dans les dogmes des sept conciles œcuméniques qui constituent, aujourd’hui encore, la seule « règle de foi » de l’orthodoxie. Celle-ci a connu plus tard, et jusqu’à nos jours, bien d’autres conciles, mais ne leur a pas donné le qualificatif d’« œcuménique » par respect pour ce grand cycle de proclamations trinitaires et christologiques au long duquel l’Église indivise a dressé les sept colonnes de la Sagesse (on pourrait noter que l’Occident chrétien a longtemps partagé cette conception, se contentant d’appeler « généraux » les conciles tenus par la suite).
Au IVe siècle, les conciles de Nicée I (325), dont le grand défenseur devait être saint Athanase d’Alexandrie., et de Constantinople I (381), préparé par les Pères cappadociens, ont précisé, pour célébrer le mystère de la Trinité, la « distinction-identité » de l’essence et de l’hypostase (la personne, au sens proprement théologique) : l’hypostase est unique dans son mode d’existence mais, simultanément, elle est, en essence, identique aux autres. Le Dieu. vivant est donc unité absolue et diversité absolue, plénitude et fondement de l’existence personnelle dans l’amour. Du Ve au VIIIe [3] siècle se précise la réalité divino-humaine du Christ, donc de l’Église son corps, et du chrétien lui-même. L’accent passe sans cesse de la dualité à l’unité et de l’unité à la dualité, pour que l’humain ne se sépare pas du divin, ni ne s’abolisse en lui, mais s’accomplisse en se déifiant. Le concile d’Éphèse (431), préparé surtout par saint Cyrille d’Alexandrie, proclame Marie Théotokos, « Mère de Dieu » pour souligner que le sujet de l’humanité du Christ est la personne divine du Verbe. Chalcédoine (451) montre que cette unité ne compromet pas mais assure la plénitude en Christ de l’humanité et de la divinité, « sans mélange, sans transformation, sans division, sans séparation ». Malheureusement, le vocabulaire employé par ce concile, celui des « deux natures » du Dieu-homme, heurte les Égyptiens attachés aux formules de l’école d’Alexandrie qui, pour souligner l’unité du Christ, fondement de notre déification, parlaient d’une « seule nature », c’est-à-dire d’une seule réalité, du Verbe incarné. Ce malentendu, vite aggravé par de lourds problèmes politiques, a entraîné la séparation des Églises « non chalcédoniennes » (arméniens, jacobites, coptes, Ethiopiens, puis Indiens du Sud), séparation qui semble aujourd’hui toucher à son terme.
Constantinople II (553) avait pourtant repris les grandes affirmations alexandrines en affirmant que « Dieu a souffert la mort dans la chair » et que l’humanité du Christ, à laquelle nous sommes greffés dans l’Église, est à la fois déifiée et déifiante.
Constantinople III (680) souligne, en contrepoint, la présence en Christ comme dans l’homme chrétien, d’une intacte volonté humaine qui s’accomplit en s’unissant librement à la volonté divine.
Enfin, Nicée II (787) justifie le culte des icônes. L’Incarnation a sanctifié la matière, Dieu s’est fait visage et l’homme trouve en lui son vrai visage, la vénération d’une icône s’adresse donc à son modèle.
Restée à peu près inconnue de l’Occident, la « christologie énergétique » des trois derniers de ces conciles et de la grandiose synthèse d’un Maxime le Confesseur et d’un Jean Damascène montre surtout, dans l’Église, le sacrement du Ressuscité, un mystère de déification qui se réalise dans l’eucharistie. Toutefois, pour le « bon ordre » de l’Église, les sept conciles ont confirmé le regroupement des communautés locales en métropoles et des métropoles en patriarcats (par ordre d’honneur : Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem). Au sommet de cette hiérarchie de centres de communion, Rome jouit d’une primauté universelle, pleinement acceptée par l’Orient dans les derniers conciles œcuméniques : droit d’appel mitigé (Rome peut casser une sentence et provoquer localement un nouveau jugement), réception indispensable et prestigieuse des décisions conciliaires, conjointement avec l’accord des patriarches et le consensus de l’ensemble du peuple de Dieu.
L’empreinte byzantine
La période qui commence à la fin du premier millénaire pour s’achever avec la prise de Constantinople par les Turcs (1453) peut être appelée proprement byzantine [4]. Le schisme des « non-chalcédoniens », la soumission par l’islâm du Proche-Orient, l’éloignement de l’Occident font de Constantinople, l’ancienne Byzance, le centre incontesté de la chrétienté qui, de plus en plus, se définit par son « orthodoxie », au double sens de « juste doctrine » et de « juste glorification ». Le patriarche de Constantinople, qui a pris le nom de « patriarche œcuménique », assume désormais les prérogatives de la primauté. La « nouvelle Rome » est aussi la capitale de l’empire orthodoxe, où se développe une culture non point régentée, mais inspirée par l’Église. Après des crises violentes, marquées par la résistance inébranlable, jusqu’au martyre, d’une Église confessante animée surtout par les moines, la tentation du césaro-papisme a été surmontée, les rapports de l’Église et de l’État définis en terme de « symphonie » : l’Église, tout en défendant farouchement son indépendance spirituelle, renonce à l’exercice du pouvoir temporel et laisse à l’État sa consistance propre, qui s’affirme en particulier dans l’existence d’une université impériale purement laïque où l’humanisme antique, parfois antichrétien, connaît des résurgences périodiques. Non loin de la capitale, dans un isolement propice à la contemplation, la péninsule de l’Athos, « jardin de la Vierge », devient le centre proprement spirituel de l’orthodoxie : chaque pays orthodoxe y entretient un ou plusieurs monastères (il y eut même, jusqu’au XIIIe siècle, des bénédictins italiens), moines et pèlerins y affluent et la « Sainte Montagne », en retour, envoie de fervents missionnaires.
Trois lignes d’évolution caractérisent cette période : l’éloignement de l’Occident l’essor de la mission, un approfondissement théologique concernant surtout l’expérience chrétienne.
Le schisme de 1054 a des causes politiques et théologiques
Le schisme entre l’Occident et l’Orient chrétiens est, en réalité, un long processus d’éloignement qui se déroule du XIe au XIIIe siècle. Deux dates peuvent servir de points de repère : en 1054, une tentative de rapprochement échoue et aboutit à un échange d’anathèmes entre un légat pontifical et un patriarche de Constantinople ; en 1204, la quatrième croisade, au terme d’une séculaire montée d’incompréhension et de haine, se jette sur Constantinople et la ravage dans une frénésie de souillure et de destruction. Icônes brisées, calices profanés, prêtres assassinés, moniales violées, une prostituée chantant des chants obscènes sur le trône patriarcal, désignation d’autorité, par le pape, d’un patriarche latin de Constantinople et latinisation forcée : on comprend que, dans les siècles suivants, les Byzantins aient préféré « le turban turc à la mitre latine » !
À côté de facteurs psychosociologiques aujourd’hui périmés, le schisme, d’un point de vue orthodoxe, eut des causes proprement spirituelles qui concernent surtout le rôle du pape dans l’Église et la théologie du Saint-Esprit. Avec la réforme grégorienne, l’Occident évolue vers une monarchie romaine absolue. La primauté, longtemps centre de communion au sein des Églises locales et dans le respect de leurs droits, devient pouvoir juridique illimité sur une Église universelle où les évêques ne sont plus que les fonctionnaires du pape. La papauté s’affirme, en effet, source de tout pouvoir, non seulement spirituel mais temporel. On mesure l’écart avec l’Orient, qui reste fidèle à l’ecclésiologie de communion du premier millénaire.
La controverse concernant le Saint-Esprit tourne apparemment autour de la formule du « Filioque [5] » : l’Occident, sans qu’un concile œcuménique ait jamais examiné le problème, avait ajouté à la parole du Christ johannique sur « l’Esprit… qui procède du Père », les mots « et du Fils », en latin « Filioque ». Aux origines du « Filioque », chez les Pères latins, les études les plus récentes décèlent non pas une opposition aux formules grecques, du reste mal comprises en Occident, mais une approche différente, peut-être complémentaire. Il n’en reste pas moins que la scolastique latine, dans son exigence rationnelle de réduire la Trinité à des schémas binaires, établit entre l’Esprit et le Fils non plus une relation de dépendance réciproque et de mutuel service, mais une relation de dépendance unilatérale. Laquelle se reflète dans les nouvelles structures de l’Église latine, où la liberté et la prophétie dans l’Esprit se trouvent soumises, par une dépendance analogue, à la présence hiérarchique et sacramentelle du Christ.
La mission orthodoxe s’étend en Europe orientale
Au tournant des deux millénaires, la mission orthodoxe convertit – et civilise – toute l’Europe orientale, du Caucase aux Carpates et à l’océan glacial Arctique. Selon la tradition polyglotte de l’Orient chrétien, l’Écriture et la liturgie sont traduites en langues populaires, souvent dotées d’un alphabet et d’une syntaxe par les missionnaires, d’où l’usage actuel de l’alphabet dit cyrillique dans les pays slaves christianisés par l’orthodoxie. Au IXe siècle, les disciples des apôtres des Slaves, saints Cyrille et Méthode, organisent en Bulgarie un puissant foyer de christianisme slave. Serbes et Roumains sont atteints au siècle suivant, une évangélisation très ancienne ayant d’ailleurs laissé des traces dans les pays du bas Danube. La Russie reçoit « officiellement » le baptême en 987, date symbolique, l’essentiel étant une lente imprégnation populaire où le relais bulgare semble avoir joué le rôle principal.
En Bulgarie et surtout en Serbie, au XIIIe siècle, lors de l’occupation latine de Constantinople, se produit une rencontre féconde avec la chrétienté occidentale, comme en témoigne l’art moins hiératique, d’un humanisme transfiguré, auquel nous devons les fresques de Sopotchani et de Boïana. Après la destruction, à la même époque, de la Russie de Kiev par les Mongols, c’est l’Église qui permet au peuple russe, épars et ensauvagé, de se ressaisir dans les clairières du Nord-Est et de s’y unifier autour de Moscou. Au XIVe siècle, le mouvement des poustinniki (« ceux du Désert ») transpose dans la forêt nordique l’aventure des premiers moines, mais élargie, par un Serge de Radonège [6], dans un vaste labeur de service social et culturel et de pacification politique.
Dans le sillage de saint Serge, l’art de l’icône s’épanouit, notamment chez Roublev et dans son école, un art saturé de lumière et proprement « transfiguratif ».
Nous découvrons de plus en plus la fécondité théologique de cette époque, longtemps dénoncée en Occident comme stérile et vouée aux « querelles byzantines ». Dans son effondrement temporel, Byzance a ensemencé de lumière le monde orthodoxe : une autre lumière que celle de la raison occidentale, la « lumière thaborique », jaillit du Christ transfiguré sur le Thabor.
L’accent est mis sur l’expérience chrétienne, la pensée – protection et support indispensables – n’étant ici que le sismographe d’un ébranlement plus central.
Autour de l’an mille, c’est le mouvement mystique et prophétique que domine Syméon le Nouveau Théologien [7]. Contre tout hiérarchisme et sacramentalisme automatiques, ces « hommes apostoliques » soulignent que l’expérience de l’Esprit est non seulement possible mais indispensable, et que seul l’homme « né de l’Esprit » peut porter témoignage de la Lumière qu’il a vue, tel Paul dans son « ravissement » ou Jean à Patmos.
Aux siècles suivants, pour surmonter une tentation qu’on pourrait appeler « pentecôtiste » ou « cathare », la pensée byzantine montre que l’Esprit repose sur le Corps sacramentel du Christ, et que l’expérience prophétique est une expérience ecclésiale. Car le Corps du Christ, pour reprendre l’expression de saint Paul, est un « soma pneumatikon », une matière qui vibre des énergies de l’Esprit.
Toute cette élaboration culmine à la grande synthèse palamite confirmée par le concile réuni en 1351 à Constantinople. Saint Grégoire Palamas pose, dans l’approche du mystère de Dieu, la « distinction-identité » de l’essence et des énergies : totalement inaccessible dans son essence, le Dieu vivant, par libre amour, se rend totalement participable dans ses énergies, dans cette lumière incréée qui resplendit au Thabor, illumine la nuit de Pâques, ruisselle aujourd’hui de l’eucharistie, anticipe dès maintenant le retour du Christ. L’homme est appelé à métamorphoser dans cette lumière son cœur, son corps, toute son existence, toute la « matière » de l’univers.
La synthèse palamite est portée par une réadaptation, à l’Athos d’abord, de la tradition des Silencieux (les hésychastes), qui suscite une réforme intérieure de l’Église : par le renouveau de la prière et de la vie liturgique et par le sens de la pauvreté. Ainsi, en Orient, les mouvements de prophétisme et de paupérisme évangéliques sont restés suffisamment intérieurs à l’Église pour que celle-ci évite les déchirements du XVIe siècle occidental et accepte sans réticence, au niveau social, les régimes socialistes de notre époque.
Du XVe au XVIIIe siècle : le « Moyen Age » orthodoxe
De la chute de Constantinople au début du XVIIIe siècle s’étend une sorte de Moyen Age orthodoxe. La domination ottomane sur les Balkans [8], l’isolement et l’archaïsme de la Russie moscovite font régner une mentalité de « société close ». La grandeur de ces siècles, pourtant, tient à l’imprégnation de sens et de beauté qui se fait dans la vie populaire [9]. Des blanches églises de l’archipel grec aux églises doucement bariolées de la plaine russe, l’espace se transfigure. Le rythme liturgique ordonne le temps où les célébrations se prolongent en fêtes. L’art sacré devient dans les Balkans, un art monastique et populaire qui met l’accent sur l’humiliation volontaire du Christ et sur une ascèse virile, dont le prototype est saint Jean-Baptiste : on le représente sec et brûlant sur les icônes, mais revêtu d’ailes. Et l’ermite, son reflet, est dans la montagne, on peut aller lui demander une parole de vie.
L’univers orthodoxe se referme sur lui-même
Pourtant, la tentation grandit d’une foi impersonnelle, légaliste, d’un ritualisme presque magique. Au terme d’une évolution commencée pendant l’époque byzantine, la liturgie tend à devenir un spectacle sacré, l’iconostase, cette cloison couverte d’icônes qui sépare l’autel de la nef, s’hypertrophie pour protéger le « saint des saints », à la manière, croit-on, du Temple de Jérusalem ; la communion, par terreur révérentielle, devient très rare ; dans les canons, l’accent est mis sur les prescriptions reprises du « Lévitique » (voir Bible, Commandements).
Dans ce contexte, le peuple de Dieu tend à se confondre avec la nationalité que l’Église sauvegarde (dans l’Empire ottoman) ou exalte (en Russie). Ainsi s’affirme le « péché historique » majeur de l’orthodoxie moderne : le nationalisme religieux. Le patriarche de Constantinople, que le sultan considère comme le chef civilement responsable du peuple chrétien, l’« ethnarque », favorise dans l’Empire ottoman l’hellénisme au détriment des Slaves et des Arabes (aujourd’hui encore, une hiérarchie grecque persiste dans le patriarcat de Jérusalem). Le peuple russe, surtout, se définit autour du mythe de Moscou « troisième Rome » et « troisième empire ».
Cet univers orthodoxe se ferme d’autant plus qu’il subit les assauts d’un catholicisme galvanisé par la Contre-Réforme. Rome pousse les États catholiques qui comptent des provinces orthodoxes, telles l’Autriche et la Pologne, à créer par la force des communautés uniates, rattachées à Rome, et spirituellement latinisées sous des apparences orientales. Intellectuellement affaiblie, l’orthodoxie doit adopter, pour résister la problématique de l’adversaire et constitue une théologie d’école pénétrée d’influences latines et allemandes [10].
Pourtant la continuité de la liturgie et de la spiritualité, l’« instinct d’orthodoxie » des fidèles, sauvegardent l’essentiel. Des confréries laïques s’opposent à l’uniatisme. Les conciles du XVIIe siècle (Iassy, 1642 ; Moscou, 1666-1667 ; Bethléem 1672) affirment, entre Réforme et Contre-Réforme, le caractère sacramentel de l’Église et le rôle du Saint-Esprit dans le sacrement. Le concile de Moscou, auquel participent les patriarches d’Antioche et d’Alexandrie, a la force de surmonter le messianisme national et le ritualisme magique, mais il le fait avec tant de violence qu’il rend inévitable le schisme – le Raskol – des « vieux croyants », farouchement attachés à ces deux tendances.
Le XVIIIe et le XIXe siècle, une « mort-résurrection »
Le XVIIIe siècle semble une agonie pour l’Église orthodoxe. Le pourrissement de l’Empire ottoman contamine l’orthodoxie grecque et balkanique. En Russie, Pierre le Grand profite de l’affaiblissement de l’Église par le « Raskol » pour abolir le patriarcat et soumettre à un haut fonctionnaire l’administration ecclésiastique. La nouvelle élite russe, rationaliste ou occultisante, semble irrémédiablement détachée de la foi traditionnelle.
L’Église intègre l’esprit critique venu d’Occident
Le renouveau survient au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, par une nouvelle intervention des Silencieux. Saint Nicodème de la Sainte Montagne, aidé par Macaire de Corinthe et Athanase de Paros, publie les grands textes byzantins, adapte plusieurs mystiques occidentaux, préconise la purification de la liturgie et la communion fréquente, compose enfin une monumentale anthologie de théologie ascétique, la « Philocalie », publiée en 1782 à Venise. Un Ukrainien fixé en Moldavie après un long séjour à l’Athos, Païssié Vélitchkovsky, traduit la « Philocalie » en slavon, édite les « Pères » en russe et en roumain, et forme une pléiade de spirituels qui vont rénover la vie chrétienne dans la Russie du XIXe siècle. Le renouveau philocalique multiplie, en effet, dans tout le monde orthodoxe, ces « anciens » dont la « paternité spirituelle » et le « discernement des esprits » attirent les foules. Autour d’eux, l’abîme entre l’Église et les intellectuels commence à se combler, car ils n’hésitent pas à assumer, dans la perspective d’une connaissance intégrale, l’esprit critique qui vient d’Occident. Les meilleurs écrivains grecs du XIXe siècle, les « deux Alexandre » (Papadiamantis et Moraïtadis) sont des amis des « gérontès ». En Russie, écrivains, philosophes, chercheurs d’absolu affluent à l’ermitage d’Optino dont les « startsi » animent une prise de conscience originale de l’orthodoxie chez les grands penseurs « slavophiles » Kirievsky et Khomiakov. Dostoïevsky trouve dans leur paternité libératrice la réponse à la dialectique [11] du maître et de l’esclave et la redécouverte du christianisme comme religion de la liberté. En 1848, en réponse à un appel de la papauté qui prépare le dogme de son infaillibilité, une grande encyclique des patriarches orientaux [12] rappelle que la Vérité, dans la tradition orthodoxe, « est sauvegardée par le corps entier de l’Église » ; Khomiakov précise aussitôt : par la libre communion (« sobornost ») des consciences personnelles unies par la foi et l’amour. Dans les Balkans libérés se forment de nouvelles Églises nationales. L’Église grecque se proclame autocéphale en 1833 et obtient en 1850 la reconnaissance de Constantinople. L’Église serbe devient autonome en 1832, autocéphale en 1879, et, après s’être unie avec les autres communautés orthodoxes de la nouvelle Yougoslavie, est érigée en patriarcat en 1922 ; l’Église bulgare s’est proclamée autocéphale en 1860, mais n’a obtenu la reconnaissance de Constantinople qu’en 1945 ; de même, elle s’est érigée en patriarcat en 1953, mais celui-ci n’a été reconnu par Constantinople qu’en 1960.
En union étroite avec des laïcs cultivés, l’épiscopat russe s’affermit et convoque, dès 1904, des commissions préconcilaires pour libérer l’Église de la tutelle du régime. Réuni à Moscou en 1917-1918, le concile de l’Église russe, qui comporte, autour des évêques, de nombreux délégués des prêtres et des laïcs, restaure le patriarcat et réforme la vie ecclésiale dans le sens d’une entière responsabilité du laïcat.
Le XXe siècle : le martyre et l’universalité
A la veille de la Révolution de 1917, une élite de grands penseurs religieux, venus du marxisme, comme Boulgakov ou Berdiaeff, ou de la recherche scientifique, comme Florensky, tentent d’élaborer une anthropologie chrétienne qui maîtriserait l’événement. Mais ils sont pris de court par la rapidité et la violence de la crise, d’autant qu’ils sont peu nombreux et que les masses, arrachées par l’industrie, la guerre et la révolution à leurs cadres traditionnels, traduisent en espérance révolutionnaire la vieille attente du Royaume.
Jusqu’en 1922, durant la phase lyrique de la révolution, des persécutions convulsives se produisent, mais elles n’ont rien de systématique et la pensée chrétienne connaît, en plein risque, une grave maturation, guidée par un extraordinaire starets, un prêtre marié, le père Alexis Metchev. Mais, avec la N.E.P., pour assurer l’avenir, Lénine fait du marxisme une idéologie exclusive et, en 1922, chasse du pays la plupart des grands penseurs religieux. À partir de 1929, tout sera fait pour détruire l’Église ou la réduire à l’état d’une superstition figée dans son archaïsme. Tout change avec la guerre : l’Église participe puissamment au redressement moral de la patrie et reçoit, en 1943, une place modeste dans la société soviétique : le droit à la vie liturgique. Dans l’Europe du Sud-Est, après la seconde guerre mondiale, les démocraties populaires ont imposé de dures restrictions à la vie de l’Église, mais il n’y a eu ni persécutions sanglantes ni destruction systématique de l’intelligentzia chrétienne. En Roumanie, un humble prêtre de campagne, dans l’entre-deux-guerres, avait, au nom du Christ, abrité des proscrits politiques. L’un d’eux devint secrétaire général du parti communiste après la prise du pouvoir. Le prêtre est élu patriarche, sous le nom de Justinien. Le patriarche Justinien Ier réorganise son Église et réalise, en 1953, une réforme monastique qui insère les communautés dans l’économie socialiste et demande aux moines de participer à la « transformation de la nature » que préconise le régime, mais en conservant « le nom de Jésus dans le cœur », c’est-à-dire « dans une perspective de transfiguration » ; il leur recommande d’assumer le devoir de prière « pour ceux qui ne savent pas, ne veulent pas ou ne peuvent pas prier ».
Si le XXe siècle est pour l’orthodoxie le siècle du martyre, il est aussi celui de l’universalité. Aux vastes migrations « économiques » vers l’hémisphère occidental se joignent les victimes de deux cataclysmes historiques, la révolution russe et la destruction, en 1922, de la Grèce d’Asie par les nationalistes turcs. Des millions d’orthodoxes sont ainsi dispersés à travers l’Occident, dans l’Europe de l’Ouest, surtout en France, en Amérique et jusqu’en Australie. Partout se constituent des paroisses, des mouvements, quelques écoles de théologie. C’est à Paris que la pensée religieuse russe porte ses derniers fruits et répand dans la pensée occidentale qu’il suffise pour le moment de nommer Chestov et Berdiaeff des semences d’orthodoxie.
LES CERTITUDES FONDAMENTALES
Dans la grande tradition orthodoxe, on ne peut séparer la théologie, la mystique et les sacrements de l’Église : l’eucharistie éclaire le sens de l’Écriture, la Parole théologique s’accomplit en célébration liturgique et les dogmes, rares et formulés à regret uniquement lorsque l’expérience chrétienne est menacée, constituent les « images conductrices » de la « vie en Christ » [13].
« Dieu s’est fait homme pour que l’homme puisse devenir Dieu »
Créé « à l’image de Dieu », l’homme est appelé à la « similitude », c’est-à-dire à une participation à la vie divine où son humanité ne s’abolit pas mais s’accomplit. La « grâce incréée », la « lumière thaborique », constitue, comme dit Maxime le Confesseur, « son origine, son milieu et sa fin ». La création de l’homme implique une sorte de retrait sacrificiel du Créateur dont la toute-puissance, culminant dans la surgie d’une autre liberté, se transforme en une vulnérabilité infinie car, disent les Pères, « Dieu peut tout, sauf contraindre l’homme à l’aimer ». Dans cet « espacement » mystérieux qui est celui de la liberté de l’homme et de l’amour divin crucifié, la grâce est cette « lumière de la vie », dont parle saint Jean, lumière que Dieu communique à l’homme pour peu que celui-ci, dans la liberté souveraine de la foi, découvre à travers le défiguré de Gethsémani, le Transfiguré du Thabor.
Dès l’origine, le but offert à l’homme est donc la « divino-humanité » ; dès l’origine, l’incarnation du Fils, archétype éternel de l’homme, fonde et aimante l’univers. La grâce est impliquée dans l’acte même de création, la Lumière incréée sourd à la racine des choses ; nature et grâce existent l’une dans l’autre, mais la liberté personnelle de l’homme peut les disloquer, ensevelissant la création dans l’enfer et la mort qui sont des modalités de cette condition humaine séparée. Satan, le « séparateur », le « porteur de lumière « devenu idolâtre de soi, amplifie et objective cette situation, et c’est pourquoi on sent dans le mal non seulement le chaos qu’a provoqué l’homme en exilant Dieu, mais une intelligence perverse. Seul, le Christ, Adam définitif, peut rouvrir à l’homme, à travers même la séparation, c’est-à-dire à travers la Croix et dans son Corps ecclésial, l’espace de l’Esprit « vivifiant » qui libère notre liberté et la rend capable de changer réellement la vie en métamorphosant la mort même.
L’orthodoxie exalte donc avant tout, dans la personne et l’œuvre du Christ, la victoire sur la mort et l’enfer et l’inauguration, encore secrète, de la « nouvelle création ». En Christ, toute séparation, et jusqu’au désespoir infini de l’athéisme – « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » – se consument dans l’Amour trinitaire, tout le créé peut désormais « passer » dans l’incréé ; c’est l’exultation pascale (Pâques signifie « passage ») renouvelée à chaque eucharistie : « Christ est ressuscité des morts, par la mort il a écrasé la mort ! À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie ! »
La Résurrection n’est donc pas la réanimation d’un cadavre dans les modalités du monde déchu (selon lesquelles, même vivants, nous sommes déjà, en un sens, des cadavres), mais le bouleversement de ces modalités la vivification inaugurée de l’humanité et de l’univers et la « vie » s’identifie ici à l’Esprit saint. L’ascension ouvre la Pentecôte, l’humanité « pneumatique » du Christ (au sens du « pneuma », le souffle vivifiant) nous atteint dans les sacrements de l’Église, dans l’Église comme sacrement du Ressuscité : par là même lieu d’une permanente Pentecôte qui flamboie déjà dans les saints pour tout embraser à la Parousie.
La Trinité et l’anthropologie « trinitaire »
Le dogme de la Trinité constitue le cœur de la théologie de l’Orient chrétien, par là même, puisque l’homme est « à l’image » de Dieu, de toute son anthropologie.
La logique déchue, enfermée dans la mort, oppose ou confond. Elle est binaire, non uni-trinitaire. Le dogme de la Trinité suggère, au contraire, la coïncidence parfaite, dans la source même de la vie, de l’unité absolue et de la distinction absolue : unité plus totale que l’Un de Plotin, ou la « non-dualité » de l’Inde ; distinction plus totale que la nostalgie occidentale d’épanouissement individuel et de dialogue. Le Trois, ici, est un nombre « méta-mathématique » (saint Basile le Grand) qui, toujours identique à l’Un, signifie le dépassement infini de l’opposition non par résorption dans l’impersonnel, mais par la plénitude de la communion où chacun, loin de s’opposer, pose les autres dans une relation uni-trinitaire proprement impensable. Chaque hypostase (ou personne, au sens non philosophique mais théologique) peut être désignée, invoquée, comme une manière incomparable de « recueillir les essences spirituelles des êtres… pour les présenter à Dieu comme des offrandes de la part de la création [14] ». Ainsi collaborons-nous, pour reprendre une autre expression du Confesseur, à transformer l’univers en « buisson ardent ».
Le sens de l’Église
Pour l’essentiel, l’ecclésiologie orthodoxe apparaît comme une ecclésiologie de communion qui tente d’exprimer directement les dogmes concernant le Christ, l’Esprit saint et la Trinité.
L’Église, en premier lieu, se définit comme Corps du Christ [15], en tant qu’elle se compose de communautés eucharistiques. La transmutation eucharistique, en effet, intègre de la manière la plus réaliste l’assemblée des fidèles en Corps du Christ. L’Église locale n’est donc pas le fragment d’une Église abstraitement universelle, mais la manifestation plénière, en un lieu donné, de l’Una Sancta. À travers le temps et l’espace il existe, en quelque sorte, une seule eucharistie, attestée par la « succession apostolique » des évêques, et toutes les Églises locales ne font qu’une en elle. Le Corps du Christ est un corps « spirituel » sur lequel repose l’Esprit [16]. Les fidèles membres du Corps du Christ, sont donc des porteurs de l’Esprit, des « pneumatophores ». A ce titre, ils sont les gardiens responsables de la Vérité, comme l’a rappelé, en 1848 une encyclique des patriarches orientaux. Le rôle des laïcs membres du « laos théou », peuple de Dieu, est très important dans la recherche et l’enseignement théologiques, il se concentre parfois dans des mouvements ou des personnalités prophétiques, particulièrement dans le témoignage des « spirituels ». Le magistère ne peut donc agir et définir qu’en tenant le plus grand compte de 1’« intuition d’orthodoxie » du peuple de Dieu. La Vérité, si elle est Vie, ne s’impose pas du dehors aux consciences personnelles, elle doit leur devenir évidente dans la communion de l’Esprit. À la rencontre de ces deux aspects de l’Église, nous trouvons l’épiclèse, « imploration » qui constitue le cœur de toute action sacramentelle. Dans la liturgie eucharistique en particulier, la transmutation ne dépend pas des seules paroles d’institution, mais essentiellement de cette épiclèse qui demande à Dieu, plus précisément au Père, d’envoyer son Esprit « sur nous et sur les dons que voici [le pain et le vin] pour nous intégrer par eux au Corps du Christ ». Le prêtre prononce l’épiclèse, mais tous s’associent à lui. Ainsi se précise l’articulation des deux sacerdoces : les laïcs, membres du sacerdoce universel, concélèbrent au niveau de l’imploration ; le ministre, qui rassemble cette imploration, atteste son exaucement grâce au « témoignage apostolique » de l’évêque et des prêtres qui le représentent dans les paroisses. D’autre part, le fait même de l’épiclèse souligne que le prêtre ne s’identifie pas au Christ, il est seulement son image, sans qu’une différence d’essence le sépare des laïcs ; c’est pourquoi, tout comme l’Église indivise, l’Église orthodoxe n’a jamais cessé d’ordonner au sacerdoce des hommes mariés.
On comprend aussi, si l’on songe à cette étroite coopération entre le peuple et le ministère, que le candidat le plus digne à l’épiscopat ait été traditionnellement élu. Cette élection a disparu de facto dans la plupart des Églises orthodoxes, et s’y maintient seulement comme une acclamation liturgique. Toutefois, l’élection des évêques existe toujours à Chypre et dans le patriarcat d’Antioche ; elle avait été rétablie dans l’Église russe par le concile de 1917-1918 et l’on a envisagé sérieusement de la restaurer en Grèce.
Corps du Christ, temple du Saint-Esprit, peuple de Dieu, l’Église apparaît finalement comme une communion à l’image de la Trinité. Communion, d’une part, des consciences personnelles. Une décision du magistère et même d’un concile réuni avec toutes les garanties canoniques d’œcuménicité doit être « reçue » par l’ensemble du peuple de Dieu, au cours d’un processus d’assimilation qui peut être tumultueux, exiger de nouveaux efforts d’éclaircissement, voire la convocation d’un nouveau concile. Le brigandage d’Éphèse au IVe siècle, le concile iconoclaste de Hieréia au VIIIe siècle, le concile d’union de Florence du XVe ont été rejetés par la conscience de l’Église, cette communion des consciences personnelles qui, en revanche, n’a pas hésité à proclamer « œcuménique », bien après coup, le concile régional réuni à Constantinople en 381, ou à donner une portée panorthodoxe à l’encyclique de 1848.
L’Église orthodoxe est une communion d’églises locales
Communion, d’autre part, des églises locales. Elle s’organise autour d’une hiérarchie de centres d’accord dont les primats reçoivent la prérogative de faire face aux communautés locales pour les empêcher de s’isoler et pour veiller à la réalité de leur communion. Très tôt, les églises d’une province ont constitué une métropole, autour d’un métropolite (les métropoles gardent un rôle important au Proche-Orient, en Grèce et en Roumanie). Puis se sont formés de vastes ensembles autocéphales (qui s’administrent eux-mêmes), communautés de civilisation à l’origine (le monde latin autour de Rome, grec autour de Constantinople, sémitique autour d’Antioche, nilotique autour d’Alexandrie). Aujourd’hui, depuis l’essor de la Russie et le mouvement des nationalités dans les Balkans aux XIXe et XXe siècles, les « autocéphalies » sont fréquemment des Églises nationales. Le primat d’une autocéphalie, le plus souvent appelé « patriarche », est élu par l’ensemble de son Église, c’est-à-dire par les évêques avec la participation du clergé et du peuple, il doit être reconnu par les autres patriarches et, surtout, par le premier d’entre eux.
Traditionnellement, en effet, un premier évêque détient une primauté universelle. C’était l’évêque de Rome dans l’Église indivise, c’est l’évêque de Constantinople – nouvelle Rome depuis le schisme, étant bien entendu que Rome reprendra la première place dès que les divergences de structure et de foi auront été surmontées. Dans la conception orthodoxe, du moins la plus traditionnelle, la primauté universelle n’est pas une domination juridique, et c’est pourquoi le dogme du premier concile du Vatican stipulant que le pape exerce une juridiction « directe et vraiment épiscopale » sur tous les fidèles est inacceptable pour l’orthodoxie. Mais cette primauté n’est pas davantage purement honorifique ; la communion à avec le premier évêque et la possibilité d’interjeter appel devant lui vérifient l’appartenance à l’Église universelle ; et dispose de prérogatives d’initiative et de présidence pour la mise en branle du magistère. Ce qui finalement semble caractériser la Tradition de l’Église indivise, c’est la multiplicité « symphonique » (et non hiérarchiste) des moyens dont l’Église dispose pour détecter l’inspiration de l’Esprit : l’accord des évêques, et particulièrement de ces « colonnes » de l’épiscopat que sont les patriarches, la confirmation prestigieuse du premier évêque, la communion des consciences personnelles et les phénomènes de prophétisme qui l’animent. Symphonie telle que personne ne peut avoir le dernier mot sauf l’Esprit et le mystérieux accord qu’il provoque. Dans cette perspective, la succession de Pierre se retrouve à tous les niveaux : dans la foi de chaque croyant, dans le témoignage privilégié des évêques qui président à l’eucharistie, comme Pierre dans la première église, à Jérusalem, enfin dans la mission du premier évêque qui doit exprimer l’unité de l’Église comme Pierre le faisait pour le collège apostolique (mais la succession de Pierre n’exclut nullement celle de Paul et celle de Jean, c’est-à-dire le témoignage des prophètes et des voyants).
LA SITUATION PLANÉTAIRE ACTUELLE DE L’ORTHODOXIE
L’orthodoxie est aujourd’hui présente dans les diverses civilisations qui coexistent ou s’affrontent à l’échelle planétaire : le monde communiste, l’Occident et le Tiers Monde.
Orthodoxie et communisme
L’orthodoxie n’a jamais développé de « théologie de la propriété ». Le souvenir de la première Église, où les biens étaient mis en commun, l’exemple analogue des monastères, les appels à la justice sociale des prophètes d’Israël et des Pères grecs (pour saint Jean Chrysostome, le pauvre est une incarnation du Christ et le sacrement de l’autel. n’a pas de sens s’il ne se prolonge en « sacrement du frère »), le sens aigu du péché social dans la Russie du XIXe siècle, tout explique que l’orthodoxie, malgré sa longue utilisation par le régime impérial, ait accepté, après 1917, la nouvelle organisation économique et sociale.
« L’État exigera-t-il le renoncement à la propriété, faudra-t-il donner sa vie pour l’œuvre commune ? Mais c’est là précisément ce que leur foi enseigne aux chrétiens », écrivait, dès 1927, un des responsables de l’Église russe. Très tôt, donc, le problème est spirituel : le témoignage du Dieu vivant et de la dimension éternelle de l’homme face à un matérialisme totalitaire.
L’Église connaît en U.R.S.S. une persécution non sanglante, mais asphyxiante
De 1943 à 1959, nous l’avons dit, l’Église russe connaît un renouveau. Le cadre juridique de ce « modus vivendi » est la distinction de l’État et du parti : celui-ci maintient sa propagande antireligieuse, mais puisqu’on peut être citoyen soviétique sans être communiste, l’État fait respecter la liberté de culte, inscrite dans la Constitution. Vers 1959, on comptait donc de 40 à 50 millions de pratiquants (sur 210 millions d’habitants, dont un certain nombre relèvent d’autres appartenances religieuses).
Toutefois, à partir de 1959, ce renouveau, parce qu’il touche des ouvriers et des intellectuels entièrement formés par le régime, exaspère les idéologues du communisme, à commencer par Khrouchtchev lui-même. Pendant cinq ans, la persécution se déchaîne, menée non seulement par le parti, mais par l’État : la Commission pour l’Église orthodoxe, section principale de la Commission pour les affaires religieuses auprès du Conseil des ministres de l’U.R.S.S., resserre son étau sur l’Église et la contraint, en 1961, à modifier le statut des paroisses., désormais prises en main par un exécutif laïc approuvé, c’est-à-dire imposé par les autorités civiles qui l’utilisent pour détruire de l’intérieur la vie des communautés. 15000 églises environ (sur 22000) sont fermées, de même qu’une soixantaine de monastères sur 68 et 5 séminaires sur 8. Persécution non sanglante, mais asphyxiante : on ne compte plus les prêtres interdits par l’État, puis arrêtés pour parasitisme », les croyants rétrogradés dans leur emploi, parfois internés dans d’étranges asiles psychiatriques.
Depuis la chute de Khrouchtchev, la situation semble stationnaire. Une opposition s’est formée dans l’Église, qui réclame l’application réelle de la séparation de l’Église et de l’État. Mais la stagnation, voire la régression du régime l’ont réduite au silence, et le devant de la scène est occupé par quelques prélats ambigus, qui ressemblent à de hauts fonctionnaires soviétiques, sauvent sans doute ce qui peut l’être, mais semblent surtout se consacrer à une vaste diplomatie politico-religieuse où les intérêts du régime et un certain messianisme de Moscou, Troisième Rome, coïncident momentanément. Les récentes persécutions ont hâté la déchristianisation de larges secteurs de la société, particulièrement les campagnes, toujours très peuplées ; elles ont empêché, ou gêné, la rencontre des intellectuels convertis et du peuple croyant, qui se trouve ainsi renforcé dans son ritualisme. Il existe une ou plusieurs Églises « souterraines » traditionalistes, mais ce sont surtout les baptistes qui connaissent un grand essor. Tandis que la théologie officielle reste terne, de jeunes intellectuels, solitaires ou formant de petits groupes marginaux, se passionnent pour la philosophie religieuse du début du siècle qui voyait dans le christianisme la religion de la personne et de la liberté. Les plus grands écrivains russes d’hier – Akhmatova et Pasternak – et d’aujourd’hui – Soljenitsyne, Siniavski – se rattachent ouvertement, quels que soient les risques, à l’esprit de l’orthodoxie.
Au total, l’Église subsiste et porte souvent un grand témoignage de prière. Beaucoup d’évêques et de prêtres ont une action pastorale discrète mais profonde. A la mort du patriarche Alexis (1945-1969), on a pu se demander si le régime, comme dans l’entre-deux-guerres, ne supprimerait pas « de facto » le patriarcat. Or, après une hésitation de dix-huit mois, il a permis la convocation d’un concile qui a élu un nouveau patriarche, Pimen, intronisé le jour même de la Pentecôte. Ce concile a été réuni du 31 mai au 3 juin 1971 au monastère de la Trinité-Saint-Serge.
Dès 1958, les dirigeants russes avaient choisi la Roumanie comme banc d’essai des persécutions. Le mouvement monastique fut décapité, les principaux spirituels et théologiens emprisonnés. Toutefois, avec la politique d’indépendance nationale, la situation s’est améliorée et l’Église roumaine est de nouveau en mesure de jouer un rôle important dans la prise de conscience de l’orthodoxie et le dialogue œcuménique.
L’orthodoxie dans le monde grec et arabe
Dans les vieilles Églises de l’hellénisme et du Proche-Orient, la situation est fort diverse selon que l’emportent les pesanteurs de l’histoire ou les poussées novatrices de l’esprit. La communauté grecque orthodoxe d’Istanbul (où se trouve le Phanar, humble siège du patriarcat œcuménique), pour avoir servi d’otage (et de victime) aux Turcs durant la crise cypriote, n’a cessé de s’amenuiser. Mais le patriarche Athénagoras Ier (depuis 1950) a su transfigurer cette faiblesse historique en rayonnement spirituel. Son esprit novateur se retrouve dans l’Église de Crète qui, sous sa haute juridiction, donne un bel exemple d’ouverture œcuménique, d’action sociale, d’approfondissement théologique, d’étroite coopération entre le peuple et ses évêques.
Un courant intégriste s’oppose aux mouvements modernes
En Grèce même, l’impact de la civilisation technique et du sécularisme provoque une crise très grave. Un vigoureux mouvement d’apostolat et d’action chrétienne, animé surtout par une confrérie (aux vœux temporaires) de prêtres et de laïcs, « Zoi » (« la Vie »), s’est affadi ces dernières années en une sorte de piétisme moralisateur tenté par le recours au bras séculier, en l’occurrence le régime des colonels, pour maintenir les dehors d’une « civilisation gréco-chrétienne ». Le primat mis en place dans ces perspectives, l’archevêque d’Athènes Hiéronymos, agit pourtant discrètement pour une plus grande indépendance de l’Église. Tandis qu’un courant intégriste, antimoderne et anti-œcuménique, se renforce et trouve appui chez les moines de l’Athos (qui dénonçaient comme hérétique le patriarche Athénagoras depuis son rapprochement avec Rome), une nouvelle génération de théologiens découvre la force novatrice de la Tradition. Une partie de ces jeunes intellectuels collabore maintenant avec le primat et l’amène à des initiatives pleines de promesses, comme la création, en 1971, d’un Centre interorthodoxe à Athènes.
L’orthodoxie arabe, longtemps réduite à l’état d’une communauté surtout sociologique dans le puzzle politico-religieux du Proche-Orient, a été rénovée, depuis les années 1940, par le M.J.O., Mouvement de jeunesse orthodoxe du patriarcat d’Antioche. Ce mouvement, purement laïc et prophétique à l’origine, a formé des prêtres et des évêques, recréé une vie paroissiale et monastique et permis la fondation, en 1970 d’une importante école de théologie à Balamand. Aujourd’hui, il s’engage courageusement dans les problèmes du Tiers Monde et surtout de l’arabité, cherchant une présence originale du christianisme au sein des religions non chrétiennes.
L’orthodoxie et l’Occident : le problème de la Dispersion
La « nouvelle immigration » (1880 env.-1924) a amené aux États-Unis, au Canada, au Brésil et en Argentine des représentants de toutes les ethnies orthodoxes (l’Église albanaise, par exemple, n’existe plus aujourd’hui qu’aux États-Unis). Les deux émigrations russes – celle qui a suivi la révolution et celle des D.P. (« displaced persons », personnes déplacées) après la seconde guerre mondiale – et la grande émigration des Grecs d’Asie après 1922, ont achevé, dans l’hémisphère occidental, la constitution d’une orthodoxie d’environ 5 millions de personnes.
En Europe occidentale, une colonie grecque s’est formée à Marseille dès le début du XIXe siècle, mais les arrivées majeures ici aussi se situent dans les années 1920 avec la défaite des armées blanches et l’incendie de Smyrne… Le mouvement continue à notre époque – Cypriotes à Londres, travailleurs grecs en Allemagne, Belgique, etc., et Serbes, nombreux en France. Dans ce dernier pays, on compte environ 100 000 baptisés orthodoxes citoyens français, en majorité par la naissance.
Partout, en effet, les orthodoxes sont devenus citoyens des pays où ils se trouvent et ont fait discrètement souche. L’émigration russe, qui comptait une brillante élite intellectuelle, a joué un rôle immense pour l’approfondissement et le témoignage de l’orthodoxie. A Paris, elle a fondé l’Institut de théologie Saint-Serge qui, après la dernière guerre, a essaimé à New York, au séminaire Saint-Vladimir, véritable creuset d’unification pour l’orthodoxie américaine.
Si l’on met à part l’aventure isolée d’un groupe l’« Église catholique orthodoxe de France » fondée par Eugraph Kovalevsky (Mgr Jean, mort en 1969), l’orthodoxie en Occident s’est refusée à tout prosélytisme. Des conversions pourtant se produisent, souvent à partir de milieux déchristianisés (c’est le cas pour l’auteur de ces lignes) et l’on trouve aujourd’hui parmi les prêtres et théologiens de la Dispersion des orthodoxes d’origine française, anglaise, allemande, suisse et américaine. Aux États-Unis, l’orthodoxie attire un certain nombre de jeunes par son sens du mystère et sa capacité non d’ignorer, mais de transfigurer la souffrance. Nombreux aussi sont les orthodoxes dans les différents domaines de la culture occidentale, du grand historien des religions Mircea Eliade au jeune et prometteur écrivain français Gabriel Matzneff [17].
La Diaspora apparaît ainsi comme un lieu de rencontre, d’échanges, de prise de conscience, où l’orthodoxie fait l’expérience de l’universel.
Pourtant, la situation psychologique de la Diaspora est fort complexe. Certains milieux voient surtout dans l’orthodoxie la sauvegarde de leur originalité nationale. D’autres, sans renier leurs origines, souhaitent insérer l’orthodoxie dans l’existence de la nation dont ils sont citoyens. C’est ainsi qu’on voit coexister des ghettos ethniques et des communautés ouvertes, d’expression anglaise aux États-Unis ou française en France. Dans ce dernier pays, ce passage de l’émigré au citoyen français de confession orthodoxe s’accentue avec l’érosion inéluctable des « refuges » russes.
Cette transition est rendue encore plus difficile par la confusion canonique qui règne dans la Dispersion. De nombreuses « juridictions » coexistent, le plus souvent dépendances des Églises traditionnelles, parfois aussi schismes dus aux remous politico-religieux entraînés par les révolutions communistes en Europe orientale : c’est ainsi que l’Église russe hors frontières » ou « Église synodale », dont le centre est aux États-Unis, dénonce le patriarcat de Moscou comme instrument de l’antéchrist.
L’Église orthodoxe prépare son concile
Le patriarcat de Constantinople, en tant que siège « œcuménique » chargé de veiller à l’unité et à l’universalité de l’Église, a revendiqué une sollicitude particulière envers la Dispersion. Il a établi sa juridiction sur la Dispersion grecque, mais n’a pu le faire sur les autres nationalités, sauf pour la fraction la plus importante de l’émigration russe en Europe occidentale, aujourd’hui « archevêché multinational » dont le centre est à la cathédrale Saint-Alexandre-de-la-Neva, rue Daru, à Paris. Depuis 1971, un vicariat provisoire du trône œcuménique réunit en France cet archevêché et la métropole grecque regroupant ainsi la très grande majorité des orthodoxes qui vivent dans ce pays. Organisation provisoire car, pour le patriarche Athénagoras, seul le concile aujourd’hui en préparation pourra définitivement régler le problème de la Dispersion.
Aux États-Unis, Constantinople a provoqué la formation ces dernières années, d’une conférence de tout l’épiscopat orthodoxe. Mais le patriarche œcuménique s’appuie beaucoup sur l’Église grecque d’Amérique et répugne à la « dénationaliser ». C’est pourquoi les jeunes théologiens de Saint-Vladimir, pionniers d’une orthodoxie proprement américaine, se sont adressés au patriarcat de Moscou qui, pour des raisons de politique générale sur lesquelles nous reviendrons, a chaleureusement accueilli leur demande et constitué en 1970 en Église autocéphale d’Amérique les orthodoxes d’origine russe qui n’appartiennent pas à la communauté « synodale ». L’événement, parce qu’il ignore le processus conciliaire où l’orthodoxie s’est engagée, a été fraîchement accueilli par la plupart des Églises sœurs. Il n’en crée pas moins un processus irréversible, et l’apparition d’une Église orthodoxe officiellement occidentale.
LES COURANTS THÉOLOGIQUES
La théologie orthodoxe au XXe siècle a été longtemps animée par la pensée russe, en Russie même, puis dans la Dispersion. Un puissant mouvement prophétique, d’une extrême modernité, attire d’abord l’attention, la « philosophie religieuse » russe. Son plus grand représentant, Nicolas Berdiaeff, est mort à Clamart en 1948, mais sa pensée féconde encore les esprits, dans des synthèses un peu différentes. La philosophie religieuse part de l’expérience spirituelle pour déchiffrer d’une manière créatrice la culture et l’histoire. Ses fondateurs ne sont pas des universitaires, mais des aventuriers de l’esprit qui ont fait l’expérience passionnée de l’athéisme, souvent à travers un engagement révolutionnaire.
En eux les Pères de l’Église rencontrent Marx, Nietzsche et Freud, ces pères du monde moderne. Rozanov [18] étudie la sexualité comme expérience religieuse fondamentale, Boulgakov [19] montre que l’économie devra choisir entre une attitude de vampirisation, qui détruit la nature, ou une attitude « eucharistique » qui la respecte, l’embellit, prépare sa transfiguration. Pour Berdiaeff, la véritable « créativité » est celle de l’homme dans l’Esprit saint : il ne s’agit ni d’opposer Dieu à l’homme, ou l’homme à Dieu, ni de séparer le « profane » et le « religieux », mais de libérer de leur myopie les démarches humaines dans la plénitude de la divino-humanité.
La connaissance « intégrale » dépasse la connaissance rationnelle
Les préoccupations anthropologiques et cosmologiques dominent cette pensée. Les philosophes religieux critiquent les limitations de la connaissance rationnelle (Chestov [20] et Florensky le font avec des accents pascaliens) et cherchent une connaissance intégrale où l’homme connaîtrait Dieu avec tout son être réunifié et communiant ; l’Église apparaît alors comme la structure même de l’esprit (les Troubetskoï, Nicolas Lossky, Berdiaeff). Toute une tendance, celle des philosophes de l’« uni-totalité » et des « sophiologues » (de Sophia, la Sagesse divine toute-présente), un Florensky, un Boulgakov, un Frank, un Zander, exalte dans l’Église le cosmos en voie de transfiguration, dans l’histoire le passage prédéterminé du Dieu-homme au Dieu-humanité et Dieu-univers.
En revanche, Berdiaeff met l’accent, avec une brûlante passion, sur la personne, le tragique, la liberté. Pour lui, Dieu est ma liberté. Sans Dieu, je suis irrémédiablement asservi aux mécanismes de la nature et de la société. Le Dieu vivant est Amour sacrificiel, rayonnement de Lumière et de Vie qui ne peut se manifester qu’à travers des transparences personnelles. Il ne peut agir comme cause physique, comme puissance de ce monde. Il ne peut que mourir sur la croix pour ressusciter dans l’Esprit de ceux qui, par libre amour, le reconnaissent. La véritable créativité est le jaillissement dans l’instant de la Lumière de l’Esprit. Non seulement la sanctification de l’ascète, mais le combat du réformateur social, l’intuition du mathématicien ou du poète, l’amour d’un homme et d’une femme, le sourire d’une mère revêtent une signification religieuse, préparent, au-delà de leur « objectivation » inévitable, la transfiguration finale de l’univers.
La Tradition patristique imprègne le monde orthodoxe
La modernité exubérante de la philosophie religieuse russe n’allait pas sans formulations inquiétantes, positions déséquilibrées, tentations gnostiques ou immanentistes assorties d’une ecclésiologie par trop libérale. Un retour à la grande Tradition patristique et byzantine s’imposait. Dans les années 1940, le père Georges Florovsky [21] et Vladimir Lossky [22] mènent l’assaut contre les excès et les incertitudes de la philosophie religieuse, tandis qu’un athonite, le père Basil Krivochéine, et un jeune théologien roumain, le père Dimitru Staniloaë, montrent toute l’importance de la synthèse palamite, et qu’une femme, Myrrha Lot-Borodine [23], étudie sereinement les voies de la déification chez les Pères grecs et les spirituels byzantins. Dans les années 1950, Florovsky développe une christologie intégrale, Lossky souligne le rapport de réciprocité qui unit le Fils et l’Esprit, le sacrement et le prophétisme. À Saint-Serge, le père Nicolas Afanassieff élabore une « ecclésiologie eucharistique » à laquelle nous nous sommes souvent référé dans ces pages. Parallèlement, un grand effort est réalisé pour réadapter à notre époque la tradition des Silencieux : mentionnons, en Europe occidentale, les travaux (et, pour certains, le rayonnement personnel) du père Sophrony [24] (qui dirige une communauté monastique près de Londres), de Mgr Antoine Bloom [25], du père Lev Gillet [26] et d’Élisabeth Behr-Sigel [27], ces deux derniers de souche française. L’œuvre majeure, cependant, dans ce domaine, est celle, en Roumanie, du père Staniloaë qui, dans les années qui suivent la guerre, a non seulement traduit, mais commenté les grands textes philocaliques, surtout ceux de Maxime le Confesseur.
La théologie néo-patristique domine aujourd’hui le monde orthodoxe. Mais elle est au départ de deux attitudes bien différentes. Les uns se contentent de répéter fidèlement les Pères et renforcent ainsi un intégrisme typiquement orthodoxe. D’autres, au contraire, enracinés dans la Tradition, tentent de répondre aux problèmes d’aujourd’hui et participent loyalement au dialogue œcuménique : ainsi le père Jean Meyendorff, à New York, historien de la christologie byzantine et du palamisme [28], et le père Boris Bobrinskoy, à Paris, qui fait œuvre de novateur en théologie des sacrements.
D’autres sont allés plus loin et ont cherché à dépasser l’opposition de la néo-patristique et de la philosophie religieuse. Aux États-Unis, le père Schmemann [29] met l’accent sur le sacrement de la vie, sur le mystère de la matérialité. Mais l’œuvre clé, ici, est celle d’un théologien laïc, d’origine russe et d’écriture directement française, Paul Evdokimov (1901-1970) [30]. Retrouvant non la lettre mais le souffle des Pères, il a intégré dans la Tradition les intuitions des philosophes religieux, surtout Berdiaeff. Le « silence de Dieu » s’identifie à son « amour fou ». L’humanité est appelée à une communion trinitaire. Tout dans l’Église est épiclèse, jusqu’au signe de croix. La véritable théologie est célébration de la Beauté. Le visage devenant icône est la seule preuve de Dieu. Le « monachisme intériorisé » universel s’unit au mystère de l’amour humain, car la véritable chasteté est « intégrité » de l’esprit, intégration de l’éros dans la tendresse. Dans les derniers temps, la féminité secrète de Dieu se manifeste et la femme, qui a partie liée avec le Consolateur, découvre sa mission nouvelle…
À travers cette pensée russe universalisée par l’exil, au-delà désormais, de nouveaux pas en avant se préparent. Dans l’humilité exigeante de la Dispersion, où tout doit passer au crible de la rigueur occidentale ; en Grèce, où les jeunes théologiens se libèrent d’une pensée scolastique et rationalisée – sur laquelle tranchait seulement l’œuvre probe et solide d’un Karmiris – pour tenter d’exprimer la lumière de la Byzance spirituelle et le destin total de l’hellénisme (à quoi les récentes incantations de Heidegger ne sont pas étrangères). Mentionnons les recherches gnoséologiques et œcuméniques de Nissiotis, ecclésiologiques de Zizioulas, anthropologiques de Nellas, et surtout les livres passionnés d’un jeune penseur et écrivain de génie, Christos Yannaras [31] : par lui, la théologie n’est plus une étrange spécialité, elle est sens et feu, elle émeut artistes et athées. Tandis que médite à l’écart le « Socrate chrétien » d’aujourd’hui, qui inspire mais n’écrit pas, Démètre Koutroubis [32].
Dans l’orthodoxie arabe, enfin, une nouvelle théologie est à la fois écrite et vécue – vécue non seulement dans la prière solitaire, mais sur les champs de bataille de l’histoire – par deux grands évêques, Georges Khodr, métropolite du mont Liban, et Ignace Hazim, métropolite de Lattaquié [33]. Profondément biblique et liturgique, profondément sémite par son sens de l’incarnation, leur pensée s’« oriente », au plein sens du terme, vers les humanités non occidentales, vers leur double exigence d’intériorité et de justice, et culmine, comme la philosophie religieuse russe, dans l’attente ultime : celle de la révélation de la révélation (et des révélations, dans l’humanité unifiée) par l’Esprit saint, « ce qui est partout présent et qui remplit tout », comme le dit la prière la plus connue de l’orthodoxie.
Les structures de l’Église universelle
Un des problèmes les plus graves qui se posent aujourd’hui à l’orthodoxie est celui des structures de l’Église universelle. Longtemps, l’universalité de l’Église s’est exprimée dans l’accord des patriarcats apostoliques, multinationaux, autour du patriarcat œcuménique. En particulier, le patriarche de Constantinople réunissait régulièrement en conciles ses frères d’Antioche, d’Alexandrie et de Jérusalem, chacun accompagné de son « synode. », représentation permanente de son épiscopat. Le dernier de ces conciles s’est réuni à Constantinople en 1872. Déjà, en effet, le mouvement des nationalités mettait en cause cette organisation. L’amenuisement de l’Empire ottoman entraînait celui du patriarcat de Constantinople, et les nations chrétiennes des Balkans, une fois libérées, se dotaient d’Églises autocéphales avec l’appui de l’Empire et de l’Église russes.
On aboutit ainsi, aujourd’hui, à deux ecclésiologies qui pourraient se compléter, mais qui, en fait, s’opposent souvent. D’une part, l’ecclésiologie traditionnelle de Constantinople, pour laquelle les structures universelles comportent un centre de communion doté de prérogatives réelles. D’autre part, l’ecclésiologie issue du mouvement des nationalités et de la polémique avec Rome, et selon laquelle l’orthodoxie est une confédération d’Églises sœurs totalement indépendantes. L’Église russe, après avoir accédé à l’autocéphalie (de facto en 1448, de jure en 1589), s’était d’abord intégrée dans le système traditionnel, pratiquant l’appel à Constantinople, faisant participer les patriarches orientaux à ses conciles. Toutefois, à partir du XIXe siècle, c’est elle surtout qui défend la nouvelle ecclésiologie, avec l’espoir que parmi les Églises sœurs, sa puissance lui donnera le premier rôle. Cette querelle de la Deuxième et de la Troisième Rome est toujours d’actualité, car le régime soviétique s’intéresse surtout à la politique mondiale de l’Église russe, tandis que l’assise historique du Phanar à Istanbul, ne cesse de s’effriter.
Pour réorganiser l’Église, en tenant compte de la multiplication des autocéphalies, Constantinople, dès 1902, lance l’idée de consultations panorthodoxes régulières, voire de la préparation d’un concile. Mais il faut arriver au patriarche Athénagoras Ier pour que ces projets prennent corps. Ce grand homme [34], dont la simplicité et la force spirituelle rappelaient celles de Jean XXIII, entreprend, au-delà des controverses, un patient et tenace rassemblement de l’orthodoxie auquel il parvient à associer, non sans sacrifices de sa part, le patriarcat de Moscou. Quatre conférences panorthodoxes se réunissent alors, à Rhodes en 1961, 1963 et 1964, et à Chambésy, près de Genève, en 1968. Rhodes I établit l’agenda d’un futur concile et Chambésy met en marche un processus préconciliaire comportant toute une série de conférences préparatoires.
C’est alors que, pour des raisons mal connues, le patriarcat de Moscou compromet, par une série de gestes délibérés, ce rassemblement qui donnait un contenu renouvelé – non de juridiction mais d’incitation – à la primauté de Constantinople. En ouvrant sa communion aux catholiques en 1969, en érigeant, en 1970, l’autocéphalie américaine, chaque fois de sa propre initiative et sans consulter l’ensemble de l’orthodoxie, il ignore le processus préconciliaire, affirme sa totale indépendance, se pose en centre d’impulsion de l’orthodoxie.
Il semble que ce blocage sera surmonté par l’intervention pacifiante des Églises de moyenne importance et par l’éveil, à l’échelle mondiale, d’une opinion orthodoxe. L’organisation mondiale des mouvements de jeunesse orthodoxes « Syndesmos » (le Lien) lors de sa huitième assemblée générale à Boston, en juillet 1971, a appelé à la réconciliation et demandé au peuple chrétien, notamment aux jeunes, de s’engager dans la préparation du concile. Des théologiens laïcs ont lancé des appels analogues.
ORTHODOXIE ET ŒCUMÉNISME
Dès 1902-1904, et plus encore par son encyclique de 1920, le patriarche de Constantinople a appelé tous les chrétiens au dialogue et à l’entraide. Dans les années vingt, il a donc été, avec les anglicans et les luthériens, cofondateur du mouvement œcuménique, structuré en 1948 dans le Conseil œcuménique des Églises, et c’est encore lui qui a sauvé la participation orthodoxe au Conseil lorsque, entre 1945 et 1955, l’Église russe dénonçait dans l’œcuménisme un instrument de l’impérialisme occidental et l’Église grecque une menace pour la pureté de l’orthodoxie. Dans les années 1960, au contraire, la politique de coexistence pacifique amène les Églises de l’Est à adhérer au Conseil dont toutes les Églises orthodoxes (sauf l’Église russe hors frontières) font partie depuis 1966. Cette participation pourtant reste difficile. Le travail du Conseil est très « intellectuel », sa tendance majeure dissout le mystère chrétien dans l’engagement politico-social, tandis que l’orthodoxie dispose de peu de forces intellectuelles, insiste sur les dimensions spirituelles et sacramentelles de l’unité et voit dans le mystère la source de tout engagement vraiment créateur. Mais c’est là que pourrait se trouver, au-delà des crispations ou des arrière-pensées, le sens du témoignage orthodoxe dans le Conseil.
La participation de l’orthodoxie, du reste, a déjà porté fruit en permettant à celle-ci, dans le cadre du Conseil, des conversations sur le fond avec les « non-chalcédoniens », conversations qui ont abouti, de 1964 à 1970, à un accord complet sur la foi, prélude à un constat d’union.
Toutefois, depuis quelques années, c’est surtout entre catholiques et orthodoxes que le dialogue le plus fécond s’est engagé. En 1964, Athénagoras Ier et Paul VI se rencontrent à Jérusalem ; en 1967, le pape se rend au Phanar et le patriarche au Vatican. Le « dialogue de la charité » a permis, dès 1965, la levée des anathèmes de 1054 et l’inauguration d’un dialogue théologique original, attentif à l’émergence de l’Église indivise. Reste le douloureux problème des communautés « uniates », vieille blessure pour l’orthodoxie, blessure encore fraîche pour le catholicisme, car l’uniatisme a été brutalement liquidé, au lendemain de la seconde guerre mondiale, dans les pays de l’Est, et ses fidèles, sincèrement catholicisés par les siècles, contraints d’entrer dans l’Église orthodoxe.
L’orthodoxie, qui n’a pas connu les ruptures du XVIe siècle, peut aider le catholicisme à accéder aux requêtes positives de la Réforme sans perdre la réalité sacramentelle de l’Église.
Tandis que le christianisme occidental subit une crise spirituelle qui met en cause le contenu même de la foi, l’orthodoxie souffre d’une crise historique qui met en cause l’incarnation créatrice de l’Église. On voit comment la rencontre pourrait se faire, et ce que chacun y apporterait. Laissons ici, pour conclure, la parole aux jeunes orthodoxes.
« Au-delà des problèmes de structures, la crise du monde contemporain est avant tout une crise du sens, une crise de l’esprit. Ce n’est donc pas le moment pour les chrétiens d’oublier l’Église comme mystère et de diminuer l’importance de la prière, car ils ne feraient ainsi qu’appauvrir le christianisme de son essence même, qui est une vie en Christ, transfigurante et déifiante. L’orthodoxie doit témoigner que la véritable libération de l’homme ne consiste pas seulement à changer le décor, mais à amener les hommes à redécouvrir la joie de la Résurrection, dans toute sa portée, c’est-à-dire dans un service qui embrasse aussi la société. » (Résolution de l’assemblée générale de Syndesmos, Boston, 12-25 juillet 1971.)
[1] Pour une présentation générale, voir P. Evdokimov : l’Orthodoxie (Delachaux et Niestlé, 1965) ; J. Meyendorff : l’Église orthodoxe hier et aujourd’hui (Le Seuil, 1966) ; O. Clément : l’Église orthodoxe (P.U.F., coll. « Que sais-je ? », 1965).
[2] Romanos Le Mélode : les Hymnes (Paris, Le Cerf, 1964-1965).
[3] Sur cette élaboration, voir J. Meyendorff : le Christ dans la théologie byzantine (Paris, Le Cerf, 1968).
[4] Pour une interprétation d’ensemble de la période byzantine, voir O. Clément : l’Essor du christianisme oriental et Byzance et le christianisme, 2 vol. (Paris, P.U.F., 1964).
[5] Sur le problème du « Filioque », voir V. Lossky : « La Procession du Saint-Esprit dans la doctrine trinitaire orthodoxe », in À l’image et à la ressemblance de Dieu (Paris, Aubier, 1967).
[6] Voir P. Kovalevsky : Saint Serge et la spiritualité russe (Paris, Le Seuil, 1958).
[7] L’œuvre presque entière de Syméon le Nouveau Théologien (texte critique par Mgr B. Krivochéine, trad. franç., par J. Paramelle) est accessible dans la collection des « Sources chrétiennes », n°’ 51, 96, 104, 113, 122, 156 (Paris, Le Cerf).
[8] Voir S. Runciman : The Great Church in Captivity (Cambridge University Press, 1968).
[9] Voir I. Kologrivof : Essai sur la sainteté en Russie (Bruges, Beyaert, 1953).
[10] Voir G. Florovsky : « The Orthodox Churches and the Ecumenical Movement prior to 1910 », in A History of the OEcumenical Movement (1517-1948) (Londres, R. Rouse and S.C. Neill, S.P.C.K., 1954).
[11] Voir la Philosophie (Paris, C.E.P.L. Denoël, 1969).
[12] Texte français dans Contacts, revue française de l’orthodoxie, t. XVII, n » 49 (Paris, 1965).
[13] Voir V. Lossky : Essai sur la théologie mystique de l’Église d’Orient (Paris, Aubier, 1968) et P. Evdokimov : la Connaissance de Dieu dans la tradition orientale (Lyon, Mappus, 1966).
[14] Saint Maxime le Confesseur : Mystagogie, 2. Une traduction française de la Mystagogie a été publiée par A. Hamman dans l’Initiation chrétienne (Paris, Grasset, 1963).
[15] Sur l’Église Corps du Christ et l’ecclésiologie eucharistique, voir G. Florovsky : « Le Corps du Christ vivant », in la Sainte Église universelle (Paris-Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1953) et N. Afanassieff et autres : la Primauté de Pierre dans l’Église orthodoxe (Paris-Neuchâtel. Delachaux et Niestlé, 1960).
[16] Sur le rôle de l’Esprit saint dans l’ecclésiologie orthodoxe, voir N.A. Nissiotis : « Pneumatologie orthodoxe », in le Saint-Esprit (Genève, Labor et fides, 1963).
[17] G. Matzneff : l’Archimandrite (Paris, La Table Ronde, 1966) ; Comme le feu mêlé d’aromates (Paris, La Table Ronde, 1969) ; le Carnet arabe (Paris, La Table Ronde. 1971).
[18] V. Rozanov : la Face sombre du Christ (Paris, Gallimard, 1964).
[19] S. Boulgakov : Du Verbe incarné (Paris, Aubier, 1943) et le Paraclet (Paris, Aubier, 1946).
[20] L’œuvre complète de Chestov est en cours de publication chez Flammarion ; ont déjà paru : la Philosophie de la tragédie, Sur les confins de la vie, le Pouvoir des clefs, Athènes et Jérusalem, Sur la balance de Job.
[21] Voir Y.N. Lelouvier : Perspectives russes sur l’Église, un théologien contemporain, Georges Florovsky (Paris, Le Centurion, 1968).
[22] Pour une vue d’ensemble sur la pensée de Lossky, voir O. Clément : « Vladimir Lossky, un théologien de la personne et du Saint-Esprit », in Mémorial Lossky, numéro spécial du Messager de l’Exarchat russe (Paris, 1959).
[23] Outre le recueil cité plus haut, voir Un maître de la spiritualité byzantine du XIV’ siècle, Nicolas Cabasillas (Paris, L’Orante, 1958).
[24] Archimandrite Sofrony : The Undistorted Image, Starets Silouan (1866-1938) (Londres, The Faith Press, 1958).
[25] A. Bloom : Living Prayer (Londres, Darton, Longman and Todd, 1966).
[26] L. Gillet : Sur l’usage de la prière de Jésus (Bruxelles, Chevetogne, 1952) ; Présence du Christ (Chevetogne, 1962).
[27] E. Behr-Sigel : « la Prière de Jésus », in Dieu vivant, no 8 (Paris, Le Seuil, 1948) ; Prière et Sainteté dans l’Église russe (Paris, Le Cerf, 1950).
[28] J. Meyendorff : Introduction à l’étude de Grégoire Palamas (Paris, le Seuil, 1959) ; Saint Grégoire Palamas et la mystique orthodoxe (Paris, le Seuil, 1959) ; Orthodoxie et Catholicité (Paris, Le Seuil, 1965) ; le Christ dans la théologie byzantine (Paris, Le Cerf, 1969).
[29] P. Schmemann : Pour la vie du monde (Paris, Desclée de Brouwer. 1969).
[30] Pour une appréciation d’ensemble, voir O. Clément : « La vie et l’œuvre de Paul Evdokimov, quelques approches », in Paul Evdokimo ; témoin de la beauté de Dieu (Paris, Contacts, 1971). Outre les ouvrages déjà cités : la Femme et le salut du monde (Paris-Tournai, Casterman. 1958) ; Gogol et Dostoievsky ou la descente aux enfers (Paris, Desclée de Brouwer, 1961) ; le Sacrement de l’Amour, le mystère conjugal à la lumière de la tradition orthodoxe (Paris, L’Épi, 1962) ; les Âges de la vie spirituelle (Paris, Desclée de Brouwer, 1964) ; le Christ dans la pensé, russe (Paris, Le Cerf, 1969) ; l’Art de l’icône, théologie de la beauté (Paris, Desclée de Brouwer, 1970).
[31] Le seul livre de C. Yannaras traduit en français est : De l’absence et de l’inconnaissance de Dieu (Paris, Le Cerf, 1971).
[32] Il a cependant collaboré au recueil, déjà cité, consacré par la revue Contacts à Paul Evdokimov.
[33] L. Hazim : l’Homme d’aujourd’hui et la Résurrection (Beyrouth, An-Nour, 1971).
[34] Voir O. Clément : Dialogues avec le patriarche Athénagoras (Paris, Fayard, 1969).