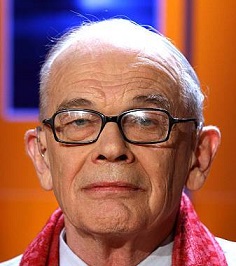(Revue Le chant de la licorne. No 23. 1988)
Si accompagner n’est pas un savoir-faire relevant d’une expérience ou d’une technique. Si chaque rencontre, parce que particulière, nous confronte avec du « jamais-vécu », du « jamais-entendu ». Qui sommes-nous donc pour prendre les chemins d’une telle rencontre ? Quel est cet esprit partagé qui nous pousse vers l’homme au souffle amoindri qui bientôt passera la mort ? D’où cet esprit tire-t-il sa tranquille assurance de pouvoir prendre corps en toute réalité ?
***
Un terrain déjà bien occupé
Dans nos sociétés dites « avancées », le médecin est le professionnel que la loi oblige le plus à fréquenter : de six mois avant notre débarquement en ce monde jusqu’aux heures qui suivent notre dernier souffle, l’homme de science mettra sa compétence à nous protéger de toutes les choses terribles qui pourraient nous arriver. Sa signature ouvre tour à tour les portes de l’école, de la colonie de vacances, de la caserne, du mariage civil ; elle garantit les remboursements de santé, les assurances-vie…
Cette omniprésence médicale a pour moi une portée considérable, même en l’absence d’activité curative : la précision des « explorations fonctionnelles » offre une sécurité qui permet à l’homme fragile de se risquer encore : prendre l’avion, faire l’ascension d’une montagne, descendre sous terre, pratiquer un sport, faire des projets d’avenir… Non seulement les limites de la mort sont repoussées, mais la vie elle-même peut garder une bonne part de sa qualité.
J’aimerais être sûr que ceux qui pratiquent l’accompagnement des mourants font pour eux-mêmes bon usage de cette médecine : que non seulement ils ne lui font pas le procès d’être « dure », mais qu’ils ont appris à l’utiliser intelligemment, c’est-à-dire avant qu’il ne soit trop tard ; qu’ils ont avec leur médecin une relation d’égal à égal et non d’élève à professeur ; que, lorsqu’ils déclarent une maladie, ils savent l’aider à déchiffrer les symptômes en termes d’un éventuel mal-être…
Ce soin qui a la vertu de retarder la mort n’a pas le pouvoir de la supprimer et il n’appartient pas au seul médecin de rappeler cette évidence : la reconnaissance d’une limite me paraît être davantage le cadeau d’une confiance mutuelle que l’exigence d’un droit : elle requiert quelque part, et des deux côtés, un brin d’humour.
Et la simplicité de faire appel à d’autres. Depuis quarante ans (c’est-à-dire depuis que les églises ont cessé de nourrir une culture), les sciences humaines, surtout la psychologie, ont investi avec courage et honnêteté les deux dimensions qui permettent à un individu d’être ouvert à son humanité : la prise en compte de son histoire et la relation à son environnement. Peurs, culpabilité, désirs de toute puissance, se sont fait démasquer à l’intérieur des conduites les plus nobles. À côté des inévitables « soupçons » qu’elles faisaient naître à leur insu, ces sciences de l’homme se sont mises au service des souffrants de toutes sortes, des handicapés de la vie que des blessures parfois anciennes retenaient d’eux-mêmes. Les professionnels de la « psyché » ont pris place à leur tour à toutes les étapes de l’aventure humaine, de la naissance à la mort ; ils ont appris à lire la vie en termes d’attachement et de séparation.
Les professionnels de la « relation d’aide » sont au service du fils, de la sœur, du couple, du malade, de l’exclu, pour les aider à vivre, à découvrir un sens au temps, à trouver du goût dans le quotidien, à entrer en responsabilité, à dire « je » … Ils ont les outils pour démêler les forces mortifères, toujours au travail et qui retiennent la vie dans leurs filets. Au-delà des querelles de clochers et au terme d’une nécessaire crise de croissance, ces travailleurs sociaux ont donné aussi la preuve de leur utilité, ils font moins peur. On verra de moins en moins médecins et psychiatres donnant, en table ronde, le spectacle d’un dialogue de sourds arrosé de politesses fielleuses. Les psychologues sont entrés à l’hôpital, ont leur place dans des services de cancérologie, de gériatrie, de pédiatrie.
Là aussi, j’aimerais que ceux qui pratiquent l’accompagnement des mourants se réjouissent avec moi de cette percée de compréhension qui arrive à vaincre toutes les résistances et tous les mandarinats. Des passerelles sont maintenant jetées entre ces deux blocs qui cassaient l’homme : son corps et son esprit. L’homéopathie a maintenant son label, les médecines douces sont enseignées dans certaines facultés de médecine. À de multiples signes, et sous la poussée d’associations d’usagers de la santé, je constate qu’un équilibre se cherche. Il prendra du temps à informer les mentalités.
C’est cependant par rapport à ce « terrain » que les soins palliatifs doivent s’identifier comme une troisième force originale et complémentaire. Comme un troisième type de soin appliqué à une situation particulière, celle qui est inaugurée par le renoncement à guérir, et qui dirige ses ressources propres et sa créativité vers un autre objectif que le retour à la santé. C’est de cet « esprit palliatif » dont je vais parler maintenant : j’essaierai de le saisir à la source de son humanité et de ses exigences, préalablement à toute réalisation particulière.
Entre le savoir-faire et le désir d’aider, une place pour exister
Parce que l’accompagnateur, quel qu’il soit, est nécessairement identifié par le mourant comme un étranger, inconnu jusqu’ici, il me paraît honnête de vérifier si, malgré toute sa bonne volonté, il n’est pas nuisible : s’il n’adopte pas les attitudes et comportements correspondant à l’état où il imagine la personne en fin de vie. S’il accepte de se placer en situation de non-savoir et porté par le désir de recevoir l’autre. L’élève est assis, il se tait, il est attentif et immobile. C’est à ces conditions que le patient ne retirera pas de la visite une fatigue supplémentaire, une irritation, ou même un sentiment plus fort de sa propre solitude. Je me réfère ici à ce que j’ai compris du premier degré de la compassion selon la philosophie bouddhiste : ne pas ajouter encore à la souffrance de l’autre.
Mais tout en ayant sa valeur, cette attitude de disciple suspendu aux lèvres du patient, disponible pour la satisfaction des besoins qu’il pourrait exprimer, peut faire souffrir à son tour. Je pense avoir provoqué, durant plusieurs années, cette souffrance-là en tant que soignant : je ne savais pas encore assez que les pauvres – il y a tant de manières de l’être – ont perdu souvent la capacité de demander pour eux, un peu comme certains vieillards ont peu à peu atrophié le geste qui mène la main vers une nourriture qui leur fait envie ; ou alors, ils demandent selon cette « éminente dignité » qui les habille d’humanité, en termes voilés qui échappent à la seule attention polie, ou bien ils se taisent parce qu’« ils ne savent pas parler » devant quelqu’un d’un autre milieu qu’eux.
Le patient peut ressentir une troisième forme de souffrance devant l’accompagnateur seulement disponible : le sentiment d’avoir devant lui un être abstrait dont il ne sait rien : quelle personne existe derrière ce sourire discret, cette voix douce qui s’est présentée comme bénévole, cette main qui ne se retire pas comme tant d’autres ? Ces temps du détachement des proches ne sont forcément propices à faire de nouvelles connaissances, poser des questions… À moins que cette personne soit capable de recevoir ce qui ne peut être dit ni à des proches qu’il est indispensable de ménager, ni à des professionnels « qu’on ne veut pas déranger ».
Cette approche par la « souffrance donnée » n’a pas pour but de décourager les candidats à l’accompagnement, ni de faire naître des questions rétroactives chez ceux qui ont de la pratique ; elle voudrait faire commencer à comprendre que, dans l’esprit palliatif, l’accompagnement est fondé sur un accord au moins implicite entre deux personnes. Il ne me paraît pas exact de penser que n’importe qui peut accompagner n’importe qui, (c’est là une des raisons qui justifie à mes yeux l’équipe comme possibilité de choix pour le patient). La porte d’entrée de tout accompagnement me paraît être la perception globale et intuitive qu’a le mourant que telle personne a les ressources pour l’aider à vivre sa mort. J’ignore évidemment sur quels indices les patients se basent ; mais a priori, ils ne me paraissent pas différents de ceux qui fonctionnent partout lorsque deux êtres se rencontrent pour la première fois. On parle alors « d’atomes crochus » ; pourquoi pas ? Je peux seulement dire que la plupart des relations un peu profondes vécues avec des patients se sont engagées au cours des premières minutes. Quel est donc ce quelque chose, cet « epsilon » difficilement identifiable, que certains possèdent et d’autres pas et qui engendre confiance ou réserve ?
Permettez-moi de l’appeler un « savoir-être », provisoirement : il est de l’ordre du centre, du foyer d’émanation et de rayonnement. Un lieu intérieur en deçà de la relation, mais relié cependant à elle, où la personne n’est le fils, la sœur, l’époux, la mère, l’employé de personne ; en retrait de l’acquis et de l’appris, et cependant sans divorce d’avec eux. Le savoir-être évoque l’idée d’un « espace intérieur » libre parce que vide. Vide de préjugés, de discours tout faits, de catégories rigides. Un vide capable d’accueillir une parole nouvelle, maintenant, sans la juger, sans la consoler artificiellement par des mots passe-partout.
S’il en était fait encore besoin, je vous demanderais maintenant ; qui choisiriez-vous pour vous aider à traverser une passe difficile ? Vous commenceriez sans doute par écarter de votre esprit : les gens pressés, les donneurs de conseils, ceux qui se feraient un devoir de vous aider, etc… Et vous accepteriez la personne dont le « savoir-être » (nécessairement original, au sens d’unique) pourrait seul vous offrir la garantie d’être respecté.
La sérénité d’un regard
Une qualité d’être reconnue et acceptée par la personne en fin de vie : voilà la première caractéristique du soin palliatif. Et il est bon de pouvoir parler encore de soin, dans l’ici – et – le – maintenant : l’accompagnateur n’est pas là pour remplacer des absents, excuser l’absence des professionnels ou aider à une « bonne mort ». Les êtres aimés, dont l’absence est ressentie comme douloureuse, personne ne peut les remplacer ; l’impression pénible d’avoir été abandonné par les médecins, personne ne peut la gommer ; la « bonne mort » n’existe pas ailleurs qu’en celui qui vit présentement son mourir.
Tout soin se réfère à un modèle de santé. Mais de quelle santé parlons-nous lorsqu’il s’agit de l’étape irréversiblement dernière d’une vie ?
-
le soin est dispensé à une personne en vie ; il s’agit donc de ne pas la « voir morte » avant son heure [1], de maintenir la communication le plus longtemps possible, même lorsque la personne est « dans le coma ». On pourrait définir la mort comme la fin irréversible de la communication. Le soin palliatif continue à voir dans le mourant un vivant et à le traiter comme tel, c’est-à-dire comme premier responsable de ce qu’il vit maintenant, et capable de rester autonome dans sa dépendance même.
-
le soin est dispensé à une personne en période de « crise », au sens étymologique du terme : phase décisive (d’une maladie par exemple), dénouement, action de séparer, de choisir, éventuellement contestation du passé. Dans cette perspective, le stress de la mort proche se comprend comme un processus positif d’adaptation, mobilisant toutes les énergies internes. Le soin palliatif prend en compte le temps de la mort de l’autre comme une étape de passage.
-
le soin n’isole pas le mourant de son contexte relationnel et affectif. La famille est considérée, selon les cas, ou bien comme celle qui aide, ou bien comme celle qui a besoin de soutien pour vivre l’épreuve du deuil. Le soin palliatif considère la souffrance morale liée aux proches (absence, dissentiments, incompréhensions, intérêts d’argent…) comme une des principales difficultés de l’étape terminale.
Au point où nous en sommes, l’esprit palliatif se définit d’abord comme une qualité de regard : délivré de l’illusion d’un retour « à la normale », des optimismes de pacotille selon lesquels « ça va aller mieux », il considère la mort comme la face cachée de la vie. S’il peut aider le mourant à souffrir de corps, d’âme et d’esprit, c’est dans la mesure où son propre savoir-être lui a appris que la meilleure humanité [2] n’est jamais menacée par la mort. Elle peut s’exercer ou se révéler jusqu’au terme sensible de la vie.
Ainsi, l’être soigné par l’esprit palliatif ne se trouve pas délivré d’une maladie mais – chose plus précieuse encore – de toute malédiction : il n’est pas regardé comme cet être aux marges du monde qui, bientôt, s’en abstraira à jamais. Rayé de l’état-civil par un monde qui l’oubliera vite. Il est traité comme digne d’éternité. Le soin palliatif comme une force de réhabilitation : au nom de son humanité, quelqu’un réassure le malade dans le réseau des solidarités humaines, le conforte dans la certitude que sa mort sera humaine, qu’il sera reconnu comme un combattant, qui n’est pas attaqué dans le dos, mais face à face.
La santé à laquelle travaille le soin de « 3e type » peut donc se caractériser ainsi : l’état de quelqu’un qui ne se considère ni puni par quelque destin de ses fautes passées, ni exclu du monde des hommes comme un être sans valeur. Le soin palliatif travaille lui aussi à une guérison : en paix avec son passé (1), libéré des appréhensions de l’après-mort, un homme affaibli et généralement dépendant des autres découvre les joies nouvelles du jour après jour ; à travers toutes les pertes imposées par la maladie, il découvre l’épaisseur du présent, goûte entre deux sommeils les douceurs d’un silence partagé à deux. Il est guéri du souci de paraître, de se montrer fort, de gérer l’avenir dans des projets sans fin ; il est guéri de la fièvre d’agir : celle des autres, maintenant, le fatigue.
Les richesses de la fraternité
Pour résumer :
— Par rapport à la personne qui meurt, il y a un premier champ où de réels services peuvent être rendus (après le passage des professionnels) : une présence de sécurité auprès du lit, susceptible de répondre à des besoins matériels immédiats : respiration, vomissements, position assise, boisson… À domicile, la présence d’un bénévole disponible à ce type de services concrets est souvent appréciée par les proches qui peuvent penser à eux durant quelques heures. La personne en fin de vie n’en demande parfois pas plus…
— Je souhaiterais que le terme d’accompagnement soit réservé à un second champ, que j’ai précédemment délimité par le fait d’être choisi, et que je vais définir maintenant en termes de mouvement : « aller de compagnie » dit Littré. Le mot d’accompagnement suggère très justement que la personne suit un chemin et que quelqu’un marche, à son rythme, à ses côtés, sur la même route. L’accompagnement, en son sens légitime, apparaît alors comme une association entre compagnons dont un des sens du Littré dit : « association entre ouvriers de même métier, en vue de se prêter des secours mutuels ». De quel métier s’agit-il donc ?
Quel est ce travail que tous deux partagent et qui les réunit dans une même solidarité ? En d’autres termes, quelle est cette expérience commune qui la rapproche et les fait se reconnaître ?
Vous avez deviné qu’il s’agit de ce mouvement intérieur, provoqué par les événements de la vie eux-mêmes, qui apprend la perte et le détachement avant de rejaillir chaque fois fortifié. Il s’agit de consentement à se séparer de ses rêves et des images construites pour son propre confort, à se laisser bousculer par l’imprévu de la vie. Les mots sont malhabiles à dire la traversée de la souffrance et l’ouverture sur une terre nouvelle : un étonnement de ne pas avoir été submergé, un présent davantage attirant. Référez-vous au « travail de deuil », au sens d’Élisabeth KUBLER-ROSS (2) : un mouvement dynamique d’incorporation de sa propre réalité qui, s’il en a le temps et l’énergie, dépasse la résignation et aboutit à l’acceptation. Il s’agit là, bien sûr, d’un expérience qui dépasse de loin la situation de maladie ou de proximité de la mort, et qui englobe toutes les formes de perte de quelque chose ou de quelqu’un ayant valeur à nos yeux.
Ce que j’appelais tout-à-l‘heure et provisoirement « savoir-être » prend maintenant la figure d’un apprentissage à la perte, qui met en jeu les forces personnelles d’adaptation à des événements imprévus, se présentant souvent sous les traits de la violence. La force potentielle d’un accompagnateur me paraît provenir de la manière dont il a su gérer ses propres deuils et ne pas être écrasé par eux.
La souffrance traversée
Qu’on m’entende bien : je ne veux pas dire que l’accompagnateur va mettre son expérience en discours sur les fruits de la souffrance. J’entends seulement que celui qui a traversé victorieusement l’épreuve (c’est-à-dire qui a réappris à vivre après une perte), ça se voit, ça se sent dans l’attitude : le dedans de l’être est habité. Effectivement, il porte en lui la conviction, apprise de la vie elle-même, que la souffrance ne fait pas mourir ; qu’elle se traverse comme un gué, parfois abrupt ou profond. Ignorant ce qu’est la mort et acceptant de rester dans cette ignorance, il a assez vécu de « petites morts » (selon l’expression bouddhiste) pour sentir qu’il doit être possible d’occuper les derniers espaces de la vie comme un combattant occupe le champ de bataille.
Il me paraît indispensable qu’aux côtés du mourant, l’accompagnateur puisse être habité de cette assurance tranquille que la mort n’est pas une défaite de l’homme ; non pas comme de quelque chose qu’il a appris et qui est bien boulonné dans sa tête, mais comme un merveilleux cadeau qui lui a été offert par l’esprit qui en lui féconde ses successifs renoncements à perdre. Cette vérité-là, elle ne se dit pas à tort et à travers, elle ne se proclame pas au tout-venant ; elle se livre comme un secret, une confidence ; elle se partage comme une joie, avec celui qui peut la comprendre, parce qu’il est prêt à la recevoir. Un secret que l’on se laisse prendre avec joie.
Et je dirais, d’autant plus volontiers qu’il a été éprouvé comme vrai : ce ne sont pas des histoires que je me raconte pour me rassurer, ce n’est pas l’influence durable de la civilisation judéo-chrétienne, ce n’est pas un antidote à ma peur de mourir. Il ne suffit pas de dire : « On juge un arbre à ses fruits » et de parler de paix profonde, de courage à vivre, de bienveillance nouvelle envers les autres… Il me paraît important que cette expérience ait pu passer l’épreuve de la parole : avoir donné à quelqu’un la permission de nous interroger sur cette expérience spirituelle, qui permet de parler de la vie comme d’un don reçu.
Je pose ici clairement la question de l’accompagnement de l’accompagnateur. Les professionnels de la « relation d’aide » s’imposent en général, au cours de leur formation, un certain travail sur eux-mêmes, qui a souvent provoqué mon admiration. À partir de techniques qui peuvent être fort diverses, seuls ou en groupes, généralement avec une composante corporelle, ils ont accepté qu’un regard étranger entre en eux, avec respect et liberté. Les psychanalystes sont tous passés par cette aide d’un autre pour faire la lumière en eux, jusqu’à ce centre qui, seul, les constitue comme sujet d’une parole.
Que l’on me comprenne bien : je ne dis pas « il faut que l’accompagnateur se fasse accompagner » ; je dis : si vous avez eu la chance (ou encore mieux : si vous avez actuellement la chance) d’une relation transparente à laquelle vous donnez votre confiance, si vous donnez à quelqu’un la permission d’entrer dans votre « intérieur » et de réagir librement au paysage qu’il découvre, votre accompagnement sera de plus grande qualité et efficacité que si vos lèvres sont closes de toute parole sur vous. La religion, dans sa grande sagesse, obligeait les chrétiens à s’ouvrir au prêtre, dans la confession, au moins une fois l’an. L’obscurité, l’anonymat, la garantie du secret facilitaient la démarche tout en montrant qu’elle ne va pas de soi et qu’elle a un côté pénible ! J’ai connu un aumônier de collège qui accueillait chaque élève avec un bon sourire et ces mots « dites-bien tout ». Je trouve admirable cette disposition intérieure à pouvoir dire qu’on est prêt à entendre n’importe quoi. Mais on ne peut pas donner ce que l’on n’a pas reçu.
Il est difficile d’accompagner quelqu’un et de lui apporter le soutien attendu, si l’on n’a pas soi-même parcouru une route identique. Il est difficile de savoir « entrer chez » quelqu’un, si nous n’avons pas nous-mêmes laissé entrer. Je retrouve ce fondement sapientiel dans ma propre tradition : un texte du livre de l’Ecclésiaste (que les éditeurs ont intitulé « la mort ») qui dit, au moyen de termes opposés, ce chemin d’humanité à parcourir d’abord pour soi :
« Il y a un temps pour enfanter, et un temps pour mourir,
un temps pour planter et un temps pour arracher le plan.
… Un temps pour embrasser et un temps pour s’abstenir d’embrassements.
Un temps pour chercher et un temps pour perdre ;
un temps pour garder et un temps pour jeter ;
Un temps pour déchirer et un temps pour coudre ;
un temps pour se taire et un temps pour parler,
un temps pour aimer et un temps pour haïr » (3,1-8).
Ces contraires non contradictoires balisent l’espace intérieur à partir duquel un accompagnement efficace devient possible : la prise en compte de deux potentiels, par exemple celui de la parole et celui du silence, qu’il convient de sauvegarder ensemble et dans le mouvement qui les relie l’un à l’autre. Il me semble que l’aide dont l’accompagnateur a besoin est justement la remise en mouvement, en lui, de chaque pôle vers son contraire : attachement et séparation, gain et perte, vie et mort.
De gré ou de force, c’est bien ce même mouvement qui est repris, mais cette fois dans toute sa radicalité, à l’approche de la mort. Un mouvement qui, pour le croyant, a la force d’enjamber la mort : il y a un temps pour se séparer de ses proches, il y a un temps pour se préparer à en rencontrer d’autres, défunts. Il y a un temps pour abandonner le multiple et un temps pour préparer la rencontre avec l’Un. C’est parfois le secret que nous confie la personne qui va passer la mort.
Des moyens pour durer
Il me semble que le souci de maintenir cet « espace intérieur », envers et contre tout, est une condition pour pouvoir durer dans l’accompagnement, lorsque la mort de l’autre est longue à venir. Durer sans épuiser ses réserves personnelles, sans perdre contact avec les richesses de la vie sociale, sans faire peser sur sa propre famille la fatigue accumulée. Ce dernier point aborde une question qui n’est pas propre à l’accompagnement des mourants : ceux qui sont investis personnellement et affectivement dans un service d’aide continue, « paniquent » souvent au constat qu’ils se vident mais qu’ils ne se remplissent pas.
Si nous laissons ouvert cet « espace » qui seul peut nous mettre à distance de notre agir, de notre relation aux autres et au monde extérieur, nous pouvons plus facilement nous connaître, nous aussi, comme être de besoin et entendre à travers notre corps nos besoins du moment ; c’est parfois celui de pouvoir être aidé : parce que quelqu’un compte sur moi et exige beaucoup de moi, j’aimerais bien, moi aussi, me sentir en sécurité dans l’expérience et la compréhension d’un autre. J’aimerais bien : vieux rêve de l’enfance, peut-être, entendre quelqu’un me dire que je fais bien, qu’il est content (qu’elle est contente) de moi, qu’il m’encourage à continuer…
Parole impossible dont il s’agit de faire le deuil, douloureusement : il n’y a personne qui puisse m’apporter cet encouragement-là. Le chemin de l’accompagnement nous engage tôt ou tard dans une vallée de solitude qui, comme toute souffrance, peut être traversée et ouverte sur la plaine d’une expérience intérieure nouvelle et positive : la mise en contact avec une énergie qui se donne et se reçoit comme un centre à partir duquel tout peut se positionner à nouveau. La solitude devient alors le lieu privilégié où se réapproprie un pouvoir d’exister et de se maintenir dans le mouvement de la vie : parler-se taire, bouger-être immobile, agir-contempler, donner-recevoir…
Vous avez compris que c’est ce possible recueillement sur cette dynamique intérieure (qui, en soi, est distincte de l’expérience religieuse au sens où elle est offerte à chaque homme qui consent à rentrer en lui-même), qui donne à l’accompagnement des personnes en fin de vie une dimension nouvelle : la capacité de rejoindre en cet autre qui va « partir » son propre pouvoir-être ou pouvoir-être encore, logé au cœur même de ses peurs, de le reconnaître même s’il est paralysé, hébété ou frappé d’interdit.
Accompagner amène ainsi à un regard de reconnaissance en l’autre de ce « centre » qui donne à son corps, son esprit, et son cœur, maintenant, de pouvoir survivre à la défaite. Mon expérience de soin m’a appris que ceci pourrait se vivre, s’apprécier dans l’extrêmement humble, en ce qu’il est lié aux « choses du corps » les plus élémentaires : que ce soit au plan réel ou symbolique, tout ce qui a quelque chose à voir avec le manger et le boire, le contact, les odeurs, les sens de l’homme. S’il se passe quelque chose dans « l’entre-deux », c’est en fonction de cette capacité d’une communication de centre à centre, dans laquelle l’accompagnateur transmet ce qui se tient en lui dans l’inconnaissable ; ce qui est advenu en lui, dont il ne connaît ni l’origine, ni la logique, ni la destination et qui se fait reconnaître par son aptitude à libérer quelque part une parole.
Lorsque l’accompagnateur ne se sert pas de la parole comme d’un masque (j’emploie ce mot au sens positif de rôle, de fonction) ce qui est non seulement son droit, mais parfois son devoir de protection, lorsqu’il perçoit fort ce qui se passe à l’intérieur de l’autre, qu’il peut témoigner qu’il comprend quelque chose du combat, de cette alchimie mystérieuse qui s’opère dans l’agonie de l’autre, alors il se trouve engagé dans la phase du plus grand respect. Vérité et relation cohabitent dans une grande pureté.
Parce que l’accompagnateur peut dire avec tout son être : « Vous êtes devenu pour moi quelqu’un d’important ». Ceci ne peut pas se dire du bout des lèvres, sous l’impulsion d’un sentimentalisme de passage, en dehors de la douceur d’une relation apprivoisée qui donne aux mots la dimension d’une audace : « tu es vivant », ces trois mots sont l’expression d’une expérience faite à deux.
Conclusion
Le soin palliatif, articulé sur les deux autres soins et ayant besoin d’eux, apparaît à la fin de ce périple comme le couronnement, la clef de voûte qui donne beauté et légèreté à l’ensemble de l’espace ; il laisse sa place à tout ce que l’homme a encore à vivre et à nommer. Il permet que le corps de l’homme, en dernière étape de vie, puisse porter sa souffrance, sa vieillesse et sa mort ; qu’apparaisse sur son visage émacié (et reste parfois quelques heures après le décès) la dimension fragile et mystérieuse de la dignité humaine.
Entre le « je ne peux plus guérir » et le « je ne peux plus rien pour lui », le soin palliatif a cette audace extraordinaire de croire qu’il y a toujours place pour un « il y a quelque chose à vivre ensemble », à reconnaître et à déchiffrer à l’intérieur d’une expérience commune d’attachement et de perte. Il permet au soignant de retrouver l’intention initiale du soin : porter assistance au désir d’autonomie du patient (au sens de cette capacité de donner et redonner sans cesse, pas à pas, un sens à sa propre vie) qui peut se vivre dans la dépendance même.
Le soignant se sait et se veut alors une « force palliative » au service de cette énergie qui habite encore le mourant, dans cette tâche jamais terminée, parfois tardivement commencée, d’accéder à son statut de sujet. J’apprécie qu’il accepte de partager ce souci avec des bénévoles.
L’auteur de cet article est jésuite. Après avoir consacré une partie de sa vie à l’encadrement d’enseignants et à la recherche éducative, il s’est reconverti dans le monde de la Santé, en tant que soignant hospitalier. Il s’est formé aux soins palliatifs au Canada. Il est également membre fondateur d’ALBATROS, association de bénévoles pour la recherche et l’action en soin palliatif. René-Claude Baud est décédé en 2016.
BIBLIOGRAPHIE
-
LINN D. et M. La guérison des souvenirs. (Desclée de Brouwer 1987).
-
KUBLER-ROSS (E). Les derniers instants de la vie (Fides 1975) – Vivre avec la mort et les mourants (Tricorne 1984).
ERNY Pierre. Accompagner les mourants : une très vieille préoccupation. (Le Chant de la Licorne. N° 19).
___________________________________
1 (La tradition religieuse occidentale comprenait la mort effective comme une séparation difficile de l’âme et du corps, prenant quelque temps après l’arrêt du cœur).
2 Le magnifique pouvoir d’adaptation de l’homme, aux circonstances difficiles de la vie, lui permet de ne pas subir sa mort ou de la regarder s’approcher en vaincue.