(Extrait de Les religions. Éd. Marabout 1974)
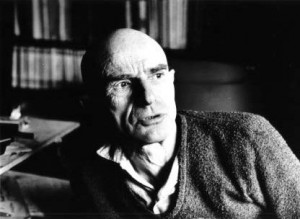
Ce chapitre propose une analyse des phénomènes psychologiques impliqués dans la naissance et le développement des sectes. Il introduit les faits significatifs par le biais de l’anecdote. Il discute les contributions possibles de diverses sciences et suggère quelques directions de recherche.
LE PROSÉLYTE
Paris, un soir d’hiver balayé par le vent et la neige. La porte d’un petit restaurant du quartier Latin s’ouvre, poussée par un marchand de journaux. Je jette un coup d’œil sur la littérature qu’il me tend. Cela s’appelle « Lumière. ». En première page, à gauche, un éditorial, signé d’une étoile ou peut-être d’un soleil, est présenté en ces termes : « Le message de Dieu », avec cette précision : « Homme, Dieu te parle ici, directement. »
J’ai reconnu le journal. C’est le porte-parole de Georges, l’ex-employé des P. et T. de Montfavet qui, depuis le 25 décembre 1950, affirme être Dieu, le Créateur du Ciel et de la Terre. Le journal promet, en haut et à gauche, le « Commentaire divin de l’actualité », et c’est littéralement qu’il faut l’entendre : tous les quinze jours, dans « Lumière ». Dieu en personne explique ce qu’Il pense de l’entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché commun, de la grève des transports, des élections cantonales. Cela irait mieux, écrit-il [1], si vous vous efforciez « de Me connaître afin de croire à partir de Ma Toute-Puissance » (les majuscules sont de Dieu lui-même).
Je lève les yeux sur celui qui me tend les deux journaux divins. C’est un monsieur très convenable, entre deux âges. Son visage n’est ni celui d’un simple d’esprit ni celui d’un fou.
« Jésus est revenu, me dit-il. Lisez et vous croirez. Vous aurez la Lumière. Vous serez sauvé. »
Un homme se dit Dieu ou prophète de Dieu. D’autres hommes le croient et le suivent. Il y a là deux problèmes. Comment en vient-on à se croire investi d’une mission infinie ? Et s’en étant convaincu, comment cette conviction se répand-elle ?
De l’escroc au visionnaire, tous les types d’hommes se retrouvent parmi les sectateurs
Du premier de ces problèmes, commençons par évacuer le cas de l’escroquerie pure et simple. Il existe.
Mais voici un type de Messie qui ne se laisse pas interpréter aussi facilement.
Au début des années 1920, vivait à East Patchogue, dans Long Island (Etat de New York), un certain Albert Reidt, né en 1892 en Allemagne, et qui — l’histoire a de ces coïncidences — exerçait comme un de ses compatriotes, ultérieurement fort connu, l’honorable profession de peintre en bâtiments. Moyen en tout, bon ouvrier, bon voisin, bon époux, bon père de famille, Albert Reidt ne se signale par rien de particulier jusqu’en 1924. Vers cette époque, il commença à exprimer des doutes sur l’avenir. Puis, il se fait plus précis : le monde était condamné. Le monde allait périr. Il périrait au début de 1925. Il périrait très exactement le 6 février 1925.
Désireux d’avertir l’humanité de ce fâcheux événement, Albert Reidt se mit à prêcher. Sur sa vieille auto noire, il peignit deux inscriptions en lettres blanches d’un pied de haut [2]. D’un côté : « Le monde finira dans les flammes », et de l’autre : « Les Epouses de l’Agneau seront les élues ». Il fut bientôt suivi par la foule, et au début de 1925 sa secte comportait un début de hiérarchie, avec la sœur Katherine B. Kennedy et le frère Willard C. Downs. Il n’est pas utile de préciser en quoi consistait cette secte, sauf sur un point : le complet désintéressement de ses adeptes. Reidt, rapporte Roger Delorme, vendit pour une bouchée de pain sa maison, sa voiture, ses meubles et tous ses biens, ne gardant sur lui qu’une chemise, un pantalon, une paire de vieux souliers, et distribua l’argent aux indigents d’East Patchogue. Les siens en firent autant.
La famille Reidt était dans le dénuement total. Les journalistes arrivèrent de New York, décidés à trouver le « truc » commercial de Reidt, l’« astuce » que tout cela cachait. Ils ne trouvèrent rien, car il n’y avait rien. Simplement, l’ouvrier tranquille et raisonnable s’était convaincu que le monde allait finir et il agissait en conséquence.
Le 6 février, une foule immense était à East Patchogue. Le chef de police du district, John Stephani, avait fait garder le prophète par huit hommes armés. Ces policiers virent des scènes extraordinaires. Des hommes en pelisse et Packard offraient des millions à Reidt pour qu’il fasse quelque chose, pour qu’il arrête l’Apocalypse imminente. Rien n’eût empêché le petit peintre de prendre cet argent, de feindre qu’il se laissait fléchir, de déclarer que ses prières allaient écarter le cataclysme. La foule de ceux qui le croyaient était telle qu’il serait sorti de l’affaire multimillionnaire en dollars.
Il refusa tout, répétant tristement que c’était trop tard, que nul ne pouvait rien faire, et que le monde était perdu. Et quand, à minuit cinq, il s’avéra que le monde allait toujours, cahin-caha, son bonhomme de chemin, Reidt fut extrêmement surpris. Sans l’intervention de la police, il eût alors été lynché. Il ne comprit jamais pourquoi le monde n’avait pas péri et annonça encore plusieurs fois au cours des mois suivants que « cette fois, ça y était ». Puis, ne voyant rien venir, il reprit ses pinceaux, et l’on n’entendit plus jamais parler de lui. L’Apocalypse vint, mais par l’effet d’un autre peintre, et vingt ans plus tard.
Le premier mouvement d’un esprit raisonnable est d’expliquer de tels cas par la faiblesse mentale et la psychose contagieuse. Mais s’il suffisait pour comprendre les choses de leur donner un nom, la médecine se serait arrêtée à Diafoirus.
Qu’est-ce qu’une « psychose contagieuse » ? Le psychiatre George Heuyer avait tenté de donner corps à cette notion en 1954 à propos des soucoupes volantes [3]. Son modèle de psychose contagieuse péchait toutefois par une hypothèse que les faits contredisent : le dérangement contagieux, selon lui, se propageait chez les esprits faibles. Il n’en est rien, comme on va le voir, par le cas d’Ummo.
Les soucoupes prophétiques : des hommes se disent venus « d’ailleurs »
Depuis le milieu des années 1960 se développe en Espagne une secte inspirée. (croit-elle) par des êtres venus d’une planète lointaine appelée Ummo. Ces êtres auraient atterri clandestinement sur la Terre, se seraient mêlés à nous, nous étudieraient et adresseraient à des personnes choisies les textes qui servent d’Écriture à la secte. Ces textes sont maintenant fort nombreux et épais. On les reçoit par la poste, soit tapés à la machine, soit laborieusement calligraphiés, soit même sous forme de microfilms. Ils ont été postés de divers lieux improbables, Berlin, l’Australie, le Canada. J’en ai moi-même reçu un certain nombre. D’autres m’ont été communiqués. La masse en ma possession approche du kilo et il doit m’en manquer.
Le physicien, le biologiste, les divers spécialistes des sciences sur lesquelles les verbeux explorateurs d’Ummo font part de leurs réflexions éprouvent à les lire les mêmes sentiments : l’auteur est un homme ou un groupe fort instruit, intelligent et habile.
Cependant, il y a quelques erreurs très grossières. Par exemple la langue supposée d’Ummo, n’ayant pas été inventée par un linguiste, se trouve être de structure indo-européenne [4].
L’affaire d’Ummo est obscure par plus d’un point et s’apparente à celle d’Urantia. La Cosmogonie d’Urantia est un énorme livre anonyme dont la traduction française (l’original est de langue anglaise) circule sous forme polycopiée. Il est censé décrire une civilisation extraterrestre. L’auteur d’Ummo est beaucoup plus habile et dispose de plus de moyens. Elle suppose des moyens matériels non négligeables et un personnel très dispersé, ou itinérant. Il n’est pas impossible que des Services de renseignements y soient mêlés, ou même l’aient montée de toutes pièces dans un but qui échappe à l’entendement. Quoi qu’il en soit — et c’est le point qui nous intéresse —, Ummo a donné lieu à une secte.
Et malgré les contradictions internes exhibées par les textes ses adeptes se recrutent dans des groupes qui ne répondent en rien au portrait du faible d’esprit tracé par Heuyer, y compris chez des gens occupés professionnellement à démasquer les imposteurs et les escrocs, ou à lutter contre les sectes : les policiers et les ecclésiastiques.
Un autre exemple de ce paradoxe est la secte des adamskistes. George Adamski (1891-1965) se fit une célébrité en affirmant, le 20 novembre 1952, avoir rencontré un homme venu de Vénus en soucoupe volante. Par la suite, ses amis de l’espace lui offrirent maints voyages sur la Lune et les planètes de notre système solaire, lui faisant à cette occasion force révélations, le plus souvent de nature « spirituelle » et du niveau : « Soyez bons et évitez le mal [5]. »
J’ai été invité un jour à une réunion exceptionnellement solennelle de la secte dans un riche appartement d’un quartier résidentiel de Paris. On nous avait promis une surprise. La cérémonie commença par la lecture de quelques pages du Maître. On se montra des autographes, ou leur photocopie. Puis on nous annonça solennellement que deux Extraterrestres étaient dans le salon voisin et qu’ils feraient leur entrée « quand ils le jugeraient utile ». On fit silence. Les mains se tordaient dans l’assistance, les cœurs tremblaient, les yeux dévoraient la porte du salon. Enfin, celle-ci s’ouvrit et nous vîmes entrer deux hommes de type oriental, indien ou pakistanais, vêtus avec une recherche un peu excessive, bagués, parfumés, calamistrés, authentiques guru de bazar. Ils nous considérèrent longuement les uns après les autres en silence, d’un air pénétré, tandis que les têtes se baissaient avec recueillement. Puis l’un d’eux annonça en anglais que, pour honorer Paris, ils consentaient à nous consacrer quelques heures de leur temps infiniment précieux. Sur quoi, ils se dirigèrent sans un mot de plus vers la table où un dîner somptueux nous attendait et mangèrent de fort bon appétit. En tenant leur couvert à l’anglaise.
Les deux messagers de l’espace ressemblaient comme des frères au premier escroc venu. On en eût trouvé de plus habiles à la première audience du plus proche tribunal. Et pourtant, parmi leurs fidèles, il y avait entre autres un avocat célèbre et un non moins célèbre acteur de la Comédie-Française. L’avocat fréquentait tous les jours des escrocs plus doués, sans s’en laisser conter. Si le comédien s’était mêlé de jouer les messagers de l’espace, il eût fait cent fois mieux. L’un et l’autre n’en croyaient pas moins aux hommes de Vénus. Faiblesse d’esprit ? Il faut trouver autre chose.
JOSEPH SMITH ET LES MORMONS
L’histoire des mormons [6] nous aidera à pénétrer un peu plus avant dans la psychologie des fondateurs de sectes et de leurs premiers fidèles.
L’« Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours » (c’est le nom que se donne l’Église mormone) est sortie des visions de Joseph Smith (1805-1844). Né dans la région du lac Ontario, au sein d’une pieuse famille de colons méthodistes, Joseph grandit dans la fréquentation et le respect de la Bible, mais aussi parmi les rivalités des diverses obédiences protestantes. Il était d’un naturel doux, docile, et ne se signalait par aucun don intellectuel particulier. On l’appelait même gentiment dans sa famille « l’illettré ». Tout le monde l’aimait.
Un « illettré » se met à enseigner
A quatorze ans, rapporte-t-il, et « alors que j’étais tourmenté par les difficultés nées des disputes des zélateurs religieux, je lus un jour l’Épître de Jacques et tombai sur le verset 5 du chapitre IV : « Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Jamais ce passage de l’Écriture ne toucha le cœur d’un homme comme celui-là le mien. J’y pensai intensément, sachant que si quelqu’un avait besoin de la sagesse divine, c’était moi. Aussi, décidant de demander à Dieu la Sagesse, j’allai dans un bois pour prier. C’était le matin d’une belle journée du printemps 1820. C’était la première fois que je tentais une chose pareille, car de ma vie je n’avais essayé de prier à haute voix. A peine avais-je commencé que je fus saisi par une puissance qui me domina entièrement et me bouleversa si fortement que ma langue fut liée, de sorte que je ne pouvais plus parler. D’épaisses ténèbres m’environnèrent et je me crus condamné à une destruction soudaine. A cet instant de grande alarme, je vis juste au-dessus de ma tête une colonne de lumière, plus brillante que le soleil, descendre lentement sur moi. Quand elle se posa sur moi, je vis deux personnages dont l’éclat et la gloire défient toute description. L’un d’eux me parla, m’appelant par mon nom et dit, me montrant l’autre : « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le ! » [7] »
Joseph parla de sa vision. On se moqua de lui, il n’insista pas et n’eut plus de visions pendant plusieurs années.
Alors qu’il avait dix-sept ans et se trouvait dans sa chambre, un visiteur entra, l’appela par son nom et, déclarant s’appeler Moroni, lui dit qu’il était envoyé par Dieu pour le charger d’une mission. Quatre ans plus tard, en 1827, le même ange lui ordonna de fouiller près du sommet du mont Cumorah pour y déterrer des plaques d’or enterrées là par l’ange lui-même quatorze siècles plus tôt. Ces plaques d’or, à en croire Joseph Smith, relataient en « égyptien réformé » l’exode de la tribu israélite de Léhi à travers l’océan jusqu’en Amérique (vers 600 av. J.-C.), et les aventures de ses descendants. De Léhi étaient sortis deux peuples, les Lamanites et les Néphites, qui ne cessèrent de se disputer la suprématie jusqu’à ce que les Néphites fussent anéantis par leurs rivaux en 421 après J.-C. Jésus ressuscité était venu annoncer l’Évangile aux fils de Léhi, qui l’avaient gardé plus fidèlement que l’Ancien Monde, si bien que le véritable, l’authentique Évangile, c’est dans le livre de Mormon, dans les plaques d’or, qu’il fallait le chercher. Notons qu’à cette date Joseph Smith avait vingt-deux ans. Avec l’aide de Moroni, il entreprit de « traduire » le livre de Mormon. En fait, la « traduction » s’opérait ainsi : Joseph Smith était seul derrière un rideau car nul ne pouvait voir les plaques sans mourir, et dictait le texte anglais à un paysan quasi illettré, Martin Harris. En juin 1829, Joseph déclara que la traduction était achevée et on se mit en quête d’un imprimeur.
Un livre étrange
Le prophète avait alors vingt-quatre ans, et c’est ce qu’il faut se rappeler quand on lit l’énorme « Livre de Mormon » : en volume, il équivaut à tout le Nouveau Testament, y compris les Actes et l’Apocalypse, plus les deux premiers livres de l’Ancien Testament, « la Genèse. » et « l’Exode ». Les épisodes, les personnages, les noms de lieux y sont innombrables, comme aussi les visions, les symboles, les discours, les admonestations, les prophéties, les cantiques. Le style en est souvent plein de grandeur [8]. Mais au-delà de la performance littéraire, le mythe de Léhi résout avec une surprenante ingéniosité toutes les contradictions de l’Amérique en gestation. Il légitime la présence de l’Europe chrétienne sur le Nouveau Continent, puisque les fils de Léhi furent eux-mêmes chrétiens. Cette légitimité n’est pas pour autant affirmée aux dépens des Indiens, puisque ceux-ci sont les seuls descendants directs de Lehi, premier possesseur de la terre américaine, et qu’il faut donc les respecter. C’est en vertu de ce verset que furent excommuniés les coupables de l’unique massacre d’Indiens dont se soient jamais rendus responsables quelques mormons au moment de la ruée vers l’Ouest. Les rapports des mormons avec les Indiens furent toujours bons dans leur État de l’Utah, au point que le gouvernement central s’adressa plusieurs fois à eux pour régler des querelles. Maintenant encore les mormons luttent pour l’égalité des Indiens qui occupent une place honorable dans leurs écoles, leurs universités, et même dans les familles mormones. Souvent, elles se font un devoir d’adopter de petits orphelins indiens qu’ils élèvent comme leurs enfants [9]. L’intérêt des mormons pour leurs frères « lamites » s’étend du reste à tous les Amérindiens. Depuis 1964, des écoles mormones enseignent les Indiens du Chili. Il est certain que le destin des Indiens d’Amérique du Nord eût été différent si leur sort avait été réglé selon les idées exposées par Joseph Smith dès l’âge de 22 ans, bien avant la ruée vers l’Ouest.
En ce qui concerne les Noirs, également, « le Livre de Mormon » rappelle fermement l’interdiction de l’esclavage [10], et ce, rappelons-le, quarante ans avant la guerre de Sécession.
Le père Chéry en prend à son aise avec le petit « illettré » Joseph Smith, son ange Moroni et ses plaques d’or [11]. Il explique la réussite des mormons par l’« insondable crédulité des foules » et la « naïveté américaine ». Ce sont là des propos imprudents. Deux faits, dans l’histoire des mormons, doivent encore retenir l’attention de quiconque s’interroge sur la genèse du phénomène des sectes et sur sa signification psychologique et historique. C’est d’abord la fin du prophète, qui fut lynché à l’âge de 39 ans par une foule plus ou moins téléguidée. Joseph aurait pu échapper à ses ennemis. Il partit même une nuit pour la Californie en compagnie de quatre fidèles. Mais il changea d’idée et revint se livrer au gouverneur Thomas Ford pour ne pas abandonner les mormons de la ville. Joseph Smith fut donc le « témoin qui se fait égorger » de sa propre doctrine, quelque conclusion que l’on doive tirer de là. Le deuxième fait est la spiritualité mormone, spiritualité surprenante pour un Européen par son mélange de rigueur et de réalisme. L’intégrité mormone est légendaire. Le mormon est un homme pieux, plus respectueux peut-être que quiconque des règles que lui impose sa religion. J’ai appris que le biologiste américain Frank B. Salisbury [12] était mormon en lui demandant pourquoi il refusait l’excellent Traminer que je voulais verser dans son verre : les mormons ne boivent pas d’alcool. Car le livre du petit « illettré » de vingt-deux ans inspire encore la vie et la méditation d’une foule d’esprits éminents.
LES PARADOXES DE LA SECTE
Pour tout autre que l’adepte, la secte est absurde. Elle est absurde par son origine, par sa réussite, et souvent par sa doctrine. Son absurdité apparente fait généralement suspecter soit la sincérité, soit le bon sens du fondateur : il faut, dit-on, qu’il ait été un illuminé ou un escroc, ou les deux.
Le succès d’une secte n’a rien à voir avec ce qu’il est convenu d’appeler le bon sens. En d’autres termes, ce qui choque le profane ne choque pas l’adepte, quel que soit d’ailleurs le niveau intellectuel de ce dernier.
Si l’on consulte la liste des mormons convaincus répandus dans le monde des affaires et de la finance, on doit convenir que la foi à l’inspiration divine d’un Joseph Smith n’est pas forcément synonyme de candeur. Le mécène lyonnais qui, dit-on, finança jusqu’à sa mort la secte de Montfavet n’était probablement pas, lui non plus, tombé de la dernière pluie. Les faiseurs de théories sur la jobardise des prosélytes eussent sans doute éprouvé des difficultés s’ils avaient essayé de lui extorquer son argent. Et pourtant, cet argent, il le donna de bon cœur jusqu’à sa mort pour une entreprise que le profane juge aberrante.
Le fondateur et ses disciples immédiats jouent un rôle déterminant
Toute secte commence petitement, comme l’avalanche. A l’origine, il peut y avoir un groupe restreint d’hommes tout à fait normaux (si ce mot a un sens) que les circonstances placent dans une situation exceptionnelle. En voici un exemple. Le 18 octobre 1685, Louis XIV signe la révocation de l’édit de Nantes, condamnant les protestants de France à abjurer ou à partir. Les suites de cet acte politique sont variées dans les diverses provinces.
Le drame des camisards
Dans les Cévennes, les huguenots sont de pauvres paysans très attachés à leur sol, ne parlant que l’occitan et épouvantés par l’idée d’exil. Le 24 juillet 1702, au Pont-de-Montvert, en Lozère, ils abattent l’abbé du Chayla, qui torturait les calvinistes. Ce meurtre aggrave la répression, qui provoque le soulèvement : c’est l’aventure des camisards. Cette aventure durera jusqu’en 1713.
Le pouvoir royal l’emporte, les survivants s’exilent. Une partie d’entre eux, à la suite de leur chef, Jean Cavalier, débarque en Angleterre. L’exemple de ces hommes et de ces femmes indomptables exerce une vive influence chez les protestants anglais. Un demi-siècle plus tard, à Manchester, cette influence commence à se cristalliser en pratiques et croyances particulières. Quand les adeptes se réunissent, un certain nombre d’entre eux, particulièrement exaltés, tombent en transe [13] et se mettent à prophétiser. Ils annoncent le prochain retour du Christ et l’urgence du repentir. Les transes sont précédées de convulsions, comme chez les sectateurs français du diacre janséniste. Paris quelques années plus tôt. Et comme les Parisiens avaient donné le nom de « convulsionnaires de saint Médard » aux fidèles du diacre, les Anglais appellent shakers (secoueurs, trembleurs) les exaltés de Manchester.
Une femme toute simple
Jusque-là, le phénomène est collectif, flou, itinérant. Les shakers ne sont encore rien de précis, mode plutôt que secte. C’est alors qu’apparaît le personnage du fondateur. C’est une femme du peuple, Ann Lee. Elle a été mariée. Elle a eu quatre enfants, tous mort-nés. Cette épreuve endurée dans la solitude, sans le recours d’aucune réflexion que la sienne (Ann Lee ne sait pas lire), va peu à peu lui révéler la Vérité. Et en même temps que la Vérité, le sens de sa mission, qui sera de la révéler au monde.
Quelle est la Vérité d’Ann Lee ? Elle est très simple, comme toutes les idées-forces ; les rapports sexuels sont le péché par excellence. L’homme et la femme doivent vivre dans le célibat. Et comme le célibat universel aboutit à l’extinction de la race humaine, le corollaire de la vérité découverte par Ann Lee est que la fin du monde est proche.
D’une expérience personnelle traumatisante et profondément vécue, elle tira un système promis, dans son esprit, à l’universalité. Bu jusqu’à la lie, son désespoir de mère frustrée la convainquit d’avoir touché, de l’intérieur, une vérité universelle. Et il faut que sa conviction ait été bien forte pour avoir entraîné tant d’hommes et tant de femmes à choisir de vivre une doctrine si contraire à la nature et pour avoir pu se transmettre à travers eux jusqu’à nous pendant les deux siècles les plus mouvementés et les plus destructeurs de l’histoire.
Ann Lee ne fut pourtant ni la première ni la dernière femme de caractère et d’intelligence à avoir été torturée dans son instinct maternel. Pourquoi son cas personnel se sublima-t-il en une doctrine ? Les psychologues et psychiatres devraient examiner si, en fait, il n’en est pas toujours ainsi, du moins quand la crise morale née de l’épreuve est surmontée. N’y a-t-il pas dans l’expérience vécue par Ann Lee et dans sa façon de la résoudre quelque chose de très semblable à ce que les théoriciens de l’antipsychiatrie [14] reconnaissent dans la schizophrénie ?
Nous n’avons aucun témoignage sur un épisode schizophrénique supposé dans les débuts de la carrière d’Ann Lee. Nous savons seulement que les premières manifestations de sa secte furent si désordonnées que la justice s’en mêla [15]. Nous savons aussi, et cela est très important, que son audience ne se limita nullement à des faibles d’esprit ou à des illuminés.
Dans leurs communautés, les shakers firent preuve d’un sens de l’organisation remarquable et d’un véritable génie inventif. Il semble, par exemple, que nous leur soyons redevables des premières machines à laver, ce qui, on l’avouera, constitue une singulière conclusion à la tragédie des camisards.
Wesley, ou la raison matée
Pour mettre en évidence les constantes d’un phénomène, la méthode expérimentale préconise d’en faire varier les conditions. Après celle d’une pauvre femme sans culture comme Ann Lee, voici l’histoire d’un homme de génie, bourgeois cultivé, grand orateur, qui, lui aussi, fonda une secte, dans le même pays et à la même époque : John Wesley, l’inspirateur des quelque 25 ou 30 millions de méthodistes actuellement vivants.
Le père de Wesley, recteur d’Epworth, lui donne, ainsi qu’à son frère Charles, une excellente éducation. Né en 1703, John fait un premier séjour à l’université d’Oxford où il se prépare à succéder à son père. Il vient ensuite passer deux ans près de celui-ci, éprouve des doutes sur sa vocation, décide de se consacrer à l’enseignement et retourne à Oxford en 1729. Avec son frère et quelques amis, il fonde alors une sorte de club où l’on discute de science et de religion. Il devient quand même pasteur, se met à prêcher et à voyager. Il va notamment en Amérique visiter la nouvelle colonie anglaise de Géorgie, constate qu’il n’y a nulle chaleur dans ce qu’il fait ou dit, que tout est vain, et rentre en Angleterre très abattu.
En 1738, au cours d’une réunion à Aldersgate Street, il entend le sermon d’un frère morave. Il est alors, comme il le raconte dans son journal, en pleine crise de dépression, ainsi que son frère Charles, qui, de surcroît, relève d’une pleurésie.
Les deux hommes, qui ont fait ensemble le voyage en Amérique, sont découragés et désorientés. Comme Ann Lee après sa quatrième fausse couche, ils doivent faire face à l’échec de ce qui leur tenait le plus à cœur : la conversion de leurs contemporains par la piété, la science et la raison.
Le soir du sermon d’Aldersgate Street, John est seul. Soudain, rapporte-t-il, « mon cœur se réchauffa étrangement ». En un éclair, il comprend tout, il touche la vérité universelle dont la privation l’avait jusqu’alors égaré : c’est la foi et la foi seule qui sauve. La science, la raison, la vertu ne sont rien sans l’expérience foudroyante de la foi. Et cette foi, il l’a. Elle le bouleverse si profondément qu’il court chez son frère, se met à lui parler et le convertit exactement comme il vient d’être converti par le frère morave ! « Donner la place prépondérante à la foi, non aux actes, remarque le psychiatre anglais William Sargant [16], entraîna le revirement total de leur conception religieuse, ce qui représente un changement aussi radical que, de nos jours, le passage du conservatisme au communisme. »
En même temps que le rôle de la foi, John Wesley avait compris comment on la trouve, et par conséquent comment on la donne. Le frère morave avait « échauffé son âme ». Il faut donc échauffer l’âme. Dès cet instant, Wesley ne cesse de perfectionner ses méthodes d’apostolat et l’on ne découvre pas sans surprise que cette recherche l’amena à réinventer celles d’un autre convertisseur de génie, Ignace de Loyola, fondateur de la Société de Jésus. Wesley note, dans son journal, le 20 décembre 1751 : « Voici la méthode de prédication que je crois être la bonne. Au début du sermon, après avoir rappelé dans les grandes lignes que Dieu aime les pécheurs et qu’il est disposé à les sauver, il faut prêcher sur la loi de la façon la plus vigoureuse, la plus complète, la plus détaillée possible. A mesure qu’augmentera le nombre de ceux qui découvrent leur état de pécheurs, on incorporera de plus en plus d’Evangile, afin de faire naître la foi et d’amener à la vie spirituelle ceux que la pensée de la loi aura frappés. »
La « conversion » ressemble à un phénomène de catalyse
Certains témoins ont rapporté les effets de cette méthode pratiquée par un homme aussi éloquent et convaincu que l’était Wesley.
Le converti était toujours saisi d’une émotion irrésistible [17]. Il se mettait à trembler, à pâlir. Souvent, il tombait sans connaissance. Alors, l’émotion devenant contagieuse, les conversions spectaculaires se succédaient dans une atmosphère mêlée de terreur et d’enthousiasme. Wesley lui-même, ne voyant aucune explication à ces incidents, les attribuait à l’action de l’Esprit saint victorieux du diable. Il en était aussi impressionné que ses auditeurs.
Tandis que je parlais, un homme devant moi s’effondra comme mort, puis un second, puis un troisième. En une demi-heure, il y en eut cinq autres, presque tous pris d’atroces douleurs. Leurs souffrances étaient pareilles à celles de l’enfer… Tandis qu’ils se trouvaient dans cette détresse, nous invoquâmes le Seigneur, et il répondit par un message de paix. »
L’action diabolique s’exerce diversement pendant les sermons de Wesley. Parfois, le Malin tourmente ceux qui s’apprêtent à recevoir la grâce. Ecoutons encore Wesley : « Vers 10 heures du matin, J.C… (une femme), qui était assise à son travail, fut soudain prise en son âme de frayeurs terribles accompagnées de violents tremblements. Cela dura tout l’après-midi, ruais le soir, à la réunion, Dieu changea son oppression en joie. Ce jour-là, cinq ou six autres personnes atteintes elles aussi jusqu’au fond du cœur trouvèrent bientôt Celui qui guérit ; il en fut de même d’une femme qui depuis des mois se trouvait dans l’affliction sans personne pour la consoler. »
Je crois que les phrases soulignées expriment l’essence des rapports unissant le prophète au converti. Le converti est un être déchiré par la souffrance morale et plongé dans un état d’incertitude intérieure qu’aucune lumière ne vient éclairer. Souvent cette souffrance morale retentit sur le corps, qui souffre lui aussi (nous examinerons plus loin les expériences de neurophysiologie qui peuvent être rapprochées de ces observations). La parole du prophète surgit dans son âme comme le grain de cristal dans un liquide en surfusion. En introduisant un modèle d’ordre dans le chaos, elle précipite l’organisation du chaos. Soudain, ce qui est en bas devient comme ce qui est en haut, tout prend un sens, et les ténèbres deviennent lumière, deux mots très employés dans les sectes naissantes.
A force d’assister à ce même spectacle, Wesley, dont il ne faut pas oublier la formation scientifique, en vint à admettre une sorte de symptomatologie de la conversion. Il alla jusqu’à la tester statistiquement. « Rien qu’à Londres, dit-il, j’ai trouvé 652 membres de notre Société… dont le témoignage est au-dessus de tout soupçon. Chacun, sans exception affirme que sa délivrance du péché fut instantanée, que la transformation ne demanda qu’un moment. »
Un bouleversement suffit : la « conversion » n’est pas un désordre mental
La conversion instantanée est une péripétie essentielle de la vie des sectes, et surtout de leur propagation initiale. Elle a ses aspects cliniques dont nous parlerons plus loin. Mais l’historien et le psychologue y trouvent peut-être une réponse à la question que nous posions plus haut : pourquoi y a-t-il toujours des esprits d’une grande intelligence parmi les adeptes, quelque absurde que cette adhésion paraisse au profane ?
C’est qu’une adhésion accordée en un éclair relève forcément d’une démarche qui ne doit rien à la raison. La raison procède, pas à pas, par le lent exercice du doute et de la critique. L’exemple personnel de Wesley est, à cet égard, très significatif. Cet homme supérieur, élevé à Oxford dans l’esprit empirique et sceptique du génie anglais, constate d’abord l’échec de son système dans le domaine religieux. Nous l’avons vu alors troublé, abattu, désespéré. Soudain, alors qu’il écoute le frère morave, quelque chose d’immense s’éveille en lui, « son âme s’échauffe », ses mécanismes mentaux s’effondrent, la loi le transporte. Il comprend tout. La lumière l’inonde. Cette lumière n’est pas celle de la raison, elle la transcende infiniment. La raison ne fera que suivre. La raison réfléchira sur l’expérience de la conversion, elle la justifiera au besoin par son discours. Mais l’âme elle-même n’a pas besoin de ce discours.
La critique rationaliste prend argument de cette absence de la raison pour rejeter la conversion parmi les désordres de la pensée [18]. Cette position implique une pétition de principe. Elle tient pour acquis ce qu’il faudrait démontrer, à savoir qu’il n’existe aucune expérience de la pensée qui puisse transcender la démarche rationnelle.
Autant dire que la Chine n’existe pas quand on a fait le tour de France sans trouver Pékin. Si l’expérience de la conversion soudaine est telle que la décrivent ceux qui la vivent, dire qu’elle n’est pas rationnelle ne nous apprend rien. Il faudrait, pour en parler utilement, avoir un moyen de décider d’abord si ce qui se fait sans la raison se fait forcément contre elle, c’est-à-dire de savoir si oui ou non la Chine existe. Si visiter la France à la loupe et n’y pas trouver Pékin ne prouve pas l’inexistence de la Chine, décrire une ville imaginaire ne prouve pas davantage son existence. Certains critiques rationalistes, plus subtils [19], marquent ici un point. « Loin de nous, disent-ils en substance, l’idée de nier l’existence de la Chine. Simplement, comme nous ne savons pas, nous demandons des preuves. Dans l’incertitude où nous laisse l’absence de preuve, nous préférons suspendre notre jugement plutôt qu’adhérer à ce qui n’est peut-être qu’une illusion. »
Cette prudence nous paraît légitime et raisonnable. Seulement, l’observation des faits nous oblige complémentairement à constater que des esprits tout aussi respectables que ces critiques sont convaincus d’avoir visité la Chine. Cette conviction est pour eux une donnée expérimentale. Wesley, rationaliste à la manière anglaise jusqu’au sermon d’Aldersgate Street, éprouve soudain, en écoutant le frère morave, une certitude qui ne lui laisse rien à désirer, même du point de vue de la raison, qui reste intacte chez lui comme le prouve son audacieuse idée de mettre en statistique le syndrome de la conversion.
L’irruption soudaine de la foi se concilie chez le converti avec l’exercice de la raison critique : voilà une constatation qu’il est tout à fait vain de contester. Et le profane a beau objecter au converti que la certitude de sa foi contredit la foi des autres, il n’en est pas gêné, car ce qu’il sait, il le sait d’expérience directe. Comment le voyageur qui arrive de Pékin prendrait-il au sérieux le raisonneur obstiné à lui démontrer que la Chine n’existe pas ?
Comment on devient Dieu
Si l’on remonte aux sources les plus lointaines d’une secte, on aboutit toujours à la conversion du fondateur, et, au-delà, à la période de trouble, d’angoisse et de recherche dont la conversion soudaine constitue l’épisode terminal.
Le livre du père Chéry [20] contient un document remarquable de ce point de vue : c’est le récit, fait par un de ses collègues, de la conversion de Georges Roux, le dieu de Montfavet. Ce témoin voyait chaque jour Georges Roux à son travail. Avant la conversion, Georges, dit-il, était un homme sérieux, sensé, intelligent, ponctuel, très juste, tolérant, gai, affable, toujours égal et souriant, mais sans platitude, jamais malade, infatigable ». Sa vie était régulière, il ne fumait ni ne buvait. Bref, apparemment, le futur dieu était un homme équilibré. D’où naquit le trouble annonciateur, c’est ce que l’on ignore.
« Il restait toujours aussi bon collègue que naguère, mais souvent devenait lointain, comme perdu dans un rêve. Puis il devint nerveux et méfiant, susceptible même. Dès la fin de 1952, il commença de se croire persécuté […]. Enfin, dès les premières semaines de 1953, il affirma être une réincarnation du Christ […]. Dans la nuit du 24 au 25 décembre 1953, à minuit, au milieu de sa vacation, il se leva, plus grave que jamais et… déclara que sa mission sur cette Terre était terminée à l’heure même […]. Il fit ses adieux, dignement, mais aimablement, aux employés présents, et disparut [21]. »
A lire ce texte, on est tenté de conclure, sans chercher davantage, au dérangement cérébral. Et ayant admis la folie de Georges, de la généraliser à Wesley, et de là, de proche en proche, à Pascal même et à tous les convertis. Car il est vrai que l’on peut trouver tous les intermédiaires entre Georges Roux, employé des postes, et Blaise Pascal, l’« effrayant génie ». Ce qui est plutôt embarrassant, car qui sommes-nous pour déclarer fou l’auteur des « Pensées » ?
Nous proposerons plus loin une hypothèse moins téméraire. Constatons pour l’instant que le chemin spirituel suivi par tous les convertis traverse une période de trouble et de souffrance, à laquelle la conversion met un terme par la refonte totale de l’être. Par conséquent, le premier converti ne manquera pas de provoquer des conversions en chaîne s’il trouve autour de lui des êtres travaillés par le même tourment et s’il est capable de leur faire vivre l’expérience qui la guéri. On le voit avec Wesley, qui court chez son frère Charles et, d’un trait, lui révèle la « lumière ». On le voit avec Georges Roux, qui convertit toute sa famille, y compris sa vieille mère, jusque-là pieuse catholique. Ses six enfants, ses gendres, ses brus croient fanatiquement à sa divinité. Ne nous demandons pas une fois de plus comment des personnes d’intelligence et de caractère partageant l’intimité d’un homme peuvent croire à sa divinité ; c’est cela même qui constitue le phénomène que nous étudions ici. Il n’y aurait pas de sectes si ce phénomène ne pouvait se produire dans l’âme humaine, dans toutes les âmes humaines, y compris les plus hautes.
Le pacifisme essénien
L’examen de toutes les sectes qui ont réussi montre toujours que la doctrine proposée résout un traumatisme propre à l’époque et au lieu où elle naît. Nous l’avons vu avec des sectes aussi différentes que les shakers et les mormons. Choisissons encore une illustration, celle des esséniens.
Leur originalité dut paraître aussi surprenante aux juifs nourris de la Bible qu’à nous celle des castrats ou des hippies.
Qu’enseignait en effet la Loi mosaïque ? Une morale sévère, mais impitoyable : ne pas pécher, ne pas jurer, ne pas voler, ne pas convoiter la femme du voisin, adorer Dieu et Lui seul, mais tout cela pour vivre longuement, posséder les biens de la terre, faire de nombreux enfants, chasser les peuples devant soi et les exterminer quand ils résistent.
Et qu’enseigne le Maître de Justice ? Ecoutons Philon : « On chercherait en vain chez eux quelque fabricant de javelots, casques, glaives, cuirasses, boucliers, en un mot d’armes ou de machines militaires, ou même d’objets pacifiques qui pourraient être tournés au mal. »
Ils sont donc absolument résolument pacifistes. Quand les Romains les massacreront, ils ne se défendront pas. C’est ce dont témoigne Flavius Josèphe (37-97) : la Guerre des juifs, 2, 8, 10.
Quant aux joies de ce monde, ils vivent « sans femme et sans amour », et leur secte, dit Pline, est une « gens in qua nemo nascitur », « un peuple où nul ne naît », qui ne se renouvelle que par l’afflux des conversions [22].
Contrairement aux juifs traditionnels, ils croient à la survie, tiennent le corps pour une guenille et l’au-delà, non la Terre, pour la Terre promise. Bref, ils sont à peu près en tout aussi opposés qu’il est possible à la loi juive primitive. Hasard ? Non pas ! La loi de Moïse est faite pour un peuple conquérant et « sûr de lui ». Les esséniens surviennent à un moment où ce peuple boit jusqu’à la lie les humiliations de l’histoire. Après des siècles de gloire, il a perdu sa liberté et paie tribut à des étrangers. Son âme est saisie de vertige devant le prestige intellectuel de l’hellénisme. Il ne lui reste rien que son cou raide et son Dieu. Mais ce Dieu lui-même semble l’avoir abandonné, d’où le désespoir, l’angoisse, la révolte. La révolte s’avère condamnée à l’échec.
La doctrine du Maître de justice est exactement celle qu’il faut alors au peuple juif pour supprimer son angoisse en résolvant les contradictions d’où elle naît. Patience, dit-il en effet, ce monde n’est pas le vrai monde des Fils de Lumière. C’est celui des maudits et des perdus. Qu’importe, par conséquent, que vous y soyez les derniers ? « Dans la main du Prince des Lumières est l’empire sur tous les Fils de Justice… et dans les mains de l’Ange des Ténèbres est l’empire sur les Fils de Perversion [23]. » Les premiers auront la « joie éternelle dans la vie éternelle, la couronne glorieuse, le vêtement d’honneur dans l’éternelle lumière », les autres seront jetés dans l’« abîme éternel », dans l’« effroi éternel et la honte sans fin, dans l’opprobre de l’extermination par le feu ».
INSUFFISANCE DE L’EXPLICATION HISTORIQUE
Ces constatations ont conduit certains esprits à interpréter l’essénisme, les sectes en général, et même les grandes religions comme des sous-produits de l’histoire, des épiphénomènes subjectifs traduisant en mythes les seules vraies réalités qui seraient celles de l’économie et des rapports de forces matériels. La discussion de cette thèse est une vaste entreprise. Bornons-nous à noter qu’elle relève d’une attitude psychologique très productive dans tous les domaines où s’exerce la réflexion contemporaine. C’est elle, par exemple, qui inspire les thèses métaphysiques d’un Monod [24]. Mais nous pouvons admettre que les sectes naissent des circonstances historiques sans les réduire pour autant à de pures traductions mythologiques. A ce compte le sucre de betterave, né du blocus continental, serait un mythe. Et aussi l’ordinateur, inventé pour résoudre les problèmes de la première bombe atomique, et d’ailleurs la bombe elle-même. Les infinis hasards de l’histoire obligent l’homme à se déchiffrer peu à peu. De ce qu’il est enfant du hasard, s’ensuit-il qu’il n’existe pas ?
Quand nous aurons prouvé que les fondateurs de l’essénisme ont substitué un judaïsme de renoncement, de pauvreté et de salut éternel au judaïsme triomphant de la conquête parce que, précisément, les juifs hellénistiques n’en étaient plus à conquérir et à posséder, mais à être dépossédés, à se multiplier, mais à péricliter misérablement, il faudra encore décider s’il est plus conforme à la vérité de l’homme de chercher son salut dans ce monde ou dans l’autre, dans la conquête ou dans le renoncement, dans la multiplication des êtres ou dans l’accomplissement d’un petit nombre. Qu’un seul de ces choix soit le bon et qu’il exclut l’autre, peut-être. Mais il faudra, pour dire lequel, voir au-delà de leur naissance historique, puisque tous deux sont également nés de l’histoire.
La secte naît-elle toujours d’une Église ?
Sans doute le lecteur aura-t-il pensé plus d’une fois en lisant les pages qui précèdent que, faute d’une définition de la secte permettant de distinguer l’essence de celles des grandes religions, notre analyse se développe de plus en plus dangereusement sur le fil d’un rasoir.
Si, en effet, nous admettons l’authenticité intérieure de l’expérience vécue par le fondateur (la part ayant été faite, bien entendu, à quelques charlatans), si nous admettons la sincérité des apôtres et des convertis, ainsi que la possibilité de leur équilibre intellectuel et moral, alors qu’est-ce au juste qui les distingue d’un Bouddha, d’un saint Paul, d’un Luther, d’un Mahomet, et, pourquoi pas, d’un Jésus ? Et en quoi une grande religion diffère-t-elle d’une secte qui aurait réussi mieux que les autres ? Loin d’éviter le danger, nous allons l’affronter en examinant les rapports des sectes avec les grandes religions.
Ces rapports ont été maintes fois discutés et définis. Pour beaucoup d’érudits, la secte ne peut même se définir que par rapport à la religion dont elle procéderait. Cette façon de voir ne laisse évidemment aucune place aux sectes comme Ummo, Urantia, les Invisibles, et autres qui ignorent les religions existantes.
Pour le père Chéry, par exemple, et d’autres érudits [25], la secte est un « phénomène de dissidence ». Au sein de l’Église de Jésus, rappelle-t-il, ce phénomène est aussi ancien que l’Église elle-même. Déjà, écrit-il curieusement, saint Paul a dû « lutter contre la dissidence judéo-chrétienne qui voulait retenir les fidèles du Christ dans les observances du judaïsme » Le père Chéry appelle donc « dissidents » les chrétiens d’origine juive qui refusent de se séparer du judaïsme !
Le grand érudit allemand Ernst Troeltsch oppose lui aussi la secte à l’Église, mais dans une perspective plus sociologique [26]. A tout moment de l’histoire, selon lui, il existe en tout lieu donné une Église hiérarchique s’accommodant de l’ordre établi et fonctionnant dans son sein. Cette Église est donc, par définition, en bons termes avec les classes dirigeantes pour le compte desquelles elle assure la surveillance de la société. De ce fait, et comme l’ordre établi lui-même, l’Église sécrète sa propre contestation : c’est la secte « égalitaire et radicale », qui exprime « la condition malheureuse des groupes non privilégiés ».
On aura reconnu dans ce schéma, l’explication proposée à la sorcellerie médiévale [27] par Michelet, lui-même écho de Voltaire. Troeltsch fonde son analyse sur les seuls rapports des Églises chrétiennes avec leurs sectes. Dans ce cadre limité, il éclaire effectivement bien des choses. Il est vrai que les grandes sectes médiévales ont exprimé le désespoir des faibles devant un ordre impitoyable qui leur interdisait toute révolte dans ce monde sous peine de se perdre aussi dans l’autre [28]. Le malheureux qui, sous peine de damnation, devait à son seigneur son sang, son labeur et sa vie se trouvait dans l’exacte situation psychologique qui, on l’a vu, prélude à la conversion. Qu’un pauvre prêcheur vaudois ou cathare vint lui parler d’un Dieu plus pitoyable, il avait toute chance d’être entendu.
La répression engendre le fanatisme
Ainsi s’explique au XVIe siècle l’effrayant fanatisme des anabaptistes, après la sanglante répression de la révolte des paysans. Quand Bryan Wilson parle de « hordes de vagabonds et de visionnaires [29] », attirées à Munster par les prédications enflammées de Jean de Leyde, il omet de nous dire quelles circonstances sociales rendaient ces « hordes » disponibles. Avec toute sa flamme, Jean de Leyde aurait maintenant du mal à retenir l’attention d’une réunion électorale dans un préau d’école. C’est que le prophète de Munster prêchait l’égalitarisme, le châtiment prochain des tyrans et la fin imminente de ce monde de fer et de sang, alors que nous n’avons plus de tyrans et que nous sommes tous égaux dans un monde confortable et mou.
En fait, l’analyse de Troeltsch ne commence à être insuffisante que lorsqu’on aborde les sectes non chrétiennes, celles que nous appellerons (un peu excessivement, bien entendu) les sectes « ex nihilo ». Cependant, au sein des sectes chrétiennes modernes, le mouvement de révolte contre l’Église établie est toujours né de la même allégation : celle de la décadence, de son laxisme, de son manque de foi, de pureté, de vertu.
Les intégristes et les marxistes chrétiens, que nous voyons actuellement se déchirer au nom d’un même retour à la pureté originelle, illustrent sous nos yeux le perpétuel phénomène de la dissidence. Ils nous montrent l’ontogenèse de la secte déviante, celle qui se réfère à une Église préexistante.
COMMENT UNE TENDANCE DEVIENT UN SCHISME
Le premier symptôme de cette ontogenèse, c’est l’apparition de la tendance. Au sein de l’Église, un groupe se dessine qui insiste plus qu’on ne l’a fait jusqu’alors sur un détail de la dogmatique, ou de la morale, ou de la liturgie, ou de tout autre aspect de l’orthodoxie. Dans le cas des chrétiens progressistes, par exemple, on accordera une importance privilégiée à certains passages du Nouveau Testament maudissant les riches, la richesse et le « monde ». Au XVIIe siècle, les premiers jansénistes furent des déviants désireux de promouvoir une morale plus austère, car, disaient-ils, le salut est plus difficile qu’on ne croit. Il est même si difficile qu’en fait n’est sauvé que le prédestiné : ce sont les thèses fameuses de l’« Augustinus [30] » sur le rôle de la Grâce dans le Salut.
La tendance, si elle est ressentie en profondeur par un groupe actif, ne peut manquer de se changer en prosélytisme. Elle va alors se heurter à d’autres tendances, invoquer pour elle l’orthodoxie, et, si la hiérarchie se fait tirer l’oreille, se retourner contre elle. Pascal commence par quereller les jésuites, puis le pape. Au sein de l’Église catholique, la secte aboutit alors automatiquement au schisme, à la séparation (c’est du moins ce qui s’est toujours produit jusqu’à Jean XXIII). C’est ce qui se produisit en Hollande : trois siècles après l’« Augustinus », il y a encore des évêques jansénistes à Utrecht, Haarlem et Deventer. Le rôle du fondateur peut se manifester plus ou moins tôt dans le processus qui va de la tendance à la secte. Parfois, c’est lui qui crée la tendance et la rassemble. Parfois, la tendance naît spontanément. On assiste alors à des conversions au sein de la tendance. Avant cet incident, le converti n’est qu’un croyant orthodoxe assez tiède Il passe de la tiédeur à l’ardeur de la façon que nous avons vue.
A mesure que les conversions se multiplient, le bourgeon poussé sur le tronc de l’orthodoxie supporte de plus en plus mal de lui rester attaché. C’est que le converti est un personnage inflexible : il détient la vérité, il l’a éprouvée jusqu’au fond de son être et ne saurait transiger avec elle. L’indignation de Pascal contre les jésuites tire sa véhémence des « pleurs de joie », du « feu », de la nuit du 23 novembre, 1654 : les « Provinciales » commencent à paraître un an après cette nuit fameuse, le 23 janvier 1656. Après Pascal, la révolte janséniste ira jusqu’au schisme.
Entre l’apparition de la « tendance » et son rejet de l’orthodoxie, plusieurs épisodes surviennent régulièrement au sein, de la secte en gestation.
La secte s’invente un mythe des origines
D’abord apparaît la conviction, toujours proclamée, d’un retour aux origines. Le sectateur affirme que l’orthodoxie a dévié, qu’elle s’est éloignée de la pureté originelle. Dans son ardent désir de rétablir l’originelle pureté unilatéralement interprétée, la tendance déviante se heurte inévitablement à l’orthodoxie traditionnelle. Car si les origines ont été trahies, il faut bien que ce soit par quelqu’un.
L’orthodoxie, c’est, par définition, la hiérarchie. Ainsi voit-on par exemple en ce moment intégristes et progressistes s’en prendre avec virulence aux évêques et aux cardinaux.
Valéry estimait que les virtualités de l’histoire se sont épuisées dans la seule histoire de Rome. On peut aussi le dire de la Rome de Pierre. Tout s’est passé au sein de l’Église catholique, à qui une séculaire expérience de la psychologie sectaire a inspiré d’infinies ressources de patience et de savoir-faire. La plupart des innombrables ordres, congrégations, compagnies, sociétés, communautés, confréries, archiconfréries qui ont fleuri dans son sein depuis la Rome antique sont nés du processus que nous venons de décrire, mais canalisés et orientés par la tolérance hiérarchique.
L’habileté de la hiérarchie à les garder, selon l’expression, « dans le bercail », ne pouvait qu’être fructueuse. D’abord, leur dynamisme prosélyte se retrouvait attelé, si l’on nous permet cette image, à l’antique barque de Pierre. Ensuite, l’existence reconnue et organisée de tendances formellement différentes permettait de détourner le redoutable corollaire de l’agressivité vers de mineures manifestations d’aigreur mutuelle.
« Homo homini lupus, clericus clerico lupior » (l’homme est un loup pour l’homme, le clerc est encore plus loup pour le clerc), dit un vieux proverbe de couvents. Sans doute Luther [31] fût-il resté dans le sein de l’Église s’il avait trouvé quelqu’un d’autre à accuser que la Cour de Rome, ou si la Cour de Rome avait compris à temps vers quel autre but orienter son ardeur réformatrice.
Enfin, et ce n’est pas le moins intéressant, les ordres et congrégations permettent de concevoir des « retours aux sources » limités, ne mettant en cause que les congrégations et ordres eux-mêmes.
Après sa prise de conscience en tant que groupe original, la secte suit un cheminement qui varie selon sa doctrine, son statut social, son environnement. Son originalité s’affirme d’autant plus qu’elle est moins bien accueillie. Cette proposition peut d’ailleurs être retournée : marginalité et originalité s’enfantent l’une l’autre. La longue histoire des frères huttériens illustre bien cette génération réciproque.
Les huttériens, ou le Salut réservé au petit nombre
Jacob Hutter, pasteur anabaptiste tyrolien, fut pendant trois ans, de 1533 à 1536, le chef d’une petite secte de paysans communistes et pacifistes installée à Austerlitz après le désastre anabaptiste de Munster. Son enseignement fut mis en forme par son successeur Peter Riedemann en 1540.
Mais la Moravie est catholique. Pour fuir les persécutions, les huttériens, qui ne semblent avoir jamais été plus de quelques centaines, commencent à émigrer collectivement.
On les voit en Slovaquie, puis en Transylvanie. Vers le milieu du XVIIIe siècle, ils sont en Russie. Toujours parlant allemand, toujours collectivistes, toujours refusant le port des armes, ils restent là un siècle. Vers 1860, pour échapper au service militaire imposé par le tsar, ils commencent à partir aux États-Unis. En 1874, ils fondent trois communautés dans le Dakota. Ils sont alors, en tout, sept cents.
Survient la première guerre mondiale. Les frères huttériens parlent toujours leur allemand du XVIe siècle et refusent toujours de se battre : ils émigrent au Canada. Depuis, ils se sont si bien multipliés qu’en 1965 on en comptait 12500 au Canada et 5000 aux États-Unis. Leur marginalité et leur originalité sont presque sans égales. Écoutons Bryan Wilson : « Les huttériens… ont le sentiment profond que le salut… se trouve au sein de leur communauté… La communauté et la congrégation se confondent, leurs statuts d’association emploient indifféremment les termes de communauté et d’Église. Le baptême, administré à l’âge adulte, marque l’admission dans la communauté et la soumission à ses règles. La soumission implique le refus de porter les armes… Ils refusent naturellement tout emploi public… Ils refusent de payer les impôts levés à des fins guerrières et de prêter serment… Les communautés huttériennes sont des sociétés fermées sur elles-mêmes, presque cloîtrées. Le monde extérieur en est exclu, sa façon de vivre est ignorée. Bien que les huttériens se marient et aient des domiciles particuliers, ils élèvent parfois leurs enfants en commun. Ils dînent ensemble (chaque sexe de son côté) et en silence. Leur vie quotidienne est celle de fermiers et ils se sont adaptés à la façon de vivre des agriculteurs des divers pays où ils se sont établis… Le taux de croissance de la population huttérienne est aujourd’hui des plus impressionnants du monde… Lorsque les effectifs d’une communauté ont atteint environ cent cinquante personnes, on pense à la diviser et à établir une nouvelle colonie : de la naissance d’une colonie à sa division, le processus dure à peu près vingt ans. Pendant ce temps, la colonie a suffisamment augmenté ses revenus pour être en mesure de financer la scissiparité, en achetant de nouvelles terres pour ceux de ses membres qui deviendront des pionniers… Les huttériens n’investissent jamais rien dans des affaires financières qui leur soient extérieures … Dans beaucoup de colonies, on a conservé à dessein certaines activités qui exigent un travail pénible… parce que l’on sent que ce genre de travail contribue à maintenir l’esprit communautaire chez les membres de la secte tout en les préservant d’une oisiveté, qui, à la longue, pourrait les inciter à exiger des distractions [32]. »
Wilson expose ensuite l’organisation politique et sociale de la secte, où tout se fait par élection et tirage au sort. Toute distinction est absente du culte, des repas, des actes de la vie quotidienne. Il n’y a pas de classes sociales : tout appartient à tous, dans un groupe donné chacun connaît tout le monde personnellement, et nul ne peut se singulariser par une situation sociale particulière.
Entre eux, les huttériens continuent de parler leur vieux dialecte tyrolien. Leur culte se fait en allemand classique. Ils ont des écoles primaires de langue allemande. Ils ont appris l’anglais, mais ne l’utilisent que pour leurs rapports avec le monde extérieur. Ils ne sont pas intéressés par l’enseignement supérieur qui, dans leur système, ne correspond à aucun besoin. Ils portent toujours le costume traditionnel, remarquable surtout chez les femmes (coiffe, longue robe paysanne, tissus sombres). Il est piquant de constater avec Wilson que ces hommes et ces femmes si dédaigneux de la vie moderne semblent heureux, que les enquêtes faites par les psychiatres montrent chez eux un taux exceptionnellement bas de désordres mentaux, que ceux qui quittent leur colonie sont très rares et ne tardent pas à y revenir.
Si donc une secte a « réussi » sans cesser d’être une secte, c’est bien la leur. Ils ne se soucient ni d’être compris ni de faire des adeptes. Ils aiment et respectent tous les hommes, ont banni toute violence de leurs rapports avec eux, mais jugent que les « autres » marchent dans les voies de la perdition. Ils présentent au plus haut point tous les caractères de la secte établie dans son état : l’exclusivisme, la conscience de la singularité, la justification idéologique.
Devant les sectes, la raison est prise de vertige
Peu de phénomènes sociaux nous en apprennent sur l’homme, ses virtualités, sa flexibilité aux limites inconnues, autant que celui de la secte. Les sectes sont omniprésentes. Combien y en a-t-il dans le monde ? On l’ignore. On les compte par milliers en Afrique, et spécialement en Afrique du Sud. Il en est de même en Amérique latine. Chez les Noirs des États-Unis certains sociologues estiment que chaque bloc d’immeubles, chaque rue peuvent être considérés comme une secte.
Tout sectateur tient le profane pour un égaré. Et le sectateur peut être un homme intelligent, sensé, critique. Dès lors, compte tenu des sectateurs de toutes sortes, celui qui étudie la secte avec ce qu’il pense être une méthode rationnelle échappe difficilement au vertige : en quoi la méthode dont il est si fier est-elle elle-même autre chose qu’une justification sectaire comme une autre ? Sur quel critère assoira-t-il son assurance ?
Cette question sera rejetée par beaucoup de lecteurs peu enclins au doute et à l’interrogation. On avancera les résultats concrets, expérimentaux, de la méthode objective dans les autres domaines de la science, la conquête de la nature, la technologie. Loin d’être une secte de plus, dira-t-on, la méthode objective consacre, au contraire, la victoire de la raison sur l’esprit sectaire, sa réfutation, son dépassement. Tout cela est indiscutable. L’ennui est que parmi les plus profonds créateurs de la science, beaucoup, qui poussèrent jusqu’au génie la maîtrise de la méthode objective et contribuèrent à la créer, furent d’illustres sectateurs : pensez à Pascal, à Swedenborg, et même à Newton. Mais, dira-t-on, tout grand esprit a ses faiblesses. Sans doute ; seule objection : qui décide où sont les faiblesses ? Le nombre ? A-t-on jamais mis la relativité ou la thermodynamique aux voix, et convient-il de le faire ? Alors ? Jugera-t-on aux résultats ? Mais lesquels ? Les huttériens n’ont-ils pas moins de fous ? Ne sont-ils pas plus heureux ?
Si l’on pousse au fond la discussion, on aboutira peut-être à ceci que, dira-t-on, la méthode objective n’exclut aucun fait. Elle les considère tous également avec un esprit froid, alors que le sectaire choisit ce qu’il accepte et ce qu’il refuse de voir : le mormon accepte la critique historique, mais refuse son application à l’ange Moroni ; l’huttérien et l’amish acceptent le téléphone, mais refusent de le fabriquer ; le chrétien (dira l’agnostique) accepte la biologie, mais en arrête les lois à la résurrection de Jésus. Seulement la méthode objective ne procède pas différemment. Elle aussi, comme nous allons le voir, procède, à tort ou à raison, par exclusive, choix et refus.
Des « miracles » sont à l’origine des sectes
Au début de toutes les sectes, et parfois pendant un temps assez long, il y a ce que le sectateur appelle les « miracles ». Si l’historien objectif n’en parle guère, pour le sectateur, ils ont une importance capitale. Ce n’est pas ici le lieu d’examiner si les miracles existent ou non, mais de savoir comment se détermine leur refus. Combien, parmi ceux qui choisissent de les récuser, ont étudié le dossier d’un seul d’entre eux ?
A cette question, on répond en général que l’on n’a pas à réfuter une allégation incroyable et que c’est à celui qui la fait d’en apporter la preuve. Mais, précisément, il existe des masses de documents qui prétendent apporter cette preuve [33]. Quelle que soit la valeur de ces documents, ceux qui rejettent les « miracles » les ont-ils étudiés ? En règle générale, non. Peut-être ont-ils objectivement raison de les rejeter. Mais qu’ils aient ou non raison, le motif du rejet ne doit rien à l’examen objectif : il est purement culturel. Il est de même nature que le choix du mormon décidant de rejeter une critique historique qu’il n’a même pas envie de connaître quand elle s’applique à l’ange Moroni, mais qu’il acceptera et même qu’il pratiquera avec talent dans tous les autres cas. Les « preuves » des « miracles » en appellent aux mêmes méthodes que toute autre preuve scientifique. Elles sont exposées par des hommes de science que rien, à part cela, ne distingue des autres hommes de science. Mais on ne leur accorde pas un examen de même nature. Quand une secte naît, ses adeptes (et parfois des profanes) attestent la production de nombreux « miracles » : guérisons, voyances, prophéties, etc. Ils lui réservent une place importante dans leur vie et leurs pensées. Il est admis par tous les gens « sensés » que ces miracles sont inexistants. Les gens sensés ont peut-être raison, mais quelqu’un s’est-il jamais demandé s’il en est bien ainsi ?
Étant donné que notre assurance dans ce domaine précis est essentiellement le fruit d’une imprégnation culturelle, comment savons-nous si notre culture est dans le vrai, et si l’évidence qui nous avertit qu’on ne peut jamais prophétiser ou parler des langues qu’on ignore n’est pas aussi trompeuse que celle de la Terre plate ? De quelle étude sérieuse tenons-nous la certitude que ce phénomène incompréhensible qu’est la conversion en chaîne se développe conformément à la logique d’une culture qui, précisément, la rejette comme aberrante ?
La période « brûlante »
Si le miracle accompagnait réellement les phénomènes psychologiques et éventuellement physiologiques qui caractérisent la conversion en chaîne, alors l’étude des sectes, et surtout des sectes naissantes, ouvrirait à l’investigation de l’homme des méthodes d’approche aussi originales que prometteuses. Si les miracles allégués pendant la période que l’on pourrait appeler « brûlante » de la secte étaient réels, cela signifierait que des phénomènes particuliers, complètement absents de la vie humaine ordinaire et par là même exclus de notre image de l’homme, peuvent se produire dans certaines circonstances dont nous connaissons les traits essentiels. Nous n’ignorons pas qu’en énonçant ces idées, même de façon purement hypothétique, nous manquons au respect que l’on doit aux idées reçues. Tant pis. Nous ne suggérons rien d’autre ici que la foi dans la méthode expérimentale et elle seule. Ce n’est pas renoncer à la méthode expérimentale que de se demander si des miracles se produisent vraiment pendant la période brûlante ». Nous pensons, au contraire, que c’est par un vestige superstitieux dommageable à la connaissance objective et contraire à la méthode expérimentale que l’on refuse de se poser la question. En veut-on une preuve ? En novembre 1969 se tint à New York un congrès international de psychiatrie sur le thème de l’hallucination. Plusieurs savants rapportèrent des cas de l’hallucination bien connue appelée « out of body » par les Anglo-Saxons (elle consiste en ceci que le sujet croit voir son corps de l’extérieur, par exemple d’en haut et reposant sur un lit ou bien de derrière, assis dans un fauteuil. Le sujet peut aussi, pense-t-il, s’éloigner de son corps, passer dans les pièces voisines, traverser les murs, etc.). Quelques-uns exposèrent leurs recherches sur ce type d’hallucination. Leur curiosité était réelle, comme aussi leur ingéniosité expérimentale. Pas un, cependant, ne rapporta une expérience ayant pour but de savoir si l’« out of body » est une illusion ou une réalité. On fit faire toutes sortes de choses à ces sujets en état d’« out of body », mais il ne se trouva aucun chercheur pour déclarer qu’il avait demandé à son patient de bien vouloir — puisqu’il se prétendait hors de son corps — lire un livre ouvert derrière sa tête, ou suivre les activités d’une personne se trouvant dans une autre pièce. Une telle expérience n’aurait pris que quelques minutes. Mais ces psychiatres étaient tous conditionnés par leur culture à tenir pour absurde une curiosité si peu coûteuse, ou plutôt à ne pas rapporter des expériences de ce genre, au cas où ils les auraient faites [34].
Peut-être la culture occidentale est-elle dans le vrai en prévoyant le résultat négatif de telles expériences. Mais, pour en être sûr, il faut les faire. Ou sinon, dire pourquoi on refuse. C’est d’autant plus nécessaire que d’autres savants, tout aussi irréprochables, affirment que l’« out of body » peut ne pas être une illusion. Quand les savants sont en désaccord, seule l’expérience est habilitée à trancher. Telle est ma position, dont rien ne me fera changer. Or les miracles allégués sont innombrables au sein des sectes et principalement, je l’ai dit, pendant la période brûlante au cours de laquelle ils jouent un rôle apologétique, éminent. Même le dieu de Montfavet a guéri des malades : « Il a effectivement guéri deux eczémas faciaux parmi les employés », rapporte un de ses collègues (catholique absolument rétif, on s’en doute, à son enseignement) cité par le père Chéry [35]. Et cet employé de la gare d’Avignon, témoin des « miracles » de son collègue, apporte une précision intéressante : « Il eut parfois, dit-il, des échecs parmi les collègues qu’il soignait : il prétendait alors que c’était parce que le malade n’observait pas ses préceptes ou parce qu’il avait eu recours à la médecine officielle [36]. »
Le Christ de Montfavet semble donc avoir constaté que l’observance est nécessaire, que le miracle est lié à la conversion.
PHYSIOLOGIE DE LA CONVERSION
Ce n’est pas ici le lieu de tenter une analyse objective de la conversion, si une telle analyse est d’ailleurs possible. Il suffira, pour la suite de notre étude, de la prendre pour ce qu’elle se donne, c’est-à-dire pour un changement psychologique radical et généralement instantané. Elle peut n’avoir aucun rapport avec la religion. Elle peut être idéologique, politique, poétique, morale. C’est par un tel changement radical et instantané que Rimbaud, de poète prodige, se trouve transformé en aventurier du négoce, ou que Koestler, de bourgeois décadent, se mue en militant communiste [37].
Que les états vécus, par Koestler et d’autres, hors de tout contexte religieux, ressemblent à ceux que décrivent les convertis et les mystiques, ne prouve nullement leur identité intérieure. Prouver l’identité de deux états intérieurs est impossible — à supposer que cela signifie quelque chose. Mais les concomitances extérieures, physiologiques ou physiques, sont, elles, contrôlables. Elles ont été étudiées par des neurophysiologistes [38], et notamment par l’Américain Roland Fischer, qui enseigne la psychopharmacologie à la Faculté de médecine de l’Université de l’Ohio.
Les expériences de Fischer, conduites avec l’appareillage habituel de la neurophysiologie, établissent un parallélisme entre l’éveil du système nerveux central et une classification des états de conscience allant du samâdhi des yogis pour les états d’éveil les plus atténués jusqu’à l’extase mystique pour les états d’hyperéveil .
Fischer démontre le principe d’une concomitance entre les états mystiques ou paramystiques et la physiologie, ouvrant ainsi une voie nouvelle, celle du laboratoire, à l’étude de la conversion. Son « spectre » des états de conscience propose trois séquences corrélatives : physiologique, sensorielle, mentale. A chaque point de l’une des séquences correspond un point et un seul des deux autres. Peut-être se trompe-t-il dans le détail des trois corrélations réciproques. Mais il suffit que le principe de ces corrélations soit établi pour qu’à l’incertitude de l’introspection se substituent l’expérience et la mesure [39] réclamées ici. En effet, étant donné que la physiologie de d’éveil est pour l’essentiel commune à l’homme et aux animaux supérieurs [40], nous sommes fondés à rechercher si la physiologie animale ne nous offre pas des processus somatiques identiques à ceux que l’on observe, mais par le biais de l’introspection, dans le phénomène de la conversion.
Quand Dieu veut foudroyer…
Nous pouvons invoquer ici une maxime très profonde que les Invisibles prêtent à l’un de leurs maîtres du nom de Rabellus et qu’aucune religion, croyons-nous, ne refusera d’endosser : « Quand Dieu veut foudroyer, dit Rabellus, il se sert de la foudre. » Ce Rabellus (dont nous ignorons l’identité) entend par là que l’action divine emprunte, pour se manifester, les voies de la Création : la foudre est un phénomène naturel.
Rechercher dans l’expérimentation animale des phénomènes semblables à ceux que l’on observe chez l’homme en proie à la conversion n’implique aucun réductionnisme du spirituel au matériel ou de l’homme à l’animal. En revanche, cette démarche peut nous éclairer sur ce qui, dans la conversion, relève de la simple physiologie. Or les correspondances existent. Le psychiatre anglais William Sargant a consacré tout un livre [41] à relever ces correspondances. Ayant pris part au débarquement de juin l944 en tant que psychiatre de l’armée anglaise, Sargant fut frappé de voir combien les crises observées chez les soldats exposés au feu ressemblaient à celles que Pavlov avait expérimentalement provoquées sur les chiens de son laboratoire. Il observa en particulier qu’au-delà d’un certain désarroi physique et moral le soldat subit une sorte de retournement de ses structures psychologiques, exactement comme le chien de Pavlov qui, longuement déconcerté par des épreuves contradictoires et douloureuses, devenait soudain le contraire de lui-même, montrait un attachement inattendu au gardien qu’il avait mordu, ou inversement. De ces observations, Sargant tira une théorie du « lavage de cerveau » qui ne concerne pas notre recherche, quoiqu’elle fasse apparaître cette pratique contrefaçon de la conversion.
Le « retournement » psychique du chien de Pavlov s’obtient par des moyens qui n’honorent guère la sensibilité de l’expérimentateur : jeûne, sévices divers, stimuli contradictoires et incompréhensibles affolant l’intelligence et l’instinct de l’animal. Ce sont des moyens à la mesure du chien. Les épreuves des soldats observés par Sargant étaient en partie à la mesure du chien qui est en l’homme, et en partie à la mesure de l’homme. Les « retournements » observés se situaient au niveau des épreuves endurées. Dans le cas d’épreuves uniquement physiques, le soldat subissait des névroses plus ou moins « animales ». Les épreuves morales entraînaient des désordres plus typiquement humains, plus profonds, ou, si l’on préfère, d’un niveau plus élevé. Ainsi il semble que la « conversion » se situe au niveau où on la provoque et où l’être qui la subit est capable de la vivre.
Cette remarque nous donne peut-être la clé ultime du fait sectaire, en même temps que la pierre de touche permettant de le situer dans le cadre du fait religieux.
Physiologie de la secte
Rappelons-nous nos remarques sur la conversion du fondateur : elle survient au terme d’un temps d’angoisse qu’elle clôt en retournant la situation angoissante, en guérissant l’angoisse par sa cause. Ainsi, Ann Lee, mère frustrée dans sa maternité, découvre-t-elle que le salut naît de la continence. Ainsi Wesley trouve-t-il dans la foi le remède à son tourment de rationaliste avide de ferveur. Ainsi l’ange Moroni révèle-t-il à Joseph Smith la justification de l’Amérique en lutte. Ainsi Pascal, l’une des plus profondes intelligences de l’humanité, trouve-t-il la paix en « s’abêtissant », selon son expression.
La guérison de l’angoisse par sa cause explique la soudaineté de la conversion. Mais de ce que la conversion retourne l’angoisse en l’égalant, il s’ensuit qu’il y a autant de conversions que d’angoisses. Le bouleversement peut survenir au niveau de l’ange ou à celui de la bête. Les innombrables sectes sexuelles, toujours et depuis toujours renaissantes, guérissent d’un petit mal aussi ancien que l’oisiveté. Cela ne va pas loin. De même les petites sectes guérisseuses qui promettent une santé florissante par l’argile, l’oignon, le végétarisme, le yin et le yang, etc. Elles ne sauraient mobiliser que la partie de notre être qui le matin se regarde la langue dans la glace. Autant de drames dans l’homme, autant de conversions possibles. Aussi pourrait-on prédire la typologie tout entière des sectes en recensant les causes de suicide et en interrogeant les statistiques de la médecine psychosomatique. A cause des variations infinies de l’histoire, cette typologie serait longue et ce recensement vaste.
Ainsi s’explique en ce moment même le pullulement des sectes là où l’histoire contemporaine est cruelle, chez les Noirs américains et sud-africains, en Amérique du Sud, en Indochine ; là aussi où des changements trop rapides détruisent les structures traditionnelles sans fournir de substitut, comme au Japon ; là où une culture en remplace une autre, comme en Occitanie, au Pays de Galles, en Écosse, ou en Europe de l’Est.
Allons jusqu’au bout de cette logique : si l’on devait désigner dans l’histoire du monde, le temps et le lieu du bouleversement le plus traumatisant et requérant donc la conversion la plus brûlante, où le trouverait-on mieux que là où deux grandes cultures — la grecque et l’hébraïque —, après s’être un moment compénétrées, se trouvèrent soudain mises en tutelle et irrémédiablement humiliées par la toute-puissance d’une troisième, la romaine ?
Ce lieu est évidemment la Palestine hellénistique soumise à un petit fonctionnaire romain, et ce temps le Ier siècle. Et l’on peut comprendre cela de deux façons : ou bien comme une explication rationaliste de plus à l’apparition du christianisme, ou bien comme une démonstration du caractère providentiel de l’histoire, qui semble avoir fait conspirer le monde antique tout entier à créer les conditions d’une conversion totale au moment précis où l’Évangile est annoncé aux hommes. Comme le biologiste dans l’apparition de l’œil, l’historien retrouve donc ici le paradoxe auquel Jacques Monod a donné le nom de téléonomie : quand on a tout expliqué par les causes, il reste que ces causes, parfois, réalisent un projet.
Examiné du point de vue des causes visibles, le christianisme n’est rien qu’une secte qui a réussi. Il est celle qui a le mieux réussi, puisque, au terme actuel de l’histoire, c’est lui oui compte le plus d’adeptes.
Mais pourquoi une secte réussit-elle mieux ? Le mécanisme de la conversion en chaîne répond à cette question : pour que la conversion du fondateur en déclenche d’autres, il faut que la réponse qu’elle donne ait valeur d’exemple. Si l’exemple s’impose à l’humanité entière, c’est que la conversion atteint à l’essence de l’homme. Son succès mesure son universalité. Son dynamisme mesure la profondeur des niveaux qu’elle mobilise dans la personne vivante.
Si donc l’hypothèse que nous avons avancée sur les miracles venait à être vérifiée, il n’y aurait aucun doute à avoir sur le nombre et l’éclat des miracles au sein du christianisme naissant. Ces miracles témoigneraient pour le moins de la profondeur humaine du phénomène chrétien, profondeur confirmée par le succès ultérieur du christianisme. On pourrait dire alors, en raccourcissant, que la grandeur des miracles témoigne du succès futur, et le succès constaté des miracles chrétiens.
Les sectes répondent à une disponibilité de l’âme
Les sectes attestent et mesurent la disponibilité psychologique, spirituelle et morale de l’homme. Déplorer leur existence, c’est méconnaître l’un des traits les plus profonds de notre être. Autant déplorer la couleur du ciel ou la rotondité de la Terre.
La disponibilité de l’homme est une adaptation évolution ayant pour fonction d’ouvrir l’homme aux changements de l’histoire. Ces changements eux-mêmes naissent de transformations que nos inventions techniques, économiques, sociales et culturelles opèrent sur notre milieu vivant.
Les animaux, qui n’inventent pas ou guère, ne modifient leur milieu vivant qu’à la vitesse de leur propre évolution biologique : ils n’ont besoin d’aucune disponibilité et n’ont donc pas d’histoire. Les adhésions irrationnelles sont, au contraire, le nécessaire complément de la démarche rationnelle. Nécessaire, car les changements quotidiens de notre milieu requièrent des réponses immédiates que le lent exercice de la raison ne saurait fournir. Il faut donc sans cesse anticiper sur la raison par des choix doctrinaires. La secte qu’elle soit religieuse, politique ou autre, fournit un dispositif automatique d’anticipation. Elle résout par voie d’autorité l’angoisse de l’indétermination intérieure. Elle tranche le problème de Buridan par une référence systématique à des réalités transcendantes au problème lui-même et à toute réalité extérieure.
Notre hypothèse n’est-elle pas elle-même une anticipation ? Ne propose-t-elle pas un choix doctrinaire que rien ne fonde ? Tel serait le cas si nous perdions de vue qu’une hypothèse ne commence à cesser d’être une pure rêverie que lorsqu’elle propose des expériences permettant de la réfuter [42] si elle est fausse. On se tromperait en croyant trouver dans notre analyse autre chose qu’une incitation à des contrôles expérimentaux.
Les plus prometteurs de ces contrôles pourraient être cherchés dans le domaine clinique, pathologique. L’hypothèse serait ainsi contrôlée dans ses conséquences latérales, hors de tout contexte religieux.
On pourrait, par exemple, essayer de guérir des troubles psychosomatiques par une aggravation mesurée de leur cause psychologique, puis en provoquant, au moment du désarroi maximal, une conversion du patient à l’égard de cette cause. La « conversion » devrait être irrationnelle, attachée à une idée imaginaire et nourrie de la seule émotion. La difficulté réside évidemment dans la crédibilité du thérapeute : on croit le thaumaturge et le prophète, mais plus difficilement le praticien en blouse blanche [43].
D’autre part, le danger d’un désarroi délibérément exacerbé est à examiner avec une extrême prudence. On pourrait donc tenter d’abord de provoquer la « conversion » après l’électrochoc ou le choc insulinique. Si ces dernières thérapeutiques produisent ordinairement des effets si irréguliers, c’est peut-être que la guérison, quand elle survient, ne résulte pas du choc lui-même (correspondant à la destruction préalable de structures mentales), mais à la conversion qui devrait le suivre et dont l’apparition est laissée au hasard. Ernest Jones, le biographe de Freud, rapporte des cas où celui-ci parvint à guérir des malades mentaux en leur « révélant » des « traumatismes refoulés » rigoureusement inexistants, mais dont Freud s’était persuadé en même temps qu’il en persuadait son patient [44].
Si les expériences que nous suggérons donnaient des résultats positifs, il faudrait en conclure que les recherches portant sur la réalité des mythes psychanalytiques sont vaines et inutiles : vaines, parce qu’il suffirait de les chercher pour les trouver ; inutiles, parce que ces mythes n’auraient nul besoin d’être vrais pour guérir. Il suffirait que le patient se mette à y croire. La cure psychanalytique serait alors une pure et simple conversion. C’est ce que pense Ellenberger.
De même, et ce sera notre conclusion, de tels résultats positifs laisseraient le problème religieux en l’état, sans rien prouver ni réfuter. S’il est vrai que « Dieu se sert de la foudre quand il veut foudroyer », on pourra toujours, en les cherchant, mettre en évidence les structures causales des événements providentiels, miracles inclus, sans pour autant expliquer, si peu que ce soit, leur caractère providentiel, puisque celui-ci manifeste un but, une finalité, une intention. Si les choses vont quelque part — ce que croit tout esprit religieux, —, dire comment elles y vont ne nous apprend rien sur l’essentiel, qui restera toujours de savoir où elles vont, et pourquoi.
Aimé Michel (1919-1992), ingénieur, licencié en philosophie et diplômé de psychologie. Écrivain et essayiste, il a étudié depuis 1952 les méthodologies du témoignage et s’est intéressé au phénomène ovni, à la mystique et à la nouvelle pensée scientifique.
[1] Le Témoin de la vie, no 202, p. 4, « Commentaire divin de la quinzaine ».
[2] Voir R. Delorme : Jésus-Christ (Paris, Albin Michel, 1971). Le livre de Delorme est léger mais véridique.
[3] Comptes rendus de l’Académie de médecine, séance du 16 novembre 1954.
[4] Voir le précédent de la langue « martienne » étudiée par Flournoy au début du siècle dans son livre : De l’Inde à la planète Mars (Genève, Editions Atar, 1900).
[5] G. Adamski : Flying Saucers Farewell (New York, Abelard Schuman, 1961).
[6] Sur les mormons, consulter : R. Mullen : les Saints des derniers jours (Paris, Mame, 1970) ; T.O’Dea : The Mormons (Chicago University Press, 1957) et surtout Fawn M. Brodie : No Man Knows my Story (New York, 1945).
[7] Récit de Joseph Smith lui-même consigné dans History of the Church (Salt Lake City, 1902).
[8] Par exemple le court livre appelé Paroles de Mormon, notamment versets 15 à la fin. Le Livre de Mormon (Paris, Editions mormones, 1962).
[9] Voir R. Mullen : les Saints des derniers jours, chap. XXX (Paris, Mame, 1970).
[10] Alma 27.9 : le Livre de Mormon (Paris, Editions mormones, 1962).
[11] H.-C. Chéry : l’Offensive des sectes (Paris, Le Cerf, 1959).
[12] F.B. Salisbury : professeur de biologie à l’Université d’Utah.
[13] Sur l’histoire de la transe, consulter : M. Eliade : le Chamanisme et les techniques archaïques de l’extase (Paris, Payot, 1968) ; sur sa physiologie : M. Keup et autres : Origin and Mechanisms of Hallucinations (New York, Plenum, 1970), et spécialement le chapitre rédigé par Erika Bourguignon.
[14] Sur le mouvement appelé « antipsychiatrie », voir D. Cooper : Psychiatrie et Antipsychiatrie (Paris, Le Seuil, 1971) ; F. Basaglia : l’Institution en négation (Paris, Le Seuil, 1970) ; R. Laing : la Politique de l’expérience (Paris, Stock, 1969) ; M. Mannoni : le Psychiatre, son fou et la psychanalyse (Paris, Le Seuil, 1970).
[15] Voir B. Wilson : les Sectes religieuses (Paris, Hachette, 1970).
[16] W. Sargant : Battle for the Mind (Londres, Pan Books, 1959) ; traduction française : Physiologie de la conversion politique et religieuse (Paris, P.U.F., 1967). Le personnage de Wesley a beaucoup inspiré ce chercheur éminent.
[17] Voir R.A. Knox : Enthusiasm, a chapter in Religion History (Oxford, Clarendon Press, 1950).
[18] Citons parmi les auteurs anciens : Murisier : les Maladies du sentiment religieux (Paris, Alcan, 1901 ; Leuba : Revue philosophique (nov. 1902) ; et parmi les auteurs modernes les rédacteurs du Dictionnaire rationaliste (Paris, Editions de l’Union rationaliste, 1964).
[19] Voir, par exemple, dans le Dictionnaire rationaliste les articles de M. Henri Lecat (Paris, Editions de l’Union rationaliste, 1964).
[20] H.-C. Chéry : l’Offensive des sectes (Paris, Le Cerf, 1959).
[21] H.-C. Chéry : l’Offensive des sectes (Paris, Le Cerf, 1959).
[22] Voir M. Simon : les Sectes juives au temps de Jésus (Paris, P.U.F., 1960).
[23] Texte du Manuel de discipline retrouvé parmi les fameux manuscrits de la mer Morte (3, 20, 21). Voir M. Simon : les Sectes juives au temps de Jésus (Paris, P.U.F., 1960).
[24] J. Monod : le Hasard et la Nécessite (Paris, Seuil. 1970).
[25] J. Labbens : « Sectes et mouvements religieux », in Chronique sociale de France, n° 5 (1952) et « Eglises, confessions, sectes et chapelles », in Chronique sociale de France, n° 6.
[26] E. Troeltsch : The Social Teaching of Christian Churches (New York, Mac Millan, 1931) ; Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen (Tübingen, Mohr, 1912).
[27] J. Michelet : Histoire de France (1833-1867) et la Sorcière (1862).
[28] Voir A. Michel et J.-P. Clebert : la France secrète, chap. IV (Paris, Denoël-Planète, 1968).
[29] B. Wilson : les Sectes religieuses (Paris, Hachette, 1970).
[30] L’Augustinus est l’ouvrage de base du jansénisme, rédigé par l’évêque hollandais Cornelius Jansen, dit en latin Jansenius (1585-1638).
[31] Voir D. Olivier : le Procès Luther (Paris, Fayard, 1971).
[32] B. Wilson : les Sectes religieuses (Paris, Hachette, 1970).
[33] Par exemple, sur le miracle allégué d’inédie, ou jeûne total poursuivi pendant des années, le cas de Janet Mac Leod étudié par J.S. Mackenzie (Philosophical Transactions of the Royal Society, vol. LXVII, p. 5). Autres bibliographies sur les « miracles » dans H. Thurston : Phénomènes physiques du mysticisme (Paris, Gallimard, 1961).
[34] Pour les comptes rendus de ce congrès, voir : Origin and Mechanisms of Hallucinations, par soixante et onze auteurs (New York, Plenum, 1970).
[35] H.-C. Chéry : l’Offensive des sectes (Paris, Le Cerf, 1959).
[36] Idem.
[37] A. Koestler : la Corde raide (Paris, Calmann-Lévy, 1953) ; le Dieu des Ténèbres (Paris, Calmann-Lévy, 1950) ; Hiéroglyphes (Paris, Calmann-Lévy, 1955).
[38] Citons A. Kasamatsu et T. Hirai : An Electroencephalic Study on the Zen Meditation (Folia Psychiatr. Neurol. Japon. 20, 315, 1966) ; B. Anand, G. Chhina et B. Singh : Some Aspects of Electroencephalographic Studies in Yogis (Electroenceph. Clin. Neurophysiol., 13, 452, 1961). Voir aussi la bibliographie des trois publications de Fischer, note suivante.
[39] Les travaux de Fischer sont exposés dans les trois publications suivantes : « On Creative, Psychotic and Ecstatic States », in Psychiatry and Art ; Art Interpretation and Art Therapy (Bâle, Jakab, Karger, 1969) ; Ueber das rythmisch Ornamentale im halluzinatorisch Schoepferischen (Linz, VIe congrès de la Société internationale d’art et de psychopathologie, 1969) ; « Drug-Induced Hallucinations », in Origin and Mechanisms of Hallucinations (New York, Plenum, 1970).
[40] Voir Y. Ruckebusch : « Le sommeil et les rêves chez les animaux » ; M. Jouvet et D. Jouvet : « le Sommeil et le rêve chez l’animal ». Ces deux textes dans : Ey et collaborateurs : Psychiatrie animale (Paris, Desclée de Brouwer, 1964), et surtout, nombreux auteurs : Brain Development and Behavior (New York, Academic Press, 1971).
[41] W. Sargant : Physiologie de la conversion religieuse et politique (Paris, P.U.F., 1967).
[42] Voir les analyses du philosophe anglais Karl R. Popper, notamment dans : The Logic of Scientific Discovery (Londres, Hutchinson, 1959) ; Conjectures and Refutations : the Growth of Scientific Knowledge (New York et Londres, Basic Books, 1962). Voir aussi M. Polanyi : « The Growth of Science in Society », in Minerca, vol. 5 (Londres, 1967).
[43] Voir H.F. Ellenberger : The Discovery of the Unconscious (New York, Basic Books, 1970).
[44] « Chez un malade qu’il avait soigné avant la guerre et dont je connaissais parfaitement la vie, écrit Jones, je rencontrai maints et maints exemples de faits dont Freud s’était convaincu et que je savais faux, alors qu’il avait refusé de croire à d’autres faits, réels ceux-là. » E. Jones : la vie et l’œuvre de Sigmund Freud (Paris, P.U.F., 1958).