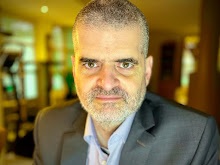Le scientifique et philosophe Bernardo Kastrup expose sa critique du matérialisme et soutient que la réalité est essentiellement mentale.
Bernardo Kastrup s’est fait connaître comme un critique éloquent et averti du paradigme matérialiste. Scientifique devenu philosophe, il avait commencé sa carrière au CERN, le grand collisionneur de hadrons à Genève ; il soutient que c’est l’esprit, et non la matière, qui est à la base du monde. Il a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet, notamment « Why Materialism is Baloney » [1], « The Idea of the World » [2] et « Brief Peeks Beyond » [3], etc. Il est aujourd’hui directeur de la Fondation Essentia, qui relie la vision idéaliste à la recherche contemporaine en science et en psychologie. Il s’entretient avec Jane Clark et Richard Gault des implications de ces idées non seulement pour la science, mais aussi pour notre compréhension de nous-mêmes en tant qu’êtres humains.
Portrait de Bernardo Kastrup
Richard : Bernardo, votre vocation semble être d’aider le monde à comprendre que le matérialisme est une façon erronée d’appréhender la réalité.
Bernardo : Oui, je crois que la philosophie du matérialisme est une théorie de la réalité incohérente et provocante. Et je suis tout à fait prêt à le répéter à qui veut l’entendre.
Richard : Votre parcours est inhabituel. Vous avez commencé votre carrière dans le monde de la science matérialiste, puis vous vous êtes orienté vers la philosophie. Vous êtes aujourd’hui titulaire d’un doctorat en philosophie de l’esprit et avez publié de nombreux ouvrages sur ce sujet, dont les plus récents portent sur Schopenhauer [4] et Jung [5].
Bernardo : En fait, j’ai toujours été philosophe par nature. Même enfant, je posais déjà les grandes questions. Je me rends compte aujourd’hui que ce n’est pas courant, mais, quand j’étais enfant, il me semblait naturel de m’interroger sur la nature de la vie, de la réalité et d’autres questions similaires. Mais dans mes études, j’ai commencé par faire de l’ingénierie informatique, que j’aime toujours. C’est maintenant mon passe-temps, et je conçois mes propres petits ordinateurs sur mon établi. Mon premier emploi fut au CERN en Suisse, où je travaillais sur le grand collisionneur de hadrons, ce qui réalisait un rêve d’enfant. J’y suis entré seulement deux jours après avoir soutenu ma thèse de fin d’études, et j’y ai été très heureux pendant plusieurs années.
Mais à un certain moment, quand on a 33, 34, 35 ans, on recommence à se poser des questions plus profondes. Dans mon cas, cela s’est produit plus tôt parce que je travaillais dans le domaine de l’intelligence artificielle. Lorsque vous envisagez de construire un ordinateur intelligent, la question qui se pose immédiatement est la suivante : cet ordinateur sera-t-il conscient ? Quelle est la différence entre l’intelligence et la conscience ? C’est à ce moment-là que j’ai commencé à réaliser qu’il était incohérent d’essayer de répondre à ces questions dans le cadre d’une hypothèse matérialiste. Plus encore : c’est impossible. C’est comme essayer de tirer le territoire hors de la carte.
Richard : Je crois comprendre que vous avez soudainement pris conscience de cela en lisant un article du philosophe David Chalmers dans lequel il définissait essentiellement ce qu’on appelle aujourd’hui le « problème difficile » de la conscience [6].
Bernardo : Oui, Chalmers a essentiellement dit qu’il n’y a rien dans les paramètres physiques — la masse, la charge, la quantité de mouvement, la position, la fréquence ou l’amplitude des particules et des champs dans notre cerveau — qui nous permettent de déduire les qualités de l’expérience subjective. Ces paramètres ne nous diront jamais ce que l’on ressent lorsqu’on a mal au ventre, lorsqu’on tombe amoureux ou lorsqu’on goûte une fraise. Le domaine de l’expérience subjective et le monde que nous décrit la science sont fondamentalement distincts, car l’un est quantitatif et l’autre qualitatif. C’est en lisant cela que j’ai réalisé que le matérialisme n’était pas seulement limité, mais aussi incohérent. Le « problème difficile » de la conscience n’est pas le problème ; c’est le postulat du matérialisme qui est le problème.
En tant que personne dotée d’un fort esprit analytique, j’ai immédiatement ressenti un abîme béant dans ma compréhension du monde. J’ai donc commencé à chercher une alternative, en corrigeant les hypothèses matérialistes que j’avais formulées sans les examiner auparavant, en les remplaçant par ce que je considérais comme un point de départ plus fiable et en essayant de reconstruire ma compréhension du monde à partir de là. Je suis finalement devenu un idéaliste métaphysique, quelqu’un qui pense que toute la réalité est essentiellement mentale. Elle n’est pas seulement dans votre esprit, ni seulement dans le mien, mais dans une forme transpersonnelle étendue de l’esprit qui nous apparaît sous la forme que nous appelons matière. La matière est une représentation ou une apparence de ce qui est, en soi, des processus mentaux.
Le message de la mécanique quantique
Jane : Lorsque vous commenciez à réfléchir à ces questions au CERN, vous sentiez-vous seul et isolé des autres scientifiques, ou était-il possible d’avoir des conversations à ce sujet ?
Bernardo : Pas vraiment. Mais lorsque l’on est proche des fondements de la physique — et au CERN, nous traitions de la partie la plus fondamentale de la science la plus fondamentale —, on s’habitue à penser en termes abstraits et à l’idée que les choses ne sont pas fondamentalement concrètes. Si vous regardez suffisamment profondément au cœur de la matière, toute concrétion disparaît, et il ne reste qu’une pure abstraction mathématique que nous appelons champs — champs quantiques. Et qu’est-ce qu’un champ quantique ? Un champ quantique est un outil mathématique postulé parce que le monde se comporte comme s’il existait. Mais cela ne signifie pas que les gens du CERN ont réellement trouvé un champ quantique ou en ont touché un.
C’est vrai même pour le boson de Higgs, qui a fait beaucoup parler de lui ces dernières années. Les gens pensent que nous avons réussi à en capturer un, à le photographier, voire à le mesurer directement au CERN. Mais ce n’est pas ainsi que cela fonctionne. Le Higgs, quoi qu’il soit, se désintègre avant d’interagir avec les équipements de mesure. Ce que nous mesurons, ce sont les débris dans lesquels il se transforme après sa désintégration. À partir de là, nous reconstruisons en quelque sorte théoriquement ce qui aurait dû être le Higgs, car nous n’avons aucune autre explication pour les débris que nous mesurons. Ainsi, même si je n’ai pas commencé à réfléchir à des théories idéalistes lorsque j’étais au CERN, cela m’a préparé à me détacher facilement de l’intuition fondamentale selon laquelle la matière a une existence concrète. Même en tant que matérialiste, je savais déjà que ce n’était pas le cas.
Richard : Vous parlez cependant beaucoup de la réalité quantique. Et si je vous comprends bien, vous proposez que la réalité se compose d’un certain nombre de domaines différents, dont l’un est celui dans lequel nous vivons la plupart du temps, fait de ce qui semble être de la matière solide. Mais ce domaine est issu d’un domaine plus fondamental qui est décrit par la mécanique quantique.
Bernardo : En fait, je n’utiliserais pas le mot « domaine ». Il n’y a qu’une seule réalité, et elle est ici même. Mais elle a plus de facettes que ce que nous pensons. Laissez-moi vous donner un exemple. Si vous êtes triste — très triste intérieurement, au point du désespoir — et que vous vous regardez dans le miroir, vous pleurez peut-être. Vous verrez donc des larmes couler sur votre visage et vos muscles se contracter, mais vous ne penserez pas un seul instant que ces larmes et ces muscles contractés sont toute l’histoire. Vous savez que derrière ces larmes, il y a la chose en soi, la chose réelle, qui est votre tristesse. Les larmes et les muscles sont donc l’apparence extrinsèque, la représentation d’une réalité intérieure.
Mais cette réalité n’est pas dans un autre monde. Elle est ici même. D’un point de vue subjectif, c’est la chose en soi — la tristesse en soi —, mais elle se présente à l’observation sous la forme de ce que nous appelons « larmes ».
Jane : La différence réside donc dans le point de vue à partir duquel nous considérons la réalité ?
Bernardo : Oui. Je soupçonne que certaines traditions mystiques du monde font référence à quelque chose de ce genre lorsqu’elles parlent du « monde réel » ou de « l’au-delà » ou autre. Ce que nous appelons le monde physique — cette planète, la lune, le soleil, les galaxies, les trous noirs, les quasars et les amas de galaxies — est comme les larmes, et le « monde réel » est comme la tristesse lorsqu’elle est vécue d’un point de vue subjectif. C’est la différence entre vous regarder pendant que vous pleurez et être vous et connaître la tristesse. Ce sont des choses très distinctes sur le plan expérientiel, mais elles ne se situent pas dans des univers différents. Il s’agit plutôt de différences de perspective qui rendent le monde complètement différent. On pourrait dire que c’est la différence entre une perspective interne et une perspective externe. Schopenhauer appelait cela la différence entre les représentations et la volonté.
Richard : Comment reliez-vous cela à ce que nous savons de la mécanique quantique, qui semble être une couche différente de notre réalité physique ordinaire ?
Bernardo : La différence essentielle réside entre la chose en soi — le monde tel qu’il est en soi — et le monde tel qu’il se présente à notre observation. Le monde tel qu’il est en soi est pur : il est une fonction de lui-même. Mais le monde tel qu’il se présente à notre observation n’est pas seulement une fonction du monde tel qu’il est en soi ; il est aussi une fonction de nous-mêmes et de la manière dont nous sommes constitués pour observer le monde.
En mécanique quantique, nous avons la notion de fonction d’onde — l’équation de Schrödinger — qui est l’expression de tous les états possibles, et lorsque nous effectuons une mesure, nous disons qu’elle s’effondre — je sais que ce terme n’est pas très heureux, mais il est universel, je vais donc l’utiliser — dans un état particulier. Mais une mesure est déjà une représentation, une apparence. C’est ce qui se produit lorsque le monde tel qu’il est interagit avec nous. Ce que nous pouvons mesurer ne sera jamais le monde tel qu’il est en soi.
Ce que la physique quantique nous dit, c’est que la matière n’a pas de réalité autonome. La matière est la façon dont le monde nous apparaît lorsque nous le mesurons, lorsque nous interagissons avec lui, lorsque nous l’observons —, quel que soit le mot que vous préfériez utiliser. Quant à ce qui se cache derrière cette apparence, nous ne pouvons pas le visualiser comme quelque chose de matériel ou de physique, car tous les paramètres utilisés pour décrire de manière exhaustive ce que nous appelons les choses matérielles sont des observables. Le mieux que nous puissions connaître du monde tel qu’il est, c’est la fonction d’onde quantique, qui est une chose statistique — une onde de possibilités.
C’est ce que nous devons comprendre. La mécanique quantique existe depuis le début du XXe siècle, mais nous avons obstinément refusé d’accepter ce qu’elle nous montre. Si nous abandonnons le besoin de préserver l’intuition selon laquelle la matière a une existence autonome, alors tout ce que nous considérons comme un grand mystère en mécanique quantique — les grands paradoxes de la non-localité et de l’indétermination, etc. — se résoudrait immédiatement. Il n’y a pas de grand mystère ici. Le mystère réside dans notre obstination à vouloir nous accrocher à une intuition erronée.
Le monde comme signification
Richard : L’une des conclusions que vous tirez de cette compréhension est que le monde est un lieu de sens. Et que nous sommes ici pour découvrir et interpréter le monde tel qu’il se présente à nous.
Bernardo : Si nous considérons la matière comme ayant une existence autonome, alors elle n’a aucun sens. Le seul sens qu’elle a est celui que nous lui donnons — elle ne renvoie à rien d’autre. Le monde devient alors plat, car il n’y a rien derrière la physicalité. C’est une vision du monde très claustrophobe — une vision nihiliste — dans laquelle il n’y a pas d’autre sens que celui que nous projetons nous-mêmes sur le monde. Quel que soit le sens que nous pensons trouver dans le monde n’est qu’une illusion.
Mais si nous absorbons et intériorisons l’idée que la matière n’est qu’une apparence, alors, soudain, le monde physique tout entier devient comme un livre à lire, car il est l’indication, le signe, de quelque chose qui se trouve derrière lui. Cela signifie que la dimension du mystère est retrouvée et que le sens de la vie revient : quelle que soit la souffrance que nous éprouvons dans notre vie, elle a un sens, car nous savons que nous sommes les yeux à travers lesquels la nature se regarde et s’expérimente elle-même. Nous apportons une contribution, que nous en soyons conscients ou non, que nous essayions de le faire ou non. Ce sont là des choses importantes.
Richard : Vous avez dit que ce sens de la signification s’est perdu d’une manière très particulière dans le monde occidental au XVIIe siècle, à ce que nous appelons « l’âge des Lumières ».
Bernardo : Je pense en fait que les Lumières ont été un pas en avant dans l’histoire de l’humanité. Mais, comme tout ce que les humains peuvent faire, elles ont un côté positif et un côté négatif. Nous avons récolté de belles récompenses, mais nous en avons également payé le prix fort, à savoir le nihilisme.
Jane : Quelles sont donc ces belles récompenses que nous avons récoltées ?
Bernardo : Eh bien, il y en a plusieurs. Le matérialisme ne s’est pas imposé sans raison. L’un de ses principaux avantages est qu’il a éliminé d’un seul coup la plus grande peur que l’humanité ait connue tout au long de son histoire, à savoir : que va-t-il nous arriver après la mort ? En termes chrétiens, irons-nous aller en enfer ? Cette peur a dominé la vie humaine au point que l’Église pouvait contrôler des continents et des civilisations entiers et devenir l’institution la plus puissante du monde occidental. C’est cette peur qui nous fait nous sentir coupables, qui nous imprègne d’anxiété et d’un sentiment de responsabilité pour nos actes. Mais si nous ne croyons en rien au-delà de l’existence matérielle, nous n’avons pas à nous inquiéter.
Et nous n’avons pas non plus à nous sentir responsables de l’avenir lointain, car nous ne serons de toute façon plus là. Nous pouvons donc continuer à piller la planète et à détériorer le climat pendant encore cent ans sans avoir à en payer un prix trop lourd, car nous ne nous soucions pas de ce qui se passera dans les cent ans qui suivront. Nous ne serons plus là. Cela rend la vie légère, comme dans « L’insoutenable légèreté de l’être » de Milan Kundera [7]. Mais le prix à payer est la dépression, le sentiment d’absurdité et l’isolement, qui sont les grands fléaux de la civilisation moderne.
Jane : Si les gens commençaient à adopter votre point de vue, devrions-nous revenir à une certaine idée du paradis et de l’enfer et à la peur qui y est associée, ou voyez-vous émerger une interprétation différente, plus bienveillante ?
Bernardo : Je pense que la nature nous montre chaque jour qu’il y a à la fois de grandes joies et de grandes souffrances. Je ne vois donc aucune raison de privilégier l’un ou l’autre de ces pôles. Ils font partie de la nature. Est-ce que je pense qu’un pôle sera privilégié par rapport à l’autre après notre mort ? Non. Je pourrais entrer dans les détails pour expliquer pourquoi je pense cela, mais pour l’instant, je vais simplement le dire.
Je pense que le processus de la mort peut être terrible, car il implique la dissolution de l’ego. Et quiconque a déjà vécu une transe psychédélique profonde sait à quel point cela peut être terrible, à quel point il est horrible de subir la dissolution de l’ego pour la première fois [8]. Si vous le vivez pour la dixième fois et que vous savez ce que c’est, ça va. C’est même agréable. Mais lorsque vous essayez de l’arrêter et de défendre votre identité personnelle, cela peut vous écraser, et plus vous résistez, plus vous souffrez. Je pense donc que les premières phases de la transition peuvent être terribles.
Après cela, je pense que tout va bien, car c’est la fin de notre dissociation, c’est-à-dire notre séparation en tant qu’individus apparents de la conscience universelle unique. C’est la réintégration dans la matrice de l’être où nous étions avant notre naissance. Et cette réintégration, je pense, est ce que la plupart des gens appellent l’amour. L’amour est la force qui rassemble les choses, par opposition à la peur, qui est la force qui les sépare. L’expérience de cette réintégration, je pense, sera équivalente à la chaleur, au fait d’être dans les bras d’un membre aimé de sa famille, à un sentiment de sécurité.
Mais après cela, après l’euphorie de la réintégration, je pense que tout est possible. Je pense qu’il est tout à fait plausible que nous puissions nous torturer jusqu’à la souffrance, comme nous le faisons ici dans cette vie. Le fait que les gens puissent faire cela montre que la conscience a ce potentiel : celui de se torturer elle-même. Je ne promettrai donc à personne qu’il ne souffrira pas.
Jane : Pensez-vous qu’il soit possible de faire l’expérience de ce sentiment d’intégration à la conscience unique au cours de notre vie, et pas seulement au moment de notre mort ?
Bernardo : Oui, bien sûr. Je pense que par le simple fait que nous sommes des êtres vivants, nous sommes déjà enracinés dans ce contexte naturel. C’est là que se trouvent les racines de notre être, là où nous trouvons un sentiment d’appartenance. Nous avons donc tous ce sentiment intuitif par nature.
Le problème, c’est que nous avons un système d’exploitation culturel dans notre intellect qui nous dit que ces sentiments ne peuvent pas être vrais. S’ils ne peuvent pas être vrais, ils ne sont pas nourris. Ils finissent par être refoulés et nous nous en dissocions. Ils sont toujours là, mais ce que l’intellect ne reconnaît pas n’est pas considéré comme plausible ou possible, donc le cœur finit par ne plus ressentir ces choses. Et lorsque toute la culture autour de nous renforce ce message, il devient impossible d’éviter l’effet ultime, à savoir que notre intellect filtre ce sentiment d’appartenance avec lequel notre moi naturel est né et qu’il aura toujours, car c’est notre racine.
(Pour en savoir plus à ce sujet, voir la vidéo ou ci-dessous).
Richard : À un moment donné dans vos écrits, vous adoptez un langage théologique pour désigner cette conscience unique et vous dites que nous vivons et mourons pour rendre un service indispensable à Dieu. Que voulez-vous dire par là ?
Bernardo : Le fait est que nous avons une perspective sur cette conscience qu’elle n’a pas sur elle-même. C’est là que réside toute la valeur du voyage que nous entreprenons. Et quand je parle de voir, je ne parle pas seulement de ce que nous voyons physiquement, mais de tout ce que nous vivons : notre désespoir, nos tribulations, l’amour que nous ressentons, l’anxiété que nous subissons. C’est le paysage que la conscience expérimente à travers nous, et c’est là notre rôle. Ce que l’idéalisme peut nous encourager à faire, c’est d’abandonner le filtre artificiel. Alors, nous ne parlons plus d’une conclusion conceptuelle. Nous parlons d’une réalité vécue.
Langage, espace et temps
Richard : Dans vos nombreux ouvrages, vous vous êtes efforcé de traduire ces idées dans un langage et des cadres conceptuels que les scientifiques et les neurologues peuvent comprendre et, espérons-le, accepter. Mais cela vous a obligé à employer un langage qui utilise des concepts très concrets. Considérez-vous cela comme une limitation ?
Bernardo : Le langage sera toujours un problème. L’une des raisons est qu’il incarne nos modalités cognitives, qui ne sont pas nécessairement des caractéristiques du monde. Par exemple, l’espace et le temps. Dans la tradition occidentale, Kant fut le premier à souligner que l’espace et le temps ne sont pas la structure objective du monde, mais des catégories cognitives, notre propre façon de décomposer les choses afin de les comprendre plus facilement.
Schopenhauer était d’accord avec cela, tout comme le sont aujourd’hui les neurosciences et la relativité d’Einstein. Le temps et l’espace ne sont pas ce que nous pensions qu’ils étaient. Ils ne sont pas absolus ; ils peuvent être déformés et courbés, et aujourd’hui, avec la gravité quantique à boucles, la physique affirme qu’ils ne sont même pas fondamentaux. Ils sont en quelque sorte des sous-produits, issus de processus quantiques. Ainsi, si vous comprenez que l’espace et le temps ne sont pas des réalités objectives, mais sont hautement subjectifs, vous comprenez qu’ils ne sont que notre propre façon d’interagir avec le monde.
Mais nous intégrons l’espace et le temps dans notre langage. Il est donc erroné de penser que le langage reflète le monde tel qu’il est. En fait, nous devons remettre en question l’idée que l’ensemble de notre perception — tout ce que nous pouvons voir et entendre — est une sorte de fenêtre transparente sur le monde. C’est une notion absurde, car si notre écran de perception était réellement transparent, de sorte que nous reflétions l’état du monde à l’intérieur de nous-mêmes, nos états intérieurs souffriraient d’une grande dispersion et nous nous dissoudrions littéralement dans une soupe en raison de la deuxième loi de la thermodynamique, c’est-à-dire en raison d’une augmentation de l’entropie. Nos perceptions doivent donc être codées et déductives, elles ne peuvent donc pas nous montrer le monde tel qu’il est.
Richard : Si ce n’est pas une fenêtre transparente, comment comprenez-vous cet écran de perception ?
Bernardo : Je le vois comme un tableau de bord avec des cadrans. Nous sommes comme un pilote qui vole à l’aide d’instruments sans pare-brise transparent. Ces instruments sont très performants. Ils sont très précis. Ils nous fournissent des informations importantes pour survivre, comme un pilote qui peut voler à l’aide d’instruments en toute sécurité et atterrir en toute sécurité s’il prend ces instruments au sérieux. Mais le monde extérieur — les nuages, la foudre, le vent — ne fait pas partie du tableau de bord. Donc, cette idée que ce que nous voyons est le monde tel qu’il est en soi est ce que le professeur Donald Hoffman appelle « une erreur de débutant » [9]. C’est très naïf.
De nombreuses recherches ont été menées dans ce domaine, mais beaucoup de défenseurs de la position matérialiste ne le comprennent pas. Ils pensent que le monde de couleurs qu’ils voient existe réellement. Mais il n’y a pas de couleurs dehors. Il n’y a pas de sons dehors. Il n’y a pas de saveurs. Selon le matérialisme, les couleurs, les sons, les saveurs sont tous générés par le cerveau à l’intérieur de notre crâne. Ainsi, lorsqu’ils affirment que ce que nous pouvons voir et goûter est tout ce qui existe, leur position est contradictoire.
Leur réponse à ce type de critique est qu’il existe bel et bien un monde extérieur, mais qu’il n’a simplement aucune couleur ni aucun sens ; il est purement abstrait. Il s’agit d’un ensemble de relations géométriques que l’on peut visualiser comme des équations mathématiques flottant dans l’espace vide. Mais en réalité, même cela va trop loin, car cela implique déjà des qualités. Le « monde réel » que postule le matérialisme est donc en fait une pure abstraction. Combien de personnes ordinaires — des personnes éduquées qui ne sont pas spécialisées dans ce domaine — comprennent vraiment ce qu’est le matérialisme ? Si elles le comprenaient, il serait bien plus facile de le rejeter.
Le matérialisme en tant que métaphysique
Richard : L’une des choses sur lesquelles vous attirez l’attention est l’incapacité générale des intellectuels de notre société à s’intéresser à la métaphysique, et ce, depuis très longtemps. La plupart des scientifiques ne reçoivent même pas de formation en philosophie des sciences, ce qui doit être l’une des raisons pour lesquelles nous nous trouvons dans cette situation.
Bernardo : Le problème est que le mot « métaphysique » est désormais associé à des méthodes introspectives d’acquisition de connaissances, telles que la prière, la méditation ou le mysticisme. Dans la culture populaire, le mot métaphysique désigne donc aujourd’hui quelque chose de spirituel. Ce n’est pas du tout l’origine du mot et ce n’est pas ainsi que je l’utilise.
La métaphysique signifie simplement l’étude de ce qui est, et elle n’est pas du tout la même chose que la physique. La science étudie le comportement des choses, et non leur nature intrinsèque. La méthode scientifique consiste à mettre en place une expérience qui interroge la nature : si je crée ces circonstances, comment va-t-elle se comporter ? Ensuite, vous menez l’expérience et la réponse est un comportement que vous pouvez vérifier par rapport à vos modèles mathématiques prédictifs.
La métaphysique est informée par la science, car, si vous avez une théorie métaphysique qui implique que la nature devrait se comporter comme A et que la science vous montre qu’elle se comporte comme B, alors votre théorie métaphysique est erronée. Ainsi, quelle que soit la théorie métaphysique que vous produisez, elle doit être cohérente avec le comportement de la nature comme prédit par une science correcte et fiable.
Le problème actuel est que nous avons une métaphysique appelée matérialisme. Mais elle est devenue si enracinée que les gens ne la considèrent plus comme une théorie métaphysique. Ils la considèrent comme un fait. Le matérialisme n’est pas la science ; c’est une affirmation sur la nature des choses, à savoir que les choses sont matérielles et non mentales.
De plus, c’est une théorie extrêmement compliquée, et l’une des pires que nous ayons jamais eues à bien des égards : en termes de pouvoir explicatif, de parcimonie, de cohérence et même d’adéquation empirique. Elle ne parvient pas à expliquer beaucoup de choses ; nous avons par exemple une théorie cosmologique qui, de son propre aveu, n’est valable que pour 5 % du contenu de l’univers. Le reste, ce qu’on appelle la « matière noire » et l’« énergie noire », n’est pas compris du tout.
Un monde idéaliste
Richard : Si la vision matérialiste du monde venait à être supplantée — et on peut supposer que ce n’est qu’une question de temps — et que votre idée de la primauté de l’esprit ou de la conscience venait à être largement adoptée, quelle différence cela ferait-il dans nos vies ?
Bernardo : Eh bien, d’une part, le monde aurait soudainement un sens, comme je l’ai dit plus tôt.
Il y a aussi beaucoup d’aspects pratiques. Si nous commençons à nous considérer comme des êtres essentiellement mentaux et à voir notre corps comme une manifestation des processus mentaux, nous devons prendre au sérieux les soins de santé mentale. Nous devons considérer l’esprit comme une voie potentielle et complémentaire pour résoudre les problèmes organiques. Cela ajouterait une toute nouvelle voie pour l’amélioration des soins de santé, en plus des médicaments et de la chirurgie.
Ne vous méprenez pas, je prends les médicaments et la chirurgie très au sérieux. Ils m’ont sauvé la vie plus d’une fois. Nous ne devons absolument pas les négliger. Nous devons les étudier, et nous ferions probablement mieux d’investir dans ce domaine plutôt que dans le prochain super-accélérateur de particules. Mais il me semble insensé d’ignorer cette autre voie qui pourrait offrir des solutions à des problèmes pour lesquels nous n’avons aujourd’hui aucun remède, comme le cancer. Que se passe-t-il réellement avec le cancer ? Certaines parties du corps désobéissent soudainement au chef d’orchestre, et un membre de l’orchestre commence à jouer séparément. Cela ne ressemble-t-il pas à l’apparence extrinsèque d’un processus dissociatif interne ?
Les chercheurs actuels sont mal à l’aise si vous leur posez des questions à ce sujet et disent qu’ils ne savent même pas par où commencer. Cela s’explique par le fait que, dans notre société, nous sommes très peu sophistiqués en matière de psychologie. Si l’on compare cela au développement de la médecine physique, nous n’en sommes même pas au stade où l’on utilise du mercure pour traiter la syphilis ou des sangsues pour sucer le sang des gens afin de guérir la fièvre. Nous avons à peine commencé à prendre des mesures pour parvenir à une compréhension correcte et approfondie de l’esprit.
Et cela est le résultat direct de nos préjugés métaphysiques. Si nous considérons l’esprit comme une sorte de sous-produit ou d’épiphénomène de la matière — voire comme une illusion —, il est évident que nous ne faisons pas l’effort de l’étudier de manière approfondie ou de développer de nouveaux langages qui nous aideraient à le comprendre. Et comme nous ne le comprenons pas bien, nous ne savons même pas par où commencer pour réfléchir aux phénomènes psychosomatiques. Cela devient alors une sorte de cercle vicieux qui perpétue la situation. Tout cela changerait si nous adoptions un point de vue idéaliste.
Jane : Ne pensez-vous pas que beaucoup de gens dans le monde occidental explorent déjà ce point de vue ? Un nombre considérable de personnes pratiquent aujourd’hui une forme de méditation, de pleine conscience ou d’introspection, et il existe une grande connaissance des traditions, telles que le Vedanta et le bouddhisme, qui ont développé des théories très sophistiquées sur l’esprit et la conscience au cours des millénaires. De plus, des personnes comme Francisco Varela et Matthieu Ricard — sans parler du Dalaï-Lama — s’efforcent de jeter des ponts entre les conceptions bouddhistes et la science occidentale.
Bernardo : Je pense que ce sont des démarches très louables que nous devrions poursuivre. Mais je pense que, d’une manière générale, notre compréhension manque encore de sophistication, tant en ce qui concerne la méditation que, par exemple, de ce qu’est le bouddhisme. Les gens pensent que dans le bouddhisme, il n’y a pas de soi, mais, en réalité, ce que cela signifie vraiment, c’est qu’il n’y a pas de soi individuel et autonome (ou isolé). Je pense qu’il y a toujours un risque à vouloir faire correspondre les courants sophistiqués de la spiritualité orientale à une forme de matérialisme et, par conséquent, à passer à côté de l’éléphant dans la pièce.
Cela se produit parce que les gens ont besoin de préserver les valeurs auxquelles nous nous sommes publiquement engagés, qui sont fondées sur des hypothèses matérialistes. Ils veulent aider le matérialisme à survivre à l’amélioration de notre compréhension dans des domaines de pointe, tels que la mécanique quantique et les neurosciences, et trouvent donc des moyens toujours plus tortueux et acrobatiques de concilier le matérialisme avec les découvertes récentes. Et cela inclut la manière dont la spiritualité orientale est abordée.
Richard : Pour finir, aimeriez-vous dire quelques mots sur votre nouveau rôle de directeur exécutif de la Fondation Essentia ?
Bernardo : Oui. En bref, je dirige désormais une nouvelle organisation dont l’objectif est de promouvoir la science et la philosophie qui soutiennent l’idéalisme. Nous essayons de réunir les chercheurs les plus importants et de produire du contenu gratuit — audio, visuel et écrit. Il y a déjà beaucoup de choses en ligne, et de nouveaux contenus sont ajoutés chaque semaine.
Jane : Cela semble très intéressant. Nous vous souhaitons bonne chance dans ce nouveau projet et vous remercions de nous avoir accordé cet entretien.
Pour en savoir plus sur Bernardo et son travail, consultez son site web www.bernardokastrup.com
Interview originale de 2021 : https://besharamagazine.org/science-technology/mind-over-matter/
_______________________________
1 BERNARDO KASTRUP, Why Materialism is Baloney: How true skeptics know there is no death and fathom the answers to life, the universe, and everything (Iff Books, 2014 ; tr fr Pourquoi le matérialisme est absurde).
2 BERNARDO KASRUP, The Idea of the World; A multi-disciplinary argument for the mental nature of reality (Iff Books, 2019).
3 BERNARDO KASTRUP, Brief Peeks Beyond: Critical essays on metaphysics, neuroscience, free will, skepticism and culture (Iff Books, 2021).
4 BERNARDO KASTRUP, Decoding Schopenhauer’s Metaphysics: The key to understanding the hard problems of consciousness and the paradoxes of quantum mechanics (Iff Books, 2020).
5 BERNARDO KASTRUP, Decoding Jung’s Metaphysics: The archetypal semantics of an experiential universe (Iff Books, 2021).
6 DAVID CHALMERS: ‘Facing up to the Hard Problem of Consciousness’ in Journal of Consciousness Studies 2, no.3 (1995), pp.200–19.
7 MILAN KUNDERA, The Unbearable Lightness of Being (trans. Michael Helm, Faber & Faber, 1985 ; tr fr L’insoutenable légèreté de l’être).
8 BERNARDO KASTRUP, More than Allegory: On religious myth, truth and belief (Iff Books, 2016).
9 DONALD HOFFMAN, The Case Against Reality: How Evolution Hid the Truth from Our Eyes (W.W. Norton & Company, 2019).