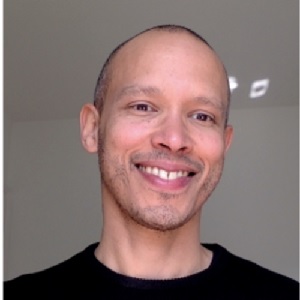Certaines moisissures gluantes peuvent prendre des décisions, résoudre des labyrinthes et se souvenir de choses. Que pouvons-nous apprendre du blob ?
 Physarum Polycephalum (Wikipédia)
Physarum Polycephalum (Wikipédia)
Pendant la pandémie de COVID-19, certaines personnes se sont mises à faire du pain, d’autres ont décidé d’adopter un chien ; moi, j’ai choisi de cultiver et d’observer une moisissure gluante. Le bureau de l’appartement de mon partenaire à Édimbourg est devenu le foyer de deux cultures de Physarum polycephalum, une moisissure gluante acellulaire parfois appelée plus familièrement « le blob ».
J’ai entamé une série d’expériences pour étudier combien de temps il fallait à deux masses cellulaires séparées issues d’une même cellule de Physarum coupée en deux cessent de fusionner l’une avec l’autre lorsqu’elles sont réintroduites. Les heures sont devenues des jours, les jours des semaines, et, faute de temps, l’expérience s’est finalement arrêtée après environ six semaines. Ce n’était toutefois que le début. Au cours de l’année suivante (à l’insu de nos voisins), j’ai mené plusieurs autres expériences. Bien qu’aucune n’ait été publiée, chacune a inspiré de nouvelles questions philosophiques — qui continuent encore aujourd’hui à orienter ma réflexion. L’une des questions centrales était : que peut nous apprendre le comportement des moisissures gluantes sur la mémoire biologique ?
Les différences entre P. polycephalum et les humains peuvent sembler immenses, mais les moisissures visqueuses peuvent révéler des éléments remarquables sur divers aspects de notre mémoire. Alors que beaucoup de gens supposent que nos souvenirs sont principalement stockés dans notre cerveau, certains philosophes comme moi soutiennent que — tout comme certains autres aspects de la cognition — la mémoire peut dépasser les limites du corps pour inclure des interactions couplées avec des structures dans l’environnement. En bref, au moins une partie de nos processus cognitifs s’étend à notre environnement. La moisissure gluante est un candidat intrigant pour explorer cette idée, car elle ne possède pas de cerveau, mais peut parfois « se souvenir » de certaines choses sans avoir besoin de stocker ces souvenirs en elle-même. Dans d’autres cas, des souvenirs acquis par apprentissage chez un individu peuvent même être transmis à un autre individu par simple contact physique. Le comportement de cette forme de vie étrange suggère que certaines de nos idées sur l’acquisition des souvenirs mériteraient d’être réévaluées.
Physarum polycephalum est un organisme ressemblant à un blob qui appartient à la classe des Myxomycètes, également appelés « moisissures gluantes acellulaires ». Contrairement aux moisissures gluantes cellulaires, qui sont des micro-amibes unicellulaires se rassemblant en une agrégation géante en forme de limace lorsqu’elles sont affamées, Le Physarum est constitué d’une seule mégacellule géante. Il possède un cycle de vie complexe composé de deux stades végétatifs distincts : un stade microscopique appelé «stade amiboflagellé » — qui apparaît après la germination des spores — et un stade macroscopique appelé « stade plasmodial ». Ce dernier, qui ressemble à une tache de peinture jaune vif et veinée, est devenu le principal objet de recherche expérimentale. Cela s’explique non seulement par sa taille impressionnante (pouvant atteindre jusqu’à 2 mètres carrés), mais aussi par sa locomotion étonnamment rapide — jusqu’à 5 cm par heure. Pas mal pour un blob.
Il se déplace sur les surfaces par des contractions oscillatoires de ses tubules internes en forme de veines, qui redistribuent le protoplasme vers les bords cellulaires, formant des excroissances ressemblant à des structures aplaties, jaunes et semblables à du chou-fleur. Pendant le stade plasmodial, Physarum se nourrit activement de micro-organismes et de matières en décomposition, deux sources d’alimentation abondantes dans son habitat naturel : les sols forestiers et les sous-bois. Il prospère dans la litière humide, les bûches pourries et les souches d’arbres, se dirigeant vers les sources de nourriture et les enveloppant tout en évitant la lumière directe du soleil et les surfaces sèches.
Le Physarum pouvait trouver le chemin le plus court dans un labyrinthe en optimisant son réseau de tubes protoplasmiques
Pendant une grande partie de son histoire scientifique, le Physarum a été classé à tort parmi les champignons, principalement en raison de sa capacité à produire des spores dans des corps fructifères pédonculés, similaires aux structures productrices de spores des champignons. Son nom d’espèce polycephalum, qui signifie littéralement « à plusieurs têtes », fait référence aux multiples structures sporifères (sporanges) de son corps fructifère, qui ressemblent à de petites têtes. Cependant, des études ultrastructurales menées dans les années 1970 et des analyses phylogénétiques moléculaires ultérieures, à la fin du XXe siècle, ont révélé que les moisissures gluantes acellulaires appartiennent en réalité aux Amoebozoaires, un groupe de protistes unicellulaires plus proches des amibes que des champignons.
L’intérêt scientifique pour le Physarum a explosé dans les années 1970 et 1980, avec des laboratoires en Europe, en Amérique et au Japon étudiant son comportement. Cependant, à la fin du XXe siècle, les recherches ont diminué. Une exception importante fut le Japon, où les études sur le Physarum ont continué, menant à plusieurs découvertes majeures. L’une des plus importantes eut lieu en 2000, lorsque Toshiyuki Nakagaki montra que le Physarum pouvait trouver le chemin le plus court dans un labyrinthe en optimisant son réseau de tubes protoplasmiques entre des sources de nourriture. Au départ, le plasmodium s’étendait et reliait les sources de nourriture par plusieurs chemins dans le labyrinthe. Mais ensuite, il rétractait sélectivement les chemins inefficaces, ne laissant que le chemin le plus court et le plus efficace. Cette recherche, publiée dans Nature, relança l’intérêt mondial pour le comportement des moisissures gluantes, inspirant une vague d’études sur les capacités de résolution de problèmes et d’apprentissage du Physarum.
Une partie notable de ce renouveau a été menée par des chercheurs comme Audrey Dussutour en France, ainsi que Tanya Latty, Madeleine Beekman et Chris Reid en Australie, qui ont commencé à mener des expériences ciblées sur la remarquable capacité du Physarum à prendre des décisions adaptatives, résoudre des labyrinthes et même manifester de l’accoutumance — une forme simple d’apprentissage. Sur le point d’être oublié, P. polycephalum est désormais reconnu comme un organisme modèle précieux en biologie comportementale. Certains chercheurs ont même exploré son potentiel en tant qu’ordinateur non conventionnel, montrant comment il pouvait exécuter des tâches de traitement de l’information et imiter des composants électroniques.
Mais comment un organisme apparemment simple comme une moisissure gluante peut-il se souvenir ?
Partout où ils migrent, les Physarum polycephalum laissent derrière eux des traces de mucus extracellulaire — un mucopolysaccharide non vivant. Dans la nature, on trouve le plus souvent ces traînées dans des zones déjà explorées par la moisissure gluante, et donc appauvries en nourriture. En principe, rencontrer cette substance pourrait donc indiquer à la moisissure la disponibilité de nourriture dans la zone — mais le mucus extracellulaire est-il réellement utilisé comme trace mnésique ?
Pour explorer cette possibilité, le biologiste Chris Reid et ses collègues ont mené en 2012 une expérience plutôt ingénieuse. Ils ont utilisé deux conditions expérimentales différentes. Dans la première condition dite « vierge », ils ont tapissé une boîte de Petri d’Agar non traité, y plaçant une goutte d’une solution de glucose à forte concentration — un « objectif ». Le glucose diffusé créait un gradient d’attraction que la moisissure pouvait suivre, se dirigeant vers la source de nourriture. Toutefois, les chercheurs ont également placé un obstacle sur le trajet : un piège sec en acétate en forme de U entre la source de nourriture et le « point de départ » de la moisissure. Les moisissures gluantes ne se déplacent pas efficacement sur des surfaces sèches ; comme dans les expériences précédentes sur les labyrinthes, elles devaient donc trouver la meilleure route pour contourner l’obstacle. Dans la seconde condition dite « recouverte », la configuration était identique, à l’exception du fait que l’Agar était recouverte d’une couche de mucus extracellulaire — comme si la moisissure avait déjà exploré la zone et y avait laissé des traces.
Reid et ses collègues ont émis l’hypothèse que, si le Physarum utilise le mucus extracellulaire comme trace mnésique de zones déjà explorées et probablement appauvries, alors les plasmodiums confrontés à ces traces dans la condition recouverte devraient mettre significativement plus de temps à atteindre l’objectif que ceux de la condition vierge. Dans la nature, une trace environnementale d’une zone déjà exploitée et épuisée serait utile : elle indiquerait à un Physarum d’aller voir ailleurs. Mais dans cette configuration expérimentale particulière, les chercheurs ont estimé que recouvrir entièrement la surface d’Agar de mucus extracellulaire ralentirait la navigation, car cette surface uniformément recouverte rendrait les propres traces du Physarum indistinctes et donc inutilisables. À l’inverse, les plasmodiums sur des surfaces vierges pouvaient déposer et utiliser leurs propres traces distinctes, créant une carte spatiale différenciée leur permettant d’éviter les zones déjà explorées.
Et c’est précisément ce qu’ils ont observé. Les plasmodiums dans la condition recouverte ont mis dix fois plus de temps à atteindre l’objectif que ceux de la condition vierge. Dans ce cas, le mucus extracellulaire n’aidait pas réellement l’organisme, mais il a permis aux chercheurs de comprendre qu’il l’utilisait comme trace mnésique.
Après avoir terminé mon doctorat à l’Université d’Édimbourg, l’un de mes directeurs de thèse et moi avons décidé de cosigner un article visant à déterminer si ces résultats soutiennent l’hypothèse de la cognition étendue (HEC) — une idée introduite par les philosophes Andy Clark et David Chalmers à la fin des années 1990. En résumé, HEC affirme que les processus cognitifs ne sont pas toujours confinés au fonctionnement interne du cerveau, mais peuvent parfois s’étendre au cerveau, au corps et aux structures de l’environnement. Des exemples quotidiens incluent l’utilisation de téléphones intelligents pour stocker et rappeler des numéros, ou le fait d’effectuer des calculs sur papier. Dans cette perspective, la cognition peut s’étendre au cerveau, au corps et au monde. Nous avons été attirés par HEC pour plusieurs raisons. Outre notre lien commun avec Clark — qui était aussi mon directeur de thèse —, je m’étais de plus en plus intéressé à l’évolution de la cognition et à la façon dont des organismes non neuronaux pourraient fournir des indices sur son fonctionnement chez les animaux. De manière importante et pertinente, si des bactéries, des ciliés et des protistes — des organismes totalement dépourvus de neurones — manifestent des capacités comme l’apprentissage, la mémoire et le comportement d’anticipation, alors la focalisation traditionnelle de HEC sur l’extension cognitive entre le cerveau, le corps et le monde semblait trop restrictive.
L’étude de Reid constitue un exemple clair où une trace mnésique existe dans l’environnement et est utilisée par l’organisme pour guider son comportement futur lorsqu’elle est rencontrée. Typiquement, on considère que la mémoire biologique implique un changement interne, dépendant de l’expérience, pouvant être rappelé et utilisé ultérieurement. Mais ici, l’utilisation que fait le Physarum de son mucus pour naviguer dans des zones appauvries en nourriture démontre une forme de mémoire spatiale qui traverse corps et environnement. En ce qui concerne HEC, c’est vraiment une évidence.
Tout comme les humains peuvent utiliser des téléphones portables ou des carnets pour stocker des souvenirs, les moisissures gluantes peuvent utiliser du mucus.
Une expérience de suivi menée en 2013 renforce cette interprétation. Cette fois, l’équipe de Reid a montré que l’évitement du mucus extracellulaire n’est pas simplement un réflexe aversif ou une réponse fixe. Lorsqu’un plasmodium était placé dans un labyrinthe en forme de Y, où du mucus extracellulaire se trouvait entre lui et une source de nourriture très nutritive (du jaune d’œuf) qu’il avait perçue, le plasmodium ignorait le mucus et le traversait pour atteindre la nourriture. Ce résultat montre de manière importante que le mucus, en tant que trace mnésique, peut être écrasé face à une nouvelle information saillante — en l’occurrence, la présence de nourriture de haute qualité — ce qui satisfait à un critère largement accepté pour la mémoire de navigation. La mémoire de navigation, comme d’autres capacités cognitives, a probablement évolué pour guider le comportement adaptatif dans des environnements dynamiques. Sans la capacité d’être remplacée en présence d’une nouvelle information, une telle mémoire risquerait d’enfermer un organisme dans des routines inadaptées. Dans le cas du Physarum, cela signifierait ignorer de la nourriture disponible simplement parce qu’elle est proche d’une trace de mucus habituellement stérile. Le fait que la nourriture soit de haute qualité comptait aussi : cela suggère que le dépassement du signal de mucus par le Physarum est un processus d’évaluation intégré — analogue à une analyse coûts-bénéfices. La mémoire, à la différence de simples circuits stimulus-réponse, est intégrée à l’économie cognitive plus large d’un organisme.
Tout comme les humains peuvent utiliser des téléphones portables ou des carnets pour stocker et rappeler des souvenirs, les moisissures gluantes peuvent utiliser du mucus. Certes, la mémoire numérique et la mémoire de navigation diffèrent dans leur nature, mais le point essentiel demeure : le Physarum a découvert, au cours de son évolution, une solution externe à la mémoire bien avant les humains.
Le fait que le mucus extracellulaire puisse être utilisé comme trace mnésique par n’importe quelle moisissure gluante apparentée à celle qui l’a laissé soulève une question importante : à qui appartient cette mémoire ? Une trace mnésique est classiquement considérée comme acquise par apprentissage dépendant de l’expérience et appartenant à l’individu qui l’a acquise. Dans le cas du Physarum, cependant, la cellule qui utilise le mucus extracellulaire et celle qui l’a déposée peuvent être différentes. Voici une manière d’aborder ce paradoxe : si le mucus n’est pas de nouveau rencontré et utilisé par le plasmodium qui l’a laissé (ou par une autre cellule apparentée), il ne peut pas être qualifié de trace mnésique. Une trace mnésique n’est créée que lorsqu’un plasmodium interagit avec le mucus extracellulaire et l’utilise pour naviguer et guider son comportement futur. Ainsi, si le mucus est qualifié de trace mnésique, cette mémoire appartient à la moisissure gluante qui la rencontre et l’utilise. Le neurophilosophe Julian Kiverstein et moi avons appelé ce processus — où le stockage et le rappel de la mémoire sont étroitement liés dans les cas de mémoire spatiale externalisée — la « fabrication de mémoire ». À l’inverse, une trace mnésique acquise par apprentissage puis stockée à l’intérieur d’un organisme ne dépend pas de son utilisation pour être considérée comme (sa) mémoire.
Ce qui rend la mémoire des moisissures gluantes si intéressante, c’est que — du moins dans certains cas — elle ne semble pas nécessiter d’apprentissage par expérience directe, chose que l’on pourrait supposer indispensable en pensant à nos propres souvenirs.
Puisque les traces de mucus sont laissées partout où une moisissure gluante rampe, une telle mémoire potentielle ne résulte pas d’un apprentissage préalable par la moisissure qui a laissé l’indice. Si cela est correct, alors l’utilisation du mucus extracellulaire par le Physarum constitue un exemple important de mémoire sans apprentissage — où la trace mnésique externe n’a pas été formée par apprentissage de la part de l’individu qui l’a laissée. Le Physarum manifeste aussi une mémoire sans apprentissage d’une autre manière — lorsqu’une trace mnésique interne est acquise sans apprentissage de la part de l’individu qui l’utilise. Pour comprendre comment cela fonctionne, considérons maintenant un exemple d’apprentissage par habituation et de stockage de mémoire internalisé chez le Physarum, qui est à la base de cette seconde forme de mémoire sans apprentissage. Une expérience dirigée par le biologiste Romain Boisseau est illustrative.
La cellule naïve a acquis une mémoire sans s’être elle-même habituée par une expérience directe avec le sel.
En 2016, Boisseau et ses collègues ont montré qu’après avoir placé à plusieurs reprises une cellule plasmodiale à une extrémité d’un pont d’Agar et déposé une petite quantité d’un stimulus aversif (quinine) entre elle et une source de nourriture, la moisissure gluante entraînée commençait à s’approcher plus rapidement de la nourriture, ignorant le stimulus aversif. Cette diminution de la réponse face à une exposition répétée au même stimulus a constitué la première preuve claire que le Physarum peut s’engager dans un apprentissage par habituation. Comme pour l’utilisation du mucus extracellulaire par le Physarum, cet exemple implique une forme de mémoire non déclarative — une mémoire exprimée par le comportement sans réflexion ou rappel conscient — mais au lieu d’une mémoire spatiale non déclarative, il s’agit ici d’une tolérance à un stimulus aversif.
Et comme si cela ne suffisait pas, des recherches ultérieures ont montré que les moisissures gluantes peuvent même transférer des souvenirs d’un individu à un autre. Dans une étude de suivi menée en 2016, David Vogel et Audrey Dussutour ont découvert qu’une cellule de Physarum naïve, non entraînée, après avoir brièvement fusionné avec une cellule entraînée et habituée, manifestait par la suite la même réponse d’habituation au sel — un stimulus aversif. Fait important, la cellule naïve a manifesté cette réponse même après séparation des deux cellules, s’approchant plus rapidement de la source de nourriture au bout d’un pont contenant du répulsif salin. En d’autres termes, la cellule naïve a acquis une mémoire sans s’être elle-même habituée par contact direct avec le sel.
Cela soulève une question : à qui appartient cette mémoire ? Comme dans le cas de la fabrication de mémoire, je souhaite suggérer que, dans le cas d’une mémoire transférée, elle appartient à la cellule plasmodiale qui utilise la trace, dans la mesure où son comportement est guidé par elle. Nous pouvons maintenant justifier cette position pour les deux types de mémoire sans apprentissage. Si la mémoire est un trait biologique soumis à la sélection naturelle, alors la sélection agit principalement sur l’organisme qui tire un avantage adaptatif de l’utilisation de la trace mnésique. Cela dit, comme les plasmodiums étroitement apparentés fusionnent fréquemment pour former une cellule plus grande, dans certains cas, les bénéfices liés à l’utilisation de la mémoire peuvent également s’étendre indirectement au producteur original du mucus extracellulaire. Par exemple, si le producteur fusionne ensuite avec l’utilisateur de la mémoire, il peut bénéficier de l’efficacité de recherche alimentaire antérieure de ce dernier (c’est-à-dire de sa bonne nutrition). Ainsi, sur des échelles de temps évolutives, la sélection pourrait agir non seulement sur la capacité à utiliser les traces de mucus comme mémoire, mais aussi sur la tendance à y laisser des informations chimiques les rendant plus identifiables pour les apparentés, en particulier si cela profite de façon fiable à la condition physique des cellules parentes.
Alors, que peut nous apprendre la moisissure gluante sur la mémoire biologique ? Une leçon est que la mémoire spatiale ne doit pas nécessairement être entièrement confinée à l’intérieur d’un organisme (à la HEC). De plus, ce qui devient trace mnésique lorsqu’il est utilisé (par exemple, le mucus extracellulaire) ne résulte pas nécessairement d’un apprentissage de la part du producteur de la trace. Autre enseignement : dans certains cas, un individu peut acquérir une telle mémoire sans s’être engagé lui-même dans un processus d’apprentissage. Cela soulève un parallèle intriguant avec le cas humain. Nous lisons et utilisons régulièrement des instructions, des cartes et des manuels rédigés par d’autres, nous appuyant sur des informations issues de leurs expériences, et non des nôtres. Bien que ces sources d’information externalisées soient généralement de nature déclarative — conçues pour représenter explicitement des faits — nous agissons souvent en fonction d’elles de manière automatique, sans avoir besoin de les rappeler consciemment ni d’y réfléchir. De cette manière, elles orientent le comportement d’une manière qui ressemble fonctionnellement à une mémoire non déclarative. Même si l’analogie ne doit pas être poussée trop loin, les cas humains et de la moisissure gluante illustrent tous deux comment la mémoire peut se dissocier de l’apprentissage individuel, devenant accessible à d’autres par le biais de structures environnementales.
Ces conclusions, bien entendu, demeurent controversées au sein des sciences cognitives et de la psychologie traditionnelles, où la mémoire est souvent définie comme le résultat d’un apprentissage par l’individu dont c’est la mémoire. Malgré les mises en garde importantes émises par des chercheurs comme Francis Crick en 1984, le stockage de la mémoire est encore souvent attribué à la plasticité synaptique — des changements dans la force des connexions entre neurones — ce qui écarte d’emblée la possibilité même de traces mnésiques externes. Cela dit, certains comme le psychologue C. Randy Gallistel — qui soutient depuis longtemps que la mémoire pourrait aussi être stockée dans des molécules comme l’ARN à l’intérieur du cerveau — sont restés vigilants à penser en dehors des cadres habituels. Cependant, étant donné les preuves empiriques de plus en plus nombreuses que le comportement guidé par la mémoire est présent chez des organismes non neuronaux, comme le Physarum, même cette pensée « hors des sentiers battus » reste solidement ancrée dans les conceptions traditionnelles selon lesquelles le cerveau est nécessaire à la mémoire et selon lesquelles une forme d’internalisme strict est incontournable — ce que HEC remet précisément en question. HEC et la mémoire sans apprentissage ne sont pas des idées faciles à avaler, mais, après tout, l’idée même qu’un organisme non neuronal puisse apprendre ne l’est pas non plus — et pourtant, le comportement du Physarum semble le confirmer sans équivoque.
Qu’il soit le sujet d’expériences menées en laboratoire (ou dans un petit bureau d’un appartement d’Édimbourg) ou celui d’une réflexion philosophique informée par les données empiriques, le Physarum est un organisme modèle précieux pour examiner, remettre en question et affiner certains de nos concepts biologiques les plus fondamentaux — comme celui de mémoire.
Matthew Sims est chercheur associé au Leverhulme Centre for the Future of Intelligence à l’Université de Cambridge, où il participe au projet Major Transitions in Cognitive Evolution. Il est l’auteur du livre Slime Mould and Philosophy (2024).
Texte original publié le 11 juillet 2025 : https://aeon.co/essays/what-can-slime-mould-teach-us-about-biological-memory