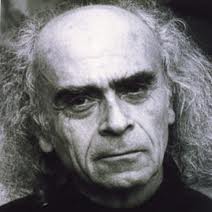(Revue Question De. No39. Novembre-Décembre 1980)
FRAGMENTS D’UN JOURNAL POUR UNE REFLEXION NOUVELLE
C’est dans un pays de granit que j’écris ces lignes. Je ne peux vivre dans un pays de béton, car le béton est un astre froid, mort depuis longtemps et que le soleil ne parvient pas à régénérer de son souffle. Je ne peux écrire que dans un pays de granit parce que seule cette roche est capable de transmettre le rayonnement intense de l’univers. Des esprits chagrins diront que ce granit est malsain parce qu’il contient du radium, de l’uranium et divers éléments assez redoutables malgré leur quantité dérisoire. La Bretagne, avec ce socle granitique qui la caractérise, est en effet l’une des régions où la radioactivité est la plus forte, atteignant même ce qu’on nomme « le Seuil de tolérabilité ». Après tout, la Bretagne a toujours été ouverte sur des mondes étranges : il y souffle le vent de l’Autre Monde celtique, celui qui ne se trouve pas en bas ou en haut, mais à côté, et il faut que le rayonnement de la terre y soit intense pour nos cerveaux engourdis par le gel de la logique aristotélicienne. Mais je ne peux m’empêcher de penser que la seule centrale nucléaire existant actuellement en Bretagne, à Brennilis, se dresse au milieu d’un marécage étrange, le Yeun Ellez, où la tradition place l’entrée du monde infernal. Coïncidence ? Alors, comment se fait-il qu’on veuille implanter une autre centrale nucléaire à Plogoff, non loin d’une baie qui est connue comme « l’Enfer de Plogoff » ? Il y a d’étranges rencontres entre l’enfer et l’énergie nucléaire.
Le héros et le pacte
D’ailleurs, si on survole le légendaire breton, on s’aperçoit que le diable y est toujours présent. Est-ce par suite d’un phénomène de rejet provoqué par la christianisation des anciens mythes païens ? Je le crois. Les êtres diaboliques des légendes bretonnes sont souvent des dieux rejetés dans les ténèbres pour cause d’anathème. Est-ce pour cela qu’ils sont diablement intéressants ?
Car le diable des légendes n’est pas Satan, le Shatam hébraïque, l’ange déchu, symbole du Mal et que les Indo-Iraniens ont nommé Ariaman ou Aryman (et qui paradoxalement était l’ancien dieu des Aryas, comme s’en est souvenu, hélas, un certain Hitler). Le diable des légendes est étymologiquement celui qui se jette en travers. Dans le schéma le plus courant, le héros de l’histoire le rencontre à un carrefour. Le diable apparaît alors sous son aspect le plus humain, le plus courtois, mais aussi le plus inquiétant, l’aspect d’un homme vêtu de noir, ou encore sous une forme féminine ambiguë, celle de la sorcière, belle ou laide, mais toujours énigmatique [1].
Car le diable, par nature, dérange un ordre établi, une situation donnée, une vie qui semblait tracée d’avance. La rencontre du diable, au carrefour, équivaut à une étape fondamentale de la démarche du héros. Tout à coup, le temps s’arrête, l’espace est bouleversé, et surtout le sens de la quête qui poursuivait inconsciemment le héros se trouve inversé. Et que le héros signe avec le diable le fameux pacte, ou qu’il se contente d’écouter ses paroles, rien n’est plus comme avant. Il arrive également que le héros, caché sur un arbre, entende la voix du diable et apprenne ainsi des secrets refusés au commun des mortels [2]. Caché et donc protégé des redoutables pouvoirs de la connaissance, le héros peut néanmoins les pratiquer pour son usage personnel. Là encore l’étape a été décisive, et le monde n’est plus comme avant.
Au fond, le thème de la Quête du Graal n’est pas différent : il s’agit d’un jeune héros, naïf et quelque peu imbécile, qui, de mésaventure en mésaventure, devient un homme accompli et un Sage, en possession des pouvoirs d’une Connaissance côtoyée sans cesse par les chevaliers mais qui échappe à leur volonté. Les mésaventures de Perceval sont autant de rencontres avec le diable. Et si dans la version christianisée de Chrétien de Troyes, encore plus dans le récit de Wolfram d’Eschenbach ou dans celui de la Quête, l’élément diabolique semble rejeté comme contrecarrant la démarche du héros, dans la version archaïque, celle du Peredur gallois [3], les choses sont bien différentes : le diable n’y apparaît que sous sa forme féminine, celle de l’Initiatrice. En effet, le héros s’égare tant qu’il peut au cours de son voyage vers le Château des Merveilles. Il ne voit rien de ce qu’il devrait voir. Il est perdu parmi les apparences que prennent les êtres et les choses, dans un univers en contradiction avec lui-même et qui est l’image du chaos de l’âme. Et c’est le personnage de l’Impératrice, femme aux multiples visages, transfiguration de la Mère et de la Maîtresse, qui, attendant Peredur à chaque croisée des chemins, lui indique diaboliquement le sentier sur lequel il doit s’engager.
L’Autre
Cette rencontre de Peredur avec l’Impératrice, ou du héros d’un conte populaire avec le diable, provoque donc une rupture : le héros se trouve brutalement confronté avec un réel qu’il ne voyait pas et dont il n’imaginait pas la puissance. Ce réel, sous les traits démystifiants du diable ou de la sorcière, c’est sa propre image inversée, comme dans un miroir. Alors il peut contempler l’Autre, cet insaisissable personnage qui le hante et qu’il n’arrive pas à extérioriser : l’Autre, en effet, fait partie de lui-même, et ce n’est qu’au moyen d’une véritable opération chirurgicale, le choc, qu’il peut en accoucher. Et là réside, comme une surprise, la découverte essentielle du héros de la quête.
Car JE est AUTRE et pourtant JE n’est pas AUTRE. Ce paradoxe ne se comprend que dans un contexte différent de celui de la logique classique. Dans sa quête du Château des Merveilles, Peredur-Perceval, dans un premier temps, obéit aveuglément aux conseils de sa mère. Il suit donc une éducation traditionnelle dans le mauvais sens du terme, tradition recouvrant malheureusement trop souvent routine ou « ce qui va de soi ». D’où les échecs du héros. La rencontre, qui le met en face de lui-même, lui fait comprendre la multiplicité de son être pourtant unique et même singulier. A partir du moment où l’Autre, sous une forme différente, lui apparaît, il peut comprendre que son être recèle de multiples formes toutes aussi uniques que celle à laquelle il était habitué. La prise de conscience fondamentale, celle qui est nécessaire à toute expérience, est de s’identifier à l’Autre, que cet Autre soit un être animé, un végétal ou un minéral. Considérer une roche comme un soi extérieur est une des premières opérations du Grand-Œuvre des Alchimistes. Cela devrait être la première des prises de conscience obligatoires dans tout système cohérent d’éducation. Nous en sommes évidemment bien loin. Mais c’est alors qu’apparaît le diable, comme élément de connaissance ou de conscience, je serai tenté de dire même : élément de mauvaise conscience d’une société qui s’appuie sur des formes rigides, sur des dogmes immuables. On sait pourtant qu’un dogme n’est immuable que dans la mesure où l’on n’ose pas y toucher. Un dogme n’est valable que pour une époque déterminée, correspondant à un besoin précis. Il est capable, lui aussi, de revêtir les aspects les plus contradictoires et les plus surprenants.
C’est sans doute pour cela que le Druidisme, religion des anciens Celtes, ou du moins ce que nous en connaissons, a toujours refusé de se laisser enfermer dans le piège de la tradition écrite. L’oralité lui conférait sa force et sa constante faculté de se remettre en question. Il n’y a pas de diable dans la tradition celtique païenne, et cela parce qu’on n’avait pas besoin de lui. Les plus anciens textes celtiques recueillis, et qui sont irlandais [4], sont formels sur ce point : le diable ne montre le bout de son nez que dans les récits où la christianisation, ayant apporté avec elle la logique méditerranéenne, a rationnalisé des thèmes qui, dans l’origine, étaient proprement irrationnels, ou plutôt para-rationnels. C’est sans doute pourquoi les âges classiques ont écarté délibérément de leur jeu ces textes qui dérangeaient et qui n’étaient que puérilités, voire diableries. Les sociétés organisées à l’extrême se défendent avec violence quand on s’avise de percer une fenêtre dans un mur où elle n’était pas prévue. L’inquisition a été la défense d’un certain christianisme autoritaire et dépositaire d’une foi unique. Dans les religions où le dogme est soumis aux variances de l’oralité, une telle institution est non seulement impensable, mais en plus elle n’aurait aucune raison d’exister.
Le philtre
Mais le rejet de toute notion oui risque de troubler l’ordre établi est quasi général. Il s’étend dans tous les domaines. Ne s’est-on pas débarrassé, après mai 1968, du phénomène « gauchiste » en le marginalisant, c’est-à-dire en le tolérant dans un cadre extérieur à celui de la société. Cela a d’abord été l’université de Vincennes. On ne l’a créée que pour pouvoir y fixer des abcès. Lorsque ceux-ci sont devenus suffisamment purulents, on avait de bonnes raisons pour la détruire, même si officiellement on prétend que l’expérience doit être maintenue. Si Pascal vivait de nos jours, il écrirait sûrement des Provinciales pour dénoncer le jésuitisme du Pouvoir. Mais il faut avouer que c’est de bonne guerre, une société minée de l’intérieur résistant beaucoup moins à la fermentation que si elle est attaquée de l’extérieur par un ennemi visible et qui est, en définitive, un élément positif puisqu’il permet la cohésion de ladite société (comme ce fut le cas pendant la Première Guerre mondiale avec l’Union Sacrée).
C’est dans ce contexte qu’on peut tenter d’expliquer une légende celtique universellement connue, mais non moins universellement obscure, celle de Tristan et Yseult. Assurément, c’est l’aventure qui peut prétendre à être interprétée selon les critères les plus divers et les plus opposés. C’est d’ailleurs pour cela que cette légende; issue d’Irlande pendant les âges obscurs, s’est répandue aussi facilement dans le monde entier, faisant rêver les uns parce que c’est une belle histoire d’amour, plongeant les autres dans des abîmes de perplexité : après tout, on ne sait toujours pas qui est Yseult, ni qui est Tristan. Et chaque nouvelle rédaction de la légende déclenche le même processus d’interrogation [5].
En dehors du rôle proprement féminin qui est celui d’Yseult, la Femme-Soleil, que je pense avoir éclairé longuement dans un ouvrage déjà ancien [6], j’ai l’impression que rien n’est dit encore sur ce schéma tragique qui est celui des deux amants réunis dans l’instant suprême et éternel de la mort. Tout reste à découvrir, notamment ce que contenait le philtre qu’ils ont bu. Etait-ce un breuvage aphrodisiaque tel que l’on en consommait autrefois dans l’Antiquité ou pendant le Moyen Age ? Je ne parle évidemment par de ces élixirs commerciaux ridicules que la brutale libération de la sexualité a fait apparaître dans des boutiques spécialisées : là, il y a de toute évidence une escroquerie et une déviance qui ne sont pas dues au diable, mais à Satan lui-même, Satan le triomphateur et le Destructeur, l’anti-Amour, le maître de la Négation. J’ose prétendre au contraire que le philtre bu par Tristan et Yseult — et versé intentionnellement, sur l’ordre d’Yseult, par Brengwain, la suivante-déesse, — était le MIROIR PARFAIT où l’un et l’autre se sont vus dans leur réalité. Il n’y a donc rien d’aphrodisiaque dans le philtre, seulement la conscience fulgurante de la complémentarité de deux êtres. Et c’est cela qui est la plus haute définition de l’Amour.
Union faussée
Car cet étrange miroir où se trouvent cachées des choses diablement intéressantes reflète ce que les êtres n’osent pas sortir d’eux-mêmes à cause des interdits de la conscience morale et de la maturation culturelle dont ils sont les objets serviles. C’est le miroir d’Alice, mais comme Alice est une nymphette impubère et solitaire, ce sont ses fantasmes masturbatoires qui prennent corps. Ou mieux, ce sont les fantasmes de Lewis Carroll, superbe nympholepte comme le sera plus tard son compatriote John Cowper Powys [7]. Tandis que Tristan et Yseult, eux, prennent conscience, par leur image inversée, de ce qui est autre en eux, et donc de ce qui dérange le cours normal des choses. Et le cours normal des choses, c’est le mariage d’Yseult avec le roi Mark, mariage dans lequel elle se donnera vierge à l’époux que la société androcratique lui a choisi, paradoxalement mais logiquement par le biais de Tristan lui-même [8]. Le diable s’est jeté en travers. L’union d’Yseult avec Mark sera faussée dès le départ, et c’est ce que la Société ne pardonnera jamais aux deux amants, usant contre eux de toutes les inquisitions dont elle dispose jusqu’à leur destruction biologique.
Yseult est sorcière
Les expressions utilisées par le sens commun pour désigner l’état des deux amants, sont révélatrices des censures sociales qui pèsent sur eux. Tristan et Yseult ont notamment « le diable au corps ». Tristan est atteint de folie furieuse et Yseult a, très prosaïquement, « le feu au cul », ce qui sous-tend une notion d’enfer. D’ailleurs, Yseult n’est-elle pas une « diablesse » ? N’a-t-elle pas le don de guérir les blessures empoisonnées ? Le plus ennuyeux pour la Société, c’est qu’on ne peut pas la traiter de « pute ». Ce serait pourtant si commode, la putain justifiant la morale et l’ordre d’une société bien établie. Mais on a beau chercher, Yseult n’est pas une « pute », à la différence de Guénièvre, l’épouse du roi Arthur, dont le rôle mythologique est fondamentalement opposé [9].
Car Yseult est sorcière. Elle a hérité de sa mère, la reine d’Irlande, le don de guérir. Voilà qui est déjà diabolique. Mais dans le schéma de la légende, trois blessures rythment l’aventure. La première blessure est celle infligée par le Morholt, oncle d’Yseult. La seconde blessure est celle qui découle du combat avec le grand serpent crêté d’Irlande, image symbolique du pouvoir paternel qu’il faut vaincre pour obtenir Yseult. Yseult guérit les deux blessures de Tristan. La troisième, celle de la fin de l’histoire, sera par contre fatale aux deux amants, car Yseult arrivera trop tard. Mais il reste à s’interroger sur les trois blessures de Tristan : sont-elles réelles sur le plan corporel ou sont-elles de simples images destinées à accentuer l’appartenance de Tristan à Yseult ? Car, ce n’est plus à démontrer, Yseult est Déesse solaire tandis que Tristan est Dieu lunaire. Par conséquent, en bonne logique commune, la lune ne peut survivre que si elle est éclairée par les rayons du soleil. Sinon, elle n’est plus que Lune Noire, et les Grecs la nommaient Hécate, la sinistre déesse des carrefours. Tristan est actif, il est l’un des plus braves — et des plus cultivés — de son temps. Il faut qu’il puise son énergie quelque part. Et où le pourrait-il sinon dans les rayons émis par la figure solaire d’Yseult ? Etrange univers où la déesse du Soleil prime sur le Dieu-Lune des sociétés androcratiques… Mais ne sait-on pas qu’Apollon, le guérisseur, était également capable de lancer des flèches pour tuer ou blesser ? Cette terrible ambiguïté de la divinité, nous la retrouvons dans le cas de Tristan et Yseult.
La brûlure d’amour
Denis de Rougemont, dans son essai désormais classique sur l’Amour et l’Occident, met l’accent sur la brûlure que ressentent Tristan et Yseult et qui — fatalité du philtre — les oblige à s’aimer physiquement sous peine de perdre la vie. Le roman en prose de Tristan précise même que Tristan ne pouvait survivre que s’il s’unissait à Yseult dans les délais absolus. D’où les fréquents retours de Tristan déguisé à la cour du roi Mark. Il n’est pas difficile de reconnaître ici les phases de la lune. Parvenu à l’état de Lune Noire, Tristan est obligé de se régénérer au contact de la solaire maîtresse qui lui infuse sa nouvelle lumière. Sinon sa blessure se rouvrirait et il perdrait son sang. Et c’est la brûlure d’une blessure jamais complètement guérie qui le pousse vers le corps d’Yseult. Mais alors pourquoi parler des blessures de Tristan et passer sous silence celles qui marquent la chair d’Yseult. Certes, la première blessure de Tristan est celle qui correspond à son amour inconscient, la deuxième étant le prémice de la révélation du philtre. Mais Yseult ? S’il est vrai que les deux héros ont vu dans le miroir leur fulgurante complémentarité. « Ni vous sans moi, ni moi sans vous », dit l’un des textes de la légende. Incontestablement. Yseult est blessée, et sa blessure n’est pas celle que Tristan lui a infligée lors de leur première étreinte.
Sa blessure, comme celle de Tristan, est celle du sexe. On a tendance à oublier que « sexe » signifie « séparation », « coupure », et que la brûlure dont parle Denis de Rougemont, brûlure inextinguible dans le cas d’amants parfaits comme Tristan et Yseult, est la marque vivante de la lointaine séparation qui fit de l’Androgyne primitif le couple. L’imperfection des êtres est sans doute due à cette séparation. Et la Divinité, qui, par définition, ne peut être que parfaite, est nécessairement androgyne. N’y a-t-il pas au fond de chacun de nous une bisexualité latente qui se réveille parfois d’étrange façon ?
En fait, la vie d’un être humain se passe à chercher l’Autre, le double inversé. Herbert Marcuse a mis en évidence que l’activité humaine, le progrès de la civilisation étaient les conséquences du report de ce qu’il nomme le principe de plaisir : ne pouvant atteindre immédiatement ce plaisir absolu auquel il tend, l’individu le projette sur l’avenir et agit de telle sorte qu’il s’en rapproche le plus possible. Mais la société se garde bien de permettre à l’individu de parvenir au stade d’achèvement, car elle se priverait alors de l’activité dudit individu. C’est pourquoi l’histoire de Tristan et Yseult est proprement scandaleuse, et c’est pourquoi on l’a édulcorée en en faisant un cas extraordinaire, en déculpabilisant leur amour — non volontaire puisque dû à la fatalité du philtre — et en culpabilisant l’adultère, au second degré, puisque la mort devient la seule issue possible à cette aventure. On imagine la portée du scandale si Tristan et Yseult avaient été deux hommes, ou deux femmes ! Car l’homosexualité ne change rien au problème : il s’agit toujours de deux êtres qui se cherchent. Mais alors que la sexualité dite normale peut déboucher sur la procréation, dont la société ne peut se passer, et qu’elle encourage, l’homosexualité, qui ne débouche sur rien d’autre que le principe de plaisir, est intolérable, sinon comme déviance marginale.
Et si l’on va au-delà des termes normalisés, le principe de plaisir n’est pas différent de l’Amour considéré dans sa phase ultime et totale. La répression sociale a œuvré de telle sorte que la sexualité s’est trouvée réduite aux seuls organes sexuels alors qu’elle concerne l’être tout entier dans sa vie biologique, dans sa vie psychique et aussi dans sa vie spirituelle, ce qu’on oublie volontiers. Qu’on relise les écrits réels ou supposés des grands mystiques de n’importe quelle religion. Thérèse d’Avila atteint l’orgasme suprême avec Dieu lui-même. Alors l’individu n’est plus enfermé dans sa désespérante solitude. Il crée, avec l’Autre, le nouvel être, celui qui est potentiel en chacun de nous mais qui ne peut surgir des ténèbres que par la fulgurance de l’union avec l’Autre.
Je suis un corps et… le monde
A ce moment, l’individu peut s’écrier : « Je suis l’Autre. » Et cela voudra dire réellement : « Je suis Autre. » L’enfermement de l’individu est aboli dans l’instant. Il n’y a aucune différence entre l’éclatement orgasmique et la prise de conscience que l’être, appartenant à tout, EST TOUT. Mais l’environnement culturel qui a été longtemps le nôtre a fait que la notion d’appartenance a été faussée. On a trop répété que l’Homme avait le monde à sa disposition. On sait maintenant ce qu’il eut est : à force d’avoir le monde et de l’avoir exploité, c’est-à-dire détruit, l’homme se détruit lui-même. Car l’homme est le monde. Le verbe avoir n’existait pas en latin, du moins dans son sens actuel de « posséder ». Il existe dans les langues dominantes de notre époque, ce qui est significatif. Mais il n’existe pas dans des langues dites vernaculaires comme le breton ou le gallois qui sont d’essence purement orale, donc proches de la vie instinctive quotidienne, proches d’une nature non encore agonisante. Quand donc pourrons-nous dire en langue française, de façon courante, « Je suis un corps » et non « J’ai un corps », « Je suis le monde » et non « J’ai le monde » ?
Et quand pourrons-nous entendre un homme prononcer non pas « J’ai une femme » mais « Je suis une femme » ? Car la solution du problème de l’être passe par la reconnaissance de l’Autre comme identique à soi-même. Sagesse élémentaire, certes, mais combien difficile à restaurer dans sa plénitude !… François d’Assise n’avait pas dit autre chose, pourtant, mais on se contente de lui élever des statues dans les églises. Merlin l’Enchanteur, lui aussi, ou du moins ceux qui l’ont fait parler, nous a donné cette leçon de choses : Je suis le Roc, je suis l’Arbre, je suis l’Eau, je suis le Feu… Le barde gallois Taliesin aussi, dont le plus étrange poème le Cad God-deu [10] est une identification totale de l’être au monde végétal. Il semble bien qu’autrefois on était ouvert sur les choses. Depuis, l’homme classique, cerné dans les étaux d’une raison abstraite, a oublié que l’Esprit ne peut s’exprimer que par la chair, et que cette chair est issue des minéraux de la terre et de l’eau du ciel. A force de nier la chair, on en est venu à nier l’Amour. Et à oublier que la seule façon d’assurer notre dignité humaine est d’atteindre à l’amour universel des êtres et des choses.
Voilà pourquoi j’écris ces lignes d’un pays de granit. Le granit de mon pays est chargé d’uranium, cet élément de destruction implacable qui est aussi la preuve que les roches vivent et se répandent sur le monde. Je suis le granit de mon pays. C’est dans cette mesure que je peux prétendre à ma nature humaine.
[1] Voir en particulier les contes la Boule de Feu, p. 91, et Yann, le chasseur, p. 198, dans J. Markale, Contes populaires de toutes les Bretagnes, Rennes, Ouest-France, 1977.
[2] Voir le conte bourguignon le Père Roquelaure, p. 111, dans J. Markale, Contes populaires de toute la France, tome 1, Paris, Stock, 1980.
[3] Ce magnifique récit a été réédité, par les soins de jean-Pierre Le Dantec, ainsi que les autres récits du Moyen Age gallois, clans la traduction jusqu’alors introuvable de Joseph Loth, les Mabinogion, Paris, les Presses d’Aujourd’hui, 1979.
[4] Lire la réédition de l’ouvrage fondamental de Georges Dottin, l’Epopée irlandaise, introduction et notes de J. Markale, Paris, les Presses d’Aujourd’hui, 1980.
[5] Il faut signaler l’excellente adaptation de la légende par Michel Manoll, sous le titre Tristan et Yseult, Paris, Jean Picollec, 1980.
[6] Dans un chapitre intitulé « Yseult ou la Dame du Verger » de mon ouvrage la Femme Celte, Paris, Payot, 1972.
[7] En particulier dans son roman Maiden Castle, traduit en français sous le titre de Camp retranché (Paris, Grasset, 1971). La nympholeptie consiste à avoir une attitude sexuellement passive, mais teintée d’adoration, envers de très jeunes filles. C’était le cas, non avoué, de Lewis Carroll et parfaitement conscient de Powys.
[8] C’est Tristan qui pousse Mark à épouser Yseult et qui se charge d’aller la quérir en Irlande. Sur le plan psychanalytique, Tristan n’a pas encore conscience de son amour pour Yseult, aveuglé qu’il est par les normes de la Société patriarcale dont il est le fidèle soutien. La révélation loi est donnée par le philtre, c’est-à-dire au moment où Yseult l’oblige à regarder son visage.
[9] Guénièvre, détentrice de la Souveraineté, est la Prostituée royale où divine qui donne ses pouvoirs à ses amants à charge pour ceux-ci d’œuvrer pour l’équilibre du royaume. Le personnage archaïque de Guénièvre a de nombreuses aventures et ce n’est que plus tard qu’on a fixé l’amour exclusif qu’elle porte à Lancelot, lui-même personnage très récent de la légende, par une imitation évidente du thème de Tristan et Yseult.
[10] Voir la version française de ce poème dans J. Markale, les Celtes, Paris, Payot, 1969, p. 363 et suivantes.