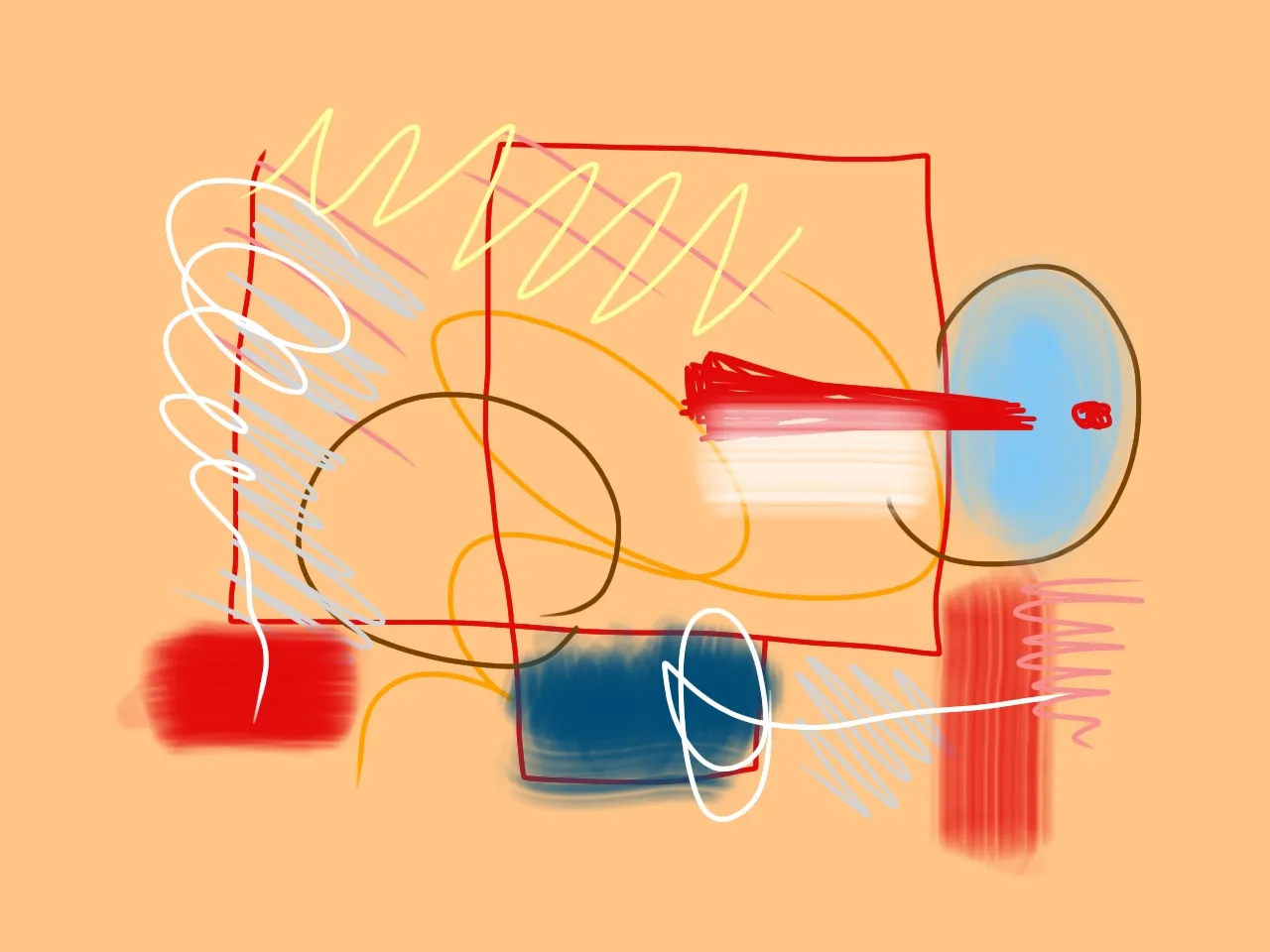Peinture de Joan Tollifson
(un article de mon site web « outpourings »)
La dépendance à l’autorité et la recherche de certitude
On dit dans le bouddhisme : « Si vous rencontrez le Bouddha sur la route (c’est-à-dire en dehors de vous), tuez-le ». Nous supposons si facilement que les autres doivent en savoir plus, ou être plus sages, plus éveillés, plus évolués, ou quelque chose de plus que nous. Nous sommes profondément conditionnés à chercher des réponses « à l’extérieur » (auprès d’experts, d’autorités, de gourous, d’écritures, etc.) et à faire confiance à ceux que nous imaginons avoir quelque chose que nous n’avons pas, ou alors à nous rebeller contre eux, ce qui n’est que l’image miroir du même phénomène.
Il y a certainement une place pour l’humilité, pour reconnaître ce que nous ne savons pas, pour permettre aux autres de nous aider, pour apprendre d’eux et reconnaître qu’en fin de compte, il n’y a pas d’« autres ». Je ne prône donc en aucun cas un faux égalitarisme ni ne dis que nous devrions jeter tous les experts, enseignants et enseignements par la fenêtre et réinventer la roue. Mais à un certain moment, d’une certaine manière, c’est exactement ce que nous devons faire — nous devons tenir seuls et être fidèles à notre propre expérience directe, à notre propre vision, à nos propres explorations et découvertes. Parce qu’en fin de compte, personne d’autre ne peut le faire à notre place, et chacun d’entre nous a un chemin et une vision uniques. Personne d’autre ne sait ce dont nous avons besoin. Et personne ne détient la seule et vraie réponse, la seule et unique bonne voie.
C’était l’une des choses les plus difficiles à comprendre pour moi, cette découverte et cette confiance en mon propre esprit. Et parfois, cette posture de se tenir seul et d’être la réalité nue et sans fard de ce moment, tel qu’il est, ne se produit pas. La recherche d’une sorte d’explication finale, d’une certitude ou d’une sécurité, d’une vérité faisant autorité est profondément addictive.
Lorsque j’ai atterri pour la première fois au Springwater Center à la fin des années 80, le centre de retraite fondé par Toni Packer, elle parlait beaucoup de notre désir d’autorité. Pour elle, il s’agissait clairement d’un problème humain majeur, comme cela l’avait été pour J. Krishnamurti. Mais à l’époque, je ne voyais pas le besoin ou la dépendance envers l’autorité comme faisant partie de mes problèmes. J’avais été élevée par des athées-agnostiques à penser librement, j’avais fréquenté une université d’arts libéraux qui encourageait à sortir des sentiers battus, j’avais été une rebelle de la contre-culture dans les années 60, une consommatrice de LSD, une lesbienne radicale fréquentant les bars, quelqu’un qui allait à l’encontre des conventions de toutes les manières imaginables, une militante politique radicale — de toute évidence, je n’étais pas quelqu’un qui avait soif d’autorité. N’est-ce pas ? Il m’a fallu beaucoup de temps pour réaliser à quel point je cherchais (et je cherche encore parfois) les « bonnes » réponses à l’extérieur de moi, je plaçais les autres au-dessus de moi et je me méfiais de mon propre esprit et de mes propres idées. Je travaille encore sur ce point.
J’ai agi de la sorte avec le « politiquement correct » et la « vérité spirituelle ». Je suis restée dans la gauche radicale pendant un certain temps après avoir commencé à sentir que beaucoup des positions que nous prenions étaient totalement erronées, mais je me suis tue. J’ai cru ce qu’ils me disaient, que mes doutes étaient symptomatiques de mes privilèges de petite-bourgeoise blanche, que je devais juste les abandonner et me soumettre à la ligne du parti. J’ai continué à essayer. Ensuite, dans le monde spirituel, j’ai admiré un certain nombre d’enseignants et d’auteurs au fil des ans, de Toni Packer à Tony Parsons, en essayant de m’ajuster à leurs perspectives (souvent contradictoires) ou de gagner leur approbation. Et il m’arrive encore de douter de ma propre vision et de me tourner vers quelqu’un d’autre.
Je vois cela se produire chez d’autres aussi, y compris chez les personnes que je rencontre. Je peux parfois dire, par exemple, que quelqu’un à qui je parle a adopté la forme prétendument « correcte » (ou « la plus élevée » ou « la plus vraie ») de la non-dualité qu’un autre prêche — que c’est devenu une croyance ou un dogme, que celui qui l’a prêché est considéré comme une autorité infaillible, et que cela bloque l’expression naturelle et la créativité de la personne avec qui je parle. C’est comme une boîte dans laquelle ils sont enfermés.
Je ne dis pas ici que nous ne devrions pas lire de livres, assister à des retraites ou à des satsangs, écouter des conférences ou regarder des vidéos sur YouTube. Tout a sa place. Mais nous pouvons commencer à discerner la différence entre ce qui nous nourrit vraiment et ce qui est une sorte de recherche désespérée ou addictive de la bonne réponse. Nous pouvons savoir si nous considérons un enseignant ou un livre comme une autorité infaillible ou simplement comme quelqu’un que nous respectons, que nous trouvons intéressant et qui mérite d’être écouté, mais que nous pouvons parfaitement remettre en question et contredire. Bien sûr, nous ne pouvons pas nous forcer à abandonner la partie insécurisante et addictive, même lorsque nous la voyons. Pourtant, plus on la voit clairement pour ce qu’elle est, moins elle a d’emprise et plus elle s’efface. Pour certains, il peut s’agir d’un événement décisif et permanent, pour d’autres (comme moi), il s’agit plutôt d’un processus graduel. Et nous ne pouvons pas choisir la manière dont il se déroule pour nous.
En fin de compte, c’est la vie qui nous fait, ce n’est pas nous qui la faisons. Même si, paradoxalement, nous SOMMES la vie. Nous sommes en effet responsables, au sens de réactifs, de tout, parce que nous SOMMES tout, et nous ne pouvons pas vraiment déterminer comment les prises de conscience, les pensées, les actions, les choix et les décisions se produisent. Est-ce que nous les faisons ou est-ce qu’ils nous arrivent ? Ou y a-t-il une fausse séparation dans ces deux formulations, une fausse division ? Comme toujours, il est très important de ne pas s’accrocher aux schémas conceptuels ou d’imaginer que notre curiosité innée et le désir profond de notre cœur seront satisfaits par les réponses de quelqu’un d’autre ou par n’importe quelle formulation conceptuelle.
Dans le bouddhisme zen, il existe une cérémonie d’ordination laïque au cours de laquelle vous recevez un nom bouddhiste que votre enseignant choisit pour vous, généralement dans une langue asiatique, et la traduction anglaise semble généralement très spirituelle et exotique, quelque chose comme « Voie de la joie / Équanimité sans limites » ou « Fleur de lotus / Esprit vide ». Mais l’un de mes enseignants zen préférés, Barry Magid à New York, donne apparemment aux gens leur propre nom, ordinaire, de tous les jours, lors de l’ordination laïque. En d’autres termes, mon nom bouddhiste serait Joan Tollifson — cette personne même, cette expression vulnérable et transitoire, tout à fait unique, totalement imparfaite, indécise, faillible et pourtant absolument parfaite, en perpétuel changement, de la totalité : C’est ce que je suis appelée à être — non pas Montagne de Tranquillité ni Vide Pur ni Fleur de Lotus, ni Toni Packer ni Tony Parsons ou Nisargadatta ou Darryl Bailey, mais CET être humain particulier, unique, sans équivalent, tel que je suis réellement, d’instant en instant. C’est une leçon tellement puissante, d’être soi-même, de trouver son propre esprit, d’être comme on est, de ne pas se cacher derrière quelqu’un d’autre, de ne pas faire le perroquet de quelqu’un d’autre, ou d’essayer de se mettre dans la peau de quelqu’un d’autre — être fidèle à sa propre vérité — dans la spiritualité, dans la non-dualité, dans la politique, dans n’importe quel domaine.
Bien entendu, cela ne signifie pas que « moi-même » est une « chose » substantielle ou persistante que l’on puisse saisir ni que cela pointe vers un recentrage égoïste, ou d’un individualisme forcené qui ignore la société, ni d’une version intransigeante du type « à ma façon ou pas du tout », ni que cela nie la plénitude et la reconnaissance que l’on est inséparable de la totalité et qu’absolument tout est moi-même. C’est peut-être le koan vivant de toute une vie que de découvrir ce que signifie exactement d’être soi (ou moi), et d’y être fidèle, d’ÊTRE cela. Aucune « réponse » ou conclusion conceptuelle facile, de seconde main, ne saurait satisfaire. Il s’agit d’un koan vivant, non résolu, qui ne cesse de se déployer et auquel seule la vie elle-même peut répondre, d’instant en instant, à l’instant même.
Être qui vous êtes
Voici un bref extrait de mon dernier livre, Death : The End of Self-Improvement (La mort : la fin du développement personnel) :
[Ma mère] aime dire aux gens que j’ai écrit des livres, et quand ils me demandent de quoi parlent ces livres, ma mère répond : « Ils parlent d’être qui vous êtes ». Et elle ajoute : « C’est très important, d’être ce que l’on est ».
Dans un sens, bien sûr, vous ne pouvez pas ne pas être qui vous êtes, à tous les niveaux, relatif et absolu, personnel et impersonnel. Mais « En quoi ne suis-je pas moi-même ? » est une interrogation, une invitation à remarquer s’il y a des façons dont je ne suis pas fidèle à qui ou à ce que je suis vraiment, qu’il s’agisse de prétendre être hétéro alors que je suis vraiment gay, ou de prétendre être doux et aimant alors que je me sens vraiment en colère, ou prétendre que je ne suis qu’une petite personne névrosée alors que je suis en réalité ce vaste rien illimité qui comprend tout, ou prétendre que je suis quelqu’un de pleinement éveillé qui sait comment fonctionne l’univers alors que je ne suis en réalité qu’un autre crétin perdu dans le bus. La question peut être entendue à plusieurs niveaux. C’est une invitation à s’arrêter, à regarder et à écouter.
– Tiré de La mort : La fin du développement personnel
Texte original publié le 30 juillet 2025 : https://joantollifson.substack.com/p/the-addiction-to-authority