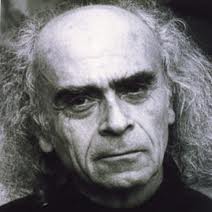(Revue Question De. No 50. Novembre-Décembre 1982)
Au moment des déchirements qui, vers 1909, conduisirent la Société de Théosophie à son éclatement et à la création de ce qu’on appelle l’Anthroposophie, le problème majeur était le suivant : faut-il fondre la recherche spirituelle occidentale dans la spiritualité orientale, particulièrement indienne (thèse d’Annie Besant), ou bien chercher en Occident des racines authentiques quoique souvent imperceptibles, enfouies profondément, ou dénaturées (thèse de Rudolf Steiner) ? Et Rudolf Steiner, après avoir justifié l’action passée de la Théosophie en un temps où « les sources de l’occultisme occidental n’étaient pas encore ouvertes », affirmait : « En maints domaines, elles ont aujourd’hui plus à donner que les sources orientales ».
Le débat est loin d’être épuisé. Outre qu’il n’est pas probant qu’un esprit occidental – dont les habitudes culturelles et la logique relèvent essentiellement du mental – puisse approfondir pleinement la pensée orientale, certaines divergences du fond entre l’Orient et l’Occident, notamment le problème de l’âme collective ou individuelle et la difficulté sémantique qui ne permet pas toujours de saisir la véritable signification d’un mot sorti de son contexte d’origine, la fusion de la spiritualité occidentale dans l’orientale s’est souvent résolue superficiellement par un syncrétisme discutable. On reconnaîtrait facilement ce syncrétisme, sous son aspect le plus primaire, dans certaines tentatives par ailleurs fort honorables, dont le néo-druidisme issu du gallois lolo Morgannwg est l’exemple le plus caractéristique. Mais, d’un autre côté, ce n’est pas sans raison que la spiritualité occidentale contemporaine, du moins celle qui déborde du cadre dogmatique des églises, cherche ainsi tant de repères dans la tradition orientale : l’homme occidental est en effet en plein cœur d’un labyrinthe dont il ne connaît plus le secret, et il ne sait plus lire les signes susceptibles de lui indiquer le chemin qui mène vers le soleil.
Déformations
Les causes de cet aveuglement sont multiples, mais on peut affirmer que l’une d’elles consiste dans le renversement de situation qui s’est produit en Grèce, à l’époque de Socrate, ce qu’on a appelé le « miracle grec », et qui a conduit l’Europe méditerranéenne à une prodigieuse évolution technologique, à un impérialisme culturel camouflé en dogme universaliste, à une appropriation politique et économique du monde, au détriment d’un esprit qui n’a pas pu suivre et qui s’est fourvoyé dans des spéculations intellectuelles dont le scientisme du XIXe siècle, avec sa prétention à vouloir tout expliquer par des équations demeure le plus beau et le plus inutile fleuron.
Cette pensée occidentale classique s’est dessinée à l’époque de Socrate. Il serait injuste et inexact de prétendre que Socrate en est le promoteur. On imagine toujours le personnage en maître d’école, ce qu’il n’était pas. Il n’a jamais enseigné ses nombreux disciples : il s’est contenté de les faire parler au cours d’entretiens qui étaient beaucoup plus amicaux et chaleureux que protocolaires et « scolaires ». La maïeutique de Socrate n’est pas un enseignement. On s’en doute un peu quand on examine les directions divergentes prises par ses disciples et par ceux qui se sont prétendus ses héritiers. Platon et Xénophon ne sont point Socrate, et Aristote à plus forte raison. Mais le fait est là, indubitable : la pensée grecque et par conséquent méditerranéenne a pris un autre chemin, celui du dualisme, mais d’un dualisme laïcisé en quelque sorte, passant de l’ontologie la plus pure aux domaines quotidiens de la logique, de la morale et de la psychologie.
La philosophie pré-socratique peut en effet se résumer, dans son essence, par la fameuse image héraclitéenne : les chemins qui montent sont aussi ceux qui descendent. On peut ainsi mesurer le fossé, que dis-je ? le ravin, qui sépare le monisme serein d’Héraclite et le système d’Aristote fondé sur la logique du Vrai et du Faux, avec tiers exclu, et par conséquent sur la division binaire entre vie et mort, jour et nuit, bien et mal. Certes, l’influence mazdéenne paraît ici évidente, mais il resterait à déterminer ce qu’entendaient exactement les sages de la Perse quand ils expliquaient le monde par une lutte permanente entre Ahura-Mazda et Ahrimane. Après tout, Ahrimane, ravalé au rang d’anti-dieu, de véritable Satan, n’est pas autre chose que l’ancien dieu tutélaire des Aryas, autrement dit des Indo-Européens primitifs, et ce serait faire injure à ceux-ci que de faire de leur dieu un simple destructeur. Il semble que le mazdéisme ait été mal compris, ou déformé de son sens primordial, comme l’a été, Au Moyen Age le mythe celtique – ou plutôt pré-celtique – de Cernunnos, le dieu cornu devenu le Diable de l’imagerie populaire.
Postulats
Ce qui est grave, c’est que la civilisation méditerranéenne s’est bâtie sur les données d’Aristote et que le Christianisme lui-même, incapable de susciter une philosophie propre, s’est réfugié presque inconsciemment dans un aristotélisme rassurant et qui avait le mérite d’apporter des solutions concrètes immédiates aux problèmes dont débattaient les églises. L’inquiétude et l’angoisse ont toujours besoin d’être guéries par des euphorisants. De même qu’il était rassurant que le soleil tournât autour d’une terre immobile dans l’espace et au centre de l’univers, il était satisfaisant pour l’esprit que l’être humain eût un corps mortel et une âme immortelle, qu’il y eût le jour et la nuit, qu’il y eût un Paradis pour les justes et un Enfer pour les méchants, et que, bien entendu, il y eût des gens qui savaient et des gens qui ne savaient pas. Le postulat d’Euclide permet de dormir tranquille, mais non le postulat de Riemann – tout aussi valable et même davantage – selon lequel la ligne droite n’existe pas parce que l’univers est courbe. En fait, le miracle grec a nié la métaphysique – et par là les approches mystiques de la divinité —, ce qui ne pouvait que contenter les théologiens chrétiens toujours soucieux de canaliser les pulsions religieuses dans un cadre fixe et normatif. Cela ne les a pas empêchés d’ailleurs de s’épuiser à vouloir définir Dieu, ce qui est une absurdité – à moins que ça ne soit la négation même de Dieu – puisque Dieu, par essence et par simple justification, est infini. Il faudra attendre Hegel pour que quelque chose de lucide, philosophiquement parlant, et non religieusement soit dit à propos de Dieu qui équivaut au néant s’il n’a pas de créature différenciées en face de lui. Mais la postérité de Hegel est comparable à celle de Socrate : elle a été largement infidèle. Fichte est remonté aux sources théologiques, ou plutôt il a été récupéré par les théologiens. Feuerbach a ouvert une porte matérialiste que Marx et Engels se sont empressés de franchir. Et la pensée occidentale a continué de se fourvoyer dans un dualisme desséchant, même et à plus forte raison dans les travaux des philosophes souscrivant au postulat matérialiste. L’une des preuves les plus récentes de ce dualisme se trouve chez un Jean-Paul Sartre dont la doctrine n’arrive jamais à trouver un moyen terme ou une synthèse harmonieuse entre l’Être et le Néant, entre le Diable et le Bon Dieu.
Spéculations
En somme, il y a longtemps que la pensée occidentale s’est engagée dans une impasse. Elle ne peut en sortir que par un volte-face complet, ce qu’on appelle une « révision déchirante ». Et ce n’est pas si facile, ni même possible en l’état actuel des choses. Dans ces conditions comment la spiritualité occidentale, qui est un des aspects de cette pensée, pourrait-elle se reconnaître en tant qu’entité distincte et retrouver ses racines qui, tout en étant occultées ou écartées, sont toujours à la portée de ceux qui veulent bien se baisser pour les ramasser ? Quelques-uns, pourtant, au cours des siècles, ont tenté cette révision déchirante, mais on ne les a guère pris au sérieux, les écartant et les marginalisant à l’extrême. Au XVIIe siècle, l’évêque anglican Berkeley est allé encore plus loin, adoptant une position proprement révolutionnaire. Son immatérialisme conduit à affirmer que la seule existence de la matière est d’être perçue. C’est évidemment l’aboutissement ultime du cogito ergo sum de Descartes, la réalité n’ayant de valeur que dans l’acte de pensée. C’est aussi un monisme répondant au monisme matérialiste : tout est esprit, et de ce fait, le problème de la dualité ne se pose même pas. Cette doctrine a le don de rendre furieux les spiritualistes comme les matérialistes de tous bords. Diderot, matérialiste et athée, la jugeait comme étant la plus absurde qui fût mais ajoutait qu’il était impossible d’en démontrer logiquement l’absurdité, ce qui revient à en faire un système parfaitement cohérent et inattaquable. D’ailleurs, en notre fin de XXe siècle, les spéculations des physiciens sur la matière, qui serait vibration, n’ont rien de contradictoires avec les thèses de Berkeley, peu s’en faut…
Négations
Mais, dans ce cas, pourquoi le Mal et son incarnation symbolique dans le personnage de Satan-Diable ? Berkeley répondait qu’il s’agissait tout simplement d’une contradiction de l’esprit, ce qui n’est pas sans rappeler le monisme celtique druidique caractérisé par le rejet d’une dichotomie fondamentale. Le moine Pélage, tout imbu de ces principes celtiques, ne pensait pas autrement. On sait qu’il se heurta violemment à Saint-Augustin pour qui le dualisme était un principe absolu. Et que dire du catharisme qui, en plein Moyen Age, semble l’abcès de fixation des thèses dualistes ? Le grand penseur que fut René Nelli a mis en lumière de façon magistrale les nuances du dualisme cathare dans un article des Cahiers du Sud (n° 387-388, 1966, p. 181-195). C’est ce qui a été dit de plus remarquable et de plus clair sur le sujet, car les véritables problèmes sont posés, à savoir l’existence éternelle ou temporaire du principe du Mal. Il semble d’ailleurs que les inquisiteurs ne se soient guère préoccupés de cet aspect fondamental de la doctrine cathare, ou tout au moins qu’ils l’aient minimisé. Il est vrai que répondre au dualisme cathare supposait une remise en question du système orthodoxe dans lequel le Diable, tel qu’il était, bien défini et bien circonscrit, était somme toute plus rassurant qu’un Mal désincarné et diffus.
De nos jours, il est de bon ton de nier la réalité du Diable en tant qu’entité personnalisée. C’est oublier que « la plus grande ruse du Diable est de faire croire qu’il n’existe pas », car il apparaît sournoisement sous ses formes qu’on n’imagine même pas. Et ces formes, n’étant point effrayantes, ne permettent plus à l’être humain de se décharger de ses pulsions négatives sur un objet, ce qui fait que la composante luciférienne de l’univers a toute liberté d’action. Un homme de bonne volonté comme Bergson, en imaginant une morale ouverte où le bien et le mal ne sont plus différenciés avec autant de rigueur et de systématisme, est tombé cependant dans un autre piège du dualisme. En opposant, comme il l’a fait, l’Intellect au Spirituel et en privilégiant ce dernier, il est allé encore plus avant vers le fond de l’impasse manichéenne.
Explications
Car le problème de l’existence du mal n’a jamais pu être vraiment résolu dans la pensée classique de l’Occident, christianisme y compris. On ne comprend pas, en particulier, que Dieu, décrit comme infiniment bon, puisse tolérer le Mal, puisse accepter que Satan tourmente le pauvre monde, même si on nous parle d’épreuves à subir ou de libre-arbitre à assumer. Théologiquement, la réponse est simple : Satan, l’archange révolté, est une créature de Dieu, et Dieu ne peut pas l’anéantir à moins que de s’anéantir lui-même puisque la fonction essentielle de Dieu est la création. Dé-créer Satan serait, pour Dieu, sa propre négation. Il ne peut donc que l’écarter, l’enfouir dans les ténèbres. Mais on ne voit guère comment cette notion ontologique pourrait être formulée simplement dans les catéchismes : ce serait avouer l’impuissance du Bon Dieu devant le Diable.
Et pourtant, l’explication se trouve là, parfaitement limpide, en même temps que la négation du dualisme. Satan fait partie de Dieu : il n’en est qu’un aspect temporairement différencié, un reflet inversé dans le miroir. Et pour ceux qui seraient scandalisés d’une telle affirmation hérétique, un exemple bien connu s’impose : celui du récit évangélique où l’on nous raconte la trahison de Judas et le baiser donné par lui à Jésus. Dans sa logique interne, le texte est incohérent : Jésus était bien connu de tous à Jérusalem, et point n’était besoin qu’il fût désigné par Judas. Cela prouve une intention symbolique. Judas, en trahissant Jésus, et en incarnant ainsi le concept satanique, est nécessaire pour que s’accomplisse la Rédemption. Judas est donc un mal nécessaire : à la limite, il fait partie intégrante de la mission divine qu’est la Rédemption et qu’on s’obstine à ne voir que dans la personne de Jésus. Il y aurait d’ailleurs beaucoup à dire sur une autre scène évangélique, celle de la Tentation de Jésus par l’Ennemi. Un examen approfondi du texte pourrait nous faire comprendre que l’Ennemi n’est autre que le double de Jésus, double projeté et présenté comme un être différent pour d’évidentes raisons de compréhension. Mais il s’agit d’un débat intérieur, analogue à ces nombreux « débats du corps et de l’âme » de la littérature médiévale, où Jésus fait le point entre les pulsions qui l’animent, extériorise ses tendances négatives et les néantise de ce fait, et se découvre en totale position d’harmonie.
Somme toute, l’image du diable médiéval, image terrifiante mais efficace, n’était point une absurdité, ni même un enfantillage dû à des gens crédules ou superstitieux. C’était un véritable mandala, un objet formel où pouvaient se cristalliser les pulsions négatives de l’être humain. Une fois ces pulsions projetées sur l’objet-diable, l’être humain s’en trouvait purifié, sûr de lui, réconcilié avec lui-même, débarrassé de sa tendance dualiste à vouloir tout décomposer en bien et en mal. L’image du diable provoquait une catharsis nécessaire. Il en était de même pour tous les récits et contes populaires où apparaissait le Malin : et, fait significatif, le « Malin » se faisait toujours rouler par ses victimes présumées. Car si la pensée spiritualiste officielle est tombée dans le piège du dualisme et s’est enfoncée très profondément dans l’impasse manichéenne, il ne semble pas que la pensée populaire soit allée aussi loin : seule, la non-compréhension des images ou des personnages symboliques a provoqué un cheminement semblable de la sagesse populaire.
Édifications
Si les penseurs officiels ont eu cette attitude, c’est que le Labyrinthe s’est compliqué au cours des siècles. On n’en finirait pas de dénoncer les fausses sorties empruntées par les spéculateurs de l’esprit. Heureusement, les poètes, sans l’expliciter clairement, ont senti que quelque chose n’allait pas dans le système mis en place. Ils se sont toujours exclus d’une telle démarche, avec des résultats plus ou moins convaincants, mais avec une vision para-normale des structures essentielles. Dans ce monde contemporain qui cherche désespérément son âme, les tentatives de ce genre ne manquent pas, et on est étonné de découvrir une négation du dualisme dans des ouvrages qui, apparemment, ne sont pas écrits pour le démontrer. Deux exemples récents illustrent bien ce propos, deux romans, ou ce qu’il est convenu d’appeler « romans » : le Christ aux orties de Charles Le Quintrec (éd. Albin Michel, 1982) et l’Herbe d’Or de Pierre-Jakez Hélias (éd. Julliard, 1982). Charles Le Quintrec nous raconte une histoire qui pourrait paraître édifiante, comparable à une quelconque hagiographie à l’usage des campagnes si on n’y décelait pas une terrible odeur de soufre et un bûcher toujours prêt à être allumé. Il est vrai que son héros, qu’il nomme Thibaud de Locmaria, est puisé à bonne source : il s’agit en effet d’un personnage historique, Pierre de Kériolet, petit hobereau de Pluvigner, en pays vannetais, qui vécut d’abord en parfaite crapule avant de se convertir et de mourir, au milieu du XVIIe siècle, en odeur de sainteté. Le personnage réel est attachant quand on connaît les méandres de sa vie, mais aussi quand on sait que la première moitié du XVIIe siècle fut, en Bretagne, une période de turbulence spirituelle. En effet, à la suite du Protestantisme et des troubles profonds occasionnés par la Ligue dans la péninsule armoricaine, celle-ci s’était fortement déchristianisée. À vrai dire, tous les vieux « démons » du Paganisme refaisaient surface. Sur les bords du Blavet, une « idole » de pierre, probablement une fausse antiquité, la fameuse Vénus de Quinipily, était l’objet d’un culte peu conforme avec les enseignements de la morale chrétienne. Et partout surgissaient de terre des statues plus ou moins mutilées ou informes que la croyance populaire avaient vite fait de reconnaître comme des représentations divines. Une contre-Réforme devenait nécessaire, qui fut prêchée par de zélés missionnaires comme les pères Michel Le Nobletz et Julien Maunoir. Ils allaient de paroisse en paroisse prononcer des sermons terrifiants et présenter des taolennou, c’est-à-dire des tableaux imagés où se trouvaient détaillés les supplices infernaux qui attendaient les mécréants et les pécheurs endurcis. Cela ne fit d’ailleurs que renforcer de façon extraordinaire le manichéisme officiel et eut pour résultat de « normaliser » la vie spirituelle – ou soi-disant telle – des Bretons. Et puisqu’on trouvait des statues dans la terre, il devenait urgent de les baptiser.
Chemins
C’est ainsi que de nombreuses statues de sainte Anne furent découvertes, généralement sous des ronces ou des orties, la plus célèbre étant celle trouvée par Erwan Nicolazic dans le village de Keranna, qui allait devenir Sainte-Anne d’Auray. Il y a bien des obscurités dans ces découvertes « miraculeuses ». Le seul point indiscutable, c’est qu’elles déclenchèrent des pèlerinages toujours profitables à certaines catégories de personnes. Et par derrière le culte de sainte Anne, grand-mère de Jésus, se profile l’étrange divinité celtique connue autrefois sous les noms d’Ana, Anu, Dana, Dôn ou encore Brigit…
C’est dire l’atmosphère dans laquelle Charles Le Quintrec fait évoluer son héros. Thibaut de Locmaria est un fils dévoyé. Il est en pleine contradiction avec lui-même. Élevé dans l’amour et le respect du Bien absolu, il va se révolter et tourner du côté du Mal absolu. Menant une vie désordonnée, batailleur, coureur de filles, voleur et violeur, voire assassin, il n’a plus qu’une idée en tête : rencontrer Satan et conclure un pacte avec lui, comme cela se fait dans toutes les bonnes traditions du genre. L’esprit faustien hante l’humanité, et c’est sans doute par dégoût devant un Bien vidé de toute sa substance créatrice que Thibaud se jette ainsi à corps perdu dans le chemin du Mal. On pourrait peut-être alors méditer sur les dangers d’un enseignement qui ne propose pour exemple qu’un Bien complètement et artificiellement isolé du contexte de la vie. Et Thibaud accomplit sa quête du Graal, le Graal étant pour lui le pacte avec Satan. Il croit reconnaître celui-ci dans un bandit de grand chemin qui terrorise, avec la bénédiction du pouvoir, la région, mais il se rend compte que c’est une illusion : ce bandit n’est pas l’incarnation du Mal absolu, il n’en est que le Jean-Baptiste. Et c’est alors que, se rendant à Loudun, au moment de la célèbre affaire des Possédées, il rencontre enfin le vrai Satan, celui qu’il attendait de toute son âme. Alors se déroule une scène étonnante dans la même veine que l’épisode du Père Goriot où Balzac nous décrit l’insinueuse tentation de Rastignac par Vautrin.
Pulsions et répulsions
Mis en présence de celui qu’il a évoqué et invoqué tant de fois dans sa vie passée, Thibaud de Locmaria le reconnaît parfaitement, mais il se garde bien de le nommer, de l’appeler, sachant inconsciemment que toute appellation est une ap-pulsion déguisée, c’est-à-dire une course effrénée vers un objet dans lequel on désire se noyer. Au contraire, le héros éprouve pour celui qu’il a cherché une insurmontable répulsion. L’ennemi a beau le tenter, lui faire miroiter la puissance et les honneurs dans cette vie et dans l’autre, Thibaud le chasse par des paroles significatives : « Je sais maintenant que je te hais. Je veux maintenant dégueuler tout le noir que j’avais dans l’âme. » La trame du récit est d’une extrême simplicité : l’Ennemi, à peine décrit par Le Quintrec, n’est pas autre chose que la projection d’une partie de la personnalité de Thibaud, sa personnalité noire (au sens strict, puisque le noir est absence de couleur, donc viduité, vacuité, négativité). Lorsque Thibaud dit qu’il vomit, au présent, ce qu’il avait, au passé, de noir dans son âme, il explique toute la scène. C’est une purification, mieux une catharsis dans la meilleure tradition de la Psychanalyse. Et si l’on comprenait encore la signification réelle du Sacrement de Pénitence, on pourrait parler de confession. Ce doublenoir qui hantait le héros est maintenant objectivé, ce qui lui permet de le rejeter et de le néantiser. Désormais, l’aspect blanc (c’est-à-dire de toutes les couleurs, donc symbole de la totalité) va dominer la vie de Thibaud de Locmaria : il se fera pauvre entre les pauvres, consolateur des malheureux, bienfaiteur de tous les hommes parce qu’il veut les aimer tous. Mais cela en dehors de l’église officielle. Il refusera les sacrements, sous prétexte qu’il en est indigne, il dénoncera le formalisme et la richesse scandaleuse du clergé, il accueillera les malandrins comme les honnêtes gens, refusant ainsi toute dichotomie sociale ou morale. Il sera vraiment le Christ aux Orties. Et comme tel, il sera persécuté par les prêtres, soucieux de maintenir l’orthodoxie et le clivage manichéen. Or, à tous les reproches des clercs, il opposera son paisible système de philosophie : « Je n’ai d’autre pouvoir que celui d’aimer mon prochain. Je n’en veux point d’autre. » C’est net, c’est précis. Débarrassé du dualisme qui le tourmentait et qui était cause de ses « mauvaises » actions. Thibaud de Locmaria, devenu Humulis (Humble), est l’incarnation de l’amour universel des êtres et des choses. Il est sorti du labyrinthe. Il sait maintenant qui il est et à quoi il est destiné, et le vocabulaire chrétien employé par Charles Le Quintrec ne change rien à l’essentiel : la prise de conscience fulgurante que le diable, au lieu d’être une puissance extérieure et objective quant à l’être, n’en est qu’une des multiples composantes. Dès lors, simplement en le dé-sacralisant, on met l’énergie qu’il représente au service de la totalité de l’être.
Abandonner l’impasse
D’une tonalité bien différente est l’Herbe d’Or de Pierre-Jakez Hélias. Certes, cela débouche sur le même amour universel des êtres et des choses, mais la quête en est moins tourmentée. Ici, la révélation ne vient pas d’une expérience individuelle où l’être est confronté avec son double. Elle est occasionnée par un cataclysme naturel, un raz-de-marée, qui oblige les individus à prendre conscience d’eux-mêmes et des autres. Et toute référence au dualisme est exclue d’emblée, car le raz-de-marée n’est même pas ressenti comme un « mal ». C’est une « chose » indifférenciée, comme il en arrive de façon normale. Dans un bateau, un équipage conduit par un étrange capitaine, Pierre Goascoz, un « fou de la tête », lutte contre l’océan pour revenir au port. À terre, les familles et les amis attendent, et dans cette attente, ils se dévoilent les uns aux autres. Ils ne sont ni bons, ni mauvais, ils sont. Cette sérénité semble largement puisée aux sources celtiques,et ces sources, dans le récit d’Hélias, sont clairement indiquées : ce sont les multiples croyances et légendes qui circulent encore de bouche à oreille dans toute la Bretagne. L’Herbe d’Or, le nom du bateau de Pierre Goascoz, c’est d’abord le nom d’une plante magique, un talisman qui permet, lorsqu’on l’a trouvée, de parcourir les vertes prairies de l’Autre Monde et d’en découvrir les secrets. Pierre Goascoz est, en son genre, une sorte de Thibaud de Locmaria. Il a eu, autrefois, une autre activité que celle de patron pêcheur. Il était capitaine de la marine, il était un « scientifique ». Et puis, il est revenu au pays, il a repris le métier de son père qui était celui de ses ancêtres. Il est en fin de lignée, comme Thibaud de Locmaria. A-t-il découvert l’Herbe d’Or ? Le vieux Nonna, un ancien gardien de phare, dont les allures de maître chaman ne font pas de doute, en est persuadé. Et quand le bateau sera revenu au port, avec tout son équipage sauf, en dehors de Pierre Goascoz, c’est Nonna qui reprendra le bateau pour conduire Pierre Goascoz vers sa dernière demeure. Mais quelle demeure ? Nonna est l’image du passeur, du nocher des Enfers, qui mène sur l’autre rive ceux qui ont accompli ici leur mission et qui doivent alors se trouver « dans les joies », pour reprendre l’expression populaire traditionnelle utilisée par Hélias.
Car, en définitive, aussi bien dans le Christ aux Orties que dans l’Herbe d’Or, le problème essentiel est celui de la mort, ou plutôt de l’après-mort. Le héros de Le Quintrec trouve sa sérénité dans la foi chrétienne, même s’il en refuse les rites jugés par lui trop entachés d’orgueil et de superfétation : il sait que Dieu l’accueillera dans le Paradis du catéchisme. Les héros d’Hélias, eux, trouvent leur sérénité dans la certitude qu’il y a, au-delà des apparences, une autre vie qui prolonge celle-ci, mais ils ne s’appuient pas sur un dogme : leur expérience personnelle leur a suffi. Et peut-être aussi se souviennent-ils des hautes croyances de leurs ancêtres, du temps des druides. Le Paradis n’est plus le résultat d’un marchandage entre le Bien et le Mal. Il est, c’est une évidence. Et les rites ne sont même pas refusés, ils sont intégrés dans le quotidien, comme en témoigne la réponse d’un des matelots de l’Herbe d’Or à un autre qui lui fait remarquer : « C’est drôle. Nous sommes dans la nuit de Noël, nous avons manqué de finir notre vie dans l’eau, nous avons beaucoup parlé, mais jamais il n’a été question du Bon Dieu, ni de tout ce qu’on nous a appris à l’église. » Cette réponse est nette, précise, profonde dans sa simplicité « Détrompe-toi. Il n’a jamais été question d’autre chose. »
Les personnages d’Hélias ne sont pas assujettis au dualisme. Tout au plus le rencontrons-nous quand il s’agit de différencier les gens de la mer des warméziens, c’est-à-dire des gens de la terre. Leurs problèmes, car ils en ont, comme tout le monde, ils les résolvent sans recourir à la dichotomie. Dans ces conditions, pourquoi, selon la vieille formule druidique attestée par un auteur latin, la mort ne serait-elle pas le milieu d’une longue vie ? C’est en tout cas la signification de ce roman, plutôt un récit initiatique : « Et si ce qu’on appelle mort n’était que l’absence de quelqu’un qui est présent ailleurs, ailleurs ou au même endroit hors de la vie des autres, dès l’instant que tous les lieux se confondent et toutes les durées se rencontrent ? ».
Pour partager cette sérénité, il est nécessaire d’avoir accompli une quête, qui est peut-être la quête du Graal, mais qui est simplement, et sans plus chercher, la quête de la vie. Blaise Pascal, qui approchait l’illumination, ne déplorait-il pas que notre imagination fût trompeuse et nous fît prendre ce qui est pour ce qui n’est pas, négligeant ainsi la recherche unique de la Réalité toute puissante, et non plus de la Vérité ? Car la philosophie occidentale classique n’a que ce mot de vérité à agiter dans nos esprits. La Réalité, personne n’en parle. Ou plutôt, on confond systématiquement vérité et réalité qui appartiennent à deux plans différents. Celui qui croit détenir la Vérité, une et toute puissante, ne fait que se fourvoyer davantage dans une impasse tout aussi redoutable. Car qui dit Vérité, sous-tend immédiatement « mensonge », ou « fausseté », et nous retombons dans le piège du dualisme. Et quand donc comprendrons-nous que le terme irréel ne désigne qu’une attitude de l’esprit ? Car l’aspect négatif de la Réalité est inconcevable : nier la réalité, c’est nier la vie, c’est se nier soi-même, c’est nier sa pensée, et on aboutit à une absurdité. Combien de malheureux humains se sont-ils perdus en mer à force de vouloir découvrir la frontière de l’Être et du Néant ?
La spiritualité occidentale n’a pas le choix si elle veut sortir de sa torpeur : abandonner l’impasse où les ténèbres s’amassent depuis des siècles. Il est réconfortant que ce ne soient pas des philosophes ou des théologiens qui nous le disent, qui nous invitent à ce « retournement », mais des romanciers de notre époque, des poètes : car, jusqu’à plus ample informé, ce sont toujours les poètes qui ont eu raison sur les coupeurs de cheveux en quatre. Les poètes, et les mystiques, c’est pareil, sont les seuls à pouvoir nous montrer le sentier qui mène à la clairière sacrée, là où, de toute éternité, croît l’Herbe d’Or.