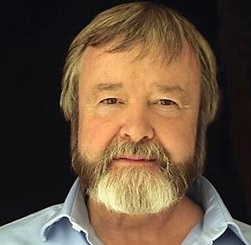Quand nous ne pouvons pas « voir » ce que nous ne pouvons pas voir
Les gens me demandent souvent ce qu’ils devraient faire pour rétablir l’équilibre entre les deux hémisphères du cerveau. La première étape pour rétablir quoi que ce soit est de prendre conscience de tout ce qui nous échappe dans notre façon d’être au monde. La première question à se poser est donc la suivante : qu’est-ce que ma vision particulière de la réalité exclut de ma vision ? Il y a bien sûr un paradoxe : si nous ne pouvons pas le voir, comment savoir ce que c’est ? Mais il existe des moyens d’éviter de se faire piéger. L’un d’eux est de cesser de croire que ce que les gens pensaient en d’autres temps et en d’autres lieux est dû à leur ignorance. L’expérience nous montre que la vérité est rarement pure et jamais simple. Nous savons différemment, pas nécessairement plus ou mieux ; et se limiter à une seule façon de voir les choses peut en occulter d’autres.
Comme vous le savez, je pense que l’attention, le type d’attention que nous choisissons d’accorder, et même le fait que nous soyons attentifs ou non, modifie totalement ce que nous découvrons dans le monde que nous apprenons à connaître — ce qui est bien sûr tout ce que chacun de nous peut connaître. L’attention est donc un acte créatif (ou destructeur) et donc nécessairement un acte moral. Louis Lavelle et Simon Weil ont comparé l’attention pure à l’amour lui-même.
En raison de l’asymétrie de leur mode d’attention, chaque hémisphère a une vision différente de tout, y compris de sa relation avec l’autre hémisphère. Cela est illustré de manière éloquente par l’histoire à l’origine du titre Le Maître et son Émissaire (The Master and his Emissary). Un maître spirituel sage s’occupait d’une petite communauté avec tant de soin qu’elle prospéra et grandit. Le Maître finit par se rendre compte qu’il ne pouvait pas s’occuper seul de tous les besoins de son peuple ; plus important encore, il se rendit compte qu’il y avait certaines questions dans lesquelles il ne pouvait pas, et ne devait pas, s’impliquer, s’il voulait conserver sa vue d’ensemble. Il a donc chargé son assistant le plus brillant pour agir en son nom. Bien que brillant, cet émissaire n’était pas assez sage pour savoir ce qu’il ignorait. Il devint arrogant et plein de ressentiment à l’égard du Maître : « Que sait-il ? », pensait-il. « C’est moi qui fais le vrai travail ici, c’est moi qui sais vraiment ». Il revêtit alors le manteau du Maître et se fit passer pour lui. L’émissaire ne sachant pas ce qu’il ignorait, la communauté déclina et l’histoire se termine par la ruine de celle-ci, y compris celle du Maître et de l’émissaire.
Ce n’est pas l’ignorance, mais l’ignorance de l’ignorance qui est la mort du savoir. L’hémisphère droit, quant à lui, sait ce qu’il ne doit pas faire. C’est la raison pour laquelle, dans l’histoire, le Maître (l’hémisphère droit) nomme l’émissaire en premier lieu.
Vous pourriez penser que lorsque je dis des choses comme « l’hémisphère gauche ne semble pas savoir ce qu’il ne sait pas », je parle de manière purement métaphorique. Mais ce n’est pas le cas. Il existe de nombreux exemples — particulièrement frappants dans le cas des patients au cerveau divisé, mais aussi observés dans des situations plus courantes telles que les accidents vasculaires cérébraux — dans lesquels l’hémisphère gauche non seulement ne sait manifestement pas de quoi il parle, mais se comporte comme s’il le savait parfaitement. Il se montre confiant et sans hésitation, même lorsqu’il parle d’un sujet dont il ne sait absolument rien. En revanche, l’hémisphère droit a tendance à être hésitant, prudent et flexible, même lorsqu’il a entièrement raison.
Il y a plusieurs raisons à cela. L’hémisphère gauche est beaucoup moins conscient de ce qui l’entoure — il « voit moins », dans tous les sens du terme, que l’hémisphère droit. Il tolère moins l’ambiguïté et tend vers une pensée exclusive, du type « soit/ou (il n’y a que deux choix possibles) » ; l’hémisphère droit est plus inclusif, enclin à la pensée du type « et/et (les deux à la fois/et) ». Cela se reflète dans la relation entre les deux hémisphères : l’hémisphère droit communique davantage et plus rapidement avec l’hémisphère gauche que l’hémisphère gauche avec l’hémisphère droit ; et l’hémisphère gauche communique davantage à l’intérieur de lui-même, tandis que « l’hémisphère droit établit davantage d’interactions bilatérales entre les hémisphères ». Le monde phénoménologique de l’hémisphère gauche est plus autonome, fermé, autovalidant — prisonnier de sa propre théorie ; le monde de l’hémisphère droit est plus ouvert aux nouvelles informations, à une vision d’ensemble et à la réalité des faits, indépendamment de ce que la théorie pourrait suggérer.
Tout cela fait que l’hémisphère droit considère la relation entre le Maître et l’émissaire comme coopérative et nécessitant les deux parties, comme le fait le Maître dans la parabole, alors que l’hémisphère gauche, comme l’émissaire, se considère comme n’ayant pas besoin (en réalité, il ne comprend pas) de ce que sait le Maître. C’est un bon serviteur, mais un très mauvais maître.
Pourquoi je vous rappelle de tout cela ? Parce que l’hémisphère gauche ne sait pas ce qu’il ne sait pas. Et c’est là que nous en venons aux métaphores.
Comme l’ont longuement expliqué Lakoff et Johnson, tout langage est métaphorique. Il ne s’agit pas seulement d’une tournure décorative de la poésie, mais il est « poétique » au sens premier de ce mot (du grec poiesis) : il crée des choses. Notre monde est construit sur des métaphores, et cela n’est nulle part plus vrai que dans la science et la philosophie. Cela signifie deux choses : nous ne pouvons en aucun cas nous passer de métaphores ; et comme la métaphore que nous choisissons gouverne ce qui est éclairé pour nous et ce qui est jeté dans l’ombre, nous ferions mieux d’être très prudents aux métaphores que nous utilisons.
Mais nous ne le sommes pas. Partout, nous comparons tout, le monde, la nature et nous-mêmes, à la machine. La machine est l’outil de l’hémisphère gauche et sa raison d’être, le pouvoir. On peut dire que les seules choses dans l’univers qui ressemblent à des machines sont les quelques morceaux de métal que nous avons créés, principalement au cours des 300 dernières années. Autrefois, nous comparions les objets de l’expérience à des entités organiques — une famille, un arbre, un cours d’eau. Pour des raisons importantes, je préfère le courant de la vie. Tout s’écoule — et peut-être surtout, et dans tant de sens, la vie elle-même.
Il y a une centaine d’années, les physiciens ont dû se rendre à l’évidence que la métaphore ou le modèle de la machine était inadapté pour décrire ce qu’ils découvraient sur le monde de la matière inanimée. La biologie, la science de la vie, cependant, est restée à la traîne — jusqu’à récemment. Une révolution est en train de se produire en biologie et il devient enfin indéniable que les êtres vivants n’ont rien à voir avec des machines. Nous ne sommes pas non plus des « machines à survivre », des véhicules robots aveuglément programmés pour préserver les molécules égoïstes que sont les gènes. Presque tout est faux dans cette malheureuse tentative. Les organismes ne sont absolument pas des « machines » ; ils ne sont pas non plus des machines de « survie » ; il n’y a aucun sens à dire qu’une seule cellule soit un robot ; ni qu’elle soit « programmée », et encore moins « aveuglément » ; ni que les gènes soient « égoïstes » ; et les organismes se débarrassent régulièrement de parties importantes de leur génome et les réarrangent, parfois dans des proportions extraordinaires.
Dans The Matter With Things, j’explore assez longuement l’inaptitude de la métaphore de la machine en biologie, au chapitre 12, intitulé « The science of life: a study in left hemisphere capture » (La science de la vie : une étude sur la capture de l’hémisphère gauche). Il compte à lui seul 70 pages, et l’argumentation est progressive, mais permettez-moi de citer quelques paragraphes hors contexte, car certains éléments ne sont peut-être pas connus de tous les lecteurs, et ils font réfléchir. Il y a beaucoup plus à dire, bien sûr, et il y a des notes complètes de toutes les sources, ainsi que d’autres discussions approfondies dans les notes. Il se peut qu’en temps voulu, je mette en ligne une plus grande partie de ce chapitre, si cela intéresse les gens.
Quelques brèves réflexions du chapitre 12
Si une cellule est placée dans un milieu légèrement acide, ses mitochondries se brisent en petites billes sphériques. Mais, étonnamment, lorsque la cellule est replacée dans un milieu normal, elles fusionnent à nouveau en chaînes et finissent par reprendre l’apparence et la structure interne de mitochondries normales. Supposons en outre que vous coupiez un bourgeon de membre en développement dans un embryon d’amphibien, que vous détachiez les cellules les unes des autres et que vous les laissiez s’agréger à nouveau en une masse aléatoire. Vous replacez ensuite cette masse aléatoire dans l’embryon. Que se passe-t-il ? Une jambe normale se développe. La forme du membre dans son ensemble dicte, selon Lewontin, le réarrangement des cellules :
Contrairement à une machine dont la totalité est créée par la juxtaposition de pièces et de morceaux ayant des fonctions et des propriétés différentes, les pièces et les morceaux d’un organisme en développement semblent naître comme une conséquence de leur position spatiale à des moments critiques du développement de l’embryon. Un tel objet ressemble moins à une machine qu’à un langage dont les éléments… prennent un sens unique en fonction de leur contexte.
Ou comme un champ dynamique. « Si l’organisme n’était que sa substance, nous ne pourrions pas le reconnaître d’un jour à l’autre », écrivait Lawrence Edwards, expert en morphologie végétale. « Pourtant, son être et en grande partie sa forme sont invariants d’un moment à l’autre et d’un jour à l’autre. La forme peut vivre dans le flux. Quelque chose de plus grand que la substance la prend, la façonne, l’utilise, puis la rejette ».
Là encore, contrairement à ce qui se passe dans une machine, il n’y a jamais deux bourgeons de membre exactement identiques dans un embryon en développement ; les bourgeons des cellules mésenchymateuses formatrices se développent chacun à leur manière. Le résultat est dans chaque cas un membre normal, entièrement formé, du type dicté par sa position. Mais pas seulement sa position « prédestinée » : le même groupe de cellules d’un bourgeon de membre peut néanmoins, bien que destiné à former le modèle d’un membre droit, donner naissance à son image miroir, un membre gauche, avec la symétrie opposée, simplement en étant transplanté sur le côté opposé de l’embryon.
Les expériences fascinantes menées sur la mouche des fruits, la drosophile, constituent un autre exemple de la suprématie du tout sur les parties. L’absence d’un gène homologue à Pax6 [qui joue un rôle essentiel dans le développement de l’œil et qui est présent sous une forme presque identique dans toute une série d’espèces, permettant le développement de l’œil d’une mouche, de l’œil d’une grenouille ou de votre œil, bien que les types d’œil, leur structure et leur fonctionnement soient très différents] fait que la mouche se développe sans yeux. Toutefois, si ces mouches sont croisées entre elles, on a constaté qu’elles finissaient par développer des yeux, bien qu’elles ne possèdent pas le gène en question.
En effet, après avoir éliminé (désactivé) les deux copies d’un gène ayant un rôle normalement important dans le développement d’une souris, des biologistes moléculaires ont constaté que, dans de nombreux cas, la souris ne semblait pas affectée et fonctionnait normalement. Chez certaines souches de souris, les mutations du gène Kit provoquent des taches blanches sur la queue et les pattes ; si une souris possède un gène Kit normal et un gène muté, elle présentera ces taches. Cependant, certains des descendants de ces souris, qui héritent de deux gènes Kit normaux, ont toujours la queue blanche.
La résistance à l’infection virale chez un ver nématode a été obtenue grâce à la présence, dans une partie de la population, d’un ADN produisant une séquence d’ARN qui réduit au silence le virus ; lors d’un croisement avec des vers dépourvus de cet ADN, certains descendants ont hérité du mécanisme antiviral et d’autres non, comme on pouvait s’y attendre. Cependant, les générations suivantes ont hérité du mécanisme antiviral même si elles n’avaient pas l’ADN requis. Cette transmission non liée à l’ADN a été suivie avec succès pendant 100 générations.
De même, la « mutation adaptative » signifie que si une souche de bactéries est incapable d’utiliser le lactose et qu’elle est placée dans un milieu riche en lactose, 20 % de ses cellules muteront rapidement vers une forme qui leur permet de le métaboliser : la mutation est alors héritée par les générations suivantes. Les organismes ne se contentent donc pas d’attendre passivement un heureux hasard ou de se résigner à disparaître, mais se remodèlent activement en réponse aux changements de leur environnement. Comme nous l’avons mentionné, les modifications de l’ADN ne sont plus considérées comme de simples accidents. En effet, Darwin lui-même a écrivait :
Jusqu’à maintenant, j’ai parfois parlé comme si les variations… étaient dues au hasard. C’est, bien sûr, une expression totalement incorrecte… Certains auteurs estiment que le système de reproduction a autant pour fonction de produire des différences individuelles ou de légères déviations de structure que de rendre l’enfant semblable à ses parents.
Une autre idée qui n’est peut-être pas très compatible avec l’idée de gènes cherchant à se préserver à tout prix.
Lorsque des défauts de développement ont été artificiellement induits chez un têtard, son développement ultérieur a pu s’adapter en conséquence, apportant apparemment des corrections vers ce qu’il semblait être son objectif final, le visage de la grenouille adulte, malgré l’absence de « programme » ou de mécanisme précédemment connu pour le guider. Michael Levin, éminent biologiste du développement et généticien à Tufts, écrit :
La plupart des organes étaient encore placés dans les bonnes positions finales, en utilisant des mouvements tout à fait différents des événements normaux de la métamorphose, ce qui montre que ce qui est encodé n’est pas un ensemble de mouvements tissulaires prédéterminés, mais plutôt un programme flexible et dynamique capable de reconnaître les écarts, d’effectuer les actions appropriées pour minimiser ces écarts et d’arrêter le réarrangement au bon moment.
La question est de savoir où se trouve l’information. C’est-à-dire l’in-form-ation. Où est stockée la forme globale de l’être, dans son ensemble, au service de laquelle agissent les mécanismes que nous pourrions détecter et mesurer ?
Si vous êtes intéressé, sachez qu’un certain nombre de conversations entre le professeur Michael Levin et moi-même sont déjà disponibles sur YouTube.
Texte original : https://iainmcgilchrist.substack.com/p/metaphors-can-make-you-blind