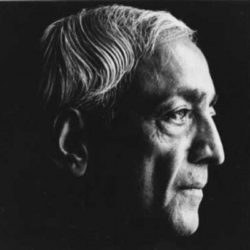Pour les noms complets des participants, voir ici.
N. Vasudevan Nair : Quel est le choix qui s’offre à l’humanité, monsieur ? Dans l’énormité de son chagrin, l’homme se trouve face au monde, ce qui est une expérience très dévastatrice. Il se met à quatre pattes pour attraper un brin d’herbe, il souffre, il est perdu. Peut-il y avoir une renaissance complète ou doit-il subir la douleur d’une naissance après l’autre ?
K : Vous demandez, monsieur, quel est le défi que l’humanité doit relever ?
N.V.N. : Quel est son choix ? Naître ou ne pas naître ? D’être ou de ne pas être ?
K : Diriez-vous que c’est là une question réelle ? Quel est le défi pour l’humanité dans la crise actuelle ?
N.V.N. : Non, ce n’est pas la vraie question. La vraie question est : être ou ne pas être.
K : Je ne comprends pas très bien la question, monsieur. Expliquez-moi, s’il vous plaît. Quelle est la véritable question dont nous discutons depuis deux jours ? Nous voyons tous, de manière évidente, la détérioration de l’humanité, non seulement dans ce pays, mais dans tous les pays, et nous devons non seulement y mettre fin, mais aussi provoquer une renaissance — non pas selon l’ancien modèle, mais un mode de vie totalement différent. Est-ce là la question que nous posons ? Nous constatons également que la science, Karl Marx, la Gita, les Upanishads, Mao et toute la propagande organisationnelle ainsi que les institutions ont complètement échoué. Et nous demandons : Existe-t-il un mode de vie qui soit totalement religieux au sens où nous utilisons ce terme ? Et nous essayons d’explorer ce qu’est cette vie religieuse. Car historiquement, comme on l’observe, une nouvelle culture, une nouvelle façon de peindre, de faire de la musique, de vivre, jaillit d’une vie religieuse profonde. Quelle est cette vie religieuse qui n’est ni sentimentale, ni romantique, ni dévotionnelle, car tout cela est totalement dénué de sens ? Qu’est-ce qu’un esprit véritablement religieux ? C’est ce que nous essayons d’investiguer dans ce groupe.
Comme l’a souligné Achyutji, la connaissance, qu’elle soit marxienne ou scientifique ou le savoir accumulé par l’humanité dans n’importe quel domaine, est en train de détruire l’homme, et, pour mettre fin à cette destruction, il faut trouver une nouvelle voie, une voie religieuse. Est-il possible de trouver une voie religieuse dans le monde moderne, avec toutes les avancées technologiques, avec toutes les relations qui s’effondrent ?
P.K.S. : Plus tôt, nous sommes arrivés à la conclusion qu’une vie religieuse est l’antithèse même de la fragmentation. Nous avons parlé de deux choses qui, à mon avis, sont mutuellement incompatibles : D’une part, vider complètement l’esprit et, d’autre part, éliminer la fragmentation. Mais la fragmentation est le contraire de la totalité. La totalité est richesse, pas le vide. Vous avez parlé de vider l’esprit. Allons-nous remplir l’esprit ou le vider ? Je ne comprends pas cette incompatibilité.
Prof. Sanjivi : C’est la question pertinente que je voulais également vous poser. Est-il possible de faire le vide dans son esprit ? Est-ce possible et pertinent, dans la vie de tous les jours ?
K : Nous essayons d’examiner un mode de vie qui ne soit pas fragmentaire, qui soit holistique, total, et qui nous conduirait peut-être à une vie véritablement religieuse. Nous avons dit que puisque la pensée en elle-même est limitée, tous ses mouvements sont fragmentaires. La pensée elle-même est fragmentée. Accepteriez-vous cela ?
San : Monsieur, il y a une difficulté à accepter cela. Même cette pensée est le résultat d’une pensée fragmentaire. N’est-ce pas ?
K : Non. Ce n’est pas une pensée, c’est une déclaration.
A.P. : C’est un insight (perception directe).
San : Même si vous appelez cela un insight, n’est-ce pas le résultat d’une personnalité fragmentaire ?
K : Non, monsieur.
G.N. : Nous possédons beaucoup de connaissances, et de ces connaissances découle une façon de fonctionner. Quelle est la différence entre la connaissance et l’insight ? Quelle est la nature de l’insight ? Une vie religieuse, dites-vous, est une vie saine. Il y a un lien entre cela et l’insight, qui n’est pas une simple connaissance, qui n’est pas une fonction de la mémoire. Est-il possible de communiquer cette distinction ?
A.P. : Je voudrais ajouter que l’insight est différent de la conclusion. Lorsqu’il y a connaissance, il y a conclusion. L’insight, quant à lui, ouvre une porte. Nous devons donc également comprendre la différence entre une conclusion qui découle de la connaissance et un insight, qui est qualitativement différent.
K : Essayons-nous maintenant d’explorer ce qu’est l’insight ?
D.S. : Nous devrions également discuter de la question de savoir comment un esprit fragmenté peut enquêter.
K : Voyons d’abord que le mouvement de la pensée doit inévitablement être un processus fragmentaire. Vous demandez si cette affirmation n’est pas elle-même une affirmation fragmentaire. Elle l’est.
Uma : Je vois le mouvement de la pensée ; je l’observe, je le perçois. Tout en observant, je deviens très silencieuse. Mais en même temps, je vois le besoin de changement, l’urgence du changement, et le contenu même de l’observation l’empêche. Il y a conflit parce que je veux changer et je vois que tout cela appartient au mouvement de la pensée.
K : Tout cela est le mouvement de la pensée, et ce mouvement même est un mouvement fragmentaire. La question est de savoir si ce mouvement fragmentaire peut prendre fin. Qu’en dites-vous, monsieur ?
D.S. : Krishnaji, je suis ébranlé. Même la question « Cela peut-il cesser ? » naît d’un autre fragment.
K : Elle a utilisé le mot « perception ». Elle observe, elle perçoit sa propre vie, et dans cette perception, elle découvre qu’il y a conflit, qu’il y a fragmentation, et la nécessité d’un changement en elle-même. Le point essentiel est donc la perception, la vision de tout ce mouvement de pensée. C’est bien ce que vous essayez de dire ? Pourrions-nous alors discuter de ce qu’est la perception, non pas en théorie, mais en réalité ? Pourrions-nous approfondir cette question et partir de là ?
San : Je pense que l’élément pertinent et utile à discuter aujourd’hui est la technique derrière cela et comment elle est possible en tant que solution pratique dans la vie de tous les jours.
P.J. : Monsieur, pourrions-nous commencer l’enquête sur l’esprit religieux par la question suivante : comment la pensée peut-elle cesser ?
San : Pour l’instant, j’accepte votre suggestion selon laquelle la solution à tous les problèmes serait la cessation de la pensée, l’arrêt du processus de pensée. Comment y parvenir ?
K : Diriez-vous qu’une vie religieuse est la fin de tout mouvement de pensée, la fin de tous les problèmes ?
San : C’est ainsi que je vous ai compris.
K : Monsieur, c’est beaucoup plus complexe. Devons-nous le discuter ?
R.D. : Une difficulté se pose à presque tous, celle du « je » et de la pensée. Lorsque nous utilisons le mot « pensée », nous semblons l’extérioriser comme si elle était là, comme une sorte d’objet que nous ne percevons pas. L’insight consiste à voir de l’intérieur. Est-il possible pour quelqu’un de voir de l’intérieur ?
K : Vous avez posé tant de questions. Par où commencer ? Voyons-nous ou comprenons-nous tous, que ce soit verbalement, intellectuellement ou profondément, que la pensée, étant en elle-même limitée, quelle que soit son activité, est fragmentée ? Le voyons-nous ou sommes-nous simplement d’accord intellectuellement avec cela ? La question suivante qui se pose serait : est-il possible d’arrêter la pensée, et si elle est arrêtée, quelle est alors mon activité dans ma vie quotidienne ? La pensée peut-elle être arrêtée, et qui va l’arrêter ? S’il existe une entité capable de l’arrêter, cette entité est soit extérieure au champ de la pensée, soit créée par la pensée elle-même. Je suis un acteur extérieur et je vais l’arrêter. Si cet acteur est extérieur — le ciel, Dieu ou autre — alors cet acteur extérieur est créé par la pensée. Notre problème est donc le suivant : la pensée peut-elle se rendre compte qu’elle est limitée et, étant limitée, se restreindre à une certaine activité dans la vie quotidienne ? La question suivante est : la pensée peut-elle devenir consciente d’elle-même, et, dans cette conscience même, se placer dans un coin particulier, pour ainsi dire, et agir à partir de ce coin ? Mais elle ne le peut pas.
D.S. : Regardons, alors, les choses sous un autre angle. Si je veux planter un clou dans le mur, je prends un marteau et je frappe le clou. Si je veux aller ramer dans un bateau, j’utilise une rame et je rame. Qu’en est-il de la pensée ? La pensée ne se voit pas de cette manière. En d’autres termes, la pensée a une fonction comme un clou pour un marteau ou une rame pour un bateau. Que se passe-t-il si la pensée s’arroge ou prend plus que ce qu’elle est censée assumer ? Vous disiez que la pensée a une fonction limitée.
K : Non, monsieur. La question est : La pensée peut-elle prendre conscience qu’elle est limitée ?
R.D. : La pensée peut-elle intellectuellement penser qu’elle est limitée ?
K : C’est encore une autre pensée qui dit que je suis limité. Alors, laissons cela de côté pour le moment. Votre conscience peut-elle prendre conscience d’elle-même ?
P.J. : Quelle est la différence entre la pensée devenant consciente d’elle-même et la conscience devenant consciente d’elle-même ? La conscience a-t-elle, elle-même, la capacité de se refléter ?
K : La conscience a-t-elle la capacité de s’observer elle-même, et non de se refléter ? Y a-t-il dans la conscience un regard ou un élément qui s’observe tel qu’il est ? Il est très important de découvrir s’il y a observation. Y a-t-il un observateur qui observe, ou n’y a-t-il que l’observation pure ?
P.K.S. : Si la conscience peut s’observer elle-même, alors il me semble que nous introduisons une dualité au sein même de la conscience.
K : Monsieur, la conscience est remplie de dualité. Je fais, je ne fais pas, je dois, je ne dois pas, la peur, le courage — tout cela constitue la conscience. C’est pourquoi c’est si difficile. Je dis une chose, vous en dites une autre. Nous ne nous rencontrons jamais.
M.Z. : Sommes-nous en train d’admettre que la pensée est capable de reconnaître un fait ?
K : Non.
S.P. : La conscience de la conscience fait-elle partie de la conscience ?
K : J’aimerais en discuter. Existe-t-il une observation sans observateur ? Car si c’est le cas, cette observation opère sur l’ensemble de la conscience. Il est important de discuter de cette question de l’observation. Nous passons à côté d’une chose très importante, à savoir qu’il n’y a que l’observation, pas l’observateur.
D.S. : Si je sais qu’il y a une observation sans observateur, j’ai déjà introduit un observateur.
K : Pourquoi n’y a-t-il pas d’observation pure ? Parce que vous introduisez un observateur dans l’observation. Alors, qui est l’observateur ? Est-ce moi qui introduis l’observateur dans l’observation ? Je dis : Tant qu’il y a un observateur différent de son observation et de ce qui est observé, il doit y avoir dualité. Comme la plupart d’entre nous observent avec l’observateur, nous devons donc examiner ce qu’est l’observateur. Je veux en arriver à un point où je peux mettre cela en pratique dans ma vie quotidienne. Comment puis-je observer sans l’observateur ? Puis-je observer mes actions, ma femme, mon mari, mes enfants, toute la tradition culturelle, sans l’observateur ? Qui est l’observateur auquel vous accordez tant d’importance ?
P.K.S. : Monsieur, vous semblez accepter de manière dogmatique la distinction entre l’observateur et l’observation, comme s’il existait un observateur en dehors de l’observation.
K : Non. J’ai dit que nous avons établi cela dans notre vie — l’observateur, « j’observe », « je regarde », « mon opinion est que », et ainsi de suite. C’est toute l’histoire qui s’est construite au fil des générations, l’idée que l’observateur est différent de ce qu’il observe. J’observe cette maison. Il est évident que la maison est différente de moi, de l’observateur.
P.K.S. : L’objet est différent de l’observateur, mais l’observation ne l’est pas.
K : J’y viens. Il y a une observation de cette chose appelée arbre. Il y a une observation, et je dis : c’est un arbre, et ainsi de suite. Nous parlons ici d’une observation psychologique. Dans cette observation, il y a une dualité entre moi et la chose que j’observe. C’est l’observateur qui introduit cette distinction. Or, qu’est-ce que l’observateur ?
S.P. : L’ensemble des expériences et des identifications constitue l’observateur. L’observateur a de nombreuses profondeurs.
K : C’est-à-dire la connaissance, le passé ; le passé étant l’accumulation de savoir, de l’expérience de l’humanité — raciale, non raciale. L’observateur est le passé.
A.P. : Avec un ajout : l’observateur est le passé plus le sens de la continuité.
K : La continuité, c’est l’observateur qui est le passé rencontrant le présent, se modifiant et continuant dans le présent.
San : L’observateur a des profondeurs très difficiles à sonder.
K : Je ne le pense pas. Je sais que l’observateur a de la profondeur, la profondeur étant la connaissance accumulée durant des siècles.
P.J. : La nature de l’observateur c’est le champ de conscience. Quelle est la totalité de l’observateur, la totalité de la conscience ?
K : Vous avez parlé de la totalité de la conscience et de la question de savoir s’il peut y avoir une observation sans observateur. Maintenant, lorsque vous dites qu’il y a des profondeurs à l’observateur, je dis que l’observateur lui-même est le champ de conscience. La totalité de l’observateur est elle-même le champ d’observation. Vous pouvez élargir l’observateur à l’infini.
Voyez, Pupulji. Rendons cela très simple : Puis-je observer ma femme ou mon mari sans toute l’accumulation que j’ai eue pendant mes vingt ans de vie avec elle ou lui ?
P.J. : Je pourrais dire « oui ».
K : Ce serait simplement être d’accord. Nous passons à côté du problème essentiel. Puis-je observer ma femme ou mon mari avec qui j’ai vécu, et à propos de qui, pendant vingt ans, j’ai accumulé des connaissances, comme elle en a sur moi ? Puis-je l’observer sans cette connaissance accumulée ?
San : En l’état, ce n’est pas possible.
K : L’observateur est le passé, qu’il s’agisse de la totalité de la conscience, de la profondeur infinie, etc. Pouvez-vous observer votre femme, votre mari, comme si vous voyiez un être humain pour la première fois ? Toute votre relation change alors.
S.P. : Il y a une difficulté. Il est arrivé qu’on puisse voir son mari ou un ami sans aucun mouvement du passé. On voit donc qu’il est possible de voir ainsi. Mais, lorsque vous dites que la relation entière est changée pour toujours, la difficulté surgit.
K : Très bien. Avons-nous communiqué l’un à l’autre que l’observateur qui est le passé et, par conséquent, lié au temps crée la distinction entre lui et sa femme — en la dominant, en la poussant ? Le passé est donc toujours à l’œuvre. Par conséquent, sa relation avec elle n’est pas basée sur l’affection, ni sur l’amour, mais sur le passé.
S.P. : Nous avons de l’affection.
K : Je me le demande. Peut-on avoir de l’affection s’il y a l’opération du passé ?
San : Il n’y a qu’une seule issue.
K : Je ne cherche pas une issue. Je veux comprendre le problème dans lequel je vis. Il n’y a pas d’issue. Tout ce qui m’importe, c’est la façon dont j’aborde un problème, car c’est cette approche qui va dicter la compréhension du problème.
P.K.S. : La question se pose alors : L’observateur est-il capable d’observer le passé ?
K : C’est ce qui constitue l’ego, le « je », le soi, le « moi ».
P.J. : Vous dites : L’observateur peut-il observer le passé ? C’est la nature essentielle de l’enquête. Est-il possible qu’une observation soit là sans l’observateur ?
San : Est-ce bien cela la question ou bien autre chose : (a) Peut-on observer sans le fardeau du passé ; ou (b) Peut-il y avoir une observation sans l’observateur ? Je trouve beaucoup de différence entre les deux.
K : Monsieur, c’est notre problème à tous. Puis-je observer une chose sans le poids du passé ? Parce que, s’il est possible d’observer totalement, alors cette observation n’est pas liée au temps, ce n’est pas une continuité. Lorsque vous le faites, ne tombez-vous pas dans un nouveau mode d’existence, quelque chose de totalement irrévocable ?
P.J. : Comment est-ce possible ?
S.P. : À ce stade, que fait l’esprit ? Que peut-il faire ? Il n’y a pas de mouvement de pensée.
K : C’est pourquoi j’explore le processus qui consiste à observer l’observateur. L’observateur est le passé. L’observateur peut-il voir le mouvement du passé tel qu’il fonctionne ? Peut-on observer le passé — la blessure, par exemple ? Peut-on observer le mouvement de la blessure, tout le cycle de la blessure, psychologiquement, biologiquement, physiquement et ainsi de suite, la blessure qui implique la résistance, l’agonie, la douleur, tout cela ? Peut-il y avoir une observation de cette blessure, cette observation racontant l’histoire de la blessure, se révélant elle-même ? Est-ce irréalisable ?
S.P. : Encore une fois, nous n’avons qu’une vision fragmentaire de l’ensemble.
D.S. : Tout ce que vous voyez d’une certaine manière est l’action de l’observateur. Ainsi, toute question surgit dans la condition de l’observateur.
K : Si je vous dis une chose simple, que l’amour n’est pas dans le temps, alors la dualité, l’observateur, tout cela prend fin. Maintenant, qu’est-ce qu’une vie religieuse ? De toute évidence, tout ce qui se passe au nom de la religion n’est pas de la religion — tous les rituels, les puja, les dieux, tout cela est exclu. Qu’en sera-t-il alors ? Tout cela est rejeté, ce qui signifie que vous vous rejetez vous-même, le « moi ». L’essence de la religion est donc l’absence totale du « moi », du « soi ».
San : Qu’entendez-vous par « soi » ? Est-ce l’ego ?
K : L’ego, c’est-à-dire mes caractéristiques, mes désirs, mes peurs.
San : Mais n’est-ce pas le mécanisme d’observation, un instrument pour observer ?
A.P. : Accepteriez-vous que je dise que le moi n’est qu’un adhésif, qu’il a la qualité de faire que les choses s’y collent ?
K : La description n’est pas le soi. Je veux voir ce qu’est le soi. Ce soi peut-il être retiré ? Puis-je me débarrasser de ma jalousie, de ma colère ? Tant que cela existe — la peur de ceci ou de cela —, je n’ai pas d’esprit religieux. Je peux prétendre être religieux en allant au temple. Vous devez voir que vous êtes égoïste. Le soi est jalousie, envie, avidité, autorité, pouvoir, position, domination, attachement. Terminez-le. Et pouvez-vous être désintéressé, pouvez-vous vivre sans le soi et vivre dans ce monde ? Est-ce cela que vous demandiez ?
San : Pas exactement. Nous en étions restés au point où la solution à tous les problèmes est d’arrêter de penser, d’arrêter tout le processus de la pensée. Il serait plus fructueux de trouver une technique pour cela.
K : Monsieur, le mot « technique » implique une pratique, une répétition continue, ce qui rend l’esprit mécanique. Un esprit mécanique ne peut jamais avoir d’amour. Voyez bien que tout système rend l’esprit mécanique. Si vous le voyez intellectuellement, allez plus loin. Nous avons eu des systèmes en abondance et personne n’est parvenu à quoi que ce soit avec ces systèmes.
D.S. : Le fait est que nous en avons parlé à maintes reprises. Inévitablement, la question est : existe-t-il un système ? Dans la nature même de l’observateur se posent les questions suivantes : comment puis-je être religieux, comment puis-je être désintéressé, comment puis-je être ceci ou cela ? Tout le monde veut obtenir une autre drogue ; tout le monde essaie d’y parvenir.
K : Oui, monsieur, tout le monde veut être autre chose. Tout le monde fait quelque chose. Alors, tout ce que je dis est : commencez là où vous êtes.
D.S. : Vous vous en tenez à cela ?
K : Oui.
D.S. : Mais vous parlez d’être désintéressé.
M.Z. : L’envie, la jalousie et tout cela, c’est là où vous êtes.
D.S. : Dans tout ce qu’il a dit, il y a une suggestion subtile que vous pouvez vous débarrasser de la jalousie, de l’envie.
K : Non, monsieur. C’est votre compréhension, plutôt une mauvaise interprétation. Je dis : Commencez tout près. Parce que, si vous connaissez toute l’histoire de l’homme qui est vous, c’est terminé.
D.S. : Vous ne changez pas cela.
K : C’est un livre, un vaste livre, et je le lis. Je n’essaie pas de le changer. Je veux lire toute l’histoire instantanément.
S.P. : Sans mouvement dans le temps, comment pouvez-vous lire ?
K : Je veux simplement connaître tout le contenu de moi-même. Ma conscience entière est son contenu. Et je l’explore. On peut enquêter sur quelque chose quand on est libre, quand on n’a pas de préjugé, de croyance, de conclusion.
R.D. : Il n’y a donc pas d’enquête sur l’histoire. L’histoire, c’est le préjugé, et vous dites : « Lisez-la ».
K : Alors c’est fini. Je suis arrivé à la fin du chapitre.
S.P. : Vous n’êtes donc pas vraiment intéressé à examiner le contenu, mais à l’arrêter ?
R.D. : Certaines personnes recherchent des systèmes. Je vois intellectuellement qu’un système ne mettra pas fin au problème. Je ne cherche donc pas. La question est maintenant de savoir ce que je fais. J’apprends et j’observe, mais mon outil d’observation reste l’intellect. Et je suis assis et j’observe avec vous. L’outil est inadéquat — l’investigation par la connaissance. Je le vois maintenant ; je vois quelque chose de très pratique. J’ai rejeté les systèmes, j’ai rejeté la pratique. Où suis-je ?
K : Si vous avez mis de côté les systèmes, la pratique, quelle est la qualité de votre esprit ?
R.D. : Il enquête, il explore.
K : Vous ne répondez pas à ma question. Quel est l’état de votre esprit lorsque vous avez écarté les systèmes ? Voyez, messieurs, vous avez vu quelque chose de faux et vous l’avez rejeté. Vous avez mis de côté les systèmes. Pourquoi les avez-vous mis de côté ? Parce que vous voyez qu’ils sont absurdes, vous le voyez logiquement. Ce qui veut dire quoi ? Que votre esprit est devenu plus aiguisé, plus intelligent. Cette intelligence va observer, écarter tout ce qui est faux. Cette intelligence voit-elle les choses de manière fragmentaire ou les voit-elle dans leur intégralité. Lorsque vous rejetez quelque chose de faux, votre esprit est plus léger. C’est comme si vous escaladiez une montagne et que vous vous débarrassiez de ce dont vous n’avez pas besoin. Votre esprit devient très, très clair. Votre esprit a donc la capacité de percevoir ce qui est vrai et ce qui est faux.
Rejeter tout ce qui est faux, c’est-à-dire tout ce que la pensée a rassemblé. L’esprit n’a alors plus d’illusion. Monsieur, c’est tout le livre, je ne lis rien d’autre que le livre. J’ai commencé par le premier chapitre qui dit : « Prenez conscience de vos sens : Prenez conscience de vos sens. Le chapitre suivant dit : Les êtres humains ont des sens partiels, exagérant un sens et niant les autres. Le troisième chapitre dit : Veillez à ce que tous les sens puissent fonctionner, ce qui signifie qu’il n’y a pas de centre pour une opération sensorielle particulière. Et le quatrième chapitre, et ainsi de suite. Je ne vais pas lire le livre pour vous. Lisez-le et explorez la nature de la vie religieuse.
Madras, 4 janvier 1979