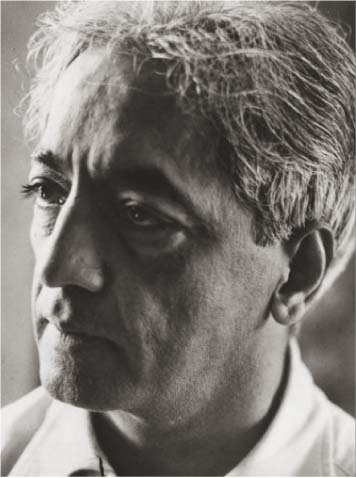Pour les noms complets des participants, voir ici.
Madras, 13 janvier 1978
Sunanda Patwardhan : Le siècle actuel est témoin d’avancées technologiques considérables et de l’élargissement des frontières du savoir, et pourtant, cela ne semble pas avoir engendré une société meilleure ni apporté le bonheur à l’homme. Partout dans le monde, des personnes sérieuses remettent de plus en plus en question le rôle de la technologie et du savoir dans la société. C’est dans ce contexte des valeurs culturelles et de la conscience humaine que nous devons rechercher les racines de la régénération et du progrès humain. L’humanité ne peut plus être considérée comme une entité de masse. Bien que nous nous réunissions à Madras, qui n’est qu’une partie, un coin, de cette grande et ancienne terre, j’ai le sentiment que notre perspective et notre approche des problèmes doivent avoir une dimension globale.
A.P. : La société moderne s’est développée au cours des deux derniers siècles. Elle repose sur certains postulats clairs : que les problèmes qui affectent la société humaine proviennent d’un manque de ressources matérielles, de la pauvreté, de la maladie, de la misère, et que ceux-ci peuvent être corrigés par le contrôle de l’environnement matériel. Cette conception persiste dans l’esprit des hommes, en particulier dans des pays comme l’Inde où la pauvreté est si répandue. De même, les modèles institutionnels de propriété et de ressources sociales ont été considérés comme l’un des principaux facteurs du désordre social. Il devient de plus en plus évident que ces postulats constituent une simplification facile et excessive. La mauvaise utilisation des ressources constitue un péril pour la survie humaine. La diversion criminelle des compétences scientifiques et technologiques vers la production d’armes létales, atomiques et autres, ainsi que la pollution, représentent de graves menaces pour la survie de l’humanité. La science et la technologie, en elles-mêmes, n’ont aucune défense contre leur propre utilisation abusive. De même, les développements dans le monde communiste exposent clairement l’optimisme naïf selon lequel des changements dans les modèles de propriété conduiraient automatiquement à la création d’une société d’hommes libres et égaux. Le marxisme et la science étaient les dieux de ma génération, mais ils n’ont pas réussi à éviter la crise dans laquelle la société humaine est plongée. Aujourd’hui, nous remettons en question la validité de la croissance illimitée du produit national brut comme indice du bien-être économique. La crise pétrolière et la crise énergétique ont donné un poids considérable à cet examen.
Une question plus large se pose : la croissance du savoir lui-même n’est-elle pas tout aussi dénuée de pertinence face à la situation centrale dans laquelle se trouve l’homme moderne ? L’homme est enchaîné à une vision fragmentée du développement humain, ce qui aggrave la crise. Nous nous éloignons donc, une fois de plus, de la périphérie pour explorer si la conscience humaine est capable d’une régénération radicale rendant possibles une nouvelle perspective et une relation saine et humaine. Nous devons aller au-delà de nos ressources actuelles de connaissance pour accéder à cette sagesse qui est aussi compassion. Tant que nous traitons l’ego comme une entité semi-permanente, il semble que l’amour soit exclu et que nous vivions dans un champ d’approximations.
La régénération de l’homme dans la société est liée au problème de la connaissance de soi. Nous constatons maintenant qu’aucune solution ne peut surgir d’une perspective sociale.
P.J. : Pouvons-nous mettre en évidence les pressions, les défis auxquels l’homme est confronté aujourd’hui, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ? Il n’y a pas de réponse au problème de l’auto-régénération tant que l’homme ne comprend pas le sens de l’humanité. Cette compréhension vient-elle du savoir, des processus technologiques ? Dans quelle direction l’homme cherche-t-il ? Je suggérerais donc que ce n’est que par la discussion, le dialogue, que la nature de notre pensée peut être mise à nu. Cela mettrait en lumière non seulement la situation critique, mais aussi la solution.
Ivan Illich : L’une de nos préoccupations au cours des dix dernières années a été qu’un défi qui était autrefois régional est devenu mondial. Par exemple, la nécessité de rechercher la joie, la paix, l’illumination, la satisfaction par l’acceptation des limites ; et une austérité, un renoncement qui pouvaient auparavant être considérés comme une tâche purement personnelle pour des individus de certaines cultures, sur la base de leurs convictions personnelles, devient aujourd’hui une condition absolument nécessaire à la survie. La nécessité de cela peut être vérifiée de manière opérationnelle, démontrée scientifiquement.
Nous sommes réunis ici, issus de cultures et de traditions très différentes. Au cours de la dernière génération, nous en sommes venus — nation après nation, groupe représentatif après groupe, partis, professions comme la médecine ou l’enseignement — à accepter comme objectif d’obligation publique certains concepts qui n’existaient pas réellement lorsque je suis né, il y a seulement cinquante ans. Le progrès, le développement, dans le sens où nous utilisons aujourd’hui ces termes, sont des concepts postérieurs à la Seconde Guerre mondiale. La croissance économique, le PNB (produit national brut), sont des expressions que certains des plus âgés parmi nous ont encore du mal à saisir. Le progrès, la croissance, le développement sont désormais essentiellement compris comme la substitution de choses que les gens faisaient auparavant par eux-mêmes. Leur valeur d’usage est remplacée par la marchandise. Dans ce processus, la politique est devenue principalement une affaire de fourniture à tous de quantités égales de marchandises. La protection égale du pouvoir et de la capacité des personnes à faire, à produire par elles-mêmes, à être autonomes, la lutte pour les libertés productives par opposition aux droits productifs, ont été presque oubliées, submergées, rendues impossibles par les divers systèmes dans lesquels nous vivons.
Si, comme vous le dites, Pupulji, il existe une toile, un outil analytique, une manière de regarder la mutation singulière à laquelle nous sommes confrontés, voici ce que je propose : pendant cent ans — et de manière très intensive pendant trente ans —, le progrès a été conçu comme un enrichissement, qui a inévitablement détruit les conditions environnementales rendant l’autonomie possible. C’est là, à mon avis, la véritable destruction de l’environnement, plus profonde encore que la destruction de l’environnement physique par les poisons et par la surexploitation agressive des ressources de la terre. C’est la destruction, dans l’environnement, des conditions — sociales, physiques, mentales — qui rendent l’autonomie possible. Lorsque l’on vit dans une grande ville presque partout dans le monde, des choses aussi simples que donner naissance ou mourir de manière autonome deviennent impossibles. L’appartement, le rythme de la vie, ne sont pas organisés pour cela. Les gens ont perdu même les compétences de base que possédait toute sage-femme ou tout être humain se tenant auprès d’un autre au moment de sa mort.
La plupart d’entre nous — à moins d’avoir la chance de vivre peut-être dans les faubourgs de Bénarès ou dans la campagne indienne — ne sont pas autorisés à mourir. J’emploie le terme transitif « mourir ». Nous cesserons d’exister sous une action que j’appellerai « Medicare (sécurité sociale) ». Ce n’est pas un meurtre, mais l’homme est transformé en légume au profit d’un hôpital. Le rythme de ce développement est celui d’une société avide et accumulatrice, une société dans laquelle les hommes sont amenés à croire que les techniques modernes exigent une telle société, où le progrès technique signifie l’incorporation de nouvelles inventions dans les processus de production de marchandises. Les livres imprimés sont des outils pour les enseignants ; les roulements à billes sont des moyens d’accélérer les véhicules motorisés jusqu’à un point où la voiture chasse la bicyclette de la route.
Or, il est illusoire de penser que le progrès technique pourrait être utilisé pour rendre une société moderne intensive en valeur d’usage. Dans une société intensive en marchandises, les biens pouvant être produits par des machines sont au centre de l’économie. Et ce que les gens peuvent faire par eux-mêmes n’est autorisé que marginalement, toléré tant que cela n’interfère pas avec le processus d’enrichissement ; dans une société où l’on inverse cette logique pour devenir intensive en valeur d’usage et néanmoins moderne, nous accueillons les dispositifs techniques uniquement lorsqu’ils augmentent la capacité des personnes à générer des valeurs d’usage non destinées aux marchés, et nous considérons les marchandises comme très précieuses seulement lorsqu’elles accroissent la capacité des personnes à faire ou à fabriquer par elles-mêmes. Dans le type de société où nous vivons, la production légitime est massivement le résultat de l’emploi. J’achète une partie de votre temps et de votre énergie, je vous paie pour cela et je vous fais travailler sous ma direction. Dans une société orientée vers la valeur d’usage, ce serait exactement l’inverse. En plus du travail, il y aurait un accès égal aux outils, des possibilités de faire ou de produire sans être employé. Tout emploi serait considéré comme une condition nécessaire.
Maintenant, comment faisons-nous l’expérience de ce que signifie être humain ? En résumant une révolution similaire survenue dans les périodes les plus sombres du Moyen Âge en Europe, mon maître, Lerner, souligne trois conceptions de révolution, de renversement : la première, qui remonte à l’âge d’or, puis recommence ; la deuxième, qui transforme ce monde en un âge d’or ; et la troisième, la conception organiciste. Lerner a soigneusement élaboré ces trois idées et a montré qu’au VIe ou VIIe siècle, une quatrième conception est apparue par l’union du message chrétien et de la tradition monastique venue d’Orient en Europe : chaque homme est responsable de sa propre révolution. Et la seule manière de transformer le monde est la transformation de chaque homme, guidée principalement par l’idée de vertu fondamentale. La première vertu à cultiver dans le processus d’une véritable révolution est l’austérité ou la pauvreté d’esprit. Et l’austérité a été définie par un philosophe du XIIIe siècle comme cette partie particulière de la vertu d’équilibre ou de prudence, qui est la base de l’amitié, parce qu’elle n’élimine pas tous les plaisirs, mais seulement ceux qui s’interposeraient entre vous et moi ou qui nous détourneraient l’un de l’autre. Ainsi, l’austérité est la condition fondamentale de la vertu pour celui qui veut trouver un équilibre avec grâce et joie.
K : Puis-je ajouter quelque chose à ce que le docteur Illich a dit ? Je ne fais qu’ajouter, je ne contredis pas. Je pense que la plupart des gens, des gens réfléchis, ont rejeté toute forme de système, d’institution ; ils ne font plus confiance au communisme, au socialisme, au libéralisme, à la gauche, à la droite, politiquement ou religieusement. Je pense que l’homme est arrivé à un point où il sent — et je suis sûr que le docteur Illich ressent la même chose — qu’il faut un nouvel esprit, une nouvelle qualité de l’esprit. Par esprit, j’entends les activités de la conscience cérébrale, la perception sensorielle et l’intelligence. Est-il possible, avant que l’homme ne se détruise complètement, de créer un nouvel esprit ? C’est la question majeure à laquelle sont confrontées la plupart des personnes sérieuses et réfléchies. On a complètement rejeté l’idée que quelques système, institution, dogme ou croyance religieuse que ce soit puissent sauver l’homme ; on exige ou on requiert une révolution non seulement sociologique, mais intérieure, avec clarté et compassion. Est-il possible pour les êtres humains de faire advenir une catégorie ou une dimension de l’esprit totalement différente ?
P.K.S. : La crise de la conscience, pour autant que je puisse le voir, est un phénomène qui se répète sans cesse dans l’histoire. Je pense donc qu’il faut la considérer d’un point de vue génétique. Il est possible de trouver un schéma général dans cette crise. Une forme est celle de l’homme contre la nature, l’homme se découvrant étranger dans un monde qu’il considère peut-être comme hostile. L’homme doit alors lutter contre les forces de la nature, et cela engendre une crise dans son cœur. Une autre forme est beaucoup plus profonde et peut-être plus significative pour l’histoire humaine : l’homme contre l’homme. Cela survient parce que l’homme considère un autre homme comme un phénomène objectif et, par conséquent, étranger. Autrement dit, un individu représente un danger, une menace, un défi pour sa propre sécurité, son intégrité. Le troisième aspect de cette crise est l’homme contre lui-même. Il ne sait pas quelle est l’inspiration de sa propre vie, de son esprit, de sa pensée. Très souvent, il mène une bataille dans son propre cœur ; il y a un dialogue entre le bien et le mal, le moral et l’immoral, le progressif et le régressif, le civilisé et le non civilisé, le mécanique et l’inspiré. À mon avis, la solution réside dans le cœur de l’homme, ce qui nous ramène à la conscience. L’examen devient alors plutôt intérieur : du point de vue indien, certainement, il y a eu des périodes où l’intériorité — aavritta chakshu — était une attitude progressiste face à l’extériorité, où l’objectivation cédait la place à l’examen.
Nandishwara Thero : Est-il possible de trouver la solution à partir des théories de la connaissance ou bien la connaissance doit-elle venir de l’intérieur ?
K : Avons-nous un dialogue théorique ou abstrait ?
I.I. : Je pense que ce qui a été dit constitue le cœur du problème. Nous avons industrialisé les gourous et, par conséquent, l’esprit d’un très grand nombre de personnes a été industrialisé. Le savoir est considéré comme compétence, conscience, valeur. En Occident, le plus grand corps professionnel est celui des bureaucrates autoproclamés ayant la fonction de gourou, appelés pédagogues, et des personnes qui ont peur de faire confiance à leurs pouvoirs latents. Je ne pense pas qu’il n’y ait jamais eu une époque où des personnes partout dans le monde, désireuses de faire confiance à leurs pouvoirs latents, aient été aussi totalement réprimées.
K : Oui, monsieur, je sais. Mais je continue à demander : avons-nous un dialogue sur des théories ou sur des réalités, la réalité étant ce qui se passe maintenant, non seulement à l’extérieur, mais en nous-mêmes ? À quel niveau avons-nous un dialogue — théorique, philosophique ou concerné par notre existence quotidienne, nos relations les uns avec les autres et notre activité quotidienne ?
En parlant de conscience, sommes-nous des individus ? Les êtres humains sont fragmentés. Avons-nous une conscience commune, chaque homme traversant la souffrance, les tourments de la solitude, toute la question de l’existence ? N’est-ce pas une conscience universelle ? Il me semble que notre conscience est la conscience de toute l’humanité, car chaque être humain traverse la peur, l’anxiété, etc. Ainsi, notre conscience est la conscience du monde. Par conséquent, je suis le monde et le monde est moi ; je ne suis pas un individu. Nous ne sommes pas des individus au sens réel du mot. Pour moi, l’idée d’individualité n’existe pas. Théoriquement, nous parlons d’individus. Cela semble merveilleux, mais, en réalité, sommes-nous des individus ou des machines répétitives ? Quand nous nous regardons profondément, sérieusement, sommes-nous des individus ? Si je peux me permettre de le souligner, soit nous discutons de manière abstraite, en théorie, soit nous nous intéressons à la révolution, à une révolution psychologique. Une révolution, une mutation, un changement profond et radical de l’homme réside dans sa conscience. Cette conscience peut-elle être transformée ? Voilà la véritable question.
P.J. : Si vous parlez de l’état actuel des choses, chacun de nous voit en lui une conscience individuelle distincte de celle d’un autre. Nous devons partir de ce qui est réellement. Et lorsque nous parlons d’une crise dans la société et dans l’homme, les deux étant en quelque sorte interchangeables, nous réalisons que nous sommes la société. Le problème se pose alors : comment en vient-on à réaliser si l’on est un individu ou non ? Comment procède-t-on ? Procède-t-on par le savoir ou par la négation du savoir ? Et s’il y a négation du savoir, quels sont les instruments requis pour cette négation ?
K : Il faut se demander de quoi est faite notre conscience, quel en est le contenu.
P.K.S. : Lorsque vous parlez de conscience individuelle, faites-vous référence à l’esprit individuel ?
K : Non, monsieur, j’ai demandé ce qu’est notre conscience. Apparemment, cette conscience est en proie à une crise profonde. Ou bien est-elle endormie, sous pression ou totalement industrialisée, comme le dit le docteur Illich, par l’industrialisation des gourous, de sorte que nous sommes simplement inexistants, que nous ne faisons que survivre ? Je voudrais demander : est-on conscient de la totalité de sa conscience, non partielle, non fragmentaire, mais de la totalité de sa propre existence, qui est le résultat de la société, de la culture, du nom de famille ? Et quelle est l’origine de toute pensée ? Cela pourrait être le commencement de notre conscience.
Qu’est-ce que ma conscience ? Ma conscience est constituée de culture, d’idées, de traditions, de propagande, etc. Le contenu constitue la conscience. Sans contenu, il n’y a pas de conscience. S’il y en a une, c’est une dimension totalement différente, et on ne peut appréhender ou parvenir à cette conscience que lorsque le contenu est effacé. Il faut donc être clair sur ce que l’on discute : discute-t-on théoriquement ou en prenant sa propre conscience et en l’examinant ? Voilà le défi.
N.T. : La conscience fait-elle partie de notre expérience ?
K : Absolument.
N.T. : Si elle fait partie de notre expérience, n’est-elle pas individualiste ?
K : Votre expérience est-elle individuelle ?
N.T. : L’expérience ne concerne que soi-même.
K : Que signifie pour vous ce mot « expérience » ?
N.T. : Faire l’expérience, c’est ressentir ; c’est le sentiment.
K : Non. Le contenu, la structure, le sens sémantique de ce mot est « traverser ». Mais nous traversons et nous faisons de ce que nous avons traversé un savoir.
N.T. : Ce « traverser » est individualiste, n’est-ce pas ?
K : Est-il individualiste de vivre une expérience ? Si je suis hindou, bouddhiste ou chrétien, je fais l’expérience de ce qu’on m’a enseigné. Ce n’est pas de l’individualité. Si je suis un catholique orthodoxe fervent, je fais l’expérience de la Vierge Marie et je pense que c’est mon expérience personnelle. Ce ne l’est pas ; c’est le résultat de deux mille ans de propagande.
S.P. : Vous semblez suggérer que le mot lui-même signifie indivisible et que, par conséquent, toute expérience est une négation de l’individualité.
K : Je n’ai pas dit cela.
S.P. : C’est implicite. Toute expérience, personnelle ou collective, qu’elle provienne de la conscience collective ou de la conscience personnelle, et la multiplicité des expériences réunies créent chez chaque être humain le sentiment d’être un individu. Cela ne peut être nié.
K : Bien sûr. Mais si je puis demander, quelle est la fonction du cerveau ?
I.I. : Mais considéreriez-vous cela comme irrespectueux si j’utilise le nom en anglais et que je dise que j’ai une connaissance de Krishnamurti ? J’ai une connaissance de vous, mais je ne vous connais pas.
K : Puis-je jamais dire « je vous connais » ? Lorsque nous utilisons le mot « connaissance », nous l’employons dans tant de catégories, de manières si compliquées. Je l’utilise de façon très simple : je vous connais, je vous reconnais, parce que je vous ai rencontré l’an dernier. Mais est-ce que je connais, si intimement que ce soit, ma femme ? J’ai dormi avec elle, elle a porté mes enfants, mais est-ce que je la connais réellement ? C’est-à-dire que je ne la connais pas parce que j’ai une image d’elle. Je crée toutes sortes d’images sensorielles sexuelles et ces images m’empêchent de la connaître, bien que je sois physiquement très intime avec elle. Je ne peux donc jamais me dire : je connais quelqu’un. Je pense que c’est un sacrilège, une impudence. Je vous connais au moment où je n’ai aucune barrière, aucune image de vous comme individu, comme docteur en linguistique. Ainsi, si je vous aborde avec un sentiment de compassion, au sens profond de ce mot, alors il n’y a plus de connaissance, il n’y a que du partage.
I.I. : Je dois accepter cela, tel que le mot « compassion » est utilisé ici.
K : La compassion signifie la passion pour tous.
A.P. : Mais nous connaissons-nous nous-mêmes ? C’est la question ultime.
K : C’est cela, monsieur. Nous connaissons-nous nous-mêmes, et comment nous connaissons-nous ? Quelle est la manière de se connaître soi-même ?
A.P. : Le problème ici est notre incapacité à nous connaître directement, à y répondre avec compassion. Lorsque je vois un cyclone en Andhra Pradesh, je me sens personnellement concerné parce que cela se produit dans l’État où je vis. Lorsque je lis qu’il y a un cyclone au Bangladesh, ce n’est pour moi qu’une information. Or, lorsque nous parlons d’« un seul monde », cela ne devient pas réellement une expérience pour nous. Cela fait vraiment partie du processus d’aliénation — l’aliénation étant le nom donné au fait que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Parce que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, notre relation au monde est également une relation plus distante.
P.J. : Permettez-moi de le formuler ainsi. Est-ce une question d’apprendre quels sont les instruments de l’apprentissage ? Les instruments profondément enracinés de la connaissance sont voir, écouter, ressentir et apprendre. L’exploration de la signification de ces instruments peut elle-même éclairer non seulement la nature des instruments, mais aussi la manière dont ils ont été pervertis pour bloquer leur fonction réelle.
K : Monsieur, seriez-vous d’accord pour que, au lieu d’utiliser la conscience comme un nom, vous l’utilisiez comme un mouvement du temps ?
I.I. : Je l’accepterais pour la discussion, mais permettez-moi alors de commenter : je vis dans un monde où je vois un magnifique coucher de soleil comme une carte postale. J’ai mené une étude complète sur l’usage des mots. J’ai constaté que l’un des dix mots entendus par une personne typique est un mot entendu en tant que membre d’une foule, en tant que public. Et neuf mots sur dix étaient des mots qui lui avaient été adressés ou qu’elle avait entendus par hasard alors qu’ils sont adressés à un autre. Aujourd’hui, par exemple, selon cette étude, neuf mots sur dix entendus par les jeunes, sont des mots programmés et un seul est un mot personnel. J’ai entendu récemment une femme écrire qu’elle avait obtenu des crédits pour dix-neuf heures de conscience. Je dis simplement que tout, dans la culture dans laquelle je vis, est industrialisé. C’est une manière additive d’éduquer.
P.J. : C’est précisément le problème du savoir — le processus additif.
I.I. : Le danger du savoir, non pas en tant que flux, mais en tant que processus additif, me rend standardisé.
K : Monsieur, quelle est la relation entre la conscience et la pensée ? Quel est le commencement de la pensée ? Comment cela vient-il à l’existence ? Quelle est la source d’où jaillit la pensée ? Il y a perception, sensation, contact, puis la pensée, le désir et l’imagination interviennent. C’est l’origine du désir. Est-ce donc là l’origine de la pensée, le commencement de la pensée, le mouvement de la pensée ?
P.J. : La pensée n’est-elle pas la réaction au défi ?
K : Oui. Si je vois le défi, si j’en suis conscient. Si je n’en suis pas conscient, il n’y a pas de défi.
P.J. : Quelle est la réaction au défi ?
K : La mémoire réagit.
R.B. : Mais, pour que la pensée se rende compte d’elle-même comme d’un piège, est-il nécessaire de voir l’origine de la pensée ?
K : Oui. Alors, on n’enregistre que ce qui est absolument nécessaire et non des structures psychologiques. Pourquoi devrais-je enregistrer votre flatterie ou votre insulte ? Pourtant, je le fais. Cet enregistrement renforce l’ego.
S.P. : Quel est cet état d’esprit dans lequel l’enregistrement n’a pas lieu ?
K : Vous voyez, c’est une question théorique.
S.P. : Non. C’est un problème réel. Sinon, on est pris dans un piège. Il y a la mémoire qui répond, et la mémoire elle-même est enregistrée avant même que je n’en sois conscient.
K : Alors, vous agissez sur la base de la récompense et de la punition.
R.B. : L’enregistrement, par longue habitude, est si instantané. Comment pouvons-nous apprendre à ralentir tout ce processus ?
K : Avez-vous déjà essayé d’écrire objectivement chaque pensée, pas seulement celles qui sont agréables ou désagréables — je n’aime pas cet homme, j’aime cette femme, tout ça ? Vous découvrirez alors que vous pouvez ralentir considérablement la pensée. Monsieur, ma question est la suivante : pourquoi enregistrons-nous psychologiquement ? Est-il possible de n’enregistrer que ce qui est absolument, physiquement nécessaire, et de ne pas construire le psychisme par l’enregistrement ?
I.I. : Je sais seulement qu’en vieillissant et en y travaillant, on peut réduire l’enregistrement.
K : Mais cela n’a rien à voir avec l’âge…
I.I. : Cela a à voir avec le fait de vivre.
K : Cela signifie que c’est un « processus » lent. Je m’y oppose.
I.I. : C’est tout ce que je sais. Parfois, on fait l’expérience d’un éclair, qui vous élève à un autre niveau, qui vous transforme, comme un phénix renaissant de ses cendres.
K : Est-il possible d’accélérer le processus de non-enregistrement, qui ne dépende ni de l’âge, ni des circonstances, ni de l’environnement, ni de la pauvreté, ni de la richesse, ni de la culture ? Peut-on voir, avoir une perception directe de toute la question de l’enregistrement et y mettre fin psychologiquement ?
I.I. : Vous devez me corriger. Il me semble qu’il existe plusieurs écoles, certaines très grandes, d’autres très petites, chacune projetant, suggérant, une certaine voie.
K : Et nous revoilà revenus aux systèmes.
I.I. : J’ai dit que je pouvais me tromper. J’imagine que celles-ci nous offrent une échelle. Certaines échelles sont trop courtes pour atteindre le niveau que certaines personnes doivent atteindre, tandis que d’autres sont si longues que nous pouvons sauter de l’échelle avant d’en atteindre le sommet. Ce n’est pas pour tous, mais pour certaines personnes, elles sont assez utiles au début. Je peux même imaginer qu’elles sont utiles dans de nombreux cas — la sagesse consistant à ne pas choisir, à ne pas chercher toute sa vie la meilleure échelle, mais à prendre celle qui fait le travail et que, par chance, j’ai à ma disposition.
K : Mais je remets en question l’idée qu’il s’agisse d’un mouvement progressif ou graduel.
I.I. : Mon école, mon institution, mon langage me disent que le développement des dons de l’esprit est comme la rive de cette lutte pour la vertu. À certains moments, nous devons lutter, pratiquer ce que vous avez appelé la vertu. Mais il arrive des moments où, soudain une bulle surgit et je suis soulevé hors de mon hier comme pour toujours. Cela ne signifie pas que ma vie doive continuer dans la même direction pour lutter encore, mais je reviens en arrière. Je sais qu’il existe certaines écoles de pensée, peut-être tout aussi cohérentes, utiles pour d’autres, où cela sera envisagé très différemment.
K : Si je puis me permettre, monsieur, il n’y a pas d’écoles. On voit la raison logique de l’enregistrement, la nécessité de l’enregistrement physique. Si l’on voit clairement, si l’on a une perception directe de la futilité psychologique de l’enregistrement, si on la réalise, c’est terminé. C’est comme lorsqu’on voit un danger, un précipice : c’est fini. De la même manière, si l’on voit profondément le danger de l’enregistrement psychologique, alors la chose est terminée.
I.I. : N’est-il pas possible que, pour certaines personnes, l’illumination vienne de plusieurs manières ? Les Arabes ont sept mots pour sept états, et, pour d’autres, cela survient comme un coup de tonnerre, comme le lever du soleil : le soleil apparaît et voilà.
K : Je ne pense pas que ce soit une affaire de minorité ou de majorité. Comment écoutez-vous ? Vous me dites qu’il y a des écoles, des degrés, et je l’accepte. Et un autre arrive et me dit que ce n’est pas du tout ainsi, et je le rejette à cause de mon conditionnement. Alors que, si je l’écoutais, lui et vous, je pourrais voir clairement que, dans l’acte même d’écouter, j’ai compris les implications des deux affirmations. Comprenez-vous ? L’écoute elle-même me libère de vous deux.