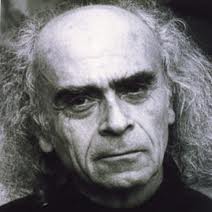(Revue Question De. No 51. Janvier-Février-Mars 1983)
« Il est des choses étranges qui dépassent la raison, la séduisent ou l’inquiètent, et que celle-ci, esclave de l’ignorant préjugé et du scepticisme de mode, d’emblée, rejette et condamne ou, parfois, dissimule, après les avoir secrètement acceptées. Lors même que le fait soit probant, s’il n’est rigoureusement contrôlable en ses moindres parties, mieux vaut le taire afin de n’être pas victime de la critique acerbe et de la facile dérision. »
Ces réflexions désabusées sont d’Eugène Canseliet (Deux logis alchimiques, Paris, 1945, p. 15), mais on pourrait en citer bien d’autres, sur ce même sujet, et empruntées à des auteurs de toute époque, dans les disciplines les plus variées. Et pourtant, comme le souhaite André Breton, « si les profondeurs de notre esprit recèlent d’étranges forces capables d’augmenter celles de la surface, ou de lutter victorieusement contre elles, il y a tout intérêt à les capter, à les capter d’abord, pour les soumettre ensuite, s’il y a lieu, au contrôle de notre raison » (Manifeste du Surréalisme, 1924).
Il est vrai qu’il est toujours difficile d’admettre ce qui dérange les habitudes acquises, ce qui vient ébranler une certitude dont l’action euphorisante dissimule mal la vanité. Quand on voit le soleil se lever le matin et se coucher le soir, il faut un raisonnement subtil pour nier l’évidence et prétendre que c’est la terre qui tourne sur elle-même, et autour du soleil. Nier cette réalité apparente, c’est rejeter du même coup une mythologie solaire dont les images, qui n’ont de valeur que sur le plan symbolique, sont devenues, par suite de sclérose et de séparation d’avec le contexte primitif, les éléments d’un dogme immuable autant que stupide. Il en est de même si l’on vient dire que la foudre ne tombe pas sur un arbre, mais qu’au contraire elle monte de l’arbre vers le nuage, comme nous le prouvent les scientifiques : cela dérange non seulement notre vision imparfaite de la réalité, mais le ce qui va de soi mythologique. Que devient Zeus foudroyant les malheureux mortels qui le défient ? Et où Prométhée a-t-il été chercher le feu du ciel ? Les Alchimistes sont allés très loin dans cette démystification, ce qui ne les a pas empêchés d’utiliser les images symboliques de la Mythologie en leur redonnant toute leur force vive. C’est dire l’intérêt qu’on peut porter aux nombreux textes écrits par des Adeptes, et même aux récits de la Tradition dite mythologique qui perdurent dans ce qu’il est convenu d’appeler la littérature épique.
L’ALCHIMIE ? CE N’EST PAS SÉRIEUX
En 1957, j’avais réalisé pour la radio une série d’émissions consacrées à la « Littérature Alchimique ». Je me bornais d’ailleurs à mettre en relief la beauté poétique et artistique de cette littérature. Mais si les émissions furent bien reçues par le public, elles me valurent des critiques acerbes de la part de la direction des programmes. Comment peut-on croire à de pareilles sornettes ? L’Alchimie, ce n’est pas sérieux. C’est même une aberration. En 1960, j’avais publié dans les remarquables Cahiers du Sud une longue étude consacrée à « Rome et l’Épopée celtique ». J’y confrontais le Mythe et l’Histoire dans un essai de reconstitution de l’ancienne épopée gauloise à travers des documents grecs et latins. Ce travail fut, en général, fort bien accepté dans ses conclusions. Mais, lorsqu’en 1961, dans les mêmes Cahiers du Sud, j’allais plus loin avec une étude sur Delphes et l’Aventure celtique, la méfiance fut unanime. J’avais en effet eu l’audace de comparer certains éléments de l’épopée celtique avec des textes alchimiques, et l’Or de Delphes était consciemment identifié avec l’Or Philosophique. Que n’avais-je pas dit ! J’étais devenu un rêveur, un naïf, j’étais tombé dans l’ésotérisme à la petite semaine. En fait, il fallait choisir : être un mythologue et me contenter d’un commentaire scientifique des anciennes épopées, ou bien broder sur des chimères.
Ce n’est pourtant point ma faute si les récits épiques, sous leur apparente naïveté, recèlent tant d’éléments étranges qui énoncent de façon poétique ce que la science moderne traduit sous forme d’équation. La belle histoire irlandaise de Bran, fils de Fébal, qui reste deux mois dans la Terre des Fées et qui, revenu en Irlande, s’aperçoit qu’il s’est écoulé deux cents ans, n’est pas autre chose qu’une illustration de la théorie de la Relativité. Les mystérieuses navigations et les longues quêtes qui fourmillent dans les épopées sont des récits initiatiques transparents. Et bien souvent, les audaces de ces auteurs plus ou moins anonymes rejoignent les soi-disant non-sens des Alchimistes traquant la réalité sous l’apparence. « En effet, les yeux des Sages voient la Nature autrement que les yeux communs. Par exemple, les yeux du vulgaire voient que le soleil est chaud, mais les yeux des Philosophes, au contraire, voient que le soleil est plutôt froid, mais que ses mouvements sont chauds. Car ses fonctions et ses effets se comprennent par l’éloignement des lieux. » Ces paroles du mystérieux Adepte Cosmopolite (Novum Lumen chymicum) sont des paroles scientifiques d’une étonnante modernité, mais aussi des clefs pour la compréhension des épopées les plus anciennes de notre tradition occidentale.
LE PROBLÈME DES ORIGINES
Mais cela pose un problème. L’alchimie semble d’origine orientale, et en tous cas, elle ne s’est guère développée en occident qu’à partir du XIIe siècle. On peut par conséquent se demander si les éléments alchimiques qu’on décèle dans les textes épiques celtiques, ou bâtis sur des modèles celtiques, comme les Romans de la Table Ronde, n’ont pas été introduits à cette époque. C’est fort possible, et c’est même prouvé dans certains cas, notamment dans la version de la quête du Graal écrite par Wolfram von Eschenbach. Mais d’un autre côté, des éléments classés comme alchimiques, se trouvent déjà dans les modèles celtiques dont les versions primitives remontent bien avant le XIIe siècle. De deux choses l’une : ou bien des symboles épiques – et mythologiques – préexistants ont été utilisés par les Adeptes et les écrivains alchimistes, ou bien des notions d’Alchimie traditionnelle étaient connues en Occident, en particulier dans le domaine culturel des Celtes, et cela depuis fort longtemps. Il est difficile de résoudre ce dilemme, mais par contre il y a bien trop de concordances pour que les rapports entre l’épopée celtique et l’Alchimie traditionnelle soient le fruit de coïncidences fortuites. Après tout, peut-être l’Alchimie a-t-elle été, sous une forme spéculative, une pensée philosophique commune à de nombreux peuples, et sans prétendre que les Celtes l’aient pratiquée de façon opérative, il est nécessaire d’en tenir compte, surtout lorsqu’il s’agit d’essayer d’interpréter des textes difficiles ou dont la polysémie ne permet pas de conclusions définitives.
PÉRIPLE INITIATIQUE
Il ne fait de doute pour personne que le Graal est un symbole alchimique et que la « quête » qui conduit le chevalier au château de Corbénic (ou Monsalvage) est un périple initiatique. Mais il ne semble pas, en dernière analyse, que le Graal primitif puisse s’identifier avec la Pierre Philosophale. Sans entrer dans des détails que j’ai examinés ailleurs (J. Markale, le Graal, éd. Retz, Paris, 1982), on peut affirmer qu’une seule des versions de la Quête du Graal, le Parzival de l’allemand Wolfram von Eschenbach, présente une texture dans laquelle se reconnaisse une volonté délibérée d’incorporer des renseignements alchimiques. De son aveu même, Wolfram a utilisé la version française de Chrétien de Troyes en y ajoutant des éléments hétérogènes et en accentuant l’aspect initiatique. D’ailleurs, le fait que, chez Wolfram, le Graal soit une pierre, et non un simple récipient comme dans toutes les autres versions de la Quête, est révélateur d’un état d’esprit. La troublante communauté des Templiers, gardiens du Graal et mainteneurs d’une lignée sacrée, n’a rien qui puisse infirmer cette opinion.
Pourtant, les versions primitives de la Quête du Graal contenaient déjà des anecdotes significatives. En premier lieu, l’image du Roi-Pêcheur, roi du Graal, blessé à la cuisse, et donc boiteux, qui passe son temps à pêcher à la ligne sur un étang, ne peut laisser indifférent celui qui s’intéresse à la symbolique des Alchimistes. Ensuite, il y a le célèbre passage où chez Chrétien, comme chez Wolfram, Perceval est en contemplation devant trois gouttes de sang sur la neige, ce qui lui rappelle la blancheur de la peau de sa bien-aimée ainsi que le carmin de ses lèvres. On a surtout mis en valeur la beauté poétique de cette image, négligeant ainsi sa valeur symbolique, mais il faut dire que cette image est tronquée dans Chrétien et dans Wolfram : la version galloise de Peredur, beaucoup plus archaïque, la restitue dans sa totalité, puisqu’il s’agit d’un corbeau qui boit le sang sur la neige. Au premier degré, l’image représente la peau, les joues et les cheveux de la femme aimée. Au second degré, on peut y retrouver les trois couleurs fondamentales du Magistère, noire, blanche et rouge. Et l’image n’a pas été inventée par les auteurs du XIIe siècle, puisqu’on la retrouve dans un texte irlandais bien antérieur, l’Histoire de Déirdré, où elle est également chargée, au premier degré, d’une signification sentimentale : l’héroïne, voyant un corbeau qui boit du sang sur la neige, déclare qu’elle n’aimera que l’homme qui portera ces mêmes couleurs sur lui. Mais il est impossible de dire si la signification au deuxième degré a précédé la signification exotérique, ou s’il s’agit simplement de la récupération d’une image somme toute très explicite.
LE ROI PÉCHEUR
Il y a d’autres épisodes révélateurs dans cette version galloise de la Quête, et qui n’apparaissent pas ailleurs. Le héros, Peredur, est soumis par le Roi-Pêcheur à une curieuse épreuve : il doit combattre, au bâton, un jeune homme brun et un jeune homme blond, et « tirer du sang » à ce dernier. Peredur réussit l’épreuve, et dans un autre château, le roi, qui n’est d’ailleurs que le double du Pêcheur, l’oblige à manier l’épée contre un anneau de fer. L’anneau est brisé, ainsi que l’épée, mais Peredur remet ensemble les morceaux qui se ressoudent. Il réussit l’épreuve une deuxième fois, mais la troisième fois, les morceaux ne se ressoudent pas. Cet épisode inexplicable dans le contexte purement épique devient très clair si on l’examine à la lumière de l’Alchimie. Que dire aussi d’un autre épisode où, pour tuer un mystérieux addanc, sorte de dragon caché dans une grotte, Peredur reçoit d’une étrange « Impératrice » une pierre qui lui permet de voir sans être vu et de tuer ainsi le monstre ? Par ailleurs, Peredur accomplit un exploit qui ne peut être qu’alchimique : il tue un serpent qui a une pierre dans la queue, et cette pierre est présentée comme « donnant de l’or ». On ne peut être plus précis, d’autant plus qu’il donne cette pierre à son compagnon Etlym Gleddyfcoch (= à l’épée rouge), dont l’armure est rouge, et qu’il marie Etlym à la « Comtesse des Prouesses ». Enfin, dans ce récit gallois de grande importance, la fameuse « porteuse du Graal » est un être androgyne, parfois sous un aspect féminin, parfois sous l’aspect d’un jeune homme, illustrant parfaitement le Rebis de la tradition hermétique. Est-ce à dire que les Celtes, particulièrement les Gallois, connaissaient, du moins sous une forme spéculative, les grandes lignes de l’Alchimie des Sages ?
LE PHILTRE ET L’ATHANOR
Certes, d’une façon générale, aussi bien dans les contes populaires que dans les épopées anciennes, le héros doit combattre un dragon pour obtenir la fille d’un roi. Le héros est d’ailleurs toujours blessé au cours du combat, et c’est un usurpateur qui apporte la tête du dragon au roi. Heureusement, la supercherie finit par être découverte et le héros peut savourer sa victoire. Dans la légende mondialement connue, Tristan ne manque pas de tuer un dragon pour obtenir Yseult, laquelle, comme son archétype irlandais Grainé (de Grein = soleil), est blonde et se présente comme une divinité solaire. Tristan, lui, est lunaire, la lune étant masculine et le soleil féminin dans les langues celtiques. Cette inversion des rôles par rapport aux habitudes classiques gréco-romaines n’est pas sans importance dans la compréhension du mythe et de ses significations latentes. En somme, l’amour de Tristan et Yseult est la conjonction inversée du soleil et de la lune. Et le soi-disant philtre que les héros boivent, paraît-il par erreur, ne serait-il pas une image de l’athanor ? Cet athanor, nous le retrouvons dans un autre épisode de la légende de Tristan, dans le très beau texte de la Folie Tristan, pour être précis. Tristan, déguisé en fou, se présente à la cour du roi Mark afin de revoir Yseult. Devant le roi et la reine, il raconte une folie, il délire en utilisant un langage à double sens que seul Yseult peut comprendre. Il déclare notamment au roi qu’il a une amie, qu’il veut l’échanger contre la reine et qu’il emmènera « dans une grande salle… faite de verre, belle et grande ; au beau milieu, le soleil y darde ses rayons. Elle est suspendue en l’air, et pend dans les nues ; quel que soit le vent, elle ne chancelle ni ne se balance. À côté de la salle se trouve une chambre faite de cristal et richement lambrissée. Quand le soleil se lèvera demain, il y répandra une grande clarté ». On croirait lire la description d’une des illustrations du livre des douze Clefs de L’Œuvre des Philosophes de Basile Valentin. Et il ne faut pas oublier qu’il s’agit de la Folie Tristan : le mot folie est ambigu, au Moyen Age, désignant également la feuillée, la « loge de feuillage » 1, ce qui nous ramène à l’épisode de la légende où Tristan et Yseult sont endormis. Le roi Mark les surprend, mais au lieu de les tuer, il remplace l’épée de Tristan, qui était fichée en terre entre les deux amants, par la sienne. On ne peut être plus renseigné quant à la volonté symbolique de l’auteur.
Au reste, l’image de la chambre de soleil ou chambre de cristal, n’est pas isolée dans la légende de Tristan. Elle se trouve déjà dans le récit irlandais de Diarmaid et Grainné, qui est l’archétype de Tristan et Yseult, ainsi que dans deux autres textes irlandais encore beaucoup plus anciens. Dans l’un, l’Histoire d’Etaine, l’héroïne, métamorphosée en insecte par suite de la jalousie d’une femme-fée, est recueillie et régénérée dans la « chambre de soleil » du dieu Oengus. Dans l’autre, les aventures d’Art, fils de Conn, le héros est reçu dans l’Île Merveilleuse par une étrange reine qui le loge dans une chambre de cristal : « Belle était l’apparence de cette chambre, avec ses portes de cristal et ses cuves intarissables, car bien qu’elles ne fussent jamais remplies, elles étaient toujours pleines » 2. Cette chambre de soleil où s’accomplit la régénération ou la maturation des êtres n’est pas autre chose que l’athanor où s’accomplit la cuisson nécessaire à la transcendance de la matière première. Mais compte tenu du fait que cette image provient du plus lointain passé mythologique des Celtes, il est difficile de ne pas y voir une résurgence d’une tradition universelle primitive, présentée de façon fragmentaire dans les épopées, de façon cohérente dans les textes hermétiques.
LA FONTAINE OUI BOUT
Dans l’archétype irlandais de la légende de Tristan, les deux amants sont réfugiés dans une grotte, mais le mari, qui les poursuit, les repère grâce à des épluchures jetées dans le ruisseau qui traverse la grotte. On sait d’une part que, dans la version allemande de Gottfried de Strasbourg, ce n’est pas dans la forêt que se réfugient Tristan et Yseult, mais dans une grotte, et que, dans la version française de Béroul, le ruisseau sert à charrier des messages de Tristan vers Yseult. Et lorsque les amants sont dénoncés et qu’ils se retrouvent au bord d’une fontaine, le roi Mark est installé dans le pin qui surplombe : on se souvient que Tristan aperçoit l’ombre du roi dans la fontaine et joue une véritable comédie. Cet épisode n’est pas sans résonances hermétiques si l’on considère les héros comme les symboles du Soufre, du Mercure et de l’Esprit-feu « qui flotte à la surface des eaux ».
La fontaine elle-même joue le rôle d’un révélateur, voire d’un athanor. C’est ce qui ressort d’un bas-relief du portail ouest de Notre-Dame de Paris, où nous voyons une fontaine sourdre sous les racines d’un chêne tandis que le chevalier-alchimiste surveille ce qui se passe. C’est auprès d’une fontaine, la Fontaine de la Soif, que Raimondin rencontre la serpente Mélusine. C’est auprès de la fameuse Fontaine « qui bout, bien qu’elle soit plus froide que le marbre » que Merlin rencontre Viviane, et que le chevalier Yvain tente la grande aventure. L’histoire d’Yvain est bien curieuse : il prend de l’eau dans la fontaine et en verse sur une dalle de pierre qui se trouve immédiatement auprès. Son geste déclenche une violente tempête, un orage épouvantable qui enlève toutes les feuilles des arbres. Après quoi, des oiseaux se rassemblent sur un pin et chantent en harmonie extraordinaire. Enfin, un chevalier noir vient provoquer Yvain qui doit se battre durement : il est vainqueur, et après quelques aventures, épouse la veuve du chevalier noir.
Le symbolisme de cette histoire est précis. Nous sommes en présence de la Fontaine des Sages, telle la « fontaine impudique » du château du Plessis-Bourré décrite par Canseliet, et grâce à laquelle « Vénus livre son eau pontique, acuée de sel harmoniac. Il convient de la recueillir avec soin, maintenant qu’elle a reçu la meilleure partie du métal mâle, figuré par l’homme chancelant de fatigue » (Deux logis alchimiques, p. 110). Mais Chrétien de Troyes, qui raconte cette histoire dans son Chevalier au Lion, n’en est pas l’inventeur : elle appartient à une ancienne tradition celtique et on la retrouve à peu près identique dans le récit gallois d’Owein, ou la Dame de la Fontaine. D’ailleurs, la Fontaine en question, celle de Barenton, située dans la forêt de Paimpont, en Bretagne, est un ancien sanctuaire préhistorique, puis druidique, dédié au dieu solaire Bélénos, c’est-à-dire « le Brillant ».
Mais où Chrétien de Troyes va plus loin, c’est quand il nous décrit son héros témoin du combat entre un serpent et un lion. Il prend parti pour le lion et tue le serpent, moyennant quoi le lion s’attache à lui comme un véritable chien. On ne peut que penser aux figures hiéroglyphiques de Nicolas Flamel : certes, il s’agit de deux dragons qui se battent, que Flamel lui-même assimile au Soufre et au Mercure, mais une variante du Plessis-Bourré présente le lion combattant un dragon mi-partie aigle et serpent. Il faut aussi penser que, dans la symbolique alchimique, le Lion Vert désigne le Vitriol philosophique 3, et que, dans la légende de Merlin enfant, il est question du combat de deux dragons qui empêchaient les fondations d’une tour d’être solides. Une fois le combat terminé, la construction devient possible. Et que penser de la « serpente » Mélusine qui, le samedi, jour de Saturne, bat de la queue dans l’eau de la grotte (ou de la chambre secrète) en l’éclaboussant partout ? Il faudrait savoir pourquoi elle n’est pas une simple sirène avec une queue de poisson.
LE DIABLE BOITEUX
Il est vrai que le dragon, ou le serpent, est toujours lié soit avec un dieu solaire, soit avec un archange de lumière, Apollon à Delphes, saint Michel un peu partout. Or, dans les langues celtiques, le soleil est féminin (également en hébreu et dans les langues germaniques d’ailleurs). C’est vraisemblablement l’origine de l’image classique de la Vierge qui écrase la tête du serpent. En dehors de son sens moral ou théologique, l’image est nettement alchimique, même lorsque, par suite de transformations diverses, elle devient la Dame à la Licorne. Et nous retrouvons ce thème dans un récit gallois très archaïque, la quatrième branche du Mabinogi. Il s’agit du roi-magicien Math qui, valide en temps de guerre, ne peut se maintenir en vie, en temps de paix, que s’il a le pied dans le giron d’une vierge. Math est évidemment un boiteux, ou un demi-boiteux, comme Gargantua, dont le nom ne provient pas d’un terme signifiant la « bouche », mais « de deux mots celtiques reconnaissables dans le breton moderne gar-gam, littéralement « à la cuisse courbe ». Dans un conte populaire du pays de Vannes, ce personnage, appelé ici le « Gergeant », est un marchand de sel qui triomphe de ses ennemis en leur jetant une poignée de ce sel à la figure, ce qui n’est pas sans évoquer un autre personnage rabelaisien, Pantagruel, lequel, dans les mystères du Moyen Age, était un diable qui assoiffait ses adversaires. Rabelais, c’est le moins qu’on puisse dire, était parfaitement conscient de ce qu’il racontait.
Le Boiteux a une grande importance dans la symbolique hermétique. Il est inutile d’insister sur Héphaistos-Vulcain, le forgeron divin, dont on retrouve les nombreuses incarnations dans l’épopée celtique et dans les contes populaires. Dans un curieux texte irlandais, les Aventures de Néra, un boiteux trouve un trésor, aidé par un aveugle. Le Roi-Pêcheur, gardien du Graal, est boiteux. Dans un autre récit irlandais, les Enfances de Finn, ce forgeron boiteux pêche un saumon merveilleux : si on en goûte, on a la révélation de tous les secrets du monde. C’est ce qui arrive d’ailleurs au héros Finn. Mais dans la légende galloise du barde Taliésin, c’est la déesse-sorcière Kerdidwen qui tient ce rôle, en faisant bouillir un « chaudron de connaissance et de renaissance ». Et c’est pour en avoir bu trois gouttes, par hasard, que le héros accomplit toutes les métamorphoses et renaissances qui le conduiront à être Taliesin, c’est-à-dire « Front Brillant », chef des bardes et sage entre les sages.
Bien entendu, dans tous les récits qui ont subi, bon gré, mal gré, l’influence chrétienne, ce Boiteux, comme le dragon et le serpent, a revêtu des couleurs infernales, au sens le plus strict du terme comme au sens que lui a donné l’idéologie chrétienne. Le Boiteux, c’est le Diable, celui qui se jette en travers, mais aussi celui qui provoque. En chimie classique, on pourrait le classer comme catalyseur. En fait, il est bien plus que cela. Et c’est probablement lui que le titan Prométhée est allé chercher dans l’Olympe pour l’enfouir au plus profond de la terre.
L’AUTRE MONDE PARALLÈLE
Mais chez les Celtes, l’idée de l’Autre-Monde n’a rien à voir avec une superposition verticale ; au contraire, les deux mondes étant parallèles, plus que jamais ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et inversement. Le Forgeron boiteux, que les anciens Irlandais nommaient Goibniu, est aussi bien chez lui sur la surface de la terre que dans les souterrains des tertres magiques, aussi bien dans le ciel lumineux que dans les îles lointaines au-delà de l’horizon marin, vers l’ouest, comme il se doit. De toutes façons, les héros celtiques qui s’enfoncent sous la terre contemplent un paysage identique à celui de la surface, et le même soleil y brille. Quant aux « jardins maritimes » si fréquents dans la symbolique alchimique, ils sont aussi nombreux que les « vertes prairies de la mer ». On croit y naviguer sur un bateau, Un coracle – c’est-là-dire un esquif formé d’une carcasse de bois revêtu de peaux et de cuirs – vers des îles lointaines : en fait,
on chevauche un rapide coursier qui traverse une plaine couverte de fleurs vers des collines battues par les vents. La poésie et l’épopée de l’ancienne Irlande sont remplies d’exemples de ce genre.
LA TÊTE DU CORBEAU
Les Gaulois, au témoignage de Tite-Live et de Diodore de Sicile, coupaient les têtes de leurs ennemis morts et les conservaient dans leurs sanctuaires. À Emain Macha, résidence du roi l’Ulster Conchobar, une salle contenait des trophées de ce genre. Parfois même, on se contentait d’enlever la cervelle et de la mélanger à de l’argile pour en faire des balles de fronde, ce qui donnait à cette arme une puissance magique irrésistible. Et dans le récit irlandais du Festin de Bricriu, il est question d’un curieux « Jeu du Décapité » : le héros Cûchulainn coupe la tête d’un géant – qui ne semble pas s’en porter plus mal – à condition que l’année suivante, c’est lui qui se fera couper la tête. Mais là, la décapitation est faite de façon symbolique. La même aventure arrive au chevalier Gauvain dans plusieurs récits de la Table-Ronde.
Mais la plus étrange histoire de tête est celle qu’on découvre dans le texte irlandais du Siège de Ben Etair. Le héros Conall Cernach, après une guerre sans merci, vient de tuer le roi Mesgegra. Il lui coupe la tête et la pose sur une pierre. Or « une goutte de sang tomba du cou et alla sur la pierre qu’elle traversa jusqu’au sol. Alors il mit la tête de Mesgegra sur une autre pierre, et la tête passa à travers la pierre ». Ce pouvoir corrosif de la tête sur le minéral n’est pas sans faire penser au dissolvant alchimique. De plus, Conall met la tête de Mesgegra sur sa propre tête, et il se met à loucher, et la tête de Mesgegra apparaît ensuite rouge ou blanche selon les moments. Des détails semblables se retrouvent dans le récit de la Mort de Cûchulainn : le même Conall, après avoir vengé son ami Cûchulainn en tuant Lugaid, l’assassin de celui-ci, pose la tête de Lugaid sur une pierre et l’oublie. Peu après, il revient chercher la tête et s’aperçoit qu’elle a fait fondre la pierre et qu’elle est passée au travers.
Il ne faut d’ailleurs pas oublier que dans la version galloise de la Quête du Graal, le fameux Peredur, ce n’est pas un vase ou un calice qui est montré lors du cortège du Château Mystérieux, mais un plateau qui contient une tête coupée baignant dans son sang. Il est vrai que non seulement les symboles changent de sens selon les circonstances, mais aussi changent d’aspect, comme s’il s’agissait de brouiller les pistes. N’oublions pas, par exemple, que dans le cadre précis de la Franc-Maçonnerie, le mot sacré change avec chaque grade, et que la formule dite « mot de semestre » est transmise tous les six mois par le Vénérable aux membres de son atelier. Nicolas Flamel, dans son explication des Figures Hiéroglyphiques, précise qu’à un certain moment du Magistère, « il faut couper la tête du corbeau…, laquelle ôtée, vient la couleur blanche ». Or, dans le récit gallois de Branwen, seconde branche du Mabinogi, le héros Brân le Béni, blessé à la jambe au cours d’une bataille, demande à ses compagnons de lui couper la tête, de l’emporter et de l’enterrer dans la Colline Blanche à Londres. Il faut savoir que Brân signifie corbeau, de même que le nom de sa sœur Branwen veut dire « corbeau blanc ». Il faut aussi savoir qu’il y a un jeu de mots en gallois entre Brân et Bryn, « la colline ». Quant à la tête de Brân, dans le récit, elle préside à un curieux festin d’immortalité. Il y a là trop de coïncidences pour que ces détails aient été rassemblés fortuitement.
LE CERF BLANC AU COLLIER D’OR
L’épopée celtique est riche en histoires de cerfs. Tout le cycle irlandais des Fiana (Finn et Ossian) est bâti sur les souvenirs d’un culte préhistorique du cervidé. Merlin apparaît souvent monté sur un cerf. Les cornes du cerf, au début symbole de puissance et de fécondité, sont devenues les attributs du diable médiéval qui n’est que la figuration de l’antique dieu Cernunnos. La chasse à courre contemporaine restitue fidèlement le culte sacrificiel évoqué par les récits épiques et le symbolisme du cerf lui-même.
En effet, par homophonie cabalistique 4, le cerf est aussi le serf. Par conséquent, le cerf fugitif que traquent les chasseurs est aussi le serviteur fugitif que recherchent les Alchimistes. Car ce servus fugitivus nous est présenté de façon très nette : « id est mercurius ». Et on nous explique même qu’Hermès l’a ainsi nommé « à cause de l’humidité volatile ». Ainsi peuvent être interprétées les nombreuses anecdotes concernant la « chasse au Blanc Cerf », telle celle racontée par Chrétien de Troyes dans son Erec et Enide et par l’auteur gallois anonyme du récit correspondant, Gereint et Enid.
On nous dit que cette chasse au cerf est une très ancienne coutume. Celui qui ramènera la tête du cerf blanc pourra prétendre aux plus grands honneurs et à la plus belle fille. Les candidats sont évidemment très nombreux. Et Chrétien de Troyes prend un soin particulier à prouver qu’il s’agit d’un rituel archaïque, mystérieux et quelque peu magique. Il n’est pas douteux qu’il savait de quoi il parlait, même s’il n’a pas voulu écrire systématiquement un « traité ». Mais ce cerf qu’on doit traquer impérativement à une certaine période de l’année (en l’occurrence la Pentecôte) pour respecter la coutume représente la « Chose Animée » dont parlent de nombreux alchimistes. Dans une des gravures de l’Hortulus Hermeticus de Daniel Stolcius, on peut voir un homme nu couché sur le dos, trois fleurs épanouies partant d’une même tige et un cerf dont les neuf bois sont marqués d’une étoile. Le quatrain qui commente cette figure insiste sur la triple lumière du soleil, précisant que « grâce à elle seront connus l’homme étoilé, les lys des champs et le cerf ». Par rapport à l’homme nu couché et inerte, le cerf « inquiet et fugitif » est réellement la « chose animée », autrement dit le volatil. Or la réalisation de l’Œuvre doit passer par le stade nécessaire défini par la Formule « rend fixe le volatil (fac fixum volatile) ». On comprend alors pourquoi le cerf-volant a été largement utilisé dans la symbolique, qu’elle soit hermétique ou héraldique 5. Il en est de même pour le dragon volant, ou encore la serpente Mélusine qui a des ailes de chauve-souris. Quant à la triple lumière du soleil, elle est en rapport avec la fête de la Pentecôte chrétienne (quand l’Esprit-Saint se répand sous forme de langues de feu) et La fête païenne dont la Pentecôte a héritée, celle de Beltaine, au 1er mai, en l’honneur du dieu Bélénos (le « Brillant »), fête marquée essentiellement par un rituel du feu 6. D’ailleurs, l’insigne bardique traditionnel, un des rares vestiges de la symbolique druidique, consiste en trois rayons, trois « lumières », qui semblent surgir d’un point central inconnu. Et le triskel celtique est de même nature.
Ce cerf, nous le retrouvons dans un épisode de la version cistercienne de la Quête du Graal. Il est présenté comme tout blanc, avec un collier d’or, et entouré de quatre lions. Il apparaît à Lancelot du Lac dans son errance. On nous donne une explication chrétienne : il s’agit de Jésus-Christ entouré de ses quatre évangélistes, et qui indique ainsi à Lancelot, non pas le chemin du Graal, mais la voie de son propre salut. C’est dans cette interprétation chrétienne que l’épisode est représenté sur une mosaïque de l’église de Tréhorenteuc (Morbihan), symboliquement situé auprès de la Fontaine de Barenton, représentée schématiquement. Mais l’aspect merveilleux de cet épisode nous fait réfléchir : et si l’on considère que les lions sont les quatre éléments, le cerf, surtout avec son collier d’or, nous indique que, selon le mot du Philosophe, « la Pierre nécessaire dans cet Œuvre provient de la chose animée ». Et dans la version galloise de la Quête, Peredur, avant de découvrir enfin le Château des Merveilles, doit lui aussi courir à la poursuite d’un cerf et en rapporter la tête. Les mésaventures qu’il traverse sont nombreuses avant qu’il puisse parvenir à son but, mais il sait ce qu’il doit faire.
LES CELTES ET L’ALCHIMIE
Ces exemples empruntés à des récits de la tradition épique des Celtes constituent la preuve que ces peuples n’ignoraient pas tout ou partie de la science hermétique. Il est plus que probable que l’Alchimie classique du Moyen Age n’a fait que retrouver et codifier des notions fondamentales remontant très haut dans le temps, et sans doute communes à de nombreuses civilisations. Pourquoi les Celtes n’en auraient-ils pas eu une part en héritage ? Il ne s’agit pas d’affirmer que les Celtes ont été des Alchimistes. Il s’agit simplement de prétendre qu’ils n’ignoraient pas le système de pensée des Alchimistes. Car l’essentiel se trouve là : avant d’être opérative, l’Alchimie est un mode de pensée, une véritable structure mentale, une remise en cause de la logique aristotélicienne, une sorte de science paralogique ou plutôt hétérologique. Or il apparaît bien que le système de pensée des Celtes ait été lui aussi hétérologique. L’Alchimie met en relief la « mystérieuse et profonde unité » de la nature, de l’homme et du divin. La pensée celtique n’envisage pas l’être humain autrement que participant pleinement à la nature et à la divinité. L’Alchimie prétend agir en même temps sur le corps et sur l’esprit, sur l’inanimé et sur l’animé, en niant la différence que la pensée classique établit entre ces deux notions. Les Celtes ont toujours refusé le fossé entre nature et culture, entre corps et âme, insistant sur le fait que l’esprit ne s’incarne pas, mais se matérialise, ce qui n’est pas la même chose. Par son monisme, la pensée celtique rejoint intimement la pensée alchimique. Si le Mercure représente la force centripète qui régit l’univers dans un sens, et le Soufre la force centrifuge qui fait apparaître la « matérialisation », et si les opérations du Magistère consistent à accomplir l’union paradoxale entre ces deux forces, alors, oui, les Celtes ont été des Alchimistes.
Lorsqu’à la fin du XVIIIe siècle, l’érudit gallois Iolo Morgannwc bâtit son rituel néo-druidique, il utilisa largement le rituel de la maçonnerie écossaise. Ce n’est sans doute pas sans raison, et quel que soit le doute au sujet de la valeur de ce rituel néo-druidique, il faut bien reconnaître que la maçonnerie écossaise avait hérité beaucoup de choses de la tradition celtique ancienne. D’ailleurs, dans le rituel du 2e degré du Rite écossais, n’y a-t-il pas un miroir caché sous un rideau ? Le symbole est tout à fait d’actualité. Car nous ignorons la plupart du temps qu’il y a un miroir caché quelque part dans notre vie quotidienne comme dans notre vie intellectuelle. À moins que nous ayons peur de regarder dans ce miroir : nous y verrions en effet le reflet inversé de nous-mêmes. Pourtant, l’Alchimie traditionnelle, qu’elle soit opérative ou qu’elle soit spéculative, et le Druidisme celtique (ou du moins le peu que nous en connaissons) nous obligent à regarder dans ce miroir caché. Mais n’oublions pas que ce que nous y voyons est inversé.
1 Comme cela apparaît dans le célèbre Jeu de la Feuillée d’Adam de la Halle, au XIIIe siècle, où l’ambiguïté est constamment maintenue entre la « feuillée » et la « folie ».
2 Pour tous ce qui concerne les textes irlandais cités, voir J. Markale, l’Épopée celtique d’Irlande, Paris, Payot, 2e éd. 1979. Pour les textes gallois, voir l’Épopée celtique en Bretagne, Paris, Payot, 2e éd. 1975.
3 Visita Interiora Terrae. Rectificande Invenies Occultum Lapide.
4 Uniquement en latin médiéval ou en français. Dans les autres langues, l’homophonie, à cause du c dur, joue avec les mots signifiant « corne » et « couronne ».
5 Il figure notamment sur les armes du roi fou Charles VI, et des légendes aussi incontrôlables que significatives se sont répandues à propos de ce choix. Voir J. Markale, Isabeau de Bavière, Paris, Payot, 1982, p. 19-20.
6 Les feux de mai ont été déplacés à Pâques (bénédiction du feu nouveau) et à la Saint-Jean.