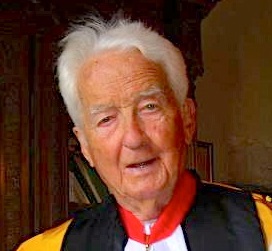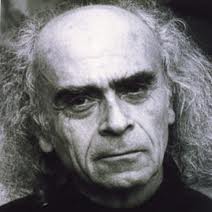Dans un premier stade, la conscience, encore infantile, est le produit d’une contradiction qui est fort loin de s’être révélée à elle-même. La perception du moi est, nous l’avons vu, d’autant plus intense que le moi ne se présente pas devant lui-même, dans un état réflexif. À l’état d’idée fixe, nous l’avons suivi dans des courses extravagantes, à la recherche de l’impossible, sans qu’il se soit jamais arrêté devant son propre spectacle comme devant un miroir. L’identification de l’être et du moi ne s’est pas encore faite : il y a identifications successives de l’être et d’une série ininterrompue de pour-moi. La petite fille qui veut une poupée est entièrement conscience de « pour-moi-poupée ». Elle n’a conscience de soi que selon les besoins, les plaisirs, les chagrins du pour-moi. La poupée se casse, il y a privation, rupture de ce pour-moi : le pour-moi pleure. On lui présente une autre distraction, voici un autre pour-moi, qui rit de voir Guignol, qui est « Guignol ». Il passe de là à être pour-moi-goûter, et ainsi de suite. Lorsque le pour-moi n’éprouve ni plaisir ni déplaisir ni besoin, il est vide et s’ennuie dans le vague. On doit, sans arrêt, lui présenter quelque objet-d’être, sans quoi il s’abandonne à des rêveries, s’identifie à elles, dans un monde imaginaire qui, selon les cas, a des points de contacts avec la réalité ou n’en a pas. La conscience du rêve éveillé rejoint celle du rêve endormi.