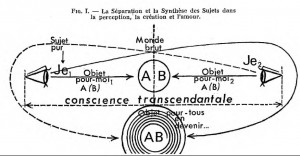(Édition le Courrier du livre 1966)
Christianisme – Marxisme – Évolutionnisme – Existentialisme… et après ?
I
LA DIMENSION HUMAINE
LES HUMANISMES ANTHROPOMORPHES
INTELLECTUALISME
Existentialisme
MARXISME
CHRISTIANISME
Jamais période de l’Histoire n’a vu se combattre autant d’humanisme – c’est-à-dire autant de conceptions l’homme – que la période que nous vivons. Et pourtant, jamais les combats idéologiques n’ont été aussi dangereux qu’aujourd’hui pour la Civilisation, parce qu’ils risquent d’entrainer dans un combat apocalyptique des centaines de millions d’hommes fanatisés. Il en résulte une tension psychologique et une instabilité sociale extraordinaires.
Cette formidable compétition des valeurs de vie est due en grande partie au phénomène d’accélération de l’Histoire provoqué lui-même par l’accélération du progrès technique et l’extension de la culture. Des formes de civilisation périmées et des Religions vétustes n’ont pas eu le temps matériel de disparaître que, déjà, les valeurs sociales montantes qui les poussaient à l’abîme sont elles-mêmes dépassées par des vérités nouvelles. On fait souvent allusion aux peuplades dites « primitives » qui, sous l’influence de leurs colonisateurs, sont passées brutalement de l’âge de la pierre à l’utilisation des armes et des outillages les plus modernes. Mais le même phénomène a lieu au niveau affectif, intellectuel et moral, dans les pays les plus civilisés. Qu’on imagine, par exemple, le fils d’un paysan breton quasi illettré, passant brutalement de la foi catholique de son enfance à l’esprit critique enseigné dans les classes françaises de Philosophie, puis s’initiant dans les Facultés aux méthodes de pensée du Marxisme, de la Psychanalyse et de la Phénoménologie ! Tout se passe aujourd’hui comme si une évolution culturelle accélérée poussait brutalement sur la scène de la conscience universelle les valeurs de vie qui se sont succédé au cours d’une trentaine de siècles. N’assistons nous pas à un accès de ferveur pour les méthodes du Yoga et du Bouddhisme Zen ? On comprend que la compétition et la confusion soient extrêmes.
Quelques-uns, parmi nos grands Humanismes, ont leurs chefs, et parfois leurs hiérarchies. Par exemple, l’Église catholique. Ces Humanismes souffrent souvent de divisions intestines, ils ont tous leurs hérésies, et parfois sont menacés de schisme. Par exemple, l’Humanisme marxiste, déchiré entre les tendances du communisme chinois et du communisme russe, ou bien encore l’Existentialisme, éclaté en nombreuses tendances divergentes, matérialiste avec Sartre, chrétienne avec Gabriel Marcel, spiritualiste avec Jaspers, héroïque avec Malraux.
Humanisme chrétien, Humanisme marxiste, Humanisme existentialiste, Humanisme héroïque (ou nietzschéen), Humanisme scientifique, Humanisme évolutionniste, Socialisme humaniste… chacune de ces appellations a sa résonance propre, signifie tout un programme, annonce tout un monde.
N’est-il pas certain, cependant, que le progrès technique et l’évolution culturelle invitent aujourd’hui les hommes à s’organiser dans une seule harmonie sociale aux limites de la Terre, pour une répartition équitable des ressources matérielles et biologiques, pour une organisation commune de l’éducation et de la procréation ? L’accélération de l’Histoire prend ici un sens : elle ressemble aux dernières foulées du coureur qui va toucher au but. La recherche scientifique, le progrès industriel, même la réflexion philosophique, l’instruction des masses, tout s’accélère parce que le but approche. Le but de l’Histoire, c’est un ordre social et économique universel soumis à une direction rationnelle. Mais atteindrons-nous ce but avant le déclenchement des conflits exterminateurs ? La question se pose d’une manière angoissante.
De trop nombreuses conceptions de l’homme – restées fermées et autoritaires – prétendent en effet brandir, dès aujourd’hui, la bannière sous laquelle l’humanité entière se rassemblera demain. Elles risquent ainsi de fanatiser les masses et de les pousser aux sacrifices les plus absurdes. D’où la nécessité d’une confrontation des buts et des programmes, en pleine lumière. Des études d’ensemble sont devenues nécessaires, elles sont réclamées par le « moment historique » que nous traversons. Exposer, critiquer, classer, comparer les Humanismes contemporains, c’est contribuer à accélérer le jugement de l’Histoire, c’est rendre plus vite au passé les Croyances désuètes, c’est dévoiler les séductions des messianismes irrationnels. Nous allons essayer d’exercer, à cet égard, un jugement aussi objectif que possible, en opérant un classement des grands Humanismes contemporains, tout en cherchant à déceler une ligne d’évolution, la direction de l’avenir.
1. – LES DEUX GRANDS COURANTS DE L’HUMANISME CONTEMPORAIN
– la tendance anthropomorphe,
– la tendance cosmologique.
D’une part, certaines doctrines supposent – franchement ou implicitement – que l’homme est la mesure de toutes choses. Nous percevons l’univers, l’infini, nous connaissons les lois des phénomènes, mais nous resterions cependant enfermés dans nos connaissances, dans les symboles de nos sciences et les images de notre culture. Nous serions en quelque sorte prisonniers d’un univers tissé de nos perceptions, d’un monde construit pierre à pierre avec nos images mentales. Nous serions prisonniers de nos sens et de nos connaissances, comme la fourmi est la prisonnière des brindilles innombrables qu’elle a ramassées pour construire la fourmilière. Ces humanismes peuvent être dits anthropomorphes ; ils gardent le contour de l’homme et s’en tiennent à la « mesure humaine » ; les idéaux ou les certitudes qu’ils nous proposent conservent la figure rassurante des symboles humains et des images familières à l’esprit humain.
Cependant, la science et certaines métaphysiques modernes nous ouvrent des horizons nouveaux. Avec eux, la « mesure humaine » et les cadres habituels de la raison sont dépassés. Est-ce que l’espace-temps d’Einstein a quelque chose de commun avec notre espace habituel ? Est-ce que les mystères de la mécanique ondulatoire, sondés par Louis de Broglie, ne défient pas la raison traditionnelle ? Est-ce que le « regard transcendantal » enseigné par Husserl et Merleau-Ponty ne perçoit pas des objets inaccessibles à la vision naturelle ? La connaissance que nous prenons de l’univers et du réel n’apparaît plus, dans ces doctrines, réductible à nos mesures ordinaires, ni appréciable suivant les canons de la logique d’Aristote. Le regard humain et l’esprit humain semblent ici s’agrandir à la mesure de l’univers. L’esprit devient sensible aux dimensions ultra-humaines de l’infiniment grand et de l’infiniment petit. Nous verrons qu’à ce niveau de recherches est en train de se constituer un type nouveau d’humanisme, à tendance cosmologique [1].
Maurice Gex a défini de la manière suivante l’esprit de cet humanisme : « La désignation « humanisme cosmologique » souligne l’union de l’homme et de l’univers … L’idée profonde qui promeut l’humanisme cosmologique est la conviction inébranlable que toute situation locale dans laquelle nous nous débattons doit s’éclairer à la lumière de la situation universelle la plus vaste que nous puissions connaître » [2].
Pourquoi, en effet, la connaissance humaine devrait-elle se résigner à ne jamais atteindre que des vérités relatives à l’homme ? Les habitants d’une région peu connue affirment : « Ce fruit est vénéneux » ? La vérité n’est-elle pas, pour un esprit libre, beaucoup plus complexe ? « Ce fruit est mortel pour l’homme, mais des animaux s’en nourrissent cependant. .. Pour quelle raison la substance nocive qu’il contient est-elle dangereuse seulement pour l’homme ? Administrée à très petite dose, quels effets – néfastes ou salutaires – cette substance capricieuse exercerait- elle sur lui ? » Autant d’observations, de questions, qui nous font entrevoir une vérité aux ramifications multiples débordant infiniment les rapports immédiatement pratiques de l’homme avec la nature. La vérité, ce n’est pas seulement une connaissance relative à l’homme, c’est un courant vital de recherches, d’hypothèses, d’erreurs et de découvertes, courant qui résulte de la puissance créatrice de l’esprit, et qui déborde de toutes parts le système des besoins pratiques – manger, se vêtir, se loger, se soigner – pour s’appliquer au Réel dans son ensemble.
Le penseur pragmatique (ou relativiste) affirme avec Protagoras : L’homme est la mesure de toutes choses. Le chercheur cosmologique, lui, dépasse résolument la mesure humaine, et il affirme : L’homme réel, l’homme intégral, est à la mesure de l’infini qui est au fond de toutes choses, parce que son pouvoir de connaître et de créer est sans limites.
***
Voici quelques lignes qui donnent, d’une manière assez juste, le ton de l’humanisme anthropomorphe. Elles sont tirées d’une étude d’Olivier Lacombe : Réflexions sur la philosophie indienne, publiée dans la revue Diogène : « L’Occident … humaniste … se voue, avec Paul Valéry, à la quête de « ce point merveilleux et mystérieux dont la connaissance rendrait l’homme maître de son propre miracle … le point où l’infini désolant des proliférations naturelles fait place au fini étonnant des œuvres accomplies qui sont du même coup des chefs-d’œuvre ». Et ce point, (Paul Valéry) en situe, avec Jean Guéhenno, l’existence « à la limite de l’homme, mais dans l’homme encore » (Olivier Lacombe : Réflexions sur la Philosophie indienne, revue Diogène, n° 24, 1958, pp. 24 à 46).
Ici apparaît l’idéal d’une perfection proprement humaine, se traduisant dans un classicisme supérieur. On aspire à la fleur d’une civilisation où les chefs-d’œuvre multiplieraient à l’infini les témoignages d’une rigoureuse humanisation de la nature, comme le Parthénon, ou le Cimetière Marin. Chacun de ces chefs-d’œuvre reproduirait, à sa manière, le visage immuable d’un homme éternel et solitaire, sur une terre humanisée comme un jardin dessiné par Le Nôtre.
***
Mais, voici maintenant des propos d’une inspiration toute différente. Ils vont nous donner le ton – plus aventureux, plus inspiré – de l’humanisme cosmologique. Ces lignes sont tirées d’un livre de Jean Rostand La Biologie et l’Avenir humain. Jean Rostand vient de nous révéler comment, par l’injection de certaines substances dans le jeune organisme en voie de développement, on pourra sans doute un jour augmenter le poids du cerveau humain, et il conclut ainsi : « N’oublions pas qu’un très léger accroissement de la masse cérébrale pourrait suffire à changer tout le sort de l’humanité … (Le) rêve (de) créer le « surhumain » n’a plus rien de téméraire… A la biologie… il appartiendrait de dépasser l’homme et, en altérant le sujet pensant, de modifier la conscience même de l’univers » (Jean Rostand : La Biologie et l’Avenir humain, pp. 92-94 ; éd. Albin Michel, 1950).
Nous découvrons ici la perspective d’un dépassement de l’homme actuel. On ne craint pas d’envisager la création d’une Surhumanité, d’une espèce humaine supérieure qui ne serait plus la fille de la nature. mais la fille de la Science, ou mieux. de l’Esprit. La pensée ne se borne plus à maîtriser une nature surabondamment créatrice, en produisant des œuvres parfaites, elle dépasse la nature dans son pouvoir même de créer, en suscitant des espèces qu’elle n’aurait pu produire. L’Esprit devient le créateur d’une « Néo-Vie », comme dit Teilhard de Chardin.
Mais l’homme actuel, et notre civilisation si lentement formés, ne risqueraient-ils pas d’être dépassés, oubliés, engloutis, par cette Évolution d’un genre nouveau ? Or, justement, l’Esprit assume ici ce risque, se croyant par destination l’agent d’une nouvelle aventure terrestre, d’une nouvelle Évolution.
Les perspectives de cette pensée cosmologique nous apparaissent exaltantes à nos heures d’optimisme et de pleine vitalité. Mais à d’autres moments moins privilégiés, elles nous semblent inhumaines, presque sacrilèges. Nous ne discuterons pas ici ces avis contradictoires. Nous essaierons seulement d’exposer, en de rapides synthèses, suivies parfois de courtes critiques, les théories actuelles les plus importantes de l’Humanisme anthropomorphe et de l’Humanisme cosmogonique.
2. — DE L’HUMANISME INTELLECTUALISTE A L’HUMANISME HÉROÏQUE :
. Paul Valéry
. Montherlant
. Malraux
Paul Valéry, dont quelques lignes nous ont aidé à définir l’humanisme anthropomorphe, a été le représentant d’un humanisme dit — plus précisément — intellectualiste, à cause du rôle capital qu’y joue l’intelligence, l’intellect, c’est-à-dire la faculté de comprendre, d’analyser, de critiquer. C’est là une orientation maîtresse de la pensée française contemporaine, représentée dès le début du siècle par André Gide.
Un critique, Paul Archambault, présente ainsi les plus célèbres promoteurs de l’intellectualisme contemporain : « Alain : l’intelligence disant non aux illusions et aux servitudes quelles qu’elles soient.
Valéry : l’intelligence recouvrant le champ du réel et du possible.
Duhamel : l’intelligence nouant avec l’amour la plus aimablement féconde des unions » (Les grands Appels de l’Homme contemporain, p. 177. Ed. du Temps présent, 1946).
Mais un tel humanisme apportait avec lui ses limites, car l’intelligence est à prédominance critique, elle manque de force constructive.
M. Teste, le mystérieux personnage créé par Paul Valéry, est le héros de cette impuissance à construire. Il se contente d’être « le maître de sa pensée », et de « la joie de se sentir unique ».
« Je suis chez MOI — dit-il — Je parle ma langue… Croyez-moi à la lettre : le génie est facile, la divinité est facile… Je veux dire simplement que je sais comment cela se conçoit… » (Paul Valéry, Monsieur Teste, Coll. littéraire Bordas, le XXème siècle, p. 303.).
On comprend que l’intellectualisme ait perdu aujourd’hui beaucoup de son influence. Il n’a, en effet, rien pu opposer d’efficace à la montée puis au déchaînement des forces irrationnelles qui ont déferlé sur notre siècle : les fascismes, la guerre, le totalitarisme technique. C’est pourquoi, les âmes fortes éprouvent aujourd’hui le besoin d’une activité morale et sociale positive. J.-P. Sartre écrit : « Le pour-soi (c’est-à-dire l’individu, le sujet de conscience) est l’être qui se définit par l’action » (Jean Paul Sartre : L’Être et le Néant, Ch. sur la Liberté.).
Attestent actuellement la vogue des humanismes dits « engagés », l’influence actuelle des St-Exupéry, des Camus, des Malraux, des Montherlant, des Sartre, et le rayonnement des doctrines militantes comme le Christianisme et le Marxisme.
*
* *
Montherlant dévoile la teneur de son humanisme dans le passage suivant de Service inutile : « J’écrivais jadis dans Aux Fontaines du Désir : « Le monde n’ayant aucun sens, il est parfait qu’on lui donne tantôt l’un et tantôt l’autre », et il ajoute : « J’aimerais voir un être de sagesse qui, après avoir démontré que tout est digne de risée, se sacrifierait pour une cause quelconque, sans autre but que de faire jouer une nouvelle parcelle de l’humanité qui est en lui. C’est déjà très bien que ne voir pas d’opposition entre les idéals qui ont mené un Kant, un saint Vincent de Paul et un Casanova ; et, je vous le confesse, pour ma part, je n’en vois pas. Mais il est mieux encore d’être à la fois — c’est-à-dire, en fait, tour à tour — saint Vincent de Paul, Kant et Casanova. À coup sûr, celui qui serait cela ferait honneur à son Créateur : il serait un bel exemplaire humain ».
Montherlant nous invite à cultiver tour à tour l’ascétisme et l’érotisme, la charité et la cruauté, pour la seule joie d’être un homme complet : son humanisme est un syncrétisme. Évoquant, dans Mors et Vita, son passé de combattant, il décrit ainsi le saisissement qu’il éprouve au soir d’une journée de bataille : « La nuit tombante — écrit-il — (donnait) une teinte uniforme aux capotes des morts français et allemands, comme s’ils étaient tous de la même patrie » (Montherlant : Textes choisis, par Bordonove. Ed. Universitaires, p. 29).
Curieuse émotion de fraternité après la fureur des combats ! Nul doute que cette promptitude à changer de registre sentimental ne produise de beaux effets. Mais comment l’action enseignée par cet humanisme syncrétique serait-elle constructive ? L’émotion évoquée ci-dessus n’a pas eu de suite, elle n’a eu aucun effet pacifiant sur le Montherlant-guerrier… Le Moi qui s’enrichit à cette « alternance » des sentiments et des engagements, c’est encore le Moi égotiste de Gide et le Moi narcissique de Valéry, ce n’est pas le Moi ouvert capable de fonder, avec d’autres Moi ouverts, le monde social pacifié dont nous avons besoin.
En réalité, l’engagement de Montherlant n’est pas un engagement social véritable : son héroïsme est celui d’un homme passionné par le jeu des combats (pour gagner le Ciel, ou pour dominer la Terre, cela ne lui importe pas) ; son héroïsme est un hédonisme, une philosophie du plaisir.
Plus sérieux apparaît, dès l’abord, l’engagement selon Malraux, qui nous invite à quitter les lieux hantés par le Moi narcissique, pour nous faire entrer dans la vie dramatique de l’Histoire.
Selon Malraux, l’homme tire sa grandeur du fait qu’il se pose, face à la Nature, comme un être qui sait qu’il existe, c’est-à-dire comme un être conscient.
« L’humanisme — écrit-il dans Les Voix du Silence — ce n’est pas dire : « Ce que j’ai fait, aucun animal ne l’aurait fait », c’est dire : « Nous avons refusé ce que voulait en nous la bête, et nous voulons retrouver l’homme partout où nous avons trouvé ce qui l’écrase » (Cité dans le Panorama des Idées contemporaine p. 720. Ed. Gallimard).
L’individu voué à cet humanisme refoule hors de lui l’animalité inconsciente et il défie l’Univers. Certes, la mort et le néant nous enferment de toutes parts, mais l’homme gagne peu à peu sur eux, particulièrement grâce aux productions de la culture et de l’Art.
« Il est beau — écrit Malraux, évoquant les œuvres de l’art qui se perpétuent, par leur beauté, à travers les siècles — Il est beau que l’animal, qui sait qu’il doit mourir, arrache à l’ironie des nébuleuses le chant des constellations, et qu’il le lance au hasard des siècles, auxquels il imposera des paroles inconnues. Dans le soir où dessine encore Rembrandt, toutes les Ombres illustres, et celles des dessinateurs des cavernes, suivent du regard la main hésitante qui prépare leur nouvelle survie ou leur nouveau sommeil… Et cette main, dont les millénaires accompagnent le tremblement dans le crépuscule, tremble d’une des formes secrètes, et les plus hautes, de la force et de l’honneur d’être homme » (André Malraux : Les Voix du Silence, cité in Panorama, p. 720).
Par la peinture, la sculpture, la poésie, l’homme investit l’Univers dont il transpose l’harmonie inhumaine dans sa vision propre, ou dans son chant personnel.
Mais il y a encore une autre manière, pour l’homme, de gagner sur le néant, c’est de faire l’Histoire. « L’Histoire, écrit Malraux dans la Tentation de l’Occident, donne un sens à l’aventure humaine » ; en effet, « L’homme est ce qu’il se fait, l’homme est la somme de ses actes ».
Ainsi Malraux a-t-il commencé par « faire l’Histoire » dans les rangs du communisme, puis il est passé dans les rangs du gaullisme. L’Histoire n’a pas, pour Malraux, d’autre sens que celui qu’on lui donne par ses actes.
Cet homme dramatique, né de lui-même, de sa volonté farouche, ne pourra jamais vaincre absolument ni la matière, ni l’univers, ni la mort, mais, par son énergie, il aura du moins agrandi contre eux son empire, un empire unique en son genre, dans un univers en lui-même privé de signification.
Toutefois, on se demande si l’impression que le néant recule devant les créations de l’homme n’est pas une illusion, un mirage consolant. Ce néant qui nous écrase n’a-t-il pas pour lui l’éternité ? La Terre n’est-elle pas, somme toute, destinée à disparaître, emportant avec elle tous les témoignages, toutes les œuvres du génie humain?
Une autre question se pose : « Qui peut prétendre aujourd’hui « faire l’Histoire », alors que c’est l ’Histoire qui menace de nous broyer sous les roues sanglantes de son devenir ?
Le néant final de la mort, la fatalité menaçante de guerres de plus en plus exterminatrices autant de questions auxquelles ne répond pas l’humanisme stoïque et dramatique de Malraux. En réalité, cet humanisme est, déjà, un existentialisme.
3. — L’HUMANISME EXISTENTIALISTE
à travers André Malraux
Albert Camus
Jean-Paul Sartre.
L’Existentialisme est une philosophie de l’homme solitaire abandonné à lui-même. En cela, il rappelle le romantisme. Les penseurs existentialistes admettent l’isolement de l’individu comme une situation pénible, mais fatale. Il est vrai qu’à notre époque, les grandes unions totalitaires — comme la Nation et la Religion — distendent de plus en plus leurs liens… et les individus se sentent abandonnés, anxieux. Cette situation historique peut être comparée à la position instable de l’adolescent, au moment où se desserrent les liens de l’autorité paternelle et de l’amour maternel. Le jeune homme est cependant encore incapable de construire sa vie dans un monde nouveau. Il éprouve, alors, un sentiment pénible de solitude et d’angoisse.
Solitude, conflit avec le monde, angoisse, ce sont les trois faces de la conscience existentialiste.
Antagonisme de l’Être et du Néant, de l’Homme et de la Nature, du Moi et de l’Autre ; abîme infranchissable de la séparation, jusque dans l’amour et dans les rapports de l’homme avec Dieu ; ces divers aspects du conflit de l’existence ont été décrits par Kierkegaard, par Jaspers, par Gabriel Marcel, par Jean-Paul Sartre… C’est un véritable envahissement de la conscience par l’état de conflit. Il est vrai que le combat, qui opposait autrefois les Croyants et le Démon, les Royalistes et les Républicains, les Croyants et les Athées, les Religions concurrentes et les Nations ennemies, déchire aujourd’hui principalement la conscience elle-même. L’Existentialisme se fait l’écho de cette déchirure de la conscience moderne. II voudrait enseigner aux hommes qu’ils sont tous plongés dans les mêmes ténèbres, qu’ils sont atteints du même malheur. N’est-il pas vrai que, dans une prison, geôliers et prisonniers sont enfermés dans les mêmes murs ? L’Existentialisme nous dévoile que nous sommes tous prisonniers de la même prison, dirigeants et dirigés, riches et pauvres, croyants et incroyants, puissants et faibles, heureux et malheureux : la prison de la violence, de la souffrance et de la mort.
Le message social d’Albert Camus n’est rien d’autre qu’une pressante invitation à nous unir d’amitié, face à l’univers hostile et à la mort. « Le monde où je vis me répugne, écrit Camus dans Actuelles, mais je me sens solidaire des hommes qui y souffrent ».
A. Camus, comme Malraux, pose l’homme dans un univers inhumain, mais la conscience selon Malraux est orgueilleuse et stoïcienne, elle exploite au profit de son orgueil cette situation tragique. Camus, lui, ne se résigne pas, il se révolte. Non pas au nom de quelque perfection absolue, au nom de quelque panacée religieuse ou politique ; l’homme de Camus se révolte pour mieux se sentir exister en tant qu’être lucide. Camus se révolte afin de mieux nous faire sentir l’abîme qui sépare notre conscience et le néant. Malraux veut gagner sur le non-être, agrandir le domaine de l’Humain. Camus intensifie notre conscience d’être face au néant, à l’inhumain. Pour lui, ni le néant, ni la mort, ni la violence ne pourront jamais être abolis, nous pouvons seulement nous discipliner pour diminuer les ravages de ces fléaux. La plus grande tentation de l’homme, selon Camus, c’est de prétendre instaurer — par la violence et le meurtre s’il le faut — le règne de l’absolue justice et du bonheur absolu. L’humanisme de Camus est fondé sur la mesure : jouissons du présent, diminuons la somme du mal, ne cherchons pas à décrocher la lune.
L’objection à lui faire, c’est que l’homme moderne est animé de forces créatrices si puissamment outillées qu’on ne voit pas comment cet humanisme hédoniste et restrictif pourrait employer ces énergies. Camus lui-même n’était pas satisfait de son message. Il disait, quelque temps avant sa mort, que son œuvre était devant lui. Or, divers indices — qu’on peut relever à la lecture d’une de ses œuvres de jeunesse, L’Envers et l’Endroit — permettent de supposer qu’une sorte de démesure dans la confiance, la générosité, l’amour, aurait été la dominante de cette œuvre nouvelle (Albert Camus : L’Envers et l’Endroit, recueil d’essais publiés en 1935-36 et réédité en 1958. Ed. Gallimard).
Il est un existentialisme particulièrement chargé de signification, c’est celui de Jean-Paul Sartre… Essayons de mettre en lumière sa teneur particulière.
***
Contrairement à Camus, qui refuse de se détourner des hommes réels et actuels, Sartre introduit un humanisme du projet, où le futur joue un rôle aussi important que dans la philosophie marxiste. Selon Camus, l’homme représente, avant tout, une donnée, il est et c’est justement cette qualité essentielle de son être que revendique l’homme de Camus, face à l’univers, à la violence, à la mort. Pour Sartre, l’homme ressent au contraire son être comme un vide, comme un néant, d’où le projet incessant qu’il a de se combler, d’agir pour se construire.
Nous sommes ramenés ici dans l’ambiance d’action dramatique qui est propre à l’homme de Malraux. Du théâtre de Sartre, nous retirons l’impression qu’une tension permanente est au cœur des rapports humains. Pour diminuer cette tension pénible, les individus « agissent », c’est-à-dire qu’ils s’efforcent de se dominer les uns les autres, de se réduire à merci : la femme veut séduire l’homme et le garder pour elle ; l’homme veut posséder la femme, puis l’asservir ; les dirigeants veulent maîtriser de plus en plus les masses, qui forment des syndicats, s’organisent dans des partis révolutionnaires. Les tentatives que fait chacun pour dominer autrui et pour échapper à l’emprise des autres, forment son histoire, édifient son être.
Tant que l’homme est vivant, talonné par sa conscience, il doit toujours faire de nouveaux « projets » pour emplir son vide, et donc continuer à lutter. Seuls, les morts sont des individus définitifs. La personne vivante ressemble, pour Sartre, à certains édifices citadins des quartiers les plus actifs, auxquels s’accrochent de perpétuels échafaudages, parce qu’ils sont toujours en transformation. Bien plus, l’humanité entière serait soumise à la même instabilité que l’individu : « L’homme est toujours à faire, écrit Sartre dans un opuscule intitulé L’Existentialisme est un humanisme. Nous ne devons pas croire qu’il y a une humanité à laquelle nous puissions rendre un culte, à la manière d’Auguste Comte. Le culte de l’humanité aboutit à l’humanisme fermé sur soi de Comte et, il faut le dire, au fascisme. C’est un humanisme dont nous ne voulons pas » (P. 92).
Ici, J-P. Sartre prend ses distances avec Malraux, car l’homme sartrien se refuse résolument à adorer sa propre Image, et il dénonce le danger, pour l’homme, de se prendre pour un Absolu, pour un nouveau Dieu. Mais, en outre, il refuse également d’adorer un Dieu transcendant, ce qui le situe aux antipodes du Christianisme.
L’unique transcendance, pour Sartre, est celle qui résulte de la conscience. C’est la conscience qui constitue en effet incessamment des objets et des êtres distincts d’elle-même (qui la « transcendent »). Sont également « transcendants », les buts de l’activité quotidienne : ramasser une pomme si on a faim, ou constituer un parti politique. « L’homme — dit Sartre — est constamment hors de lui-même » (P. 92).
La « transcendance » n’est pas ici un Dieu, comme pour les chrétiens ; on la trouve dans les objets que nous percevons, dans les buts que nous nous proposons, dans les êtres que nous fuyons ou que nous désirons.
« Il n’y a pas d’autre Univers, dit encore Sartre, qu’un Univers humain, l’univers de la subjectivité humaine » (P. 93). Cette phrase sonne comme une réplique moderne des paroles fameuses de Protagoras : L’homme est la mesure de toutes choses. L’humanisme existentialiste de Sartre est essentiellement relativiste et anthropomorphe.
En outre, Sartre croit à la totalisation universelle de tous les projets individuels — recherche de la nourriture, désirs sexuels, briguer une situation, professer telle doctrine — dans une immense
dialectique de l’Histoire. De la même manière que les gouttes de pluie se totalisent dans le fleuve en marche vers la mer, les actions individuelles se totaliseraient dans le devenir de l’Histoire. Ce devenir est aujourd’hui tumultueux, il nous secoue dangereusement. Et pourtant, selon Sartre, il nous emporterait irrésistiblement vers une société juste, libre et pacifique, où tous les besoins humains seraient enfin satisfaits. Voici comment il formule cet espoir dans sa Critique de la Raison dialectique : « C’est la lutte des hommes sur tous les plans et à tous les niveaux — dit-il — qui délivreront la pensée captive et lui permettront d’atteindre à son plein développement » (Jean Paul Sartre : Critique de la Raison dialectique, p. 17).
En quoi cette vision messianique se distingue-t-elle de la croyance marxiste dans un devenir historique libérateur de l’homme ? C’est que Sartre ne croit pas à la dictature du prolétariat. Il ne croit pas que cette dictature soit une condition nécessaire à la libération humaine. À peine publiée, cette position restrictive a soulevé chez les théoriciens du Parti Communiste français un tollé général.
Il existe encore un grave sujet de divergences entre J-P. Sartre et les penseurs du marxisme officiel ; ces derniers défendent, en effet, un matérialisme « dialectique », suivant lequel la nature entière (l’évolution de la matière, de l’univers et des êtres vivants) pousserait à la roue de
l’Histoire humaine ; au contraire, Sartre s’en tient au matérialisme historique ; d’après cette vision de l’Histoire, les hommes seuls, animés qu’ils sont de besoins et de désirs, seraient les moteurs du devenir humain.
Nous ne pouvons ici démonter les mécanismes du désir humain, ni les processus de la conscience malheureuse analysée par Sartre. Ces analyses sont remarquables et forment le contenu de son principal ouvrage philosophique, L’Être et le Néant.
Quant à l’humanisme sartrien, il nous semble fortement teinté par un messianisme à tendance irrationnelle, et resté très en arrière sur les critiques de Camus à l’égard des idéologies historicistes, sources de divisions et de violences entre les hommes.
Comment, en effet, les hommes réels et souffrants, qui ont vécu deux guerres mondiales, particulièrement absurdes et cruelles, feraient-ils confiance à l’Histoire, telle que nous la connaissons ? Le fameux « devenir historique » n’apparaît-il pas à nos yeux comme une dialectique de mort de plus en plus meurtrière, plutôt qu’un processus de libération ? (À consulter : A. Niel : Jean Paul Sartre, héros et victime de la conscience malheureuse ». Courrier du Livre)
À travers ces critiques, nous touchons du doigt la faiblesse de l’humanisme existentialiste, qui voudrait unir les hommes en leur donnant une même conscience de leur malheur et de leur abandon. Quelle amitié décevante et fragile, qui se reconnaît à peine elle-même au milieu des ténèbres de l’absurde, du dégoût, de la compétition et de la haine !
On a vu comment Sartre a été violemment pris à partie par les communistes. Interrogeons ces derniers à leur tour sur le contenu de leur humanisme.
4. — L’HUMANISME DU MARXISME OFFICIEL.
Selon Roger Garaudy, qui représentait la pensée officielle des Partis communistes français et Soviétiques : « L’humanisme marxiste, s’il ne place rien au-dessus de l’homme, n’est pas un humanisme clos. Il entend ne limiter l’homme à aucune de ses réalisations » (Roger Garaudy : Perspective de l’Homme, p. 316. P.U.F. 1959).
On reconnaît ici le projet de faire naître l’homme total cher à Karl Marx, épanoui à la fois intellectuellement et manuellement, individuellement et socialement. Si cet idéal a autant de succès aujourd’hui, c’est qu’il répond à l’aspiration de centaines de millions d’hommes, insuffisamment nourris, mal logés, mal éduqués, livrés à des dirigeants égoïstes et autoritaires.
Mais on doit justement se demander si la théorie actuelle du Marxisme — vieille déjà de plus d’un siècle— est capable de satisfaire aujourd’hui les besoins de l’homme en sécurité matérielle et en activité spirituelle. En effet, ces besoins sont devenus énormes, étant donné les succès de la Science et du Machinisme. L’extension d’une Science et d’une Technique où triomphe l’esprit rationnel n’emporte-t-elle pas l’espèce dans un devenir imprévisible ? Le pouvoir créateur de l’homme n’a-t-il pas transformé d’ores et déjà la Terre en une seule Société, animée par un seul Esprit ? Cet Esprit de l’homme ne peut souffrir de se sentir limité, enfermé, et il n’aura de cesse que l’éclaircissement du mystère des origines et de la fin de l’univers ne lui découvre, en arrière et en avant, le champ d’une durée infinie… C’est le dialogue avec l’univers et avec l’infini que recherche la pensée humaine, ce n’est pas le combat hégélien contre une Nature hostile.
Mais justement, est-ce que la philosophie du Marxisme officiel contemporain ne limite pas finalement l’homme ; en arrière par la matière, et en avant par l’idée a priori de la Société communiste ?
« L’humanisme marxiste, écrit Garaudy, est matérialiste et communiste » (Roger Garaudy : Perspectives de l’Homme, p. 317, P.U.F. 1959).
Matérialiste, parce que notre origine serait la matière ; et communiste, parce que l’Histoire nous conduirait fatalement à une société communiste. Mais n’est-il pas aussi limitatif de faire descendre l’homme de la matière que de le faire naître de la volonté arbitraire d’un Dieu tout puissant ? Et ce Dieu ou cette Matière, d’où proviennent-ils à leur tour ? C’est faire reculer le problème des origines, ce n’est pas le résoudre. L’homme qui veut connaître honnêtement le fond des choses ne peut être ici satisfait. Et pourquoi la libération de l’espèce devrait-elle passer nécessairement, et dans tous les pays, par une société communiste ? De plus, vouloir pour l’avenir une société où l’homme s’épanouisse, est-ce là un idéal capable de nous faire renoncer dans le présent à tout orgueil, à toute injustice, à toute violence ?
En réalité, toute rêverie sur les origines et sur la fin de l’existence humaine tend à nous faire oublier le problème social, le problème de nos rapports actuels, qu’il faudrait délivrer de l’orgueil et de l’exploitation. N’est-il pas évident que la pacification des rapports humains exige la fin des conflits entre les Mythes concernant les origines et la fin du monde ? Comment le problème des rapports du Moi avec l’Autre, ou du Moi avec la mort pourrait-il trouver sa solution dans quelque « matérialisme » ou dans quelque « spiritualisme » préfabriqués ?
La solution au problème de notre existence n’est-elle pas dans l’avènement d’une reliance concrète de l’individu avec les autres hommes et avec le monde ? Or, une telle reliance ne saurait s’accommoder d’aucune étiquette politique ou religieuse, un tel lien consistant dans une synthèse spontanée du moi et d’autrui, et de l’individu à l’univers, sans arrière-pensée confessionnelle. Est-ce que l’élan créateur, chez l’artiste ou le savant, est de droite ou de gauche ? Ainsi l’élan d’amitié pure, l’humain originel, n’est-il d’aucune obédience.
« La théorie des classes — écrit Garaudy — et de leurs luttes est la base de l’Histoire marxiste » (Roger Garaudy : Perspectives de l’Homme, p. 319, P.U.F. 1959).
La matière aurait d’abord produit la vie, dont l’évolution aurait abouti à l’homme et à la pensée.
Ensuite, le travail de la matière par l’homme aurait abouti à la formation des classes sociales. Enfin, le conflit des classes sociales évoluerait fatalement vers le triomphe politique du Prolétariat, dont sortirait, non moins fatalement, la société communiste. L’évolution de l’univers… le devenir de l’Histoire… l’aboutissement de la vie sur la Terre…, on a l’impression que cette immense aventure n’est pas seulement conduite par une finalité anthropomorphe, elle est devenue une aventure communiste !
On a vu que Sartre refuse de se laisser avaler par ce gigantesque finalisme de la Nature, supposé par le Matérialisme dialectique. Il s’en tient à la croyance dans le pouvoir libérateur de l’Histoire-violente. Quant à Camus, il va plus loin encore, puisqu’il refuse même de croire à la vertu libératrice du « devenir historique ». Camus ne voit dans cette théorie qu’une affirmation tout juste bonne à justifier les pires violences des nouveaux César, violences perpétrées avec la ferveur d’un rite religieux, dès lors qu’elles vont dans le sens supposé de l’Histoire.
Nous touchons ici, encore une fois, au fond de l’impasse où vont buter tous les humanismes de combat : Humanisme héroïque, Humanismes existentialistes ou marxistes. Aucune de ces visions du monde ne tient compte du fait que l’état de division et de compétition où l’humanité se débat depuis 4.000 ans est aujourd’hui devenu une menace de mort pour la civilisation (À consulter : A. Niel : La Crise de la Civilisation. Courrier du Livre). Aucune de ces visions de l’homme ne consiste dans un progrès réel vers l’affranchissement de notre état de division et de malheur.
Les humanismes anthropomorphes, malgré leur valeur esthétique ou leur pouvoir d’analyse, restent impuissants à fonder une vision du monde qui tende à dissoudre dès aujourd’hui, les antagonismes des Nations, des classes sociales, des Religions et des individus, une vision du monde qui incite tous les hommes présents à s’unir dans une action fraternelle et constructive.
* * *
Qu’est-ce qui paralyse ainsi l’imagination créatrice — morale et sociale — des penseurs anthropomorphes ? Ne serait-ce pas justement l’Image singulière, plus ou moins adorable, que chacun d’eux se forme de l’homme accompli, de l’homme parfait ? Est-ce qu’un Surhomme existentialiste ou communiste ne suppose pas toujours l’existence et le mépris des sous-hommes ? Toute religion exclusive n’a-t-elle pas ses élus et ses exclus, ses bienheureux et ses damnés ? Cette division de l’humain est fatale, à chaque fois que l’amitié, l’union, est projetée dans une Idole, un Fétiche, au lieu d’être vécue spontanément, sans projection d’un Homme-absolu.
L’échec des humanismes anthropomorphes à unir tous les hommes actuels et réels dans une vaste amitié ouverte et vivante, rappelle la maladresse et les chutes de l’apprenti cycliste, parce qu’il n’arrive pas à détacher ses yeux de son guidon et de sa roue. Il n’arrivera à garder son équilibre que lorsqu’il sera enfin parvenu à dépasser du regard, loin en avant, son corps et sa machine, c’est-à-dire sa propre existence figée, fétichisée.
Ainsi est-ce, le plus souvent, une image figée de l’Homme qui empêche les rapports fraternels entre individus réels. Comment aider les autres efficacement si on est soi-même embarrassé par un lourd drapeau ? Comment enseigner aux autres hommes le libre rapport fraternel, si, par nos actes et nos paroles, nous essayons d’attirer notre prochain dans les filets de quelque Doctrine ?
C’est pourquoi le courant des humanismes cosmologiques est aujourd’hui si important. Une fois l’individu replacé dans l’Univers, collaborant avec l’infini et avec tous les autres hommes, ayant retrouvé en lui la source de la Création, il se trouve délivré de toute projection de lui-même, de tout Absolu. Il n’est plus porté à adorer ni un Dieu transcendant, ni une humanité fétiche, parce que le courant de la création et de l’amitié a découvert sa voie, de l’individu à l’univers et du Moi à l’Autre Moi. Alors le pouvoir créateur infini tend à émerger dans l’homme, l’entraînant vers la prospection indéfinie des possibles : nouvelles formes d’art, nouvelles théories scientifiques, expériences inédites d’amitié ouverte, au sein de la profession, de la famille, de la Cité. En effet, plus rien ne s’oppose à la libre circulation des actes solidaires.
La Société ouverte annoncée par Bergson s’établit d’elle-même, à partir des individus enfin capables d’amitié pure. Voilà l’horizon social et moral que tend à dégager l’humanisme cosmologique, dont nous allons passer en revue les diverses orientations : Humanisme évolutionniste, Humanisme scientifique, Socialisme humaniste, Humanisme essentiel.
5. — RENOUVEAU ET ÉLARGISSEMENT DE L’HUMANISME CHRÉTIEN.
. L’Évolution christique, du Père Teilhard de Chardin.
. L’Encyclique Pacem in Terris.
Toutefois, avant d’en arriver aux humanismes cosmologiques, il nous faut signaler une pensée capitale, singulièrement significative de notre époque, et issue du renouveau actuel de l’humanisme chrétien. Nous voulons parler de l’œuvre à la fois scientifique, philosophique et mystique du Père Teilhard de Chardin [3].
Dans la mesure où cette œuvre se propose comme une synthèse de la doctrine catholique et de la science moderne, on peut la considérer comme un nouvel aspect de l’humanisme chrétien. On verra même qu’il est parfois difficile de dire si une telle œuvre est d’inspiration anthropomorphe ou cosmologique.
Le Père Teilhard a voulu démontrer que l’évolution terrestre, la montée des espèces successives vers l’homme, puis l’ascension culturelle de l’humanité et la disparition finale de la Terre avaient un caractère prédestiné, puisque cette immense aventure conduirait à l’avènement d’un Christ cosmique d’apparence humaine, et intimement lié à l’Histoire de la terre.
Cette vision « pan-christique » de l’Évolution reste donc bien anthropomorphe ; l’univers ayant sa raison d’être dans l’apparition et la survie des âmes individuelles, et son accomplissement dans le règne universel et éternel d’un Être divin, étroitement relié, par sa destinée de Créateur et de Sauveur, à la destinée de l’espèce humaine.
Mais, par ailleurs, Teilhard a pensé que la foi chrétienne et la religion catholique devaient se régénérer au contact de la Science moderne et du Transformisme ; cette plongée du Teilhard chrétien dans le courant d’une évolution vivante, puis historique, dont le ressort serait une pure énergie spirituelle-matérielle sans commencement ni fin, cette plongée dans le gouffre sans fond du Réel en devenir, donne à la pensée teilhardienne l’allure d’une pensée cosmologique.
Revenons un moment à l’anthropomorphisme de Teilhard. On a vu comment le marxisme croit à la marche dialectique de tous les phénomènes naturels et de toutes les volontés humaines vers une société libre et pacifique, la société communiste. Teilhard de Chardin, lui, fait concourir tous les phénomènes matériels et vitaux, tous les événements, toutes les violences de l’Histoire, tous les projets individuels, à l’avènement du Christ en tant que personne cosmique, ce qui donne finalement une figure anthropomorphe à la création entière : « En vertu de l’interliaison Matière-Âme-Christ — écrit Teilhard de Chardin dans le Milieu divin — quoi que nous fassions, nous ramenons à Dieu une parcelle de l’être qu’il désire. Par chacune de nos œuvres, nous travaillons, atomiquement mais réellement, à construire le Plérôme, c’est-à-dire à apporter au Christ un peu d’achèvement » (T. de Chardin : Le Milieu divin, p. 50. Ed. du Seuil).
La Cosmogénèse — c’est-à-dire la marche en avant de l’Univers et de l’Histoire — est essentiellement, pour Teilhard, une Christo-génèse, une marche en avant vers le règne céleste et ultra-terrestre de Christ-Omega. Avant l’homme doué de pensée, l’Évolution biologique résultait d’une poussée matérielle et mécanique. Mais, à partir de l’homme, selon Teilhard, un nouveau moteur lance en avant le progrès, c’est la conscience. Cette importance évolutive de la conscience nous éloigne des conceptions du matérialisme dialectique, et nous rapprocherait plutôt de J-P. Sartre.
Toutefois, les individus, selon Sartre, sont mus par leurs besoins et leurs désirs, — et leurs actes s’inscrivent dialectiquement dans la matière (outils, livres, usines, villes, aménagement du milieu, institutions sociales) de façon qu’ils participeraient atomiquement mais réellement à la marche de l’Histoire vers une société d’hommes libérés des chaînes matérielles — alors que, pour Teilhard, l’Histoire avance du fait d’un attrait sentimental exercé sur les individus par un Dieu, caché pour les athées, plus ou moins éclatant pour les croyants, un Dieu en train de se constituer comme Centre universel de conscience, et comme principe universel d’union, à travers l’évolution douloureuse et difficile du monde.
« Douleurs et fautes, larmes et sang — écrit Teilhard de Chardin à la fin du Phénomène humain — autant de sous-produits… engendrés en chemin par la Noogénèse… même au regard du simple biologiste, rien ne ressemble autant que l’épopée humaine à un Chemin de la Croix ».
Dans cette conception, plus nous nous laisserions attirer, séduire par la personne du Christ, plus nous serions unis et actifs dans l’œuvre humaine collective et historique qui doit aider la Terre à s’acheminer vers sa fin et à passer dans l’éternité.
Que penser de cet humanisme original, qui se veut simultanément chrétien et scientifique ? Nul doute que l’angle de vision ne soit plus vaste que dans la conception du monde marxiste. Pour le passé, on remonte beaucoup plus en arrière que la matière, jusqu’à l’action d’un principe spirituel-matériel. Et pour l’avenir, on dépasse le projet d’une Terre libérée, noosphérisée, pour atteindre, par delà la mort une zone d’union où les élus sont miraculeusement unis entre eux dans le sein de Dieu, sans toutefois disparaître en tant qu’âmes individuelles.
Pourtant, il subsiste de graves limitations, des énigmes, des inconséquences. D’où vient lui-même le Dieu-source, et pourquoi a-t-il déclenché une si douloureuse Cosmogénèse ? Pourquoi cet immense « Chemin de la Croix » évolutif, dont le plus clair résultat est la haine éternelle des damnés contre les bienheureux du Paradis ? En outre, est-ce que le caractère confessionnel d’un tel Dieu, qui apparaît à un moment donné de l’Histoire, qui a ses peuples élus et ses fils préférés, ne doit pas être finalement une cause de division parmi les hommes : Chrétiens contre Musulmans, contre Juifs… et croyants contre athées ? Les Marxistes voudraient nous persuader que l’évolution de l’univers est matérialiste et communiste. Un Teilhard nous affirme que le devenir universel est chrétien et même catholique. De telles déterminations ne tendent-elles pas à s’exclure, incitant les hommes à se combattre plutôt qu’à s’unir ?
Toutefois, l’œuvre du Père Teilhard de Chardin n’est pas seulement panégyrique. Son immense succès est dû, justement, au fait qu’elle dépasse l’esprit confessionnel. Cette œuvre contient même le germe d’un humanisme délivré de l’obsession limitative et narcissique de l’humain. Teilhard ne voit-il pas la vie « en pression partout dans l’univers » (T. de Chardin : Le Groupe zoologique humain, 37 Ed. Albin Michel) ? N’admet-il pas l’existence d’autres « centres cosmiques » que la terre ? L’existence perd ici la mesure humaine, pour devenir la manifestation d’une énergie vitale sans commencement ni fin. L’œuvre de Teilhard abonde en ouvertures lumineuses qui percent les murailles des plus lourdes énigmes métaphysiques. Alors s’élève la voix du mystique et du poète.
Dans le Milieu Divin, Teilhard évoque l’éveil des individus au sentiment d’une présence universelle, capable de les unir immédiatement entre eux dans le feu d’une communion spirituelle vivante qui pourrait presque se passer d’étiquette religieuse particulière : « Le Milieu Divin — lisons-nous — se manifeste à nous comme une incandescence des nappes intérieures de l’être… »
Et voici Teilhard décrivant l’intuition mystique : « La perception de l’omniprésence divine est essentiellement une vue, un goût, c’est-à-dire une sorte d’intuition portant sur certaines qualités supérieures des choses » (Le Milieu divin, ouv. cité, p. 163).
Le mysticisme mi-chrétien, mi-cosmologique du Père Teilhard de Chardin annoncerait-il une sorte de crise des humanismes anthropomorphes — parmi lesquels l’humanisme chrétien — attirés malgré eux par le grand souffle des pensées cosmologiques ? Il se pourrait qu’en Teilhard se soit trahie l’aventure d’une vénérable croyance traditionnelle anthropomorphe en train de s’universaliser par le fond, sous l’influence d’un courant de pensée irrésistible d’allure cosmologique.
* * *
Un autre aspect du renouveau de l’Humanisme chrétien apparaît dans les tentatives actuelles de l’Église romaine pour contribuer à la fondation de ce que Teilhard appelait un Esprit de la Terre. L’Encyclique du Pape Jean XXIII, Pacem in Terris — datée d’avril 1963 — est significative de cet esprit nouveau (Jean XXIII, Pacem in Terram, Ed. Spes, Paris 1963).
Dans ce texte fondamental, le chef de l’Église romaine dépasse de loin l’étroitesse de vues du dogmatisme et du fanatisme religieux. N’y admet-on pas que toutes les Cités, toutes les Croyances se trouvent aujourd’hui dans l’obligation de collaborer au sein d’une même communauté mondiale ? La création de cette communauté, lisons-nous, « est aujourd’hui… impérieusement réclamée par les exigences du bien commun universel » (p. 21).
Une telle communauté, librement constituée, aiderait à « instaurer partout la justice, la liberté et la paix. La guerre généralisée n’est-elle pas devenue impensable ? Cependant, l’instinct de conservation des peuples les pousse à « consacrer des sommes énormes aux dépenses militaires » (p. 127). Ce n’est certes pas un tel instinct qui forgera la communauté mondiale, c’est une compréhension mutuelle, c’est l’amour mutuel : « Il est permis d’espérer — lit-on à la fin de la IVe partie de l’Encyclique, sur l’Organisation de la Communauté mondiale — que les peuples, intensifiant entre eux les relations et les échanges, découvriront mieux les liens d’unité qui découlent de leur nature commune ; ils comprendront plus parfaitement que l’un des devoirs primordiaux issus de leur communauté de nature, c’est de fonder les relations des hommes et des peuples sur l’amour et non sur la crainte. C’est en effet le propre de l’amour d’amener les hommes à une loyale collaboration, susceptible de formes multiples et porteuse d’innombrables bienfaits » (p. 127).
Dans ces lignes résonne un noble appel à la pure fraternité. Jean XXIII s’y abstient même de prétendre que l’exhortation à l’amour soit un enseignement réservé à telle religion particulière. Il oppose même cet amour à la crainte, c’est-à-dire qu’il n’y voit plus un commandement, mais une spontanéité.
On n’est donc pas surpris que, dans le but de servir le bien commun universel — qui pose aujourd’hui « des problèmes de dimensions mondiales » (p. 135) — les Catholiques soient invités à collaborer avec des non-Catholiques : « Qu’ils ne considèrent pas leurs seuls intérêts — est-il dit — et collaborent loyalement en toute matière bonne en soi ou qui peut mener au bien » (p. 167).
Dans cette Encyclique se manifeste un esprit d’une très grande ouverture sociale et morale. Pourtant, on va voir que certains obstacles s’y opposent encore à un échange complètement libre des sympathies. N’est-il pas vrai qu’une libre amitié entre voisins, entre ouvriers et dirigeants, ne saurait être fructueuse et prolongée que si la poursuite d’aucun intérêt égoïste — individuel ou collectif — ne paralyse la liberté de leurs rapports ? Or, il semble que l’Encyclique elle-même trahisse parfois la recherche d’un intérêt égotiste, quand, par exemple, on espère que le progrès social et moral portera les hommes « à mieux connaître le Dieu véritable, transcendant et personnel » (p. 59).
Comment prévoir, en effet, quelles seraient les conséquences spirituelles d’une telle Révolution : la complète interliaison des consciences, la disparition de l’égoïsme ? On a vu que le même texte admet et encourage l’évolution de l’espèce vers son unification morale et politique. Mais l’intérêt confessionnel réapparaît lorsque ce progrès vers l’union est présenté comme un appel invitant tous les hommes « à former ensemble une unique famille chrétienne » (p. 123).
N’est-il pas certain qu’une vue complètement ouverte et désintéressée sur l’avenir serait moins affirmative ? L’unité humaine ne demande-t-elle pas aujourd’hui à être constituée par-dessus les communautés particulières, dans une amitié affectivement libérée des étiquettes sociales et historiques ? L’Encyclique elle-même ne vient-elle pas de le reconnaître ?
Ajoutons que certaines prises de position en manière économique semblent également devoir faire obstacle au libre jeu évolutif des rapports d’amitié — celle-ci par exemple : « De la nature de l’homme dérive… le droit à la propriété privée… y compris les moyens de production » (p. 39). N’est-on pas, au contraire, porté à supposer que, dans certaines circonstances, les rapports d’une saine amitié entre les hommes pourraient aboutir à la suppression de certaines formes abusives de la propriété privée ?
Malheureusement, les vues évolutionnistes d’un Teilhard de Chardin n’inspirent pas encore suffisamment la pensée chrétienne officielle. Ne lit-on pas dans la même Encyclique que : « L’ordre (moral) propre aux communautés humaines (est) universel, absolu et immuable dans ses principes » (p. 51) ?
Or, tout homme cultivé sait aujourd’hui que notre idéal de liberté et de justice était inconnu des hommes primitifs. La personne humaine, dont l’humanisme chrétien se fait à juste titre le héraut, n’est-elle pas une conquête de l’évolution historique, matérielle, sociale et culturelle ? Pourquoi, dans ces conditions, devrions-nous admettre que cette même évolution doive s’arrêter à la personne humaine d’aujourd’hui, à cet homme qui, malgré quelques améliorations, reste empli d’ignorances graves et marqué de terribles faiblesses ?
Nous touchons ici, à nouveau, à la frontière qui sépare les humanismes anthropomorphes des humanismes cosmologiques. Les premiers, du Christianisme à l’Existentialisme et au Marxisme, s’appuient sur la croyance que l’homme d’aujourd’hui est le point final de l’évolution biologique et culturelle. Chacun d’eux voudrait même — dangereuse concurrence ! — que cet homme définitif se range dans une humanité unique sous leur direction exclusive. Ces affirmations hâtives ne sont pas sans orgueil.
Les humanismes cosmologiques, nous allons le voir, restent ouverts sur un avenir qu’ils ne veulent marquer au sceau d’aucune doctrine particulière. Nous allons passer en revue les plus grands appels de ce courant de pensée essentiellement moderne. Ces appels mettent tous au premier plan le caractère fondamentalement créateur de l’homme, et par conséquent son pouvoir indéfiniment évolutif. Au lieu d’apparaître comme un Absolu, l’homme actuel, délivré de sa propre image, va se dévoiler comme une plate-forme propice au lancement d’une Histoire nouvelle, et au départ d’une société au destin imprévisible.
II
LA DIMENSION COSMIQUE
Les Humanismes cosmologiques :
Évolutionnisme
Humanisme scientifique
Socialisme humaniste
Humanisme essentiel
6. — L’HUMANISME ÉVOLUTIONNISTE DE BERGSON A JULIAN HUXLEY
« 1907, la gloire de Bergson est devenue mondiale — écrit un de ses disciples. Grâce à ses cours au Collège de France, les mondaines ont aidé à briser les murs que la Sorbonne dressait. Mais ses idées sont entraînées dans un tumulte de passion qu’il eût voulu leur épargner. De 1896 à 1906, une véritable guerre civile a sévi sur la France » (Gilbert Maire : Bergson et l’Élan vital, in L’Age nouveau, p. 75 ; ouv. cité, mars 1959).
L’émotion ici évoquée fut soulevée par une nouvelle vision du monde, celle qui reste exposée dans L’Évolution créatrice. Selon Bergson, l’évolution de l’univers et l’histoire de notre planète (l’apparition de la matière, le transformisme des espèces vivantes et leur aboutissement dans l’homme, animal révolutionnaire, doué de conscience) auraient leur ressort dans un Élan vital qui serait une véritable énergie créatrice, analogue à l’énergie de la pensée et qui serait par conséquent de nature spirituelle. L’Élan vital a d’abord organisé la matière en d’innombrables espèces vivantes de plus en plus libres, grâce au perfectionnement du système nerveux, puis il s’est finalement épanoui dans la Conscience et dans la liberté humaines. Mais à travers l’humanité actuelle, l’effort de l’Élan vital pour se libérer pleinement de l’obstacle matériel continue. Le progrès de notre adaptation au milieu n’est-il pas évident ? Le succès des sciences et des techniques en témoigne. Malheureusement, nous restons, dans nos rapports sociaux, les victimes de nos réflexes d’orgueil, de peur et de violence. C’est pourquoi la fonction évolutive et « prophétique » (représentée avant l’apparition de l’homme par certains mammifères aux membres non spécialisés, et aux instincts mal délimités) serait aujourd’hui assurée au niveau social, par certains individus remarquables, activement engagés dans le combat pour libérer l’humanité de ses frontières. Ces individus, annonciateurs d’une société ouverte et fraternelle, tendent à faire éclater les limites des sociétés fermées et égoïstes où nous restons enfermés — comme des crustacés dans leur carapace — sociétés qui nous contraignent à une discipline figée et le plus souvent absurde. Ces groupements fermés, ce sont nos États, nos Classes sociales, nos Hiérarchies, nos Religions absolutistes. Dans ces individus ouverts, l’Élan vital, selon Bergson, émergerait dans toute sa force. C’est pourquoi de tels individus se sentiraient animés par la plénitude de l’énergie spirituelle fondamentale. Bergson, dans Les deux Sources de la Morale et de la Religion, évoque cette union de l’individu avec le principe divin universel. Dans cette union, l’individu et le vouloir universel se fusionnent, sans que l’individu soit aboli. Au contraire, il se sent supérieurement libre : « Maintenant c’est Dieu qui agit par (l’âme de l’individu), en elle : l’union est totale… C’est désormais, pour l’âme, une surabondance de vie… Une exaltation calme de toutes ses facultés fait qu’elle voit grand, et, si faible soit-elle, réalise puissamment… » (H. Bergson : Les deux Sources de ta Morale et de la Religion, pp. 247 49).
Par l’inspiration, et surtout l’exemple de ces nouveaux mystiques, délivrés de l’adoration statique d’une Image autoritaire du divin, l’humanité est invitée à comprendre sa destination évolutive, qui est d’aboutir à une société supérieure, où s’affirme pleinement l’activité créatrice de la conscience, dans un climat de liberté et d’amour, pour des temps indéfinis. La société actuelle ne serait donc pas définitive pour Bergson. Elle est traversée d’un courant d’énergie spirituelle qui tend à la rendre de plus en plus perméable au dialogue, à l’amitié. Bergson ne dit-il pas que l’énergie créatrice doit se définir par l’amour ? (H. Bergson : Les deux Sources de la Morale et de la Religion, pp. 247 49).
En quelque sorte, nos institutions politiques et sociales rappelleraient ces inhumaines silhouettes de pylônes et de câbles, grâce auxquels s’élance l’énergie invisible qui permet à la Cité lointaine de s’édifier et de grandir. Elles font songer aussi au système nerveux rudimentaire des premiers êtres vivants, à travers lequel, cependant, la force de l’Élan vital commençait de se tracer un chemin vers le cerveau infiniment complexe de l’homme doué de pensée.
Ainsi la force de l’Élan vital, à travers nos institutions absurdes et cruelles, essaierait de s’ouvrir un chemin vers une Cité harmonieusement complexe, où la pensée de l’homme serait libérée définitivement des conflits, des violences et des servitudes matérielles. Dans une telle société agirait en toute liberté, avec le maximum de puissance efficace, la force créatrice d’une pensée que plus rien ne distinguerait de l’énergie fondamentale qui sous-tend l’univers.
Profondément universaliste, l’humanisme bergsonien est aussi radicalement cosmologique : la matière, la vie, l’homme sont les aspects d’une immense énergie vitale qu’on ne saurait représenter sous les traits d’aucune Image métaphysique ou religieuse, mais seulement atteindre par l’intuition de notre Moi profond et son intime durée. N’est-ce pas cette durée elle-même, identique à l’Élan vital, qui émerge dans l’âme délivrée, et qui émergerait dans les masses, au sein d’une Société sans frontières ?
Ainsi apparaît toute tracée la ligne future du progrès humain vers une plus grande liberté de pensée et d’action : davantage de loisirs, une éducation permanente pour tous, la participation de tous les hommes aux joies de l’art et de la recherche… Le but de cette libération, ce n’est pas un état de bonheur extatique, c’est une activité cohérente de tous les hommes, dominée par l’expression de la fonction créatrice : développement de l’amitié, initiation aux joies de l’effort collectif, intensification de la recherche, création technique, artistique et artisanale,.. Alors, l’humanité entière se replongerait aux sources de la durée vivante.
« Nous y gagnerons de nous sentir plus joyeux et plus forts — écrit Bergson —. Plus joyeux, parce que la réalité qui s’invente sous nos yeux donnera à chacun de nous, sans cesse, certaines des satisfactions que l’art procure de loin en loin aux privilégiés de la fortune ; elle nous découvrira, par-delà la fixité et la monotonie qu’y apercevaient d’abord nos sens hypnotisés par la constance de nos besoins, la nouveauté sans cesse renaissante, la mouvante originalité des choses. Mais nous serons surtout plus forts, car à la grande œuvre de création qui est à l’origine et qui se poursuit sous nos yeux, nous nous sentirons participer, créateur de nous-même » (H. Bergson : La Pensée et le Mouvant, pp. 133-134).
L’Humanisme évolutionniste introduit en philosophie une vision du monde, à la fois adaptée à la théorie biologique du Transformisme, et capable d’interpréter l’actuelle crise de la Civilisation : celle-ci résulterait du fait que le progrès matériel rend plus intenses et dangereux les conflits d’intérêts et de puissance, dans un monde où les rapports sociaux et moraux n’ont fait, eux, aucun progrès décisif vers l’union et l’harmonie.
C’est dans ce dernier domaine que l’humanisme évolutionniste voudrait introduire un esprit nouveau. Son intention est d’éveiller les hommes au sentiment que leur conscience, leur âme, leur pensée, sont mus par un élan créateur qui anime l’univers entier. Au niveau de culture et de puissance où l’homme est parvenu aujourd’hui, il lui appartient d’orienter lui-même sa destinée, et de prendre en main le gouvernail de son devenir. N’est-il pas vrai que l’énergie spirituelle fondamentale a émergé dans la conscience ? Autrement dit, l’homme ne peut plus compter que sur lui-même. Quelle terrible responsabilité ! Mais aussi quelle raison supérieure de nous unir, que cette tâche magnifique : poursuivre ensemble l’œuvre de l’univers et la faire aboutir dans une vie terrestre harmonieuse, qui serait le prolongement et l’aboutissement de la Création entière.
Cette vision du monde se retrouve, avec des variantes, chez tous les penseurs évolutionnistes ; par exemple, chez Gustave Mercier, qui publia en 1949, à 70 ans, son Dynamisme ascensionnel ; chez le penseur hindou Aurobindo Ghose, dont la Vie Divine, publiée en 1919, annonce Teilhard de Chardin ; chez des biologistes, comme Albert Vandel et Julian Huxley. Ce dernier représente aujourd’hui le néo-darwinisme anglo-saxon, mais il n’est plus strictement matérialiste, comme Darwin. Selon J. Huxley, l’univers se transforme lui-même, car il n’est pas seulement matière, mais également esprit. « Le cosmos entier — écrit-il — dans son immensité effrayante se compose d’une même étoffe du monde » (Voir L’Age nouveau, ouv. cité, p. 28, n° 106).
Cette étoffe du monde serait donc simultanément matérielle et spirituelle. Ce tissu fondamental, à un premier niveau, constitue la matière inanimée, d’où émerge peu à peu l’être vivant, qui évolue jusqu’au moment où apparaissent la pensée et la conscience. Cette montée de la vie vers l’homme n’est pas destructrice des niveaux d’existence antérieurs — animalité et matière —; pas plus que l’émergence du sommet d’une montagne à travers une mer de nuages ne suppose la destruction de sa base et des pentes intermédiaires. L’homme ne reste-t-il pas, aujourd’hui même, le contemporain d’animaux, de végétaux et de minéraux qui l’ont précédé sur la Terre, et qui ont rendu possible l’ascension vers la pensée ? Ce phénomène se reproduit d’ailleurs à l’échelle cosmique, puisque la Terre actuelle reste la contemporaine du milieu stellaire primitif où s’est lentement poursuivie son ascension vers la vie et la pensée.
Il est probable qu’en d’autres parties de l’univers, d’autres planètes ont commencé à leur tour la même ascension, étant destinées à nous relayer dans l’avenir, quand la terre devra disparaître. Nous sommes devant le spectacle d’un perpétuel recommencement de la vie et de la pensée, l’univers produisant des mondes habités d’êtres conscients, comme un arbre produit successivement à chaque saison nouvelle ses fleurs et ses fruits. Mais l’univers serait un arbre immortel, au feuillage indéfiniment persistant.
À la source de cet immense devenir, il y aurait un courant d’énergie de nature spirituelle ; cette énergie s’exercerait de manière différente aux divers niveaux du Réel — matière, vie, pensée, société fermée, société ouverte — mais il y aurait une tendance permanente vers plus de conscience et de liberté.
Cette idée de divers paliers d’organisation de la matière est fondamentale dans la biologie contemporaine. Notre humanité actuelle appartiendrait elle-même à un certain niveau d’organisation de l’Étoffe cosmique, correspondant à un certain degré de conscience et de liberté. On comprend alors que nous sommes encore trop menacés par nos propres conflits, pour que nous puissions prétendre avoir atteint un niveau d’organisation social et biologique supérieur.
Songeons à une belle œuvre d’art — par exemple à l’Enseigne de Gersaint de Watteau — ou bien imaginons le plus puissant et le plus perfectionné de nos moteurs. Quel chemin à parcourir avant que le gouvernement et l’éducation de notre espèce, avant que la vie économique de notre planète, aient atteint ce niveau de perfection esthétique ou technique ! Mais l’accès à un niveau supérieur du Réel est toujours difficile : « Le passage à un nouveau palier évolutif, écrit Albert Vandel, c’est une rénovation entière de la totalité de l’organisation » (Voir L’Age nouveau, ouv. cité, p. 27, n 105).
Nous comprenons mieux alors l’actuelle imperfection de l’homme. Nos injustices, nos violences témoignent que l’énergie spirituelle n’a pas encore complètement émergé dans une société humaine super-organisée, ayant atteint le palier supérieur de l’unité humaine. Normalement donc, l’ascension biologique, puis matérielle et culturelle de notre espèce devrait préparer un accomplissement final de l’homme, dans un être où le pouvoir créateur de l’esprit ait complètement éliminé les forces de destruction. Ici apparaîtrait un nouveau « palier d’organisation » mental et social, où régnerait un ordre moral sans conflit ni frontières.
Les penseurs évolutionnistes croient que l’homme est doué d’immenses possibilités de transformation individuelle et sociale, et qu’il pourrait devenir très supérieur à ce qu’il est aujourd’hui. Ce point de vue les distingue radicalement des penseurs du Christianisme, du Marxisme officiel et de l’Existentialisme, pour lesquels l’homme d’aujourd’hui est un être définitif, qui pourrait être sauvé ou délivré, mais non pas transformé, métamorphosé, dépassé.
Julian Huxley, lorsqu’il propose de fonder une « science des possibilités humaines » (Voir L’Age nouveau, ouv. cité, p. 36, n 106), nous invite à travailler à la tâche qu’il croit la plus urgente : aider l’homme actuel à passer à un niveau supérieur de relations sociales et de conscience métaphysique.
Plus que tous les autres humanismes déjà étudiés, l’Humanisme évolutionniste nous convie à nous unir, sans que nous ayons pour cela à nous refermer sur une croyance nouvelle. Nous devons nous unir parce que nous vivons tous la même aventure évolutive. L’exhortation à l’unité humaine ne cherche plus ici à se prévaloir d’aucune étiquette idéologique ou religieuse. On part simplement du fait que, dans tous les hommes, tend à émerger dans sa plénitude spirituelle et créatrice l’énergie fondamentale qui anime la nature et la vie. En même temps, l’homme se découvre un rôle dans l’univers : en participant à l’acte créateur profond qui sous-tend la nature, il tend à faire progresser l’ordre matériel et vital, sans lequel l’esprit n’aurait plus de support.
Tout être humain contribue donc à ce que la Terre puisse devenir un jour, par sa perfection, un des piliers de l’Être universel et sans fin.
Nous avons comparé plus haut l’univers à un arbre immortel, dont les fruits successifs seraient les planètes habitées et mortelles. Peut-être vaudrait-il mieux parler d’une forêt d’étoiles où les mondes naîtraient et s’épuiseraient successivement, de sorte que la forêt immense, l’univers, ne pourrait jamais mourir. Chaque individu n’a-t-il pas, en lui la conscience qu’alimente indéfiniment la renaissance des êtres et des mondes ? Ainsi, chacun peut-il se sentir participer à l’être immortel, sans qu’on ait besoin de préciser les aspects futurs de cette immortalité. Selon Bergson, la conscience déborde infiniment les limites du cerveau individuel, de sorte que, dans la mort, c’est seulement un support provisoire de cette conscience qui disparaît.
« L’unique raison de croire à l’extinction de la conscience après la mort — écrit-il dans l’Énergie spirituelle — est qu’on voit le corps se désorganiser, et cette raison n’a plus de valeur si l’indépendance de la presque totalité de la conscience à l’égard du corps est, elle aussi, un fait que l’on constate » (Cité dans La Pensée de Bergson, par François Meyer, p, 45 – Bordas).
La fraternité à laquelle nous invite l’Évolutionnisme tire sa justification à la fois de l’unité de la conscience, de l’unité de la vie et de celle du cosmos. Élever une famille sans intention égoïste ni autoritaire, exercer une profession par vocation profonde, participer sans ambition au gouvernement de la Cité, en cherchant à y faire régner l’esprit de justice, c’est en même temps faire avancer l’évolution de l’espèce, et c’est contribuer à maintenir l’ordre infini de la Création. Il y a certainement un facteur d’union quasi-irrésistible dans le sentiment de cette grandiose tâche collective.
N’oublions pas cependant que l’individu concret a sa vie dans le présent. Comment garderait-il toujours devant les yeux la perspective d’une tâche aussi vaste ? On aimerait pouvoir redescendre au niveau d’une plénitude plus familière que le sentiment un peu exalté de cette immense aventure cosmique. Quel rapport le feu d’artifice des galaxies a-t-il avec notre souci du pain quotidien, nos difficiles amitiés, les injustices, les guerres, la souffrance, la mort ?
On comprend que L’humanisme évolutionniste aurait besoin d’être complété par des notions plus concrètes, capables de diriger les hommes dans leur action quotidienne, en leur proposant une morale et un art de vivre adaptés à notre monde. Mais nous allons voir que L’humanisme cosmologique n’a pas dit son dernier mot avec l’Évolutionnisme. Il existe notamment un humanisme essentiellement moderne, qui semble tout prêt à répondre aux exigences concrètes de l’action quotidienne, c’est L’humanisme scientifique. Voyons quelles sont les grandes directives de son enseignement.
7. — L’HUMANISME SCIENTIFIQUE de Joliot-Curie, Bachelard, Einstein et Louis de Broglie
On peut voir dans l’Humanisme scientifique une réponse aux attaques injustes de certains penseurs — comme Bernanos et Unamuno — contre le machinisme et la culture scientifique. Il est certain que la science est devenue une menace pour la civilisation — en développant le pouvoir meurtrier des armes détenues par des gouvernements irresponsables ; en favorisant une exploitation anarchique des richesses de la planète, etc…
Mais la Science n’est pas elle-même responsable des fléaux qu’elle menace de déclencher sur l’humanité. Les responsables sont l’égoïsme et la volonté de puissance, qui détournent les plus grandes inventions du génie humain pour les faire servir à des buts militaires, ou bien aux intérêts insatiables du confort et de la vanité.
Il serait d’ailleurs tout à fait impossible de renoncer aujourd’hui aux acquisitions de la Science. Sans les machines et les techniques, l’humanité souffrirait aussitôt de pénurie dans tous les domaines : insuffisance des communications, raréfaction des vêtements et de la nourriture, les masses privées de journaux et de livres. Ajoutons que de graves maladies n’ont pas encore été vaincues et que 3 hommes sur 4 ne mangent pas à leur faim.
Certains savants ajoutent qu’il faut prévoir également le cas où nous serions soudain menacés par quelque maladie inconnue : « Une bactérie peut, demain, s’attaquer à l’espèce humaine — écrit Joliot-Curie — et tenter de la détruire, comme d’autres espèces qui ont déjà disparu. Il existe une espèce d’herbe, le zooster, qui, en deux ans, a presque complètement disparu de toutes les côtes du globe. Cet accident qui a frappé une herbe peut, demain, s’abattre sur l’homme. Pour pouvoir combattre efficacement ces fléaux éventuels, il nous faut accumuler une réserve considérable de résultats scientifiques. Non seulement il serait fou de vouloir de nouveau enchaîner Prométhée, mais il nous faut, au contraire, appliquer l’esprit scientifique pour trouver des solutions aux difficiles problèmes de notre existence présente » (Conférences de l’UNESCO., Ed. Fontaines, 1947).
Ce n’est pas l’esprit de Prométhée, ce n’est pas l’esprit scientifique qu’il convient aujourd’hui d’enchaîner, c’est l’esprit de violence, c’est la haine mutuelle des hommes. Mais ici même l’esprit de la science n’est-il pas un précieux exemple ? Ne suppose-t-il pas l’absence de parti-pris personnel, l’humilité devant les faits ?
Gaston Bachelard évoque, dans son ouvrage Le Nouvel Esprit Scientifique, l’aventure du physicien britannique J. Thomson, « plein d’enthousiasme pour l’œuvre de son fils révélant que les électrons en mouvement constituent des ondes… », alors que lui-même avait travaillé toute sa vie à prouver que les électrons étaient des corpuscules.
Et Bachelard conclut : « Du père au fils on peut mesurer la révolution philosophique que réclame l’abandon de l’électron comme chose ; on peut apprécier le courage intellectuel nécessaire à une telle révision du réalisme. Le physicien a été obligé trois ou quatre fois depuis vingt ans de reconstruire sa raison et, intellectuellement parlant, de se refaire une vie » (Panorama, ouv. cité, p. 753).
Ce désintéressement devant les faits, qui dissout l’égoïsme et les préjugés de la passion est une des leçons majeures de l’esprit scientifique. N’est-ce pas également un caractère essentiel de toute vérité scientifique, que d’unir tous les hommes dans une même adhésion, par-dessus les frontières où s’enferment les Races, les Nations, les Classes sociales et les Religions ? Un médicament nouveau guérit une maladie cruelle ; une formule mathématique interprète une nouvelle catégorie de phénomènes, et l’adhésion est tout de suite universelle.
« La Science est, écrit Joliot-Curie, et c’est l’un de ses plus hauts titres, un élément fondamental d’unité entre les pensées des hommes dispersés sur le globe. Il n’est pas selon moi, d’autre activité humaine dans laquelle l’accord entre les hommes soit toujours aussi certainement acquis. L’observation scientifique se traduit par les mêmes réactions de pensée quelles que soient la longitude et la latitude. Et on pourrait se demander s’il n’en serait pas également de même chez d’autres êtres vivants de notre univers, s’ils existent, si différente de la nôtre que puisse être leur forme, du moment où ils seraient dotés de la faculté de penser, c’est là l’universalité de la Science » (Panorama, ouv. cité, p. 753).
On pourrait aller plus loin encore, en faisant remarquer que la Science ne relie pas seulement entre eux les hommes, mais qu’elle les suppose eux-mêmes reliés à l’univers, à l’infini, au mystère des choses. La Science est, en quelque manière relieuse, c’est-à-dire religieuse. Est-ce que la vérité sur l’univers ne vient pas au savant comme une parole révélée, dictée par une faculté mystérieuse ? Einstein lui-même disait : « Le fait que (le monde) est compréhensible est un miracle » (Al. Einstein : Conceptions scientifiques, morales et sociales, p. 56 Flammarion).
L’homme primitif se sentait relié à l’infini par de troubles sentiments de crainte et d’espérance. Einstein maintient sa méfiance à l’égard de certaines croyances modernes en un Dieu personnel, mis à la tête de la Création par des individus plus désireux de se faire craindre et obéir, que soucieux de dégager la vérité sur l’homme et sur le monde.
« La principale source des conflits… entre la religion et la Science — écrit Einstein — se trouve dans ce concept d’un Dieu personnel… Dans leur lutte pour le bien moral, les ministres de la religion doivent avoir la hauteur de vue d’abandonner la doctrine d’un Dieu personnel… cette source de crainte et d’espérance qui rendait dans le passé les prêtres si puissants » (Id. : pp. 25-27).
L’humanisme scientifique affirme que la vérité sur l’homme, sur l’infini, sur la mort, ne saurait être terrifiante. Il la croit au contraire sérénifiante. Joliot-Curie écrit : « Je dirai que la pure connaissance scientifique nous apporte la paix de l’âme en chassant les superstitions, en nous affranchissant des terreurs invisibles, en nous donnant une conscience de plus en plus exacte de notre situation dans l’univers » (Panorama, p. 753).
Nul doute que la morale de la Science ne soit une morale de l’union — union des hommes entre eux, union entre l’homme et l’infini — c’est-à-dire une morale vraiment humaniste. Voyons maintenant quelle est sa philosophie.
On doit à Copernic et à Galilée et d’avoir délogé l’homme de sa position illusoire au centre de l’univers, en démontrant que la Terre tournait autour du soleil. Puis Lamarck et Darwin ont accrédité la notion d’une vie en évolution et d’une humanité en devenir, notion qui détruit la légende d’une humanité immobile dans le temps.
Or, une troisième leçon d’humanisme cosmologique nous est donnée par la physique contemporaine, pour laquelle la connaissance scientifique ne provient pas uniquement de l’initiative humaine, mais d’une sorte de travail intime de l’étoffe essentielle du monde.
Pour l’homme primitif, et pour certains philosophes modernes — comme Hegel et Sartre — percevoir un objet, ou connaître une vérité scientifique, cela revient toujours à prendre pour soi, à s’emparer. Le sorcier et Fai chimiste étaient déjà respectés pour leurs pouvoirs sur les forces de la nature.
Jean-Paul Sartre écrit, de nos jours encore : « Le connaître est une modalité de l’avoir » (L’Être et le Néant, p. 507).
Cette conception suppose une sorte de combat entre le sujet et l’objet, entre l’individu et le monde. De même suivant l’idéalisme, le sujet, la connaissance, ne saisit que des idées, des fantômes engendrés par l’esprit qui semble tout puissant ; par contre suivant le réalisme et le matérialisme, il existe vraiment une réalité indépendante de l’esprit, et celui-ci est alors complètement subordonné.
Or, ces disputes traditionnelles sont aujourd’hui dépassées par la réflexion sur les méthodes de la science. Le sujet et l’objet, l’individu et le monde apparaissent de plus en plus, pour le savant moderne, comme les deux faces d’un phénomène complètement original, le pouvoir de connaître, la faculté de connaissance. Celle-ci jaillit au contact de l’homme et du monde, de même que surgit un arc-en-ciel au contact du soleil et des nuages.
Il n’y a donc pas de réalité objective absolue. Quand on photographie un atome, on l’éclaire, mais en le bombardant de photons, on le dérange, on le déplace ; la photographie obtenue constitue seulement une synthèse de l’esprit-sujet et du réel-objet. Mais il n’existe pas non plus de sujet absolu. Aucun homme ne peut s’abstraire de son rapport avec le monde. Devant les caractères d’une écriture inconnue, l’ignorant ne devient pas un pur sujet devant un objet complètement mystérieux. Il reste un sujet dans le monde, et il constate : je vois des traits, des points, des triangles… Il y a toujours un échange, un dialogue, un rapport constructif avec le monde même dans l’ignorance et terreur.
Cette leçon de la Science, le physicien Heisenberg l’a résumée ainsi : « La connaissance des atomes et de leur mouvement « en soi », écrit-il, …n’est… plus le but de notre recherche… nous nous trouvons … au sein d’un dialogue entre la nature et l’homme » (Heisenberg : La Nature dans la Physique contemporaine, in Planète, n° 5, p. 25).
Plus d’opposition, plus de combat du sujet et de l’objet, de l’homme et de la nature, mais une collaboration. Est-ce qu’une maison, une route ne sont pas des synthèses de la matière brute et de l’homme qui les a construites ? Ainsi toute perception, toute connaissance, seraient-elles des synthèses du sujet et de l’objet. Selon Hegel et Marx, l’union de l’homme et de la nature devrait se produire dans l’avenir au terme dialectique de l’Histoire. Au contraire, la philosophie de la science nous révèle que la synthèse homme plus nature a lieu dès aujourd’hui. Ce qui n’a pas lieu, ce qui nous manque, c’est la synthèse, c’est l’union constructive, socio-synthétique, entre les hommes eux-mêmes.
Il est donc vrai que la Science nous offre le modèle d’une activité et d’une morale supérieures. Désintéressement, objectivité, communion : n’est-il pas évident que la pratique de ces vertus, au niveau politique et social, aurait les conséquences les plus heureuses pour la paix et la justice ?
* * *
On peut toutefois douter que la communion spirituelle pratiquée par une équipe de savants, soit directement transposable dans les rapports moraux — par exemple entre directeurs et ouvriers, professeurs et étudiants, parents et enfants. En effet, ces personnes ont entre elles des rapports intersubjectifs directs, qui ne sont plus conditionnés par un travail pratique immédiat. Partager des profits industriels entre directeurs, ingénieurs et ouvriers, n’est-ce pas — exclusivement — un problème de rapports directs entre personnes ? Or, les rapports interpersonnels directs constituent justement aujourd’hui le plus grand problème de l’homme.
La solidarité humaine dans le dur travail collectif rappelle l’amitié indirecte des hommes face à l’univers inhumain, invoquée par Albert Camus. À ce type de solidarité, il manque l’étincelle chaleureuse, le don gratuit de soi-même et la communion profonde des personnes.
Même rapport un peu froid entre l’homme et l’infini dans L’humanisme scientifique. Louis de Broglie compare l’effort de l’homme actuel, dans ses rapports avec le monde, à celui d’un artisan solitaire travaillant à une tapisserie de hautelice. Seul lui apparaît l’envers de son ouvrage ; l’endroit ne lui sera dévoilé que le jour où l’ouvrage pourra être retourné et contemplé en face.
« Peut-être, dit Louis de Broglie, sommes-nous victimes d’une illusion et attribuons-nous trop d’importance à l’espace et au temps, simple cadre de nos perceptions… L’ouvrier qui, face au revers de son ouvrage, tisse une tapisserie de haute-lice, pourrait ne pas se rendre compte de l’œuvre réelle qu’il accomplit, mais il s’en apercevrait le jour où il pourrait retourner son ouvrage et le contempler en face. Ainsi la pensée humaine… apercevra-t-elle peut-être un jour au-delà des lisières de l’espace et du temps le véritable sens de l’œuvre que (poursuit l’effort de la vie) » (Pathé Marconi : Le dernier Message de Louis de Broglie – disque).
Nul doute que la vision de cet immense effort collectif ferait apparaître plus vaines que jamais toutes les frontières qui divisent l’espèce. Il semble cependant que le souffle intersubjectif de l’amitié doive prendre sa source ailleurs que dans la vision d’un travail commun. On a vu que le véritable rapport moral consiste dans une relation directe entre les personnes. Le rapport constructif entre les sujets a ses exigences propres. Qu’on l’appelle amour, amitié pure, socio-synthèse, relation humaine fondamentale, ce rapport apparaît indépendant de la simple solidarité pratique, ou de la simple communion devant le danger.
Ici, deux courants de recherche, retiendront notre attention. D’une part, un Socialisme « humaniste », vision entièrement renouvelée de la doctrine socialiste, dans le prolongement du socialisme idéaliste français ; d’autre part, un humanisme que nous qualifierons d’essentiel, parce qu’il recherche les conditions d’une harmonie fondamentale des personnes par-delà les frontières de l’espace et du temps.
8. — LE SOCIALISME HUMANISTE de Proudhon à Jaurès, Charles Andler et Erich Fromm
Nous avons déjà parlé d’une certaine doctrine socialiste, et nous l’avons classée parmi les humanismes anthropomorphes. Il s’agissait du socialisme dit matérialiste (matérialisme historique et matérialisme dialectique de Karl Marx, Engels et Lénine). Ce matérialisme assigne à l’Histoire une évolution fatale, ayant sa route tracée d’avance vers l’unité et la liberté humaines. Aussi, un tel matérialisme ne demande-t-il à l’homme qu’un minimum d’intervention créatrice. Une fois que l’individu a compris le mécanisme de l’Histoire (évolution des modes de production, théorie de la plus-value, conflit des classes sociales), son action devient celle d’un rouage conscient du devenir historique : on agit suivant les directives du Parti, dans le sens supposé d’une plus grande efficacité de l’action révolutionnaire.
Au contraire, le socialisme humaniste dont nous allons parler n’est pas anthropomorphe ni anthropo-finaliste. Il ne croit pas que le « devenir historique » (la suite des révolutions et des guerres) soit une marche fatale vers l’unité humaine et la liberté. Il affirme au contraire que la paix et la justice ne sauraient triompher que si l’homme intervient et innove de toute la force de ses énergies créatrices.
Le socialisme matérialiste affirme que l’histoire violente, avec ses guerres, ses conflits sociaux, ses révolutions, avance fatalement vers la justice et la paix.
Le socialisme humaniste affirme au contraire qu’il faut commencer par établir un esprit de paix et de justice. Sans une telle humanisation du rapport social spontané, les conflits de classe et l’exploitation de l’homme par l’homme réapparaîtront toujours sous une forme ou sous une autre. Il ne s’agit plus d’obéir aux lois d’un devenir empli d’une cruauté bénéfique, il s’agit de désobéir à une fatalité inhumaine, en créant par la force de l’invention un ordre social et une culture délivrés des conflits, des inégalités et des violences.
Le socialisme matérialiste ne demande à l’individu, pour l’instant, qu’un minimum d’initiative, de création et de fraternité. Ces qualités proprement humaines s’épanouiront plus tard, dans une société qu’il nous faut préparer dans la discipline et, s’il le faut, par la violence.
Au contraire, le socialisme humaniste demande dès aujourd’hui à l’individu le maximum de lucidité, d’invention et de chaleur fraternelle. En quelque manière, il faut planter immédiatement la graine qui donnera naissance un jour à l’arbre gigantesque de la société universelle. Cette semence, c’est l’amitié pure ; c’est le rapport direct d’union fraternelle d’un individu à l’autre. Mais se conduire en homme fraternel est justement le problème moral et social le plus difficile à résoudre. Spontanément, les individus entrent en conflit au lieu de pratiquer l’amitié, que ce soit dans la famille, dans la profession, dans la Cité. Il existe une aliénation ségrégative spontanée de l’homme social, qui suscite aussitôt le supérieur et l’inférieur, l’ami et l’ennemi, le puissant et le faible. N’est-ce pas justement fuir devant ce problème, que de compter sur l’Histoire pour le résoudre ? En réalité, la plupart des doctrines politiques, morales et religieuses ne cherchent pas à guérir l’homme de son aliénation ségrégative. Elles exploitent, le plus souvent, cette aliénation : en flattant le goût de la compétition, l’orgueil, la vanité, la volonté de puissance. Les Gouvernements promettent la puissance nationale, les Partis recherchent la supériorité politique, les Morales font miroiter le succès et les récompenses, pour ce monde ci ou pour l’autre. Mais aucune de ces doctrines ne recherche honnêtement à propager un art de vivre qui satisfasse pleinement la nature sociale et créatrice de l’homme, son besoin d’un rapport d’union fraternelle avec les autres hommes, avec la nature et avec l’infini.
Dans ces dernières lignes, nous avons sans le vouloir résumé le programme du Socialisme humaniste. Le vrai progrès, pour cette doctrine humanitaire, tend à satisfaire à la fois les besoins matériels de l’homme, et les exigences de sa nature consciente : besoin de l’individu d’exister en tant que personne, mais besoin aussi de se dépasser dans le rapport solidaire avec les autres, et dans la pensée sereine de la mort ; besoin d’inventer, mais aussi besoin d’aimer ; besoin d’initiative personnelle, mais aussi besoin de se sentir participer à l’effort de l’espèce et au devenir de l’univers.
L’idée de liberté, tant de fois invoquée par les moralistes, les philosophes et les idéologies révolutionnaires, apparaît dès lors sous un jour complètement nouveau. La notion commune de liberté a toujours trahi un certain désir de puissance. Pour l’homme asservi, la liberté, c’est son désir aveugle de revanche sur le Maître. Pour le moraliste, la liberté, c’est le pouvoir de vaincre le mal, et une telle victoire octroie la supériorité sur les faibles, sur les vicieux, sur les méchants.
Une certaine liberté, inconsciente de sa contradiction, est ici revendiquée comme une revanche ou un pouvoir supérieur sur d’autres hommes. Cela explique que la Révolution française ait pu aboutir à la dictature de Napoléon, puis à l’hégémonie de nouvelles classes sociales, et que le Manifeste Communiste ait pu conduire à la dictature de Staline et à de nouvelles hiérarchies autoritaires : une liberté de revanche et de puissance a été revendiquée, puis obtenue par tous les moyens, mais la véritable amitié, la communion constructive, n’a pas été réalisée.
N’est-il pas évident que le besoin réel de liberté n’a rien à voir avec un désir égoïste ? — Qu’est-ce que la liberté, sinon le pouvoir de s’épanouir jusque dans le rapport social le plus complet, où l’individu soit capable de se dépasser dans une conscience supérieure ? — Qu’est-ce que la liberté, sinon la plénitude du pouvoir humain de connaître, d’agir et d’aimer ?
Proudhon a écrit que la liberté, ce n’est pas le droit pour chacun de faire ce qu’il veut ; sinon, dit-il, « L’existence d’un seul individu sur toute la face du globe donnerait ainsi l’idée de la plus haute liberté possible » (Proudhon : Confessions d’un Révolutionnaire, 1849).
Je suis libre de la vraie liberté si je peux échanger des idées avec les autres, si je peux recevoir gratuitement leur aide. « Liberté et solidarité, dit encore Proudhon, sont termes identiques » (id.).
Même idée d’une liberté-reliance chez Bakounine : « Je ne suis pas un être libre — écrit-il — si les autres hommes ne le sont pas ». En effet, comment puis-je dialoguer, inventer, être pleinement actif et épanoui, si je vis au milieu de gens égoïstes et ambitieux ?
« Pour être libre, écrit encore Bakounine, j’ai besoin de me voir entouré et reconnu comme tel, par des hommes libres. Je ne suis libre que lorsque ma personnalité, se réfléchissant, comme dans autant de miroirs, dans la conscience également libre de tous les hommes qui m’entourent, me revient, renforcée par la reconnaissance de tout le monde. La liberté de tous, loin d’être une limite de la mienne, comme le prétendent les individualistes, en est au contraire la confirmation, la réalisation et l’extension infinie. Vouloir la liberté et la dignité humaine de tous les hommes, voir et sentir ma liberté confirmée, sanctionnée, infiniment étendue par l’assentiment de tout le monde, voilà le bonheur, le paradis humain sur la terre » (Bakounine : Deuxième conférence aux ouvriers de Saint-Imier. Cité dans Les Cahiers du Socialisme libertaire, n° 36).
On pourrait dire que le socialisme humaniste est moins une requête agressive de liberté qu’une recherche positive de la pleine socialité de l’homme. Cette recherche a des bases concrètes : elle part du fait que le caractère social, la joie du rapport social ouvert, font essentiellement partie de la nature humaine, au même titre que le caractère conscient et créateur. On comprend pourquoi cette doctrine se prétend en progrès sur la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789, strictement individualiste. Quelles sont les origines historiques du socialisme humain, comme l’appelle Jaurès (Jean Jaurès, P.U.F., p. 42) ?
Le socialisme humaniste contemporain a son origine dans le socialisme idéaliste français. C’est en France qu’eût lieu la première grande révolution politique à caractère individualiste et libéral, mais c’est également en France qu’on a découvert l’homme social, le socius, qui dépasse l’individu par son importance économique et culturelle.
Saint-Simon, Charles Fourier et Proudhon ont appuyé leurs théories sur l’existence de cet homme social, révélée par le mode industriel de production : la vie collective est une source particulière de richesses, dont tous les hommes devraient pouvoir profiter, grâce à une juste répartition. Poursuivie dans cette direction, la pensée socialiste (ce terme est devenu courant vers 1840) aurait abouti à l’analyse de l’esprit de compétition et de puissance, qui fait obstacle aux rapports de fraternité et de justice. Malheureusement, l’idéal socialiste a dévié dans les Idéologies autoritaires, notamment avec le matérialisme historique, qui attribue un rôle bénéfique à l’Histoire violente.
On ne peut nier que Marx ait entrevu la vérité sur l’homme aliéné, coupé simultanément de l’autre homme et du monde matériel, par le conflit des intérêts économiques. Malheureusement,
Marx n’a pas compris que cet homme aliéné est capable dès aujourd’hui d’activités créatrices et productives — sans lesquelles il n’y aurait ni sciences ni techniques. Karl Marx a réduit arbitrairement l’homme actuel à son activité aliénée, solitaire et conflictuelle ; il n’a fait aucune confiance à l’initiative morale, à la force créatrice de l’amitié, c’est pourquoi il a donné tant d’importance à la dictature centralisatrice de l’État prolétaire.
Le Socialisme humaniste croit au contraire qu’il faut appuyer tout progrès social sur les forces réelles de fraternité, qu’il faut réveiller dans les hommes par la parole et l’exemple. Un tel socialisme a trouvé son affirmation explicite chez Jean Jaurès.
Jaurès croyait à la possibilité, pour l’esprit, de s’élever immédiatement au niveau de la liberté. « Ce n’est pas seulement par la force des choses — écrit-il — que s’accomplira la Révolution sociale. C’est par la force des hommes, par l’énergie des consciences et des volontés… le niveau moral de la société communiste de demain sera marqué par la hauteur morale des consciences individuelles dans la classe militante d’aujourd’hui » (Panorama…, p. 266).
Voici quelques lignes d’un collaborateur de Jaurès, Charles Andler, où celui-ci définit ce qu’il appelle le socialisme pur. « La défense de l’individu — écrit-il — contre l’oppression collective (de la religion, du gouvernement, du capitalisme)… n’est qu’une doctrine négative. Les idées de droit, de justice, d’égalité par lesquelles elle s’exprime, laissent les hommes dans un état d’antagonisme, de raidissement et de sécheresse qui n’est pas un idéal suffisant » (Vocabulaire philosophique de Lalande, mot socialisme).
Comment nier que les travailleurs ne soient dans l’obligation actuelle de lutter afin d’obtenir un salaire suffisant ? Mais, de l’avis de Ch. Andler, les programmes socialistes ne devraient pas se borner à ce genre de revendications matérielles, ils devraient rayonner une amitié communicative, se faire l’écho de rapports humains ouverts au niveau des travailleurs eux-mêmes. « Le vrai socialisme — écrit Andler — croit possible d’atteindre un état de spontanéité, de confiance, de joie, il ne réclame la liberté et l’égalité que pour atteindre à la fraternité ».
C’est toujours la même idée, que la conscience créatrice et fraternelle doit s’exprimer dès maintenant, qu’elle ne doit pas se résigner à attendre un monde meilleur. Par exemple, dès aujourd’hui, le travailleur doit requérir un travail intéressant, qui ne fasse pas de lui un robot, même si ce robot est bien payé et bien nourri : « Le vrai socialisme, écrit à ce propos Ch. Andler dans le même texte, (ne) considère (pas) le travail comme une valeur marchande qu’il faut payer à son juste prix, mais comme la participation volontaire à une œuvre collective, (comme) la transformation humaine des choses… Il conçoit le rapport normal de l’ouvrier et de son travail par analogie avec l’attitude de l’artiste et du savant ».
L’existence d’une conscience créative dans l’homme est ici explicitement reconnue. C’est à une telle conscience, c’est à l’activité saine dans l’homme qu’il faut faire confiance dès aujourd’hui, plutôt qu’à la croyance dans une fin suprême de l’Histoire. Ce point de vue trouve une confirmation inattendue dans un courant nouveau de psychanalyse qui s’est développé aux États-Unis, et dont l’aboutissement remarquable est la Psychanalyse humaniste d’Erich Fromm.
***
Suivant l’école de Psychanalyse dite « culturaliste », le milieu culturel réagit constamment sur la psychologie de l’individu (le milieu culturel, c’est-à-dire les habitudes morales, les institutions politiques, le régime économique). C’est à partir de ce phénomène qu’Erich Fromm a expliqué l’angoisse de l’homme moderne.
Au Moyen-Âge, les croyances religieuses n’étaient pas mises en doute, car la société était solidement structurée. Aujourd’hui, au contraire, l’individu est jeté dans la vie comme un être solitaire qui doit lutter pour son existence dans un monde instable, d’où son anxiété. Mais Fromm ne pense pas que nous devions retrouver la sécurité dans un nouveau système rigide de croyances et de hiérarchies. Il ne s’agit pas de revenir en arrière, mais d’aller en avant. L’individualisation de l’homme était fatale, étant donné le progrès culturel et Raffinement de la raison. Mais la même culture qui a fait de l’homme grégaire un individu, n’est pas encore capable de relier entre eux ces super-individus, par une éducation à la communion ouverte, par un entraînement à la reliance spontanée. C’est pourquoi l’individu, qui n’a jamais été aussi libre qu’aujourd’hui à l’égard de la Cité et à l’égard des Dieux, prend peur devant sa liberté. Cet homme apeuré se réfugie aujourd’hui dans les mystiques multiples et les passions diverses que lui dispense la civilisation moderne : compétition pour le confort, pour la puissance économique ou politique, jeux, loteries, distractions puériles de toute sorte.
On assiste donc à un début de régression : l’individu en voie de libération trouve, dans les anciens cadres sociaux ou dans des formes nouvelles de grégarisme, les moyens les plus sûrs de fuir sa liberté — c’est-à-dire son autonomie d’action et de création. Il en résulte que le pouvoir de création et d’amour de cet homme surindividualisé reste inemployé, d’où une douloureuse instabilité psychologique, dominée par la dépression, l’insatisfaction, l’angoisse.
Selon Freud, l’individu et la société sont ennemis. (Une telle opposition n’est pas sans analogie avec l’esprit du socialisme revendicatif). Au contraire, selon Erich Fromm, qui rejoint ici Proudhon et Bakounine, l’individu et la société ne peuvent exister séparément. Voici quelques lignes significatives tirées de son manifeste Let man prevail (Let Man prevail, a socialist Manifesto and Program – The call association) : « Le but d’une société est de réaliser toutes les conditions nécessaires… au plein développement (des) facultés intellectuelles, affectives et créatrices (de l’homme)… Le socialisme humaniste a la conviction… que tous les hommes sont solidaires. Il flétrit le culte de l’État, de la nation ou de la classe… il est radicalement opposé à la guerre et à la violence… Dans une société socialiste, le but de l’industrialisation n’est pas d’atteindre la plus grande productivité économique possible… (mais) la plus grande productivité humaine, (l’homme devant trouver) dans son travail, dans ses loisirs… un moyen de stimuler toutes ses facultés… Pour le socialisme humaniste, le développement démocratique… touche également la sphère économique… (ce qui entraîne) le contrôle démocratique de toutes les activités économiques par les participants (travailleurs manuels, ingénieurs, etc…) » (Même texte, in trad. française : Études, Bruxelles, n° 6, p. 47 et suiv.).
En tant que théoricien socialiste, Fromm demande que la société favorise le pouvoir créateur de l’homme : « Toutes les formes de l’expression artistique — écrit-il notamment — musique, danse, théâtre, etc., sont d’une suprême importance pour le développement humain de l’homme ».
Fromm a découvert, en effet, que j’énergie de création et d’amour inemployée se convertit en destructivité. N’est-ce pas un fait d’observation courante que les enfants et les nations jeunes encore impuissants à s’affirmer dans les arts ou dans les techniques ont une prédilection pour la violence, la cruauté, les combats ? Développer le sentiment esthétique et l’activité artistique c’est prévenir l’ennui, la haine, le déchaînement des violences.
L’homme moderne, selon Fromm, est au bord d’un choix décisif. Il lui faut se décider, soit à construire « un monde joyeux et créateur », soit à poursuivre sa marche aveugle dans : « un monde voué à l’autodestruction, par la bombe atomique ou par l’ennui et le vide » (id.). De même que Jaurès, Fromm est persuadé que le vide d’une existence sans but, et même le vide de la mort sont comblés, lorsque l’individu est librement créateur et fraternel. C’est alors que l’homme dépasse la terre, qu’il se révèle citoyen de l’infini, parce qu’une conscience supérieure a émergé en lui.
« Quel peut bien être ce principe — écrit Jaurès — qui unit toutes les consciences en exaltant chacune d’elles, sinon la conscience absolue et divine qui est tout ensemble liberté infinie et unité infinie et qui, présente à toutes les consciences particulières, leur communique cette liberté et cette unité ? …Il ne faut pas que la religion puisse apparaître aux hommes comme quelque chose d’extérieur à la vie elle-même, il faut qu’elle soit la vie… prenant conscience dans son intimité de son propre principe » (Jean Jaurès : La Question religieuse et le Socialisme, p. 53. Ed. de Minuit).
Y aurait-il dans le socialisme humaniste le germe d’une religion nouvelle, à tendance panthéiste et cosmologique ? Fromm pense que l’homme a besoin d’une foi, et Jaurès écrit que l’ordre social actuel « empêche l’avènement de la vie religieuse dans l’humanité ».
En réalité, nous touchons ici à un problème que le socialisme humaniste ne peut qu’effleurer, le problème des rapports de l’individu avec l’infini et avec la mort. Ce problème a beau être implicitement résolu dans l’acte de reliance sociale (au cours duquel l’individu dépasse infiniment son ego) — il demande cependant à être considéré en lui-même.
Le plus grand savant, l’artiste le plus génial ne s’interrogent-ils pas constamment sur le problème fondamental de l’existence, bien que ce problème ait trouvé en eux-mêmes sa réponse implicite, du fait de leur activité créatrice ? Qu’est-ce que l’homme ? Qu’est-ce que le Moi ? Pourquoi le monde ? Pourquoi la mort ? Quel est le sens de l’univers visible et de l’être invisible ?
Précisons que dans l’esprit d’un humanisme cosmologique complètement ouvert, ces questions apparaissent vidées de leur sens traditionnel. Par exemple, on ne désire plus atteindre à une Cause transcendante. On cherche plus concrètement à se placer dans le courant où se succèdent les êtres et les choses, de façon que l’esprit vive lucidement les processus du Réel. On voudrait pouvoir prendre conscience de l’enchaînement profond qui unit les choses entre elles et les êtres entre eux, enchaînement qui leur permet de s’équilibrer, de correspondre, et de jouer dans l’harmonie universelle leur rôle d’êtres séparés et multiples.
Cette recherche du sens profond des choses est devenue aujourd’hui assez riche pour qu’on puisse parler de l’avènement d’un humanisme essentiel.
III
LA DIMENSION ESSENTIELLE
L’humanisme intégral à travers Saint Exupéry,
Merleau-Ponty, Husserl , Tagore, Aurobindo ,
Krishnamurti
I. — La découverte de la mesure essentielle de la conscience par la Phénoménologie nous dévoile un mécanisme profond de conscience-existence qui nous rapproche du fonctionnement intime de la Réalité humaine et cosmique.
***
Rappelons-nous d’abord l’allégorie de la tapisserie, imaginée par Louis de Broglie : l’univers visible, notre activité volontaire, nos soucis quotidiens, nos projets, tout cela ne serait que l’envers d’une immense tapisserie, que nous tisserions ensemble, dans le grand atelier du monde. Mais l’endroit du travail, le Réel véritable dans sa magnificence, n’apparaîtrait pas à nos yeux.
Nous avons vu que certaines doctrines ont approché un telle Réalité. Pour le Socialisme humaniste, le sens définitif de l’effort humain serait dans une société humaine harmonieuse et égalitaire, supérieurement adaptée à l’univers pour des temps immenses. L’endroit de la tapisserie apparaît alors dans la vie illimitée d’une société humaine pacifique et juste, à laquelle l’activité de chacun s’intégrerait spontanément.
Au point de vue métaphysique, la connaissance discerne alors, au cœur de l’univers, l’action d’un Esprit fondamental, mais qui ne serait transcendant ni à l’homme ni au monde. Cet Esprit serait le lien même qui rattache l’individu au monde, les individus entre eux, et toutes choses entre elles.
Parlant de cet Esprit fondamental, Jaurès écrit : « Le monde idéal et transcendant n’est pas … distinct de ce qu’on appelle le monde réel … Si la conscience et la vie ne sont point des entités occultes qui viennent s’ajouter à l’univers, il faut qu’elles soient l’univers lui-même » (Jean Jaurès : La Question religieuse et le Socialisme, pp. 51 et 46. Ed. de Minuit).
Toutefois, de telles affirmations restent intuitives ; elles manquent de bases concrètes, insérées dans l’expérience. Or, nous allons voir que, justement, sur ce point, la métaphysique contemporaine se fait de plus en plus précise, et qu’elle tend à devenir, à sa manière, expérimentale.
Notons que Jaurès, dans ses intuitions métaphysiques, retrouve le courant d’une spiritualité ancestrale. Ne va-t-il pas jusqu’à affirmer, lui, un marxiste et un matérialiste, que l’infini est esprit et conscience, unité et amour ? « Il dépend de l’humanité — écrit-il — et de son élan vers la Justice… d’achever dans une sphère déterminée de la nature, le mouvement obscur et incertain des choses dans l’infini, c’est-à-dire dans l’unité et l’amour » (Jean Jaurès : même ouvrage, p. 40).
À cette conscience unitaire, qui anime à la fois l’individu, l’espèce et l’univers, Shrî Aurobindo donne la parole dans un de ses poèmes, Le Moi cosmique, rajeunissant une des plus anciennes intuitions de la métaphysique indienne :
« Je suis l’unique Moi que la nature emplit,
L’immuable témoin au siège d’infini,
Le silence qui plane au-dessus des collines,
Le mouvement spiral des pouvoirs cosmiques.
J’ai brisé les barrières du mental incarné,
Je n’ai plus à garder l’apparence d’une âme ;
Les galaxies de feu se profilent en moi ;
L’univers est mon tout inimaginable » (Aurobindo, Le Moi cosmique, poème traduit dans L’Age nouveau, n° 110).
Mais l’aspect unitaire ne peut caractériser, à lui seul, le conscient-existant fondamental. La conscience cosmique présente également un aspect divisé, sans quoi il n’y aurait ni particules élémentaires, ni monde matériel, ni individus multiples pour percevoir et transformer le milieu matériel. Selon Aurobindo lui-même, le Purusha, en même temps qu’unité infinie, a le caractère, dit-il, d’une « conscience individualisatrice, qui est la cause de toute notre expérience de nous-même et du monde » (Aurobindo, La Vie divine, T. II, p. 556 Ed. Albin Michel).
Il est certain que la métaphysique orientale a beaucoup insisté sur l’aspect unitaire du conscient-fondamental. Aurobindo, par exemple, ne voit dans l’ego personnel qu’une « construction superficielle » (Aurobindo, même ouvrage, p. 777). Cela explique certaines critiques injustes des philosophes occidentaux à l’égard de ce qu’ils appellent, avec un certain mépris, la « mystique orientale ».
« Vous rêvez d’entendre la Note fondamentale ? Faites le silence — écrit le Père Teilhard de Chardin dans un opuscule sur L’Apport spirituel de l’Extrême-Orient. Vous voulez sortir de l’agitation et du plural ? Enfoncez-vous graduellement dans les profondeurs de vous-même, éliminant l’une après l’autre toutes les nuances chatoyantes ou pénibles en lesquelles l’Être se pulvérise pour former l’apparence du monde autour de vous. Essayez et vous constaterez qu’une essence universelle est là, sous-jacente à tout, qui n’attend que votre retour à elle pour vous absorber et vous identifier à soi ! Une sorte de Dieu-substrat, donc, ou encore un « Dieu de détente », atteint par relâchement de l’effort de différenciation où nous engage le phénomène cosmique ; voilà au fond, si j’entends juste, l’objet et l’expression proposés, sous mille formes diverses, par la sagesse hindoue, à notre besoin d’adoration. En fin de compte, pas d’amour vrai dans cette attitude : puisque identification n’est pas union » [4].
Dans la « mystique orientale », Teilhard de Chardin — par manque d’information — ne voit qu’une doctrine de l’extase et de la fusion. En réalité — nous y reviendrons — la métaphysique indienne a eu l’intuition du double caractère, à la fois fusionnant et séparateur du phénomène de conscience de soi. Toutefois, l’aspect séparateur de la fonction universelle de conscience n’avait jamais été dégagé avec autant de netteté qu’aujourd’hui, par la méthode phénoménologique.
Le phénoménologue étudie les phénomènes que sont nos pensées, nos expériences, dans la mesure où elles impliquent la simultanéité d’un penseur et d’un objet de pensée [5]. Pour lui, toute conscience est conscience de quelque chose : du moi, d’autrui, de tel objet, de tel sentiment. Être une conscience, cela suppose en effet la rupture entre un moi-sujet et les objets du monde, aussi bien qu’entre le moi et les autres hommes. Mais la perception d’une pomme n’est pas seulement le sentiment d’être séparé de la pomme, c’est aussi la certitude que je peux l’atteindre, la saisir ; c’est en outre la certitude que son existence est perceptible par les autres hommes. Autrement dit, toute pensée, toute conscience {de quelque chose) impliquent simultanément une relation étroite entre un moi et un objet, entre un moi et les autres hommes :
« Le caractère de « relation », écrit Husserl, …appartient, dans son essence, au phénomène (de conscience) » (Id.).
Quelques lignes de Krishnamurti, qui est un excellent représentant de la pensée indienne contemporaine, montrent bien le chemin parcouru depuis Descartes jusqu’à Husserl : « J’entre en existence, dit-il, (non) parce que je pense que je suis (Descartes disait en effet : je pense, donc je suis) : j’existe parce que je suis en état de relation » (Krishnamurti : La première et la dernière Liberté, Ed. Stock, pp. 110-111).
L’événement philosophique capital de notre époque, c’est la description de ce processus de relation, dans la mesure où il unit un moi-sujet et le monde-objet, et les moi entre eux, dans une immense expérience du monde, à la fois individuelle et universelle, et en constant devenir. Mais la découverte la plus remarquable est celle d’un niveau de conscience plus profond que la conscience banale de soi-même, la conscience transcendantale. Quand nous nous postons à ce niveau profond de conscience, nous pouvons assister à la séparation du Je le plus radical, le plus subjectif. La conscience transcendantale, c’est le niveau de conscience où le Je et le monde instituent leur face à face, à partir d’un organisme vivant situé dans le monde.
Husserl appelle « transcendantale » cette conscience, parce qu’elle introduit la transcendance (la distance) des objets du monde à l’égard du moi-sujet : « Toute transcendance, écrit-il, se constitue uniquement dans la vie de la conscience, comme inséparablement liée à cette vie… (La) conscience du monde …porte en elle-même « ce monde réellement existant » (Husserl : Les Méditations cartésiennes, pp. 52-53. Ed. Vrin).
D’une part, la conscience sépare le moi et le monde. Mais, d’autre part, la conscience de soi se retrouve une et unique dans l’unité du monde, et dans l’identité-à-soi des objets du monde. Imaginons une caverne profonde, emplie de ténèbres. Cependant, par une fissure, pénètre un faisceau de lumière. Le rayon lumineux traverse les ténèbres et va donner l’existence à un rocher au fond de la caverne. Ainsi l’unité de la conscience franchit-elle l’abîme dont les bords sont le Je et le monde, le moi et le toi, et va-t-elle constituer, sur l’écran de la pensée, les objets et les idées que Husserl dénomme unités de sens.
Pour prendre conscience de soi, la conscience se rompt dans la distance originelle du moi et du non-moi ; mais afin de se retrouver elle-même dans son unité, elle reconstitue constamment l’unité rompue dans chacun des objets-identités de la perception et de la culture.
Un coucher de soleil, une paire de ciseaux, l’idée de liberté, voilà de tels objets, et qui perdraient leur identité, si la conscience venait à perdre la sienne, c’est-à-dire à disparaître. La conscience de soi constitue les objets dans leur identité d’objets, mais, en même temps, elle les repeint d’une couleur fraîche, parce que la synthèse du Je et du monde est toujours à refaire, à chaque instant.
Ce courant d’union, dans le champ de la séparation, Husserl l’appelle « synthèse irrationnelle » : « synthèse qui, dans toute conscience, crée l’unité… du sens objectif » (Husserl : Les Méditations cartésiennes, p. 43. Ed. Vrin).
Pensons au progrès de la culture, depuis le premier feu de bois allumé par la main de l’homme, jusqu’à la flamme tonitruante qui propulse nos fusées vers les étoiles. Ce progrès n’a pu se produire que parce qu’une même synthèse de l’homme et du monde a toujours suivi le même chemin. Cette synthèse est l’activité innée de la conscience elle-même, dans le champ de séparation du moi et du non-moi, de l’homme et de la nature. Cette synthèse de l’homme et du monde ressemble à un fleuve sans cesse grossissant, enflé des apports nouveaux des synthèses nouvelles, fleuve qui descendrait au fond d’une vallée profonde, dont les contreforts seraient le moi et le non-moi : le moi et l’autre, l’homme et le monde, dont la dualité réapparaît constamment dans son état originel, grâce à l’action de la conscience transcendantale séparatrice.
Aujourd’hui même, chaque individu, à chaque instant, n’est-il pas le théâtre d’un gonflement incessant des expériences, des idées, qui résultent de la synthèse continue de son moi et du monde ? Ainsi le progrès de notre culture, depuis les origines de l’homme, est-il identique dans l’essence au devenir de tout homme, vécu dans le cours de son existence personnelle.
On s’aperçoit de ce progrès personnel, quand on réentend une symphonie familière après un long oubli, ou bien si on relit un ouvrage très longtemps après la première lecture. La distance, l’oubli, l’éloignement, la séparation, sont féconds dans la mesure où ils préparent un rapprochement, une réunion entièrement nouveaux, imprévus.
Ainsi la séparation toujours neuve du moi et du monde est-elle une source de continuelles découvertes, de synthèses inédites, imprévisibles; elle est le ressort du progrès incessant du moi et de l’espèce.
Cependant, la fusion du moi et du monde dans chaque identité objective — une pomme, un ciel d’été, un visage d’enfant — suppose une autre synthèse : celle de tous les moi, de tous les hommes. Qu’est-ce que Paul qui monte l’escalier ? Qu’est-ce que l’arbre qui gratte mes carreaux ? sinon, en même temps, des êtres universels que chacun peut voir à sa manière, du belvédère de son corps ?
Voici un crayon sur ma table. Son identité d’objet est un aspect fugitif de ma conscience, à travers mon corps. Mais, en même temps, ce crayon a une réalité universelle, parce que la conscience de soi est une, par-dessus les individus multiples. N’ai-je pas la certitude que ce crayon, en tant que pour-moi, est aussi un pour-tous ?
Mais ni le crayon pour-moi, ni le crayon pour-tous, n’est une réalité immobile. C’est un objet constitué incessamment par le courant continu de la conscience de soi dans le champ du moi-au-monde, et du moi-toi.
Je prends une notion exacte de ce courant indéfiniment constitutif de la conscience, si je me mets à décrire le crayon — suivant mon devenir personnel — dans une page au style travaillé qui, peut-être, par sa perfection, traversera les siècles… Dans la mesure où je suis un moi séparé, je ne suis ni le crayon ni les autres hommes, mais voici que jaillit de cette distance la continuité d’un rapprochement sans fin entre moi et l’objet, moi et les autres hommes. — L’unité de la conscience universelle finit toujours par se retrouver dans l’objet identique à soi pour-tous, mais c’est un objet en perpétuel devenir, en état de perpétuelle renaissance, dans le champ de la séparation originelle du moi et du monde.
On est ici aux sources dialectiques de la conscience-existence. On touche au secret de toute vie et de toute existence, matérielle, biologique et spirituelle. Est-ce que tout ce qui existe n’est pas existence séparée — depuis l’atome à l’individu — mais aussi existence réunie, dans un ordre unitaire, universel, au surplus en perpétuel devenir ?
II. — L’Humanisme essentiel n’est pas une idéologie, c’est un humanisme intégral ; c’est une vision de l’homme puisée dans la connaissance du fonctionnement intime du « fond des choses ».
L’Humanisme essentiel apporte à l’individu le dépassement de lui-même dans une activité naturelle et spontanée de reliance avec le monde et avec les autres hommes.
***
De cette philosophie nouvelle, se dégage une curieuse vision de l’homme et du monde, débarrassée de toute étiquette idéologique, et qui dépasse de partout l’homme et le monde. La description des mécanismes du conscient-existant nous dévoile la façon d’exister de tout ce qui peut exister pour une conscience ; il en résulte une vision de l’homme tirée de la connaissance du fond des choses, et qui ne peut se développer que dans un humanisme essentiel. Merleau-Ponty dit justement que la description phénoménologique fait apparaître : « le système « moi-autrui-les-choses » à l’état naissant » (Merleau-Ponty : Phénoménologie de la Perception, p. 69 Ed. Gallimard).
Cet humanisme essentiel nous dévoile une dimension de la vie que nous ignorons habituellement : la relation profonde, le rapport essentiel (eidétique) de l’individu au monde. Ce point de vue nous permet de dépasser la vision des choses dans laquelle la vie courante nous enferme habituellement : nous nous découvrons alors une existence qui outrepasse les horizons les plus lointains.
Nous aurions pu naître ailleurs, de parents différents, sur une planète étrangère, naître il y a 3.000 ans, ou dans 100.000 ans, quelque chose de nous-mêmes est indifférent à ces contingences spatiales et temporelles, c’est notre rapport essentiel au monde, c’est notre conscient-existant fondamental — dont la dialectique a-spatiale et a-temporelle a cependant besoin de prendre conscience de soi à travers une action quotidienne.
Jaurès confiait un jour à ses amis : « Il me semble que je vis au milieu de camarades éternels » (Jean-Jaurès : La Question religieuse et le Socialisme, p. 24). Cela ne voulait pas dire que Jaurès croyait à l’éternité physique des individus, mais qu’il croyait à la valeur intemporelle de la camaraderie, quand elle est ouverte et profonde, jaillie comme l’expression même du conscient-fondamental.
Nous sommes loin ici de l’Absolu fustigé par Teilhard de Chardin, parce qu’il absorberait finalement le Moi individuel ; nous faisons au contraire l’expérience d’une conscience profonde radicalement séparatrice, dont le destin est de s’accomplir par et à travers les individus : « Jointure et membrure de l’Être qui s’accomplit à travers l’homme », écrit Merleau-Ponty (Merleau-Ponty : Signes, p. 228 Gallimard).
La description des processus de la pensée et de la perception par la moderne phénoménologie rejoint et confirme l’intuition des métaphysiques ancestrales de l’Orient [6]. — Il existerait une dialectique de la séparation-union, dont l’essence serait intemporelle (comme celle du Mental cosmique dans le Bouddhisme Zen), mais cette essence dialectique serait vécue plus ou moins par nous, à chaque instant. Cette dialectique serait identique au rapport essentiel de l’individu avec le monde. Elle serait le jeu même du réel. Son fonctionnement engendrerait l’espace et le temps, avec son défilé sans fin d’individus et d’univers.
Tagore a rajeuni la vieille métaphysique indienne par des images fraîches et personnelles. Il écrit que notre vie, « telle un fleuve bat contre ses rives… mais se rend compte à chaque instant qu’elle a une issue sans fin du côté de la mer » (Tagore : Sadhana, p. 79 Albin Michel).
Cette image donne bien l’idée des deux aspects complémentaires de la conscience de soi : un aspect individuel et séparé, et un aspect universel, cosmique, infini. Ce n’est donc pas l’homme réel, l’homme complet, que nous saisissons dans l’individu solitaire.
Cependant, le Moi universel que nous portons en chacun de nous n’est pas davantage un être complet. L’homme intégral est l’individu simultanément séparé du monde par la conscience de soi, et relié au monde dans la perception, dans la création, ou dans Pacte d’aimer — actes par lesquels le soi-conscience fondamental retrouve son identité à soi. Quant au conscient-existant complet, c’est l’être simultanément identique à soi dans l’intemporel, et séparé de soi (donc conscient de soi) dans l’individu.
*
* *
Les descriptions de la méthode phénoménologique nous permettent de rectifier certaines affirmations de la métaphysique indienne contemporaine. Par exemple, celle-ci d’Aurobindo, relative au Moi universel : « L’unité est son être, écrit-il dans La Vie divine… mais la différenciation cosmique et l’individualité multiple sont le pouvoir de son être ; il les déploie constamment, c’est son délice et la nature de sa conscience de les déployer » (La Vie divine, ouv. cité, p. 557).
Cette forme d’expression est très poétique. Mais elle met en scène abusivement un personnage mystérieux, une sorte de divinité cosmique, qui sollicite notre admiration ou notre « adoration ». Or, la conscience transcendantale n’est pas du tout cela, c’est une subjectivité radicale, dont nous pouvons prendre conscience, parce qu’elle est en nous.
Voici quelques lignes de Merleau-Ponty, qui donnent bien l’idée de cette dimension infinie de la conscience de soi, dimension complémentaire de notre aspect fini, organique et personnel : « La vraie réflexion me donne à moi-même non comme subjectivité oisive et inaccessible, mais comme identique à ma présence au monde et à autrui, telle que je la réalise maintenant : je suis tout ce que je vois, je suis un champ intersubjectif, non pas en dépit de mon corps et de ma situation historique, mais au contraire en étant ce corps et cette situation et tout le reste à travers eux » (Phénoménologie de la Perception, ouv. cité, p. 513).
La dialectique du conscient-existant fondamental ne peut être saisie que dans son ensemble. On peut la résumer sous la forme d’un schème dynamique, dégageant nettement le rapport du sujet et de l’objet, au sein de la conscience transcendantale (p. 132). Ce schème est vécu à chaque fois qu’on réalise la spontanéité dont le Bouddhisme Zen avait eu l’intuition. « L’action naturelle » est l’action la plus convenable pour réaliser quoi que ce soit : atteindre la cible dans le tir à l’arc, résoudre un problème de mathématiques, trouver les mots qu’il faut pour réconforter un ami déprimé.
Dans tous ces cas, la conscience séparatrice ouvre à tout moment la voie d’une synthèse nouvelle du Je et du milieu , elle établit un nouvel équilibre de l’homme et du monde (outil original, nouvelle vérité pratique, amitié renforcée entre des êtres, etc…). La spontanéité créatrice, qui rend possible une adaptation renouvelée du moi au monde, ou une entente mutuelle des hommes entre eux, peut être considérée comme la vraie liberté.
*
* *
On découvre du même coup une liberté qui est amour, puisqu’elle est synthèse vivante du moi et d’autrui. « L’amour, écrit Tagore, se consomme dans l’harmonie… entre deux libertés » (Sadhana, ouv. cité, pp. 76-77).
On retrouve cette même exigence d’égalité entre les êtres, dans l’amour authentique, chez Erich Fromm. L’amour synthétique n’est pas ce combat d’influences et d’exigences qu’on a si souvent décrit ; il est une synthèse créatrice. C’est d’ailleurs là un mode des rapports humains qui est loin de se borner aux relations sexuelles : « Le professeur, écrit Fromm, (lorsqu’il pratique non pas l’autorité, mais l’amitié) est à son tour instruit par ses élèves, l’acteur est stimulé par son auditoire, le psychanalyste est guéri par son malade » (Cité in Critique, n° 138, p. 979).
N’est-il pas évident que ce type de rapports interpersonnels est extensible à l’infini ? Les individus se différencient continuellement (par la naissance, par l’invention personnelle, par le tempérament et le caractère) ; mais aussi bien, par leur union constructive au monde et leur synthèse mutuelle, ils enrichissent la vie et l’harmonie de l’homme à l’univers (amour procréateur, productivité artistique et professionnelle, tolérance, amitié).
L’instauration des structures complexes de l’adaptation au monde (maisons, moyens de transport, usines, laboratoires, institutions sociales) n’est-elle pas une conséquence de la synthèse multiple des individus entre eux, et de leur action d’ensemble sur le milieu naturel ? Le progrès technique, l’apparition de philosophies nouvelles et de styles nouveaux, tout ce devenir a son ressort dans le surgissement continuel d’individus séparés, venant susciter à chaque instant un renouveau salutaire dans le rapport de l’homme avec le monde.
Quelle extraordinaire leçon d’humanisme que cette connaissance de la vie essentielle de l’homme ; que ce dévoilement des modes profonds de la conscience-existence ! Plus de société parfaite à fonder, « communiste » ou « divine », « libérale » ou « socialiste » ; mais une Cité ouverte s’instaurant d’elle-même, sous la forme d’une synthèse naturelle des libertés. L’humanisme essentiel est une orientation de culture fondée sur la connaissance des lois essentielles du rapport de séparation et d’union qui va du Moi au Non-Moi, et de l’homme à l’univers. La connaissance de cette dialectique infinie rendra possible un exercice de plus en plus efficace du pouvoir créateur de l’homme dans ses rapports avec le monde.
L’humanisme essentiel nous permet d’entrevoir un niveau supérieur de conscience et d’existence, où l’espèce accomplirait spontanément la loi cosmique, la réalisant, bien sûr, à sa manière, dans une synthèse originale de l’homme-univers.
III. —L’Humanisme essentiel est un « Art de vivre » : il délivre l’homme des frontières de la Terre et des frontières du moi, mais il le libère en même temps pour l’activité la plus individuellement créatrice et pour l’action sociale la plus constructive.
***
La séparation des individus s’opère, selon Husserl, sur un fond de permanente communion intersubjective de pensée et d’existence : « Cette union, dit-il, est un « lien qui… est sui generis, une communion effective, celle qui est la condition transcendantale de l’existence d’un monde, d’un monde des hommes et des choses » (Mêd. Cartésiennes, ouvr. cité, p. 109).
Aucune âme individuelle, aucune « monade » ne peut être, pour Husserl, décrite comme un Ego enfermé dans ses propres limites. Toute conscience est représentée par lui comme une vision simultanée de soi et des autres êtres, vision qui s’engage dans un horizon infini (comme dans une salle où tous les murs sont recouverts de glaces…) : « Les hommes, écrit-il dans les Méditations Cartésiennes, ne peuvent être appréhendés que comme trouvant d’autres hommes autour d’eux (en réalité ou en puissance). La nature infinie et illimitée elle-même devient alors une nature qui embrasse une multiplicité illimitée d’hommes (et, plus généralement, d’animalia), distribués on ne sait comment dans l’espace infini, comme sujets d’une intercommunion possible » (Méd. cartésiennes, ouv. cité, p. 111).
Même vision d’une présence intersubjective des êtres chez Saint-Exupéry : « Tu es nœud de relations, écrit-il, et rien d’autre… Tu existes par tes liens… La grandeur d’un métier est peut-être avant tout d’unir des hommes » (Saint-Exupéry par lui-même, pp. 91-94. Ed. du Seuil).
Saint-Exupéry veut parler ici d’une amitié ouverte, toute vibrante du lien intersubjectif essentiel. Toute amitié fondée sur l’intérêt, ou sur la foi jalouse dans un Absolu commun, est une amitié aliénée : « Absurde, écrit-il, la notion de classe… (d’exploiteur)… Il n’est que des hommes » (Saint-Exupéry par lui-même, pp. 147. Ed. du Seuil).
L’amitié véritable est une émanation du rapport intersubjectif essentiel, qui n’est autre que le conscient-existant lui-même ; c’est l’amitié pure, dont l’élan unit et harmonise spontanément les êtres dans le champ de la séparation transcendantale.
***
Nul doute que le mystère dialectique des rapports entre l’individu et le monde ne soit tout entier contenu dans les rapports du Moi avec l’Autre, d’où l’importance de l’éducation. Le schème dynamique de la séparation-synthèse (p. 132) montre que la synthèse des sujets a sa condition dans la complète individualisation du Moi, dans sa complète séparation. C’est pourquoi l’éducation doit tendre à faire du jeune enfant un individu libre des tabous autoritaires et des commandements irrationnels. — L’individu qui obéit de gré ou de force à des ordres, à des modèles, disparaît en tant que Je, et il devient incapable de la synthèse d’amitié. « Tu ne tueras
point », ordonne le Dieu des Chrétiens. Mais ce commandement lui-même a été enfreint par Dieu, qui a rendu les hommes mortels, pour les punir de la désobéissance d’Adam. Et cette faute résultait elle-même de la non-obéissance à un commandement autoritaire : ne pas manger le fruit de tel arbre. De ce commandement autoritaire a résulté tout le malheur des hommes, parce que l’éducation à l’amour faisait défaut au départ. En réalité, ce sont des hommes sans amour qui ont imaginé un Dieu autoritaire, fait à leur image.
L’enfant doit être éduqué à l’amour, c’est-à-dire à la synthèse intersubjective. Jean-Jacques Rousseau avait raison de vouloir remplacer l’obéissance de l’enfant aux ordres donnés par une expérience créatrice de l’enfant, mis en rapport avec le monde.
L’éducation libérale n’enseigne pas une liberté absolue, qui enfermerait l’enfant dans ses caprices, elle met son Je en rapport avec le monde réel, et les autres réels ; alors s’opère une naturelle synthèse du jeune individu avec le monde et avec ceux qui l’entourent ; il pratiquera désormais spontanément, toute sa vie, la coopération, le dialogue, l’entraide.
***
C’est la vigueur de sa séparation et de sa liberté qui fait de l’individu une source constante de création pratique, un être capable de ranimer à chaque instant la flamme de l’amitié et de l’invention. Comment de nouvelles créations, de nouvelles synthèses de l’homme et de la nature (machines, découvertes, remèdes, œuvres d’art, amitiés ou familles nouvelles, etc…), pourraient-elles apparaître, sans une séparation toujours neuve, toujours fraîche de l’individu et du monde ? Qui saurait dire quels seront les mœurs sexuelles dans 1.000 ans, la nature des styles en peinture et en architecture, la direction prise par les grandes hypothèses scientifiques ?
Or, ce grand mystère du devenir créateur humain a son origine dans la double séparation du Moi et du Toi, de l’homme et de l’univers. — C’est une telle dichotomie naturelle que vient combler toute nouvelle vérité, chaque dévouement de l’amitié, chaque fusion de l’amour, chaque minute de travail humain.
La séparation renaît continuellement à chaque instant du moi, et avec tout nouvel individu, de sorte que l’art et la science, l’amour et le travail, sont lancés dans un progrès sans fin. Ce progrès a lieu dans le champ d’une séparation toujours neuve du Moi et du monde, ce dernier s’enrichissant au surplus, à tout moment, de tout le passé individuel et collectif, de tout l’héritage de la mémoire, des techniques et de la culture.
Les penseurs de L’humanisme essentiel font fréquemment allusion au phénomène capital du surgissement de l’individu originel. Erich Fromm voit une condition fondamentale de l’amour authentique dans le respect de l’immense séparation, dans le respect du caractère inassimilable de l’Autre.
Tagore a développé, dans un de ses poèmes, l’aspect inverse du même sentiment : le moi le plus aimant reste insondable, inassimilable à l’autre : « J’ai mis à nu devant toi ma vie entière… C’est pourquoi tu ne me connais pas. Si ma vie était une simple pierre colorée, je pourrais la briser en cent morceaux et t’en faire un collier que tu porterais autour du cou… Mais ma vie n’est qu’amour, bien-aimée… Mon cœur est près de toi comme ta vie même, mais jamais tu ne pourras le connaître tout entier » (Tagore, Anthologie, p. 108, Seghers).
Écoutons maintenant la même chose, dite dans le style froid du phénoménologue : « (L’expérience du monde) — écrit Husserl — a toujours ses horizons ouverts et indéterminés. Dans ces horizons, chaque homme est pour chaque autre un être physique, psychophysique et psychique formant un monde ouvert et infini où l’on peut accéder, mais où …on ne pénètre pas » (Méd. Cart., p. 111).
Lorsque l’Autre nous parle, nous le comprenons par une véritable fusion avec lui (il se produit une synthèse des Je), et pourtant le langage personnel de l’Autre défie toute compréhension absolue, définitive. Il en résulte que plus les paroles de l’Autre sont libres, c’est-à-dire autonomes et créatrices, plus elles nous défient et nous séduisent par leur tonalité mystérieuse profonde. — Voici cette qualité spéciale de la parole évoquée par Saint-Exupéry : « Si… le langage par lequel tu me communiques tes raisons d’agir est autre chose que le poème qui doit me charrier de toi une note profonde, s’il ne couvre rien d’informulable… alors je te refuse » (Saint Exupéry… ouvr. cité, p. 170).
Quelque chose ne peut pas être atteint ou décrit dans l’Autre, c’est la source de sa pensée. Cette source jaillit, en effet, au point exact de la rupture du moi et du toi, dans le champ de la conscience transcendantale. Mais la séparation des sujets de pensée appelle, normalement, leur fusion, dans des aspects nouveaux du langage, de l’entraide, de l’amour.
Rappelons-nous encore une fois l’allégorie de la tapisserie… Elle ne fait allusion qu’à l’aspect objectif de l’effort humain. Mais cet effort a aussi un aspect subjectif et essentiel, qui lui donne son sens dynamique.
Le sens dynamique de notre vie nous apparaît dans l’accomplissement d’une sorte de geste essentiel, par lequel l’individu, simultanément, se sépare du monde et s’unit au monde, se sépare de l’autre et s’unit à lui, contribuant, par ce geste même, au devenir de l’ordre immense de l’homme-univers dans le champ de l’ego transcendantal. La pente naturelle de ce geste fondamental, simultanément, réalise l’adaptation vivante de l’homme à l’univers, et accomplit la démarche profonde du conscient-existant.
***
Le moi que nous sommes, l’instant que nous vivons, ont une existence unique et éphémère, distincte de l’éternité, et cependant ils sont l’éternité elle-même, illimitée et indivisible. La vie créative, pleinement vivante, révèle l’unité mystérieuse de l’individuel et de l’universel, de l’éphémère et de l’éternel.
Est-ce que ces formules dévoileraient le secret des choses ? Permettraient-elles à l’esprit de se saisir dans un énoncé définitif, où son énigme serait dissoute ? Cela n’est pas possible. Le sens ultime de la vie ne peut être dévoilé entièrement par le simple énoncé intellectuel des processus du conscient-existant. La signification de la vie apparaît également dans l’émergence d’une certaine qualité essentielle du vivre, aidée seulement par la connaissance. La valeur irremplaçable de l’humanisme essentiel est éducative. Il enseigne à l’individu comment s’harmoniser à la qualité essentielle de l’Être-existence. Il n’en reste pas moins que cette qualité est à réaliser par chacun, à travers son propre effort, suivant son style personnel.
Que dire, dès lors, d’une civilisation tout entière avidement tournée vers la réussite d’objectifs matériels extraordinaires (pouvoirs de destruction inimaginables, voyages interplanétaires, confort raffiné), sinon qu’elle se détourne de L’humanisme fondamental ? Celui-ci enseigne une certaine qualité du vivre, qui exclut l’avidité et la recherche vaine, jamais satisfaite, de l’abondance matérielle. La poursuite de l’avoir et du pouvoir épuise les corps et détourne l’esprit de l’aventure créatrice.
Est-il un voyage plus fantastique que l’acte de franchir l’abîme qui sépare le moi et le toi par le langage ou l’entraide ? Ce voyage nous porte au-delà de toutes les distances que tous les cosmonautes pourront jamais franchir.
« Il y a, écrit Emmanuel Mounier, plein d’hommes qui font les mêmes gestes dans les mêmes lieux, mais qui portent en eux… des univers plus distants que les constellations… » (Emmanuel Mounier, Le Personnalisme, p. 22. Coll. Que sais-je ?).
Nous ne cherchons pas ici à déprécier la recherche technique. Nous condamnons seulement l’esprit d’avidité, la poursuite de réussites matérielles qui exigent le travail de millions d’esclaves et de milliers de techniciens robotisés — au nom de la prospérité et de la force de l’État. Serait-ce même en invoquant la gloire de l’homme, qu’on n’aurait pas le droit d’asservir ainsi les individus aux entreprises de la pure puissance matérielle.
Il semble d’ailleurs que la plus grande réussite matérielle de l’espèce ne s’accomplira qu’une fois réalisée la société la plus saine et la plus libre. Alors les initiatives et les compétences s’ordonnent spontanément avec le maximum d’efficacité. Mais ce n’est plus suivant le temps du désir que cette efficacité de l’effort humain trace désormais sa route, c’est dans le champ de la dichotomie du moi et du monde, où se recrée indéfiniment la totalité toujours nouvelle de l’homme-univers.
***
L’homme enfin ouvert à sa dimension essentielle découvre qu’il existe hors du temps. Mais ce n’est pas là une position en marge du réel, résultant d’une nostalgie de l’éternel ; c’est l’état spontané d’un être de conscience qui sent jaillir en lui la source du temps. II s’agit d’une position hors du temps, qui propulse le temps.
« O temps, suspends ton vol ! et vous, heures propices,
Suspendez votre cours !
Laissez-nous savourer les rapides délices
Des plus beaux de nos jours !
… … …
Mais je demande en vain quelques moments encore,
Le temps m’échappe et fuit ;
Je dis à cette nuit : « Sois plus lente » ; et l’aurore
Va dissiper la nuit ».
Ces vers de Lamartine expriment la requête d’un amour romantique, d’un amour-désir, qui voudrait occuper le plus de durée possible. Mais tout à l’inverse, l’amour-plénitude a justement sa source hors du temps, puisqu’il est le rapport essentiel et intemporel de séparation-union, vécu par deux êtres. Un tel amour se sent le ressort du temps réel, qui conduit à la mort ; il n’est donc pas la victime d’un courant plus puissant que lui. La mort elle-même fait partie de son devenir terrestre, mais elle ne concerne pas son processus profond, qui est, par nature, intemporel.
Un tel amour ne suppose, dès lors, ni tristesse ni nostalgie ; il consiste dans une union vivante et continue, capable de franchir les plus vastes abîmes.
Marcel Proust ne réclamait pas un arrêt du temps qui vienne prolonger son émotion délicieuse, quand le goût de sa madeleine imbibée de thé lui fit revivre, soudain, un souvenir oublié. Il entrevoyait, au contraire, que son émotion émanait d’un Moi intemporel : « Qu’un bruit, qu’une odeur, déjà entendu ou respirée jadis, le soient de nouveau, à la fois dans le présent et dans le passé, réels sans être actuels, idéaux sans être abstraits, aussitôt l’essence permanente et habituellement cachée des choses se trouve libérée et notre vrai moi, qui parfois depuis longtemps semblait mort, mais ne l’était pas… s’éveille, s’anime en recevant la céleste nourriture qui lui est apportée… Une minute affranchie de l’ordre du temps a recréé en nous pour la sentir l’homme affranchi de l’ordre du temps » (Marcel Proust : Le Temps retrouvé, T. II).
Cette liberté de l’homme « affranchi de l’ordre du temps » n’est pas une extase, ni une plongée dans l’éternel. C’est une émergence, dans l’individu, de l’acte fondamental d’exister, dans une action qui atteint, dès lors, au maximum d’efficacité pour toute espèce de réalisation — par exemple, ici, la soudaine recréation d’un souvenir. Mais cette liberté intemporelle est aussi bien capable de s’insérer dans le courant de la vie familiale ou professionnelle, dans le temps du devenir culturel ou politique.
En effet, comment, si je suis parvenu à vivre moi-même le geste essentiel de la reliance au monde, dans une action spontanément créative, comment pourrais-je ne pas agir pour aider et libérer autour de moi les autres hommes, qu’ils soient prisonniers de chaînes économiques ou de croyances irrationnelles, qu’ils soient asservis politiquement ou spirituellement ?
L’humanisme essentiel est éducation de l’homme à sa profondeur a-spatiale et a-temporelle ; mais il est aussi libération de sa force constructive, dans l’instant le plus actuel, parmi les êtres réels qui l’entourent, dans le milieu matériel et historique où il vit. L’humanisme essentiel est un humanisme du réel, un humanisme intégral.
* * *
« C’est en vivant mon temps, écrit Merleau-Ponty, que je peux comprendre les autres temps… C’est en m’enfonçant dans le présent… en assumant résolument ce que je suis par hasard… que je peux aller au-delà… »
Vivre de la vie essentielle n’est pas possible, pour Merleau-Ponty, si je n’assume pas à fond ma condition concrète (par exemple, instituteur mal payé et mal considéré ; ou travailleur manuel prisonnier — provisoirement — de sa pauvreté, etc…). Du sein de toute condition sociale pleinement vécue, on peut toujours, en effet, retrouver le chemin de l’amitié pure.
« Ferai-je cette promesse ? écrit encore Merleau-Ponty ; risquerai-je ma vie pour si peu ? Donnerai-je ma liberté pour sauver la liberté ? Il n’y a pas de réponse théorique à ces questions. Mais il y a ces choses qui se présentent, irrécusables, il y a cette personne aimée devant toi, il y a ces hommes qui existent esclaves autour de toi et ta liberté ne peut se vouloir sans sortir de sa singularité et sans vouloir la liberté.
Qu’il s’agisse des choses ou des situations historiques, la philosophie n’a pas d’autre fonction que de nous réapprendre à les voir bien, et il est vrai de dire qu’elle se réalise en se détruisant comme philosophie séparée » (Phén. de la Perception, ouv. cité, p. 520).
Il en est de même pour les Humanismes contemporains, Christianisme, Marxisme, Évolutionnisme, Humanisme scientifique, Existentialisme, etc… ; ils ne se réaliseront qu’en se détruisant en tant qu’humanismes séparés. Les Humanismes d’aujourd’hui se raccrochent tous à une idéologie, à un système du monde, à une vision de l’homme conditionnés par une finalité idéologique : réaliser la société divine, ou communiste, préparer le triomphe de tel Dieu, faire prévaloir telle faculté humaine, par exemple, la raison, l’intuition ou l’imagination. Or, toutes ces fins sont exclusives et limitatives, c’est pourquoi elles sont séparatrices de divers types d’humanité opposés entre eux dans des conflits insolubles. — Mais supposons qu’on affirme au contraire : l’homme est la Réalité elle-même ; il ne s’accomplira donc pas dans quelque situation extérieure à lui ; il ne saurait s’épanouir que dans l’expérience complète des possibilités créatrices qui sont en lui, avec la pensée-conscience.
Ce message est celui d’un humanisme qui rassemble tous les hommes dans une seule action, progressive, unitaire et harmonieuse. Cette vision de l’homme n’est limitée par aucune finalité, elle est un humanisme intégral. Il n’existe plus aucun but extérieur au rapport essentiel qui rattache, originellement, l’homme à l’univers et les hommes entre eux. Vivre ce rapport originel est la liberté, la spontanéité créatrice, où s’exprime enfin sans entraves le conscient-existant fondamental.
Une telle vision du monde est profondément révélatrice du sens de la vie humaine : attachés à nos tâches quotidiennes, nous sommes libres cependant par notre pouvoir même de les accomplir, un pouvoir qui est, fondamentalement, a-spatial et a-temporel, c’est-à-dire sans limites. Ce pouvoir d’agir et d’être, il baigne les mondes, et il englobe tous les êtres ; il est le sujet transcendantal de conscience, absolument unique et essentiellement multiple.
L’immense tapisserie imaginée par Louis de Broglie n’est plus, pour nous, « invisible » parce que nous ne pourrions pas la voir, elle reste « invisible », parce que le mode de vision qui nous la découvre n’a aucun rapport avec nos sens ou notre imagination ; le mode de vision qui nous découvre le vrai sens de nos vies, c’est une super-conscience de nous-mêmes.
L’immense tapisserie que nous édifions ensemble, l’ouvrage objectif éternellement remis en chantier, et pourtant achevé depuis l’éternité, c’est l’univers infini inaccessible à nos sens en lequel s’incarne la Force-conscience fondamentale, perpétuellement en activité à travers ses formes innombrables, dans le champ a-spatiotemporel de la dichotomie du moi et du toi. L’immense tapisserie, c’est l’univers mouvant, ce sont les fruits insaisissables du conscient existant en perpétuelle activité à travers un constant état d’être.
Chacune de nos vies est cet acte séparant-fusionnant, simultanément individuel et cosmique, et chacune de nos vies travaille donc à l’œuvre immense constituée par cet acte, œuvre à laquelle chacun ajoute quelque chose, du seul fait qu’il existe, en tant que conscience-de-soi séparée à chaque instant refusionnée dans l’unique et universel soi-conscience-identique-à-soi.
Il semble donc que le destin normal des Humanismes contemporains serait une évolution spontanée — par des voies différentes — vers une prise de conscience supérieure de la part de l’homme, celui-ci voyant enfin en lui délivré le pouvoir essentiel de conscience et d’existence qui est, éternellement, au fond de la Nature.
(Nov. 1963 – Mai 1965)
André NIEL Né en 1913. Professeur à Paris. Premiers essais littéraires vers 1936. Puis activités dans la Résistance avec Mathilde Niel.
Après la libération se consacre à la recherche des conditions de la santé psychologique et affective. A fait paraitre en 1953 un ouvrage sur Krishnamurti, traduit et publié à Bombay en 1957.
Publie alternativement des poèmes, des aphorismes, des études dans de nombreuses revues françaises et étrangères : étrangères : La Table Ronde, Critique, Preuves, L’Age Nouveau, Synthèses, etc.
Il a fondé avec Mathilde Niel un groupe de chercheurs, d’écrivains, de psychiatres, de pédagogues, l’institut de l’homme de Paris, dont l’objectif principal est « la libération des facultés sociales et créatrices de l’individu » (Jean Rostand, Erich Fromm et Maurice Lambilliotte font partie du comité international)
[1] Nous avons employé le terme d’humanisme cosmologique pour la première fois dans une étude publiée dans la revue Critique : Vers un Humanisme cosmologique ; mars 1956, 0° 106.
[2] Maurice Gex : Vers un Humanisme cosmologique : La synthèse de Teilhard de Chardin, in Revue de Théologie et de Philosophie, 1957, III, Lausanne.
[3] À consulter : Teilhard de Chardin : Le Phénomène humain (Ed. du Seuil).
A. Niel : Teilhard de Chardin et la Crise contemporaine, revue Preuves, janv. 1957 ;
La Bio-Métaphysique du P. Teilhard de Chardin, revue Critique, août 1955 ;
L’Évolution, n° spécial de L’Age nouveau, T. I, mars 1959, T. II, sept. 1959.
[4] À consulter :
A. Niel : Les vues cosmologiques du P. Teilhard de Chardin et la Métaphysique indienne, in France Inde, fév. 1956.
Jacques Masui : sur Teilhard de Chardin et la Métaphysique indienne, revue Synthèses, n° 108 109.
[5] À consulter : Husserl : Qu’est-ce que la Phénoménologie ? In La Philosophie contemporaine, p. 344 (Ed. Fischbacher).
[6] À consulter : A. Niel et H. Chandravarty : Husserl et la Recherche occidentale du Soi, in L’Age nouveau, n° 110.