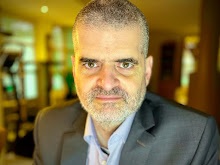6 décembre 2024
Au cours des derniers jours, de nombreuses personnes ont commenté sur mon blog et dans les médias sociaux les critiques de l’idéalisme analytique formulées par le Dr Rupert Sheldrake dans le podcast et la chaîne YouTube Theories of Everything. Avant aujourd’hui, je n’avais pas vu la vidéo et j’avais donc largement rejeté la plupart de ces commentaires comme étant probablement exagérés, car je connais Rupert depuis des années et je sais qu’il est un penseur prudent et nuancé et un gentleman impeccable. Aujourd’hui, cependant, après avoir reçu un autre commentaire, j’ai regardé la séquence en question, que je mets en lien ci-dessous (voir à 8:14 min).
J’avoue avoir été déconcerté par cette vidéo. Je vais essayer de répondre aux critiques de Rupert aussi objectivement que possible, mais il est probable que je n’y parvienne pas entièrement. En effet, j’ai lu, respecté et admiré le travail de Rupert pendant des années avant même de commencer à publier le mien. Son attaque est un coup de théâtre tout à fait inattendu de la part de quelqu’un qui est très proche de mon cœur philosophique (et même personnel), et elle suscite donc des émotions qu’il vaut mieux laisser de côté dans un discours analytique.
Voici mes réponses, dans l’ordre chronologique où les critiques de Rupert sont présentées dans la vidéo ci-dessus.
POUR LA SCIENCE, RIEN DE NOUVEAU
Rupert semble considérer comme une faiblesse de l’idéalisme analytique le fait qu’il ne contredise pas la science. Pour ma part, je considère qu’il s’agit moins d’une vertu que d’une condition préalable à toute métaphysique défendable. En effet, la science a fonctionné de manière phénoménale en tentant de modéliser et de prédire le comportement de la nature au cours des quatre derniers siècles. Toute métaphysique impliquant que la science ne devrait pas fonctionner est donc tout simplement erronée, pour des raisons empiriques écrasantes. La science ne remplace certainement pas une métaphysique lucide, comme certains scientifiques l’ont naïvement soutenu, mais en tant que méthode de modélisation et de prédiction, elle fonctionne manifestement. Et Rupert, en tant que scientifique, le sait certainement.
Je n’ai jamais été anti-science, bien au contraire. À mon grand regret, je réalise de plus en plus qu’une minorité significative de mes lecteurs me considère, pour une raison ou une autre, comme étant engagé dans une sorte de croisade anti-science. J’ai même récemment exprimé ma perplexité à ce sujet, car je ne comprends pas d’où vient cette impression largement erronée. Elle n’a jamais été correcte. Quiconque prête attention à mon travail aura certainement remarqué que j’appuie la plupart de mes propos sur des résultats scientifiques, et ce depuis le début.
Peut-être Rupert veut-il dire que l’idéalisme analytique n’ouvre pas suffisamment de nouvelles perspectives ou voies d’investigation pour la science. Mais si c’est le cas, il se trompe. Au fil des ans, j’ai inlassablement mis l’accent sur ces nouvelles voies d’investigation scientifique ; si souvent, en fait, que je ne sais même pas où commencer à citer mes écrits.
D’une manière générale, étant donné que, dans le cadre de l’idéalisme analytique, notre esprit est simplement dissocié de l’espace cognitif qui constitue le reste de la nature, il est tout à fait concevable que des facteurs qui affaiblissent la dissociation puissent entraîner des phénomènes tels que des formes de télépathie et de clairvoyance. Je n’ai jamais approfondi cette question, simplement parce que je ne suis pas un expert en parapsychologie et que je n’ai pas le bagage nécessaire pour dire quelque chose d’important à ce sujet. Je ne suis pas non plus très intéressé par les phénomènes extraordinaires, car je trouve le quotidien suffisamment mystérieux et déroutant. Je dis cela sans préjugé ni jugement ; c’est simplement ce que je ressens. Quoi qu’il en soit, si Rupert veut dire que l’idéalisme analytique n’ouvre pas les portes à de nouvelles voies d’investigation en science, telles que celles explorées dans son propre travail, alors c’est faux.
Rupert souligne que l’idéalisme analytique reste naturaliste et réductionniste. C’est tout à fait exact. Je pense que le monde se déploie spontanément, selon ses propres dispositions inhérentes (c’est-à-dire les régularités observées que nous appelons les « lois de la nature »), et sans intervention surnaturelle d’un agent extérieur au-delà des limites de la nature elle-même. Je promeus une ontologie analytique, pas une religion. Et je pense que le réductionnisme, s’il est interprété correctement (à savoir que les choses complexes peuvent être expliquées en termes de choses plus simples, par opposition à la vision vulgaire du réductionnisme selon laquelle les grandes choses doivent être réductibles à de petites choses), est plus que probablement vrai ; ou devrait à tout le moins être la voie préférée sur le plan opérationnel pour modéliser la nature, puisqu’il a bien fonctionné pendant quelques siècles maintenant. Le seul point de vue que mon naturalisme et mon réductionnisme contredisent est une forme de théisme abrahamique, interprété littéralement. Mais si les critiques de Rupert sont motivées par ses vues théistes, je pense qu’elles sont inappropriées dans le contexte de la science et de la philosophie ; en d’autres termes, ses critiques ne comptent pas. Ce qu’il considère comme un handicap, je le vois comme une force.
L’IDÉALISME ANALYTIQUE N’EST QU’UNE FORME DE PHYSICALISME
Avant aujourd’hui, je n’aurais jamais pu imaginer qu’un malentendu aussi superficiel puisse provenir d’un penseur et d’un communicateur aussi nuancé et prudent que Rupert. C’est une représentation erronée de l’idéalisme analytique, une caricature vulgaire, véhiculée sur un ton confusément enthousiaste, autoritaire et définitif. J’aurais attendu de lui, à tout le moins, qu’il préambule cette malheureuse erreur de caractérisation avec des mots comme « pour autant que je le comprenne », ou « pour autant que je le sache après l’avoir brièvement examiné », ou quelque chose dans ce sens. Cela aurait été un strict minimum, par souci de transparence, de prudence et d’honnêteté. Mais il s’est présenté, tant par son ton que par son comportement, comme un expert connaissant parfaitement la chose qu’il déformait librement.
La seule équivalence métaphysique entre l’idéalisme analytique et le physicalisme classique est que tous deux reconnaissent l’existence d’un monde extérieur au-delà de notre esprit individuel. Mais cela est certainement difficile à contester, à moins d’une forme de solipsisme. Même la physique émergente de la perspective à la première personne (voir la vidéo ci-dessous, par exemple) reconnaît indirectement un terrain ontologique commun aux différents observateurs, où ces observateurs se perçoivent mutuellement, même si ce terrain commun n’est pas strictement physique. Dans le cadre de l’idéalisme analytique, ce terrain est mental, ce que nous appelons « physicalité » étant simplement la manière dont nous représentons cognitivement ce terrain ontologique commun lors des observations. En d’autres termes, la physicalité est une représentation du tableau de bord, lors de la mesure, du monde réel et mental qui est mesuré. Mais ce monde mental mesuré est vraiment réel ; il existe indépendamment de l’observation. Après tout, il y a bien quelque chose qui est mesuré. Pourquoi Rupert s’attendrait-il à autre chose ? Comment pourrait-il défendre une autre chose d’une manière analytique ou empirique viable ?
Au-delà de cela, l’Idéalisme analytique est entièrement distinct du Physicalisme dominant, à un degré si vaste et si évident qu’il semble inutile de l’expliquer davantage à quiconque s’est déjà modestement familiarisé avec mes écrits. Pourtant, je reconnais que penser que l’idéalisme analytique est en quelque sorte l’équivalent du physicalisme est une idée fausse courante parmi les « experts des médias sociaux » superficiels et négligents. Mais je sais que Rupert n’est pas de ceux-là. Quoi qu’il en soit, j’ai répondu à cette idée fausse en de nombreux endroits, notamment dans mon nouveau livre, Analytic Idealism in a Nutshell (L’idéalisme analytique en quelques mots). Je cite le passage pertinent ci-dessous :
« Eh bien, Bernardo, si toutes les sciences sont encore valables dans le cadre de l’idéalisme analytique et qu’il existe toujours un monde indépendant de nous, alors l’idéalisme analytique est en fait un physicalisme sous une autre étiquette ; cela revient au même ».
Ce point de vue étonnamment myope est étonnamment répandu. Si vous vous y êtes identifié, ne vous blâmez pas trop sévèrement. La raison pour laquelle cette perspective est myope est qu’elle ignore totalement les différences colossales entre les implications de l’idéalisme analytique et celles du physicalisme classique. Mais notre culture récompense les jugements rapides et, par conséquent, décourage la profondeur de réflexion nécessaire pour explorer les implications des nouvelles idées.
Dans le cadre de l’idéalisme analytique, votre vie, votre métabolisme, ne sont pas la cause ou le générateur de votre conscience, mais simplement ce à quoi votre réflexion (mentation) privée ressemble de l’extérieur, c’est-à-dire de l’autre côté de la frontière dissociative. La vie est ce à quoi ressemble la dissociation. Par conséquent, la fin de la vie est la fin de la dissociation, et non la fin de la conscience.
La fin d’un processus dissociatif n’est pas non plus la fin des états mentaux contenus dans la limite dissociative ; c’est simplement la fin de la limite dissociative. Cela signifie que les états mentaux précédemment détenus par l’alter — les souvenirs et les connaissances de toute une vie — sont relâchés dans le contexte cognitif plus large de la nature dans son ensemble au moment de la mort. Nos souvenirs et nos connaissances durement acquis — souvent au prix de nombreuses souffrances — ne sont pas perdus à la mort, mais, au contraire, deviennent accessibles à la nature dans son ensemble. Cette situation contraste avec le point de vue physicaliste : lorsque vous mourez, tous vos souvenirs et vos connaissances sont perdus à jamais, et toute cette souffrance n’a servi à rien. Il est clair que ces deux scénarios ne sont pas du tout similaires et que leurs différences sont d’une grande importance pour nos valeurs, nos choix de vie et notre expérience de la vie en général.
En outre, bien que l’idéalisme analytique préserve — voire renforce — la justification des médicaments et de la chirurgie en médecine, il ouvre une voie supplémentaire pour le traitement des affections organiques : la thérapie par la parole et les pratiques connexes. En effet, selon l’idéalisme analytique, le corps n’est pas un simple mécanisme distinct de l’esprit, mais l’apparence extrinsèque des processus mentaux. Par conséquent, toute affection organique est, à la base, une affection mentale. Cela ne signifie pas que l’on puisse guérir le cancer par la pensée positive — comme nous l’avons déjà dit, le complexe du moi est naturellement dissocié des fonctions autonomes et n’a donc qu’une influence causale limitée sur elles. Mais cela signifie qu’il est judicieux de chercher à savoir s’il est possible d’atteindre des niveaux plus profonds de notre physiologie par des moyens psychologiques, afin de traiter certaines affections « physiques ». En fait, il pourrait s’agir de l’explication manquante de ce que l’on appelle l’effet placebo, qui, dans le cadre du physicalisme, n’est qu’une anomalie gênante. Pouvons-nous délibérément induire cet effet par des méthodes psychologiques, maintenant qu’un cadre métaphysique cohérent le valide et l’explique ?
J’ai déjà longuement exploré les implications de l’idéalisme analytique dans des écrits précédents, et je ne vais donc pas répéter tout cela ici. Il suffit de mentionner — comme je l’ai fait plus haut — ce que je crois être deux des plus importantes. L’invitation qui vous est faite — en particulier si vous êtes tenté de considérer l’idéalisme analytique comme l’équivalent du physicalisme d’une manière importante — est de réfléchir aux différentes implications de ces points de vue très différents. Qu’est-ce qui change pour vous si vous vous considérez non pas comme un mécanisme physique, mais comme un être mental, dont les contenus mentaux et la subjectivité fondamentale ne seront jamais perdus pour la nature ?
L’IDÉALISME ANALYTIQUE NE FAIT AUCUNE PRÉDICTION EXPÉRIMENTALE QUI LE DISTINGUE DU PHYSICALISME
Il s’agit là encore d’une déformation grossière et manifestement fausse, bien qu’elle ait été communiquée sur un ton d’autorité et de certitude. Encore une fois, j’ai récemment abordé ce sophisme courant, mais remarquablement superficiel dans mon dernier livre. Voici le passage en question :
« L’idéalisme analytique n’est-il pas infalsifiable ? »
Avant de répondre directement à cette question, il est important de noter que, lorsque Karl Popper a proposé la falsifiabilité comme exigence pour les théories scientifiques, il parlait de… eh bien, de théories scientifiques, c’est-à-dire de théories qui modélisent et prédisent le comportement de la nature, et non de ce qu’est la nature. Une théorie scientifique doit être falsifiable, c’est-à-dire qu’elle doit faire des prédictions sur le comportement futur de la nature qui peuvent être vérifiées par rapport aux résultats expérimentaux. Si ce n’est pas le cas, la théorie est infalsifiable et n’est donc pas une théorie scientifique à proprement parler.
Mais en ce qui concerne l’idéalisme analytique, ainsi que le physicalisme classique, il ne s’agit pas d’une théorie scientifique qui prédit le comportement futur de la nature, mais de déclarations métaphysiques sur ce qu’est la nature. Les critères permettant de choisir la meilleure théorie dans ce cas sont plus variés que la falsifiabilité : ils impliquent la cohérence logique interne, la cohérence contextuelle, la parcimonie conceptuelle, le pouvoir explicatif et l’adéquation empirique. Ce dernier critère signifie que les implications d’une théorie métaphysique appropriée ne doivent pas contredire la science établie. Et dans la mesure où la science établie est falsifiable, une théorie métaphysique doit effectivement être liée à la falsifiabilité, mais seulement de manière indirecte.
La question qui se pose est donc de savoir si l’idéalisme analytique est compatible avec la science établie. La réponse est un « oui » retentissant. Comme nous l’avons vu précédemment, la science établie a montré que — à l’exception des fantaisies théoriques infalsifiables pour lesquels il n’existe aucune preuve positive — les entités physiques n’ont pas d’existence autonome, mais sont plutôt le produit de mesures. C’est exactement ce que soutient l’idéalisme analytique, puisque toutes les entités « physiques » sont des représentations perceptuelles des mesures, qui ne persistent que tant qu’une mesure est effectuée. Et cela contredit directement le physicalisme dominant, qui présuppose précisément que les entités physiques, en tant que fondamentales, doivent avoir une existence autonome, indépendante de l’observation.
La science établie a également montré qu’il existe des cas — comme lors des états psychédéliques, comme discuté précédemment — dans lesquels l’activité cérébrale diminue, alors que la richesse et l’intensité de l’expérience augmentent. Ce phénomène est pour le moins très difficile à comprendre dans le cadre du physicalisme classique, selon lequel il n’y a rien à expérimenter en dehors de l’activité cérébrale. En revanche, l’idéalisme analytique s’en accommode aisément, car l’activité cérébrale n’est que ce à quoi ressemble l’expérience intérieure, vue de l’extérieur, c’est-à-dire qu’elle n’est qu’une image de l’expérience intérieure. Et contrairement aux causes, les images n’ont pas besoin d’être complètes : elles n’ont pas besoin de révéler tout ce qu’il y a à savoir sur le phénomène qu’elles représentent. Dans le cas des psychédéliques, les images laissent beaucoup de choses de côté.
En outre, les psychédéliques ne sont qu’un cas parmi d’autres où, contrairement aux attentes physicalistes, les fonctions cérébrales et la richesse de l’expérience sont inversement corrélées. Comme nous l’avons vu plus haut, la restriction du flux sanguin vers le cerveau due à la strangulation ou aux forces G — qui réduisent le métabolisme cérébral en raison du manque d’oxygène ou de l’hypoxie — peut entraîner des transes de type psychédélique et des « rêves mémorables ». L’hyperventilation, qui réduit également le flux sanguin vers le cerveau parce qu’elle induit des niveaux élevés d’alcalinité dans le sang, peut conduire à des prises de conscience qui transforment la vie, un phénomène exploité par certaines techniques thérapeutiques de travail sur la respiration. Même une lésion cérébrale pure et simple peut conduire, dans certains cas spécifiques, à une expérience intérieure plus riche.
Dans le cadre d’une maladie appelée « syndrome du savant acquis » (cherchez-le), certaines personnes ayant subi des lésions cérébrales à la suite d’un traumatisme crânien survenu lors d’un accident de voiture, d’un coup de foudre ou même d’une blessure par balle à la tête, manifestent soudainement des capacités cognitives extraordinaires, telles que des talents artistiques, la capacité d’effectuer des calculs complexes presque instantanément et une mémoire parfaite. Il a également été démontré qu’un groupe important de vétérans de la guerre du Vietnam ayant subi des lésions des lobes frontaux ou pariétaux avait une propension plus élevée à vivre des expériences religieuses transformatrices (voir : « Neural correlates of mystical experience », par Irene Cristofori et al, publié dans Neuropsychologia, 2016). Même les patients ayant subi des lésions cérébrales à la suite d’une intervention chirurgicale pour l’ablation de tumeurs connaissent une « autotranscendance (ou dépassement de soi) » significativement plus élevée (voir : « The spiritual brain: Selective cortical lesions modulate human self- transcendence », par Cosimo Urgesi et al., publié dans Neuron, 2010). En outre, un groupe de soi-disant « médiums en transe » a montré une activité significativement réduite dans les zones du cerveau liées au raisonnement et au traitement du langage, précisément lorsqu’ils sont engagés dans des activités qui nécessitent un raisonnement et un traitement du langage importants (voir : « Neuroimaging during trance state: A contribution to the study of dissociation », par Julio Fernando Peres et al, publié dans PLoS ONE, 2012).
Je pourrais continuer ainsi longtemps, mais vous voyez l’idée. Bien que la plupart du temps l’activité cérébrale soit en corrélation directe avec la richesse de l’expérience intérieure, dans certains cas spécifiques, mais généraux et cohérents, c’est le contraire qui est vrai. Ces cas sont les cygnes noirs qui réfutent le physicalisme et justifient l’idéalisme analytique.
Les preuves scientifiques évoquées ci-dessus ne répondent pas seulement à la question de la falsifiabilité de l’idéalisme analytique et du physicalisme classique, elles apportent également une confirmation empirique positive de l’idéalisme analytique dans des domaines scientifiques très différents.
Il est clair que l’idéalisme analytique est l’une des hypothèses métaphysiques les mieux étayées sur le plan empirique. Il bénéficie de 50 ans de preuves expérimentales dans les Fondements de la physique et, dans la mesure où il s’aligne sur la théorie de l’information intégrée et lui fournit un fondement métaphysique, également des décennies dans les Neurosciences de la conscience. Il est remarquable que la critique de Rupert soit à l’opposé de la vérité, une vérité qu’il est en mesure de connaître depuis de nombreuses années.
L’IDÉALISME ANALYTIQUE EST UNE THÉORIE DE SALON
L’utilisation de l’expression « théorie de salon » a toujours été désobligeante et insultante, tant en science qu’en philosophie, ce dont Rupert est parfaitement conscient. Elle est tout à fait inutile dans le contexte d’échanges constructifs fondés sur des arguments et destinés à faire progresser un débat entre des personnes qui se respectent mutuellement et qui respectent le travail de l’autre. En bref, c’est l’équivalent d’un coup bas. Je ne comprends pas pourquoi Rupert choisit de m’insulter délibérément et inutilement, car je n’ai jamais été que bienveillant et favorable à son travail et à sa personne (pensez à la débâcle de la censure TEDx, au cours de laquelle j’ai pris sa défense au point de promettre de ne plus jamais donner de conférence TEDx). Si j’ai offensé Rupert à un moment ou à un autre depuis la dernière fois que nous avons été ensemble (lors d’un dîner à l’automne 2018, si je me souviens bien), je l’ai fait tout à fait à mon insu. Le ton que nous avons adopté l’un envers l’autre, et envers le travail de chacun, a toujours été cordial et respectueux. Je ne sais tout simplement pas d’où vient ce changement.
Quoi qu’il en soit, cette accusation soulève immédiatement la question de savoir en quoi, précisément, l’ontologie théiste et trinitaire de la transcendance propre à Rupert (dont il discute avec enthousiasme dans la seconde moitié de la vidéo ci-dessus, selon des lignes ouvertement bibliques) n’est pas elle-même une théorie de salon. Comment Rupert fonde-t-il objectivement et empiriquement une divinité transcendante, mais délibérée, interventionniste et toute-puissante, ainsi que sa nature trinitaire ? Quelles expériences a-t-il proposées pour vérifier cette hypothèse non triviale ? Selon ses propres critères, et à moins d’une hypocrisie flagrante, il s’agit là de questions critiques, potentiellement disqualifiantes pour l’évaluation de toute théorie métaphysique, y compris la sienne.
LE PROBLÈME DE L’IDÉALISME ANALYTIQUE EST QU’IL NE PEUT PAS EXPLIQUER LA MATIÈRE
Il s’agit là de la déformation la plus vulgaire et manifestement de mauvaise foi de mon travail dans l’ensemble de la critique. Rupert crée un faux argument scandaleux en suggérant ouvertement que ma tentative de rendre compte de la matière se limite à la métaphore des « ondulations sur l’océan ». Il semble également abuser de sa connaissance personnelle de moi pour s’arroger l’autorité d’être au courant de ma pensée privée sur la question. Il est évident que ce n’est pas le cas. Ses critiques m’indiquent clairement que Rupert n’a aucune compréhension de l’idéalisme analytique au niveau académique (et encore moins une compréhension privilégiée), ou qu’il a choisi de faire des déclarations qui vont à l’encontre d’une telle compréhension. Je ne comprends sincèrement aucun de ces deux scénarios.
J’utilise la métaphore des « ondulations sur l’océan », mais seulement après avoir présenté un compte rendu explicite, précis et élaboré de la matière dans le cadre de l’idéalisme analytique. Rupert doit le savoir, tout comme n’importe quelle personne qui s’est intéressée à mon travail de manière plus qu’occasionnelle. Pour l’amour du ciel, j’ai écrit une thèse de doctorat entière sur ce sujet précis, ainsi qu’un certain nombre d’articles évalués par des pairs. Est-il plausible que j’aie obtenu toutes ces publications et un second doctorat en limitant mon argumentation aux « ondulations sur l’océan » ? Et juste pour montrer quelque chose d’accessible aux non-universitaires, voici un cours en vidéo gratuit en ligne dans lequel j’explique, pendant plus de six heures (!), comment l’idéalisme analytique rend compte de la matière.
Rupert déforme outrageusement ma tentative de rendre mon travail accessible au grand public par le biais d’une métaphore et la présente comme un manque de substance, de rigueur et de précision ; et il le sait. Qu’il choisisse de le faire en tant que chercheur dépasse mon entendement. À mon avis, ses déclarations se rapprochent dangereusement d’une tentative délibérée de désinformation par la création de faux arguments, ce qui n’est pas digne d’un chercheur, et encore moins de Rupert Sheldrake. Et si sa défense consiste à dire qu’il n’était tout simplement pas conscient de l’ampleur de mes travaux (ce que je trouve totalement invraisemblable, car je sais qu’il en sait plus que cela), alors le ton autoritaire qu’il a choisi d’adopter, et les affirmations définitives qu’il a choisi de faire, sont tout aussi discutables. Lorsque l’on sait que l’on ne connaît pas nécessairement le sujet dont on parle, on ne parle pas comme il le fait dans la vidéo ci-dessus.
L’IDÉALISME ANALYTIQUE EST FAUX, CAR IL S’ARRÊTE AU VERSET 2 DU LIVRE DE LA GENÈSE
Il est évident pour tout le monde que je vais me défendre de cette critique particulière. Mais avant de le faire, permettez-moi de dire ceci : Je respecte profondément les écrits et les intuitions religieux. Je crois qu’ils f donnent des indices sur des aspects de la réalité qui ne peuvent être saisie par le langage, la logique aristotélicienne ou les modèles conceptuels. J’ai écrit abondamment à ce sujet dans mon livre More Than Allegory (Plus qu’une allégorie). À ce titre, je suis ouvert à la possibilité que l’idéalisme analytique soit effectivement incomplet ; en fait, j’en suis certain, car comment des singes bipèdes pourraient-ils élaborer des modèles précis et complets de la nature ? Je ne rejette donc pas les critiques de l’idéalisme analytique fondées sur la religion. Je n’ai pas reçu d’éducation religieuse moi-même, mais cela signifie aussi que je n’ai aucun compte à régler avec la religion.
Cependant, je ne pense pas que les points de vue basés sur l’intuition religieuse puissent être considérés comme des arguments analytiques ou empiriques. Et c’est précisément ce que Rupert tente ostensiblement de faire ici : dénoncer l’idéalisme analytique comme une philosophie inadéquate pour des raisons analytiques et scientifiques. Il s’agit évidemment d’une mauvaise approche, dans la mesure où elle voile de manière trompeuse les motivations religieuses sous le vernis de l’argumentation rationnelle. Et cela ne justifie certainement pas les nombreux arguments spécieux, les fausses déclarations et les affirmations trompeuses faits avec un ton d’autorité tout aussi trompeur.
DIEU EST LA BASE DE LA CONSCIENCE, L’IDÉALISME ANALYTIQUE EST DONC ERRONÉ
Je laisserai cette critique sans réponse, même si c’est la partie de sa critique à laquelle il consacre de loin le plus de temps et dans laquelle il semble s’investir le plus émotionnellement. Je la souligne ici simplement parce qu’elle semble confirmer un sentiment que j’ai eu tout au long du manifeste militant de Rupert contre l’idéalisme analytique : je soupçonne qu’en raison de ses dispositions religieuses, il se sente offensé par l’esprit naturaliste et réductionniste de l’idéalisme analytique. Peut-être voit-il l’articulation purement rationnelle, sèche et empirique de mon dernier livre comme une trahison d’un pacte de confiance tacite, implicite entre nous, dont je n’étais pas conscient. Peut-être perçoit-il l’articulation purement rationnelle, sèche et empiriquement fondée de mon dernier livre comme une trahison d’un pacte tacite et implicite de confiance entre nous, dont je n’avais pas conscience. Mais il est inutile de spéculer davantage sur ses motivations, car je n’ai pas d’accès direct à l’état intérieur de Rupert lorsqu’il a choisi de dire ce qu’il a dit. Tout ce qui me reste, c’est ma perplexité et ma déception face à ce qu’il a dit et à la manière dont il l’a dit.
Personnellement, je ne vois pas de contradiction fondamentale entre le naturalisme et le réductionnisme d’une part, et la foi religieuse d’autre part, à condition de ne pas être littéraliste. Je considère la nature comme un vaste océan de subjectivité, ce qui en dit long sur la manière dont ces choses pourraient être conciliées. Mais je ne pense pas qu’il soit approprié pour un érudit de déformer et d’attaquer les points de vue analytiques d’un autre en raison de ses convictions religieuses. L’attaque n’est pas non plus appropriée si elle n’est pas motivée par une argumentation sensée, mais par une réaction émotionnelle à une offense ou une trahison religieuse perçue.
Je regrette profondément cet épisode, car il m’a privé du respect que je porte à une personne que j’admire ouvertement et que je considère comme un modèle depuis de nombreuses années. Ma déception est amère, et la critique, aussi invalide soit-elle, m’a blessé à un niveau très personnel. Mais nous avançons, dans un esprit d’honnêteté et d’ouverture.
Texte original : https://www.bernardokastrup.com/2024/11/response-to-rupert-sheldrakes.html
__________________________
La réponse de Rupert Sheldrake
 Rupert m’a demandé de publier sa réponse à l’article précédent, dans lequel je me défendais contre son attaque de l’idéalisme analytique. Voici sa réponse, sous la forme d’une lettre, dans son intégralité et sans modifications.
Rupert m’a demandé de publier sa réponse à l’article précédent, dans lequel je me défendais contre son attaque de l’idéalisme analytique. Voici sa réponse, sous la forme d’une lettre, dans son intégralité et sans modifications.
Cher Bernardo,
Je regrette le ton de mes remarques lors de mon entretien avec Curt Jaimungal, car j’ai beaucoup de respect pour vous et votre travail. Votre œuvre m’influence. Je pense que votre promotion de l’idéalisme analytique a élargi le champ du débat philosophique moderne et ouvert des questions et des discussions qui n’auraient pas été possibles autrement. Je m’excuse de m’être exprimé d’une manière que vous avez trouvée blessante.
Lorsque je parlais à Curt de votre travail, je le faisais comme s’il s’agissait d’une conversation entre nous deux. Nous avions déjà eu plusieurs discussions informelles lorsqu’il était à Londres peu avant notre entretien. Malheureusement, je n’ai pas pensé à l’impact de la conversation sur des personnes qui n’en savaient peut-être pas beaucoup sur vous et pour qui mes commentaires auraient pu être trompeurs. Si j’avais réfléchi davantage, j’aurais d’abord précisé en quoi l’idéalisme analytique diffère du physicalisme, avant de dire que votre position idéaliste comprend également certains aspects du physicalisme et du réductionnisme. J’ai compris cela peu avant ma conversation avec Curt, car je venais de lire votre nouveau livre.
Dans le sous-titre de Analytic Idealism in a Nutshell (L’idéalisme analytique en bref), vous le qualifiez de « seule métaphysique plausible du XXIe siècle ». C’est une affirmation provocante, qui m’a amené à réfléchir à la base de votre rejet de toutes les autres formes d’idéalisme. Je n’ai pu que conclure que c’est parce que vous partagez encore certaines des hypothèses par défaut du physicalisme, y compris le naturalisme et le réductionnisme, comme vous l’indiquez vous-même clairement.
À la page 2 de Analytic Idealism in a Nutshell, vous écrivez que l’idéalisme analytique « embrasse le réductionnisme », ce qui signifie que « les phénomènes complexes peuvent être expliqués en termes de phénomènes plus simples ». Comme vous le soulignez, plus simple ne signifie pas nécessairement plus petit, mais dans le contexte de la biologie, le réductionnisme signifie en pratique réduire les organismes à des processus moléculaires, et le comportement à l’activité des nerfs.
J’ai passé soixante ans à lutter contre le réductionnisme en biologie, en psychologie et dans les études sur la conscience. En biologie, le réductionnisme a longtemps régné en maître sous la forme de la biologie moléculaire, axée sur les gènes et autres molécules. Cette attitude réductionniste a inhibé la recherche holistique en biologie du développement, en comportement animal, en psychologie et en médecine en forçant tout à entrer dans un moule physicaliste, en pointant vers un supposé fondement ultime de tout, la physique quantique fondamentale. À la lumière de mon histoire personnelle, votre plaidoyer en faveur du réductionnisme m’a fait penser que votre position était proche du physicalisme, bien que vous soyez un idéaliste.
Vous adhérez également au naturalisme. Voici votre propre définition : « Les phénomènes du monde extérieur se déroulent spontanément, selon les dispositions inhérentes à la nature, et non selon l’intervention extérieure d’une divinité extérieure à la nature » (également à la page 2). Dans l’usage courant, le physicalisme, le naturalisme et l’athéisme sont étroitement liés et souvent traités comme identiques. Le naturalisme emprunte sa large crédibilité dans le monde séculier au prestige de la science physicaliste. Je sais que vous distinguez l’idéalisme analytique du physicalisme en faisant de la conscience, plutôt que des processus physiques, un élément fondamental, mais comme vous le dites vous-même explicitement, vous reprenez plusieurs hypothèses et attitudes physicalistes dans votre idéalisme, ce que j’ai essayé de résumer par l’expression « physicalisme idéaliste ». Je reconnais que cette expression est trompeuse et qu’il serait plus juste de parler d’« idéalisme à saveur physicaliste ».
Notre désaccord le plus fondamental concerne Dieu. Tous les croyants en Dieu, moi y compris, sont des idéalistes dans le sens où ils considèrent la conscience divine comme fondamentale. Vous voulez exclure Dieu de la science et de la philosophie, en particulier tout type de Dieu abrahamique. Le fait d’épouser le naturalisme vous permet de le faire par principe. Mais même si vous rejetez tout ce qui a trait au christianisme, au judaïsme et à l’islam, les religions indiennes regorgent d’exemples d’idéalisme trinitaire ou advaïtique (non-duel). En outre, la plupart des formes d’idéalisme trinitaire ou advaïtique n’impliquent pas l’intervention d’un Dieu surnaturel extérieur dans le fonctionnement spontané de la nature. Elles ne revendiquent pas, comme vous le dites, une « intervention externe d’une divinité extérieure à la nature », mais considèrent plutôt que la conscience divine est sous-jacente à toute la nature et la soutient en permanence. Le philosophe David Bentley Hart, par exemple, le montre très clairement dans son livre The Experience of God : Being, Consciousness, Bliss.
Nous sommes d’accord sur le fait qu’il est nécessaire d’abandonner le physicalisme traditionnel. Nous sommes d’accord pour dire que l’idéalisme offre une meilleure vue d’ensemble philosophique. Mais je prends au sérieux les idéalismes religieux ou théologiques, alors que vous les excluez a priori en invoquant le principe naturaliste. Dans ce cas, la seule forme d’idéalisme qui subsiste est la vôtre.
J’ai été injuste en qualifiant votre forme d’idéalisme analytique de théorie de salon et je suis désolé de cette remarque. Je vous ai mis dans le même sac que d’autres philosophes, mais en fait, vous vous êtes à plusieurs reprises penché sur des résultats scientifiques et empiriques détaillés. Vous avez également fait des suggestions visionnaires pour la recherche empirique. Dans votre livre More Than Allegory (2016), vous avez créé une fantaisie de type science-fiction dans laquelle vous avez envisagé des expériences sur les psychédéliques dans lesquelles les gens recevaient des perfusions intraveineuses de substances psychoactives (« le mélange de jus ») qui prolongeaient leurs états altérés de conscience afin qu’ils puissent les explorer dans les moindres détails. Par la suite, cette expérience a été réalisée avec de la diméthyl tryptamine (DMT) à l’Imperial College de Londres, avec des volontaires très courageux. Les résultats ont été publiés l’année dernière dans les Proceedings of the National Academy of Sciences.
Vous et moi sommes habitués aux controverses et reconnaissons que d’autres personnes ont sincèrement des points de vue différents. Les idées se développent par le dialogue, et nous avons déjà participé à une discussion cordiale que tout le monde peut regarder en ligne.
J’espère que nous pourrons poursuivre nos discussions dans un esprit d’ouverture.
Rupert
Texte original : https://www.bernardokastrup.com/2024/12/rupert-sheldrakes-rejoinder.html
Voir l’entretien Kastrup/Sheldrake faisant suite à l’échange précédent: