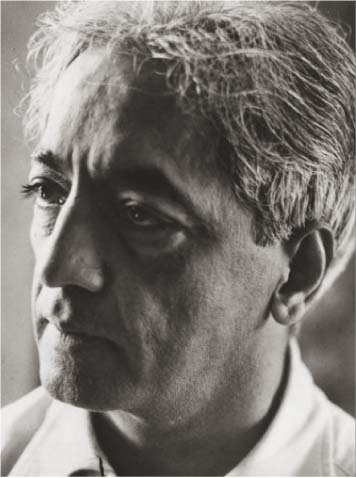Pour les noms complets des participants, voir ici.
P.J. : Pouvons-nous commencer à esquisser le paysage de l’avenir de l’homme, les problèmes auxquels il est confronté et ce qui, dans la matrice de l’esprit humain, l’empêche de se libérer ?
K : Quel est l’avenir de l’homme ? L’ordinateur peut surpasser l’homme, apprendre plus vite que lui, enregistrer plus d’informations. Il peut apprendre, désapprendre, se corriger, en fonction de ce qui a été programmé. Il existe des ordinateurs qui peuvent programmer d’autres ordinateurs et ainsi continuer à apprendre davantage. Alors, quel est l’avenir de l’homme quand tout ce qu’il a fait ou fera, l’ordinateur peut le surpasser ? Bien sûr, il ne peut pas composer comme Beethoven, il ne peut pas voir la beauté d’Orion un soir dans le ciel. Mais il peut créer un nouveau Vedanta, une nouvelle philosophie, de nouveaux dieux, etc. Que doit alors faire l’homme ? Soit il cherche à se divertir, il entre de plus en plus dans le monde du sport, il cherche à se divertir religieusement. Ou alors, il se tourne vers l’intérieur. L’esprit humain est infini. Il possède une immense capacité, non pas une capacité de spécialisation, non pas une capacité de connaissance. Il est infini.
C’est peut-être l’avenir de l’humanité : les scientifiques commencent à se demander ce qu’il adviendra de l’homme lorsque l’ordinateur prendra en charge l’ensemble de l’humanité. Aujourd’hui, le cerveau est occupé, il est actif. Lorsqu’il ne sera plus actif, il s’étiolera et la machine prendra le relais. Nous risquons tous de devenir des zombies, de perdre notre extraordinaire capacité intérieure ou de devenir superficiellement intellectuels, à la recherche du monde du divertissement. Je ne sais pas si vous avez remarqué que la télévision consacre de plus en plus de temps au sport, surtout en Europe. Est-ce là l’avenir de l’homme ? L’avenir de l’homme pourrait dépendre de la bombe atomique, de la bombe à neutrons. En Orient, en Inde, la guerre peut sembler très lointaine. Mais si vous vivez en Europe, la bombe suscite d’énormes inquiétudes ; la guerre y est très proche. Il y a donc deux menaces : la guerre et l’ordinateur.
Quel est donc l’avenir de l’homme ? Soit il va très profondément à l’intérieur, non pas en explorant seulement les profondeurs de son esprit et de son cœur. Ou bien il se laisse divertir. La liberté de choix, la liberté face à la dictature, la liberté face au chaos sont des problèmes auxquels l’homme doit faire face.
Dans le monde, il y a de grandes perturbations, une grande corruption ; les gens sont profondément perturbés. Il est dangereux de marcher dans les rues. Lorsque nous parlons de se libérer de la peur, nous voulons la liberté extérieure, la liberté du chaos, de l’anarchie ou de la dictature. Mais nous ne demandons jamais s’il existe une liberté intérieure : la liberté de l’esprit. Cette liberté est-elle réelle ou théorique ? Nous considérons l’État comme un obstacle à la liberté. Les communistes et autres totalitaires disent que la liberté n’existe pas, que l’État, le gouvernement, est la seule autorité. Et ils répriment toute forme de liberté. Alors, quel type de liberté voulons-nous ? À l’extérieur ? À l’extérieur de nous ? Ou une liberté intérieure ?
Lorsque nous parlons de liberté, s’agit-il de la liberté de choisir entre tel ou tel gouvernement, entre ici et là, entre la liberté extérieure et la liberté intérieure ? La psyché intérieure l’emporte toujours sur l’extérieur. La psyché c’est-à-dire la structure intérieure de l’homme — ses pensées, ses émotions, ses ambitions, ses actions, sa cupidité — l’emporte toujours sur l’extérieur. Alors, où cherchons-nous la liberté ? Pouvons-nous en discuter ? Peut-on se libérer de la nationalité qui nous donne un sentiment de sécurité ? Peut-on se libérer de toutes les superstitions, de tous les dogmes et de toutes les religions ? Une nouvelle civilisation ne peut naître que d’une religion authentique, et non de superstitions, de dogmes ou de religions traditionnelles.
P.J. : Vous avez posé une question : quel choix l’homme a-t-il dans le monde extérieur lorsque le monde intérieur ne participe pas au mouvement de la liberté ? Autrement dit, sans savoir si l’esprit est libre ou asservi, y a-t-il un choix possible dans le monde extérieur ? Est-il possible pour un esprit inexploré de faire un choix dans le monde extérieur ?
S.K. : Monsieur, vous avez parlé de l’ordinateur et de la possibilité que le cerveau humain dépérisse par manque d’activité. Envisagez-vous alors la possibilité que l’homme disparaisse et soit remplacé par une entité non biologique ?
K : Peut-être, mais ce que je veux dire, c’est que nous devons prendre les choses telles qu’elles sont et voir si nous ne pourrions pas provoquer une mutation dans notre cerveau lui-même.
S.K. : J’aimerais vous poser quelques questions supplémentaires sur la liberté de l’esprit lorsqu’il est en état de servitude. Nous ne connaissons qu’une liberté relative. Il existe une distinction complète entre la liberté intérieure et extérieure et la servitude. Par exemple, nous parlons de l’avidité et de l’agressivité de l’esprit. Pour moi, cela fait de l’homme un être humain. C’est ce qui fait la différence entre un ordinateur et un homme. J’aimerais que vous nous éclairiez un peu plus sur cette liberté. S’agit-il d’une liberté relative ? Inclut-elle toutes les émotions dont nous parlons ? Comment peut-on être avec elles, vivre avec elles ? Il semble que certaines limites soient imposées par les coutumes et qu’essayer de les transcender, c’est essayer de transcender l’humanité elle-même.
K : L’esprit humain a vécu dans la peur pendant des millions de siècles. Cette peur peut-elle prendre fin ? Ou allons-nous continuer à l’entretenir jusqu’à la fin de nos jours ?
P.J. : Ce qu’a dit le Dr Kakkar, c’est que ce sont ces mêmes éléments de peur, d’envie, de colère, d’agression, qui constituent l’humanité. Quelle est votre réponse à cela ?
K : Le sont-ils ? Nous les acceptons comme faisant partie de la nature humaine. Nous y sommes habitués. Nos ancêtres et la génération actuelle ont accepté cela comme étant la condition de l’homme. Je remets cela en question. L’humanité, un être humain, peut être totalement différent.
P.J. : Si vous le remettez en question, alors vous devez pouvoir montrer ce qui rend possible l’extinction de ces éléments pour que l’humanité dont vous parlez puisse s’épanouir totalement. Comment cela est-il possible ?
R.T. : Cela signifie aussi que la liberté ne peut exister que si l’on a éteint ces éléments.
K : Oui, monsieur, tant que je suis attaché à une conclusion, à un concept, à un idéal, il n’y a pas de liberté. Devons-nous en discuter ?
P.J. : C’est, après tout, le cœur du problème de l’humanité.
J.S. : Puis-je élargir la question en suggérant que dans la déclaration ou la question posée par le Dr Kakkar, une autre conception de la liberté est implicite, où l’on obtient la liberté non pas en se débarrassant de la peur, de l’anxiété, de l’avidité, etc., mais en les intégrant, en les incorporant dans un ensemble plus vaste.
K : En les intégrant dans une conscience plus large.
Swami Chidanand : Apprendre à y faire face avec succès.
S.K. : Puis-je développer ? Il y a deux choses : la peur fait partie de l’humanité ; son élimination fait également partie de l’humanité. Si vous ne parlez que de l’élimination du désir ou de son apaisement, alors atteindre un autre état revient, selon moi, à laisser de côté l’autre aspect. Et cela est très important pour moi en termes de stratégie. Ma stratégie consiste à croire que l’envie, la cupidité, etc. font partie de l’humanité, car c’est ce qui fait l’homme. L’homme doit vivre avec elles, mais il doit en faire des alliées et les utiliser. Alors, il verra que les peurs ne sont pas aussi grandes que nous le pensons, que l’avidité n’est pas si effrayante. Réduire la peur, l’atténuer, l’utiliser, telle est ma stratégie.
P.J. : Le Dr Kakkar a raison, on ne peut pas prendre uniquement les éléments sombres de l’homme. C’est le même centre qui parle de la transformation du bien, qui parle de tous les éléments qui sont aujourd’hui considérés comme opposés. C’est l’ensemble qui constitue l’homme, l’ombre et la lumière. Est-il possible d’intégrer l’ombre et la lumière ? Et qui les intègre ? C’est là que réside le problème central. Il s’agit de savoir s’il existe une entité capable de choisir, d’intégrer.
K : Pourquoi cette division : ombre, lumière, beauté, laideur ? Pourquoi y a-t-il cette contradiction chez les êtres humains ?
Shanta Gandhi : Sans contradiction, il est difficile de vivre. La vie est pleine de contradictions. L’un des résultats de la vie est la contradiction.
K : Oh ! Vous considérez la vie comme une contradiction. La contradiction implique le conflit. Pour vous, la vie est donc un conflit sans fin. Vous réduisez la vie à un conflit perpétuel.
S.G. : La vie, telle que nous la connaissons, l’est certainement.
K : Nous avons accepté que la vie soit un conflit. C’est peut-être notre habitude, notre tradition, notre éducation, notre condition.
S.G. : Ma difficulté est que l’outil qui me permet d’atteindre cette conscience est aussi mon propre esprit. C’est la somme totale de ce qui est conditionné par ce qui s’est passé. Et je ne peux commencer qu’à partir de là.
K : Nous commençons donc par la condition humaine. Certains disent qu’il est impossible de changer cette condition ; on ne peut que la modifier. Les existentialistes disent qu’il est impossible de la déconditionner. Par conséquent, vous devez vivre perpétuellement en conflit. Nous nous contredisons, c’est tout.
S.K. : Ce que je ressens, c’est qu’il y a deux conditions ; cela fait partie de la croissance et du développement humains. Il y a deux conflits qui sont inéluctables. L’un est la séparation, la prise de conscience que « je suis » différent de mes parents. Cela fait partie de l’évolution humaine. Le second est la différenciation, lorsque l’on apprend la différenciation des sexes — je suis un homme et l’autre est une femme ; cela fait partie de l’évolution humaine, des aspects de la contradiction, des différences, et ce sont les angoisses de base qui sont inéluctables dans l’esprit humain.
K : Alors, qu’est-ce que l’intégration ?
S.K. : C’est essayer de les réunir.
K : Peut-on réunir les opposés ? Ou bien n’y a-t-il pas d’opposé du tout ? Puis-je approfondir cette question ? Je suis violent ; les êtres humains sont violents. C’est un fait. La non-violence n’est pas un fait. La violence est « ce qui est » ; l’autre n’est pas. Mais tous vos dirigeants, vos philosophes, ont essayé de cultiver la non-violence. Qu’est-ce que cela signifie ? En cultivant la non-violence, je suis violent. La non-violence ne peut donc jamais exister. Il n’y a que de la violence. Pourquoi moi, l’esprit, crée-t-il l’opposé ? Comme un moyen d’échapper à la violence ? Pourquoi ne puis-je pas m’occuper uniquement de la violence et ne pas me préoccuper de ce qui n’est pas un fait ? Il n’y a que la violence ; l’autre n’est qu’un moyen d’échapper à ce fait. Il n’y a donc que « ce qui est » ; pas « ce qui devrait être » ; les idéaux, les concepts, tout cela disparaît.
A.P. : Lorsque vous dites que la non-violence n’est qu’une idée et que la violence est un fait, l’enquête doit logiquement faire un pas de plus et demander : la violence peut-elle prendre fin ?
K : Certainement. Nous devons d’abord comprendre ce qu’est la violence. Qu’est-ce que la violence ? La conformité est une violence. La limitation est une violence.
S.K. : J’aimerais comprendre un peu mieux.
K : Qu’est-ce que j’appelle la violence ? La colère, la haine, frapper l’autre, le tuer pour un idéal, pour un concept, pour le mot « paix ». Et la violence est-elle une idée ou un fait ? Quand je me mets en colère, c’est un fait. Pourquoi l’appeler violence ? Pourquoi lui donner un nom ? Je donne un nom à une réaction que l’on appelle violence. Pourquoi est-ce que je fais cela ?
Regardez, il y a un écureuil sur le toit. Dois-je le nommer ? Suivez-vous ma question ? Est-ce que je le fais à des fins de reconnaissance, renforçant ainsi la réaction présente ? Bien sûr. La réaction actuelle est donc enfermée dans le souvenir du passé et je nomme ce souvenir du passé comme étant de la violence.
S.K. : Oui, monsieur, je découvre aussi que la violence est une violation. Je vous disais « oui » sans comprendre ce qu’est la violence.
S.C. : Quand vous parlez de violence, nous connaissons bien sûr la violence, on fait référence à la colère, mais il y a aussi la violence subjective.
K : J’allais y venir. Qu’est-ce que la violence ? Faire du mal à autrui, blesser quelqu’un psychologiquement par la persuasion et par le biais de récompenses et de punitions ; en le faisant se conformer à un modèle en le persuadant logiquement, affectueusement, d’accepter un certain cadre — tout cela, c’est de la violence. Apparemment, c’est inhérent à l’homme. Pourquoi appelons-nous cela violence ? Cela se produit tout le temps. La tradition le fait, tout le monde religieux le fait, le monde politique le fait, le monde des affaires le fait, le monde intellectuel le fait, en imposant leurs idées, leurs concepts, leurs théories.
S.G. : Toute éducation est-elle violence ?
K : Non. Je n’utiliserai pas le mot « éducation » pour l’instant. Existe-t-il un esprit qui ne peut pas être persuadé, un esprit qui voit très clairement ? Telle est la question.
S.K. : Non.
K : Pourquoi dites-vous « non » ?
S.K. : Parce que la question que vous avez posée est de savoir s’il existe un esprit qui ne peut pas être persuadé. Ce que je veux dire, c’est qu’un tel esprit n’existe pas.
K : Nous sommes le résultat de la persuasion ; toute propagande, qu’elle soit religieuse ou politique, nous persuade, nous met sous pression, nous entraîne dans une certaine direction.
S.K. : Cette persuasion est si profonde qu’elle nous est inaccessible. Elle porte tellement de masques que nous ne pouvons plus les voir.
K : Pouvons-nous nous libérer de cette violence ? Pouvons-nous être libérés de la haine ? Évidemment, nous le pouvons.
P.J. : On ne peut pas en rester là et dire : « De toute évidence, vous pouvez être libre ».
K : Sommes-nous d’accord sur ce point ?
S.K. : Que nous haïssons, oui. Mais pouvons-nous nous libérer de cette haine ? Non.
K : Nous allons approfondir cela. Quelle est la cause de la haine ? Pourquoi me détestez-vous lorsque je dis quelque chose que vous n’aimez pas ? Pourquoi me repoussez-vous de côté, vous qui êtes plus fort, plus puissant intellectuellement, etc. Pourquoi suis-je blessé ? Psychologiquement, quel est le processus de la blessure ? Qu’est-ce qui est blessé ? Qui est blessé ? L’image que j’ai de moi-même est blessée. Si vous venez la piétiner et y planter une épine, je suis blessé. L’image que j’ai de moi-même est donc la cause de la blessure. Vous me dites quelque chose, vous me traitez d’idiot, et je pense que je ne suis pas un idiot ; vous me blessez parce que j’ai une image de moi-même qui dit que je ne suis pas un idiot.
S.K. : À une condition près : lorsque vous dites que l’image est blessée lorsqu’on la traite d’idiote, cela signifie que ce n’est pas vous qui êtes blessé, mais quelque chose que vous avez inventé.
K : Nous sommes le résultat de chaque blessure.
S.K. : Ce n’est pas vous qui êtes blessé.
K : Non. Supposons que je pense être un grand homme. Vous arrivez et vous me dites : « Ne soyez pas ridicule, il y a beaucoup d’hommes plus grands que vous ». Je suis blessé. Pourquoi ? De toute évidence, j’ai une image de moi comme d’un grand homme. Vous venez me dire quelque chose qui va à l’encontre de cette image. Je suis blessé. Ce n’est pas moi que vous blessez, c’est l’image que j’ai de moi-même. L’image que j’ai construite de moi-même est blessée. La question suivante est donc : puis-je vivre sans l’image que j’ai de moi-même ?
S.K. : Non.
P.J. : Où, dans quelle dimension, puis-je découvrir que je fais une image de moi-même ?
K : Je ne découvre pas, je perçois.
P.J. : Où ?
K : Qu’entendez-vous par « où » ? Vous venez de me faire remarquer que j’ai une image de moi-même. Je n’y avais pas pensé, je n’avais jamais vu mon image. Vous me le faites remarquer, vous affirmez que j’ai une image. Je vous écoute très attentivement, avec beaucoup d’attention, et dans cette écoute même, je découvre le fait que j’ai une image de moi-même. Ou bien, est-ce que je vois une image de moi-même ?
P.J. : Je ne pense pas avoir été assez clair. Si je ne le vois pas comme une abstraction, alors ce mécanisme à fabriquer des images est le terrain sur lequel cela est perçu. Permettez-moi d’aller un peu plus loin. Il y a un fondement à partir duquel la machine à fabriquer des images émerge.
K : Pourquoi utilisez-vous le mot « fondement » ?
P.J. : Parce qu’en parlant et en répondant, on a tendance à devenir conceptuel. Si l’on sort du conceptuel pour aller vers l’actuel, alors l’actuel est le processus même de la perception.
K : C’est tout. Arrêtez-vous là.
P.J. : Je ne peux pas m’arrêter là. Je vous pose une autre question : Je ne le perçois pas dans votre déclaration ; alors où le percevrai-je ?
K : Vous le percevez au moment où il se produit.
P.J. : Quand vous dites « au moment où il se produit », où est-ce que je perçois ? Est-ce que je le perçois à l’extérieur ou dans mon imagination ?
K : J’ai vu cet écureuil se promener. Je le perçois, je perçois le fait, je regarde le fait que j’ai une image.
P.J. : Ce n’est pas très clair.
K : C’est très très clair. Vous me dites que je suis un menteur. J’ai menti. Je me rends compte que je suis un menteur.
P.J. : Y a-t-il une différence entre réaliser que je suis un menteur et percevoir que je suis un menteur ?
K : J’ai perçu que je suis un menteur. Je suis conscient — utilisons le mot « conscient » — que je suis un menteur. C’est tout.
P.J. : Pouvez-vous approfondir cette vision du mouvement à l’intérieur de l’esprit ? Je pense que c’est le cœur de tout cela.
K : Nous parlions d’être libre de la peur. Nous voulons discuter de l’ensemble du mouvement de la peur. Il commence avec le désir, avec le temps, avec la mémoire ; il commence avec le fait du mouvement actuel de la peur. Tout cela est impliqué dans le grand fleuve de la peur. Soit la peur est très, très superficielle, soit c’est une rivière profonde avec un grand volume d’eau. Nous ne discutons pas des différents objets de la peur, mais de la peur elle-même. Maintenant, discutons-nous d’une abstraction de la peur ou d’une peur réelle dans mon cœur, dans mon esprit ? Est-ce que je fais face à la peur ? Je tiens à être clair sur ce point. Si nous parlons d’une peur abstraite, cela n’a aucun sens pour moi. Je me préoccupe uniquement de la peur réelle. Je dis que cette peur implique tout cela, le désir et la complexité même du désir, le temps, le passé qui empiète sur le présent et le désir de vouloir aller au-delà de la peur. Tout cela doit être perçu. Je ne sais pas si vous me suivez. Nous devons voir une chose comme la goutte de pluie qui contient toutes les rivières du monde, voir la beauté de cette goutte de pluie. Une seule goutte de désir contient tout le mouvement de la peur.
Qu’est-ce que le désir ? Pourquoi le réprimons-nous ? Pourquoi dites-vous qu’il a une importance considérable ? Je veux être ministre ; mon désir est pour cela, ou mon désir est pour Dieu. Mon désir pour Dieu et mon désir d’être ministre sont une seule et même chose — c’est le désir. Je dois donc comprendre la profondeur du désir, pourquoi il anime l’homme, pourquoi il a été réprimé par toutes les religions.
On se demande quelle est la place du désir et pourquoi le cerveau est consumé par le désir. Je dois le comprendre non seulement au niveau verbal par l’explication, par la communication, mais aussi au niveau le plus profond, dans mes tripes. Quelle est la place de la pensée dans le désir ? Le désir est-il différent de la pensée ? La pensée joue-t-elle un rôle important dans le désir ? Ou bien la pensée est-elle le mouvement du désir ? La pensée fait-elle partie du désir ou la pensée domine-t-elle le désir, contrôle-t-elle et façonne-t-elle le désir ?
Je pose donc la question : La pensée et le désir ne sont-ils pas comme deux chevaux ? Je dois comprendre non seulement la pensée, mais tout le mouvement de la pensée, l’origine de la pensée ; non pas la fin, mais le commencement de la pensée. L’esprit peut-il être conscient du début de la pensée et aussi du début du désir ?
Je dois répondre à cette question : Qu’est-ce que le désir et qu’est-ce que la pensée ? Tout d’abord, il y a la perception, le contact, la sensation. Par exemple, je vois une chemise bleue dans la vitrine. Je vais à l’intérieur et je touche la texture, et de ce contact naît la sensation. Ensuite, la pensée se dit : comme ce serait agréable si je mettais cette chemise bleue. La création par la pensée de l’image de cette chemise sur moi est le début du désir.
S.K. : Vous avez dit que vous le ressentez dans les tripes. Je pense que c’est là que réside le désir.
K : Nous comprenons le désir, comment il naît, où la pensée crée l’image et où le désir commence. Mais qu’est-ce que le temps ? Le temps est-il un mouvement de la pensée ? Il y a le temps physique, le soleil se lève, le soleil se couche à un certain moment ; le temps en tant que passé, présent et futur ; le temps en tant que passé se modifiant lui-même, devenant physiquement le futur ; le temps en tant que parcourir une distance ; le temps en tant qu’apprendre une langue. Et puis il y a tout le domaine du temps psychologique. J’ai été, je suis, je serai. C’est un mouvement du passé à travers le présent qui se modifie en futur. Le temps de l’acquisition de connaissances par l’expérience, la mémoire, la pensée, l’action — c’est aussi du temps. Il y a donc le temps psychologique et le temps physique.
Maintenant, le temps psychologique existe-t-il réellement ? Ou bien la pensée en tant qu’espoir a-t-elle créé le temps ? C’est-à-dire que je suis violent, je serai non-violent, et je réalise que ce processus ne pourra jamais mettre fin à la violence. Ce qui mettra fin à la violence, c’est d’affronter le fait et de rester avec lui, sans essayer de l’esquiver ou de le fuir. Il n’y a pas d’opposé, il n’y a que « ce qui est ».
Et qu’est-ce que la pensée ? Pourquoi l’homme a-t-il donné une importance considérable à l’intellect, aux mots, aux théories, aux idées ? À moins que je ne découvre l’origine de la pensée, comment elle commence, peut-il y avoir une conscience de l’émergence de la pensée ? Ou bien la conscience vient-elle après son surgissement ? Est-on conscient du mouvement de l’ensemble du fleuve de la pensée ? La pensée est devenue extraordinairement importante. La pensée existe parce qu’il y a la connaissance, l’expérience, accumulées dans le cerveau sous forme de mémoire ; de cette mémoire naissent la pensée et l’action. C’est dans ce processus que nous vivons, toujours dans le domaine du connu. Ainsi, désir, temps, pensée, sont essentiellement la peur. Sans cela, il n’y a pas de peur. J’ai peur intérieurement et je veux de l’ordre à l’extérieur — dans la société, la politique, l’économie. Comment peut-il y avoir de l’ordre à l’extérieur si je suis dans le désordre à l’intérieur, ici ?
P.J. : Puis-je mettre de l’ordre en moi s’il y a du désordre à l’extérieur ? Je pose délibérément ce problème qui se trouve dans la dichotomie que vous avez faite au début entre l’extérieur et l’intérieur. L’extérieur est comparé à l’ordinateur, d’une part, et à la bombe atomique, d’autre part, qui, selon moi, est en train de prendre le dessus.
J.U. : Nous ne pouvons pas réaliser cette liberté sans nous relier à l’extérieur, là où il y a dukh (souffrance), où il y a tant d’agitation. Nous ne pouvons pas comprendre le processus de liberté sans faire le lien entre l’intérieur et l’extérieur.
K : Ai-je bien compris la question ? Vous dites que la division entre l’extérieur et l’intérieur est fausse. Je suis d’accord avec vous. C’est un mouvement comme une marée, qui va et vient. Donc, ce qui est à l’extérieur, c’est moi ; moi, c’est l’extérieur.
L’extérieur est un mouvement de l’intérieur ; l’intérieur est le mouvement de l’extérieur. Il n’y a aucune dichotomie. Mais en comprenant l’extérieur, ce critère me guidera vers l’intérieur, de sorte qu’il n’y ait pas d’illusion, car je ne veux pas être trompé à la fin. L’extérieur est donc l’indicateur de l’intérieur et l’intérieur est l’indicateur de l’extérieur. Il n’y a pas de différence. Mon rôle n’est pas de me débarrasser de l’extérieur ; je dis que j’en suis responsable. Je suis responsable de tout ce qui se passe dans le monde. Mon cerveau n’est pas mon cerveau : c’est le cerveau de l’humanité, qui s’est développé à travers l’évolution et tout le reste. Il y a donc une responsabilité, politique, religieuse, sur toute la ligne.
New Delhi
5 novembre 1981 Session du matin