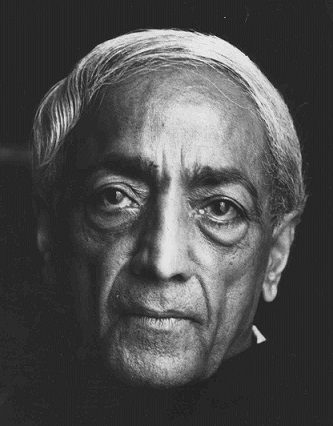Pour les noms complets des participants, voir ici.
P.J. : Rimpocheji a posé une question : en vous écoutant au fil des années, on a le sentiment que la porte est sur le point de s’ouvrir, mais elle ne s’ouvre pas. Y a-t-il quelque chose qui nous inhibe ?
A.P. : Nous vivons dans le temps. Trouvons-nous que la porte de la perception est fermée parce que la perception est absente ?
P.J. : Beaucoup d’entre nous ont ce sentiment d’être sur le seuil.
B.K. : C’est vrai pour nous tous, mais une partie du problème également — et c’est peut-être implicite dans la question — est que nous avons peur d’ouvrir la porte à cause de ce que nous pourrions trouver derrière.
P.J. : Je n’ai pas dit cela.
A.P. : Ce que vous dites impliquerait qu’il y a quelqu’un qui ouvre la porte. Ce n’est pas comme cela.
K : Qu’est-ce qui empêche quelqu’un, après avoir fait preuve de beaucoup d’intelligence, de raison, de réflexion rationnelle et après avoir observé sa vie quotidienne, qu’est-ce qui nous bloque tous ? Telle est la question, n’est-ce pas ?
P.J. : Je dirais même plus. Je dirais qu’il y a eu de la diligence, du sérieux, et nous avons discuté de cela pendant des années.
K : Mais pourtant, quelque chose ne fonctionne pas. C’est la même chose. Je suis une personne ordinaire, assez bien éduquée, avec la capacité de m’exprimer, de penser intellectuellement, rationnellement et ainsi de suite ; il manque quelque chose de totalement essentiel à tout cela, et je ne peux pas aller plus loin — est-ce cela la question ? De plus, est-ce que je perçois que toute ma vie est terriblement limitée ?
P.J. : Je dis que nous avons fait ce qu’il fallait faire. Nous avons pris les décisions.
K : Très bien. Que peut faire un homme ou une femme qui a étudié K, qui a discuté toutes ces années, mais qui se retrouve face à un mur ?
P.J. : Je ne suis ni ici ni là ; je suis entre les deux. Je suis au milieu du courant. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes là ni que vous n’avez pas commencé. Vous devez en tenir compte, monsieur, même si vous dites qu’il n’y a pas d’approche progressive.
K : Alors, quelle est la question ?
P.J. : C’est comme si quelque chose était sur le point de s’ouvrir, mais cela ne s’ouvre pas.
K : Êtes-vous comme le bourgeon qui a traversé la terre ; le soleil a brillé sur lui, mais le bourgeon ne s’ouvre jamais pour devenir une fleur ? Parlons-en.
G.N. : Le temps biologique pousse à l’action grâce à l’énergie inhérente qu’il contient. Vous dites qu’il en va de même pour le temps psychologique, qui propulse également une certaine forme d’action. Le temps psychologique est-il un dépôt, comme le temps biologique ?
K : Vous mélangez deux questions. Pupulji dit ceci : j’ai fait la plupart des choses, j’ai lu, j’ai écouté K, je suis arrivée à un certain point où je ne suis plus totalement dans le monde ni avec l’autre. Je suis prise entre deux. Je suis à mi-chemin et je n’arrive pas à aller plus loin.
B.K. : Je pense que la réponse a été suggérée par vous depuis plusieurs années, et c’est la réponse intellectuelle que nous donnons.
P.J. : Je ne suis pas prêt à accepter cela. Quand je pose cette question à K, tout cela, je l’ai vu et traversé.
B.K. : La partie rationnelle de l’esprit est réprimée.
P.J. : Non, ce n’est pas le cas. J’ai observé le temps. Je me suis plongé dans le processus du temps — le temps psychologique. J’ai vu son mouvement. Certaines des choses que K dit me semblent ainsi. Je ne peux pas dire qu’elles me sont totalement inconnues. Mais il semble y avoir un point où un saut est nécessaire.
K : En termes chrétiens, vous attendez que la grâce descende sur vous.
P.J. : Peut-être.
K : Ou bien cherchez-vous une intervention extérieure pour briser cela ? N’êtes-vous jamais arrivé à ce point où votre cerveau ne dit plus : « Je cherche, examine, demande », mais est absolument dans un état de non-savoir ? Comprenez-vous ce que je dis ? Quand le cerveau réalise : « Je ne sais rien », sauf en ce qui concerne la technologie — n’êtes-vous jamais arrivé à ce point ?
P.J. : Je ne dirais pas cela, mais je connais un état dans lequel le cerveau cesse de fonctionner. Ce n’est pas qu’il dise : « Je ne sais pas », mais tout mouvement cesse.
K : Vous passez à côté de mon point.
P.J. : Non.
K : Je crains de ne pas être assez clair. Un état de non-savoir — je pense que c’est l’une des premières choses exigées. Nous argumentons toujours, cherchons ; nous n’arrivons jamais au point de vacuité absolue, de non-savoir. N’en arrivons-nous jamais à ce point, de sorte que le cerveau soit vraiment à l’arrêt ? Le cerveau est toujours actif, cherchant, demandant, argumentant, occupé. Je demande : existe-t-il un état où le cerveau n’est pas occupé par lui-même ? Est-ce cela le blocage ?
M.Z. : Dans le vide, il y a une ouverture immense où rien n’est stocké, où il n’y a aucun mouvement, où l’état d’ouverture du cerveau est à son maximum.
K : Je n’introduirais pas tous ces mots pour l’instant. Je demande simplement s’il existe un moment où le cerveau est totalement inoccupé ?
S.P. : Que voulez-vous dire par « totalement inoccupé » ?
B.K. : Il ne pense pas en ce moment-là. Il est vide.
K : Voyez le danger, car vous traduisez tous ce que j’ai dit.
J.U. : Toute action s’inscrit dans un cadre spatio-temporel. Essayez-vous de nous amener au point où nous voyons que toute action telle que nous la connaissons est liée au temps et à l’espace, est une illusion, et doit donc être niée ?
K : Oui. Elle est niée. Est-ce une théorie ou une réalité ?
J.U. : Parlez-vous de cet état qui se situe entre deux actions ?
K : Commençons par enquêter sur l’action. Qu’est-ce que l’action ?
J.U. : En réalité, il n’y a pas d’action.
K : Tous, vous ne faites que théoriser. Je veux savoir ce qu’est l’action, pas selon une théorie, mais l’action elle-même, le faire.
J.U. : L’action est le mouvement de la pensée d’un point dans l’espace à un autre ou d’un moment du temps à un autre…
K : Je ne parle pas de la pensée se déplaçant d’un point à un autre, mais de l’action, du faire.
P.J. : Quelle est la question fondamentale ?
K : J’essaie de poser la question fondamentale que vous avez soulevée au début : Qu’est-ce qui nous empêche de fleurir ? J’utilise cependant le mot avec sa beauté, son parfum, sa joie. Est-ce essentiellement la pensée ? Je m’interroge. Est-ce le temps, ou est-ce l’action ? Ou bien, n’ai-je pas vraiment, profondément, lu le livre que je suis moi-même ? J’ai lu certaines pages du chapitre, mais je n’en ai pas terminé la lecture complète.
P.J. : À ce stade, je dis que j’ai lu le livre. Je ne peux pas dire que je l’ai lu complètement, car chaque jour, chaque minute, un chapitre s’y ajoute.
K : Non, non. Nous y sommes enfin. Je pose une question : avez-vous déjà lu le livre, non pas selon le Vedanta ou le bouddhisme ou l’islam ni selon les psychologues modernes, mais lu le livre ?
P.J. : Peut-on jamais demander si l’on a lu tout le livre de la vie ?
K : Si vous avez lu le livre, vous constaterez qu’il n’y a rien à lire.
J.U. : Vous avez dit que s’il y a perception de l’instant dans sa totalité, alors l’instant entier est.
K : Mais ce n’est qu’une théorie. Je ne critique pas, monsieur. Pupulji a dit : J’ai écouté K, rencontré divers gourous, médité. À la fin, il ne reste que des cendres dans mes mains, dans ma bouche.
P.J. : Je ne dirais pas qu’il ne reste que des cendres dans mes mains.
K : Pourquoi ?
P.J. : Parce que je ne les vois pas comme des cendres.
M.Z. : Nous sommes arrivés à un certain point. Nous avons exploré.
K : Oui, je l’admets. Vous êtes arrivés à un certain point et vous êtes bloqués là. C’est bien cela ?
P.J. : Je suis arrivé à un certain point, et je ne sais pas quoi faire, où aller, comment me tourner.
R.B. : Vous voulez dire que la percée ne se produit pas ?
K : Pourquoi ne pas être simple ? J’ai atteint un point, et ce point inclut tout ce que nous avons dit, et à partir de là que je vais commencer.
P.J. : Vous devez comprendre une chose. Il y a une différence, Krishnaji : entreprendre un voyage et ensuite dire que nous sommes dans le désespoir. Je ne dis pas cela.
K : Vous n’êtes pas dans le désespoir ?
P.J. : Non. Je suis également assez éveillé pour voir qu’après avoir voyagé, la fleur ne s’est pas épanouie.
K : Alors vous demandez : pourquoi la fleur n’éclot-elle pas, pourquoi le bourgeon ne s’ouvre-t-il pas — exprimez-le comme vous voulez.
A.P. : Pour sortir du contexte personnel, lorsque vous nous parlez, il y a quelque chose en nous qui réagit et dit que c’est juste, que c’est la vérité, mais nous ne parvenons pas à l’attraper.
P.J. : J’ai pleuré en mon temps. J’ai connu le désespoir en mon temps. J’ai vu l’obscurité en mon temps. Mais j’ai aussi eu les ressources pour m’en sortir, et, après m’en être sorti, je suis arrivé à un point où je dis : « Dites-moi, j’ai fait tout cela. Et maintenant ? »
K : Je viens à vous et je vous pose cette question : « Avec tout ce que vous avez dit jusqu’à maintenant, quelle serait votre réponse ? Au lieu de me demander, que me diriez-vous ? Comment répondriez-vous ? »
P.J. : La réponse est tapas.
A.P. : Tapas signifie qu’il faut continuer, ce qui implique le temps.
P.J. : Cela signifie brûler les impuretés qui obscurcissent votre vision.
K : Comprenez-vous la question ? « La pensée est impure » — pouvons-nous approfondir cela ?
R.B. : C’est très intéressant : la pensée est impure, mais il n’y a pas d’impureté.
K : Lorsque vous admettez que la pensée est impure — impure dans le sens où elle n’est pas entière…
R.B. : Oui, c’est ce qui corrompt.
K : Non. La pensée n’est pas entière. Elle est fragmentée ; par conséquent, elle est corrompue, impure, ou utilisez tout autre mot que vous souhaitez. Ce qui est entier est au-delà de l’impur et du pur, de la honte et de la peur. Lorsque Pupulji dit : « Brûlez l’impureté », écoutez cela de cette façon. Pourquoi le cerveau est-il incapable de percevoir la totalité et d’agir à partir de cette totalité ? La racine du problème — le blocage, l’inhibition, le fait de ne pas fleurir — est-elle la pensée incapable de percevoir la totalité ? La pensée tourne en rond. Et je me pose la question : supposez que je sois dans cette position, je reconnais, je vois, j’observe que mes actions sont incomplètes et que, par conséquent, la pensée ne peut jamais être complète. Par conséquent, tout ce que fait la pensée est impur, corrompu, pas beau. Alors, pourquoi le cerveau est-il incapable de percevoir la totalité ? Si vous pouvez répondre à cette question, vous pourrez peut-être répondre à l’autre question.
R.M.P. : Vous avez correctement interprété notre question.
K : Alors, pouvons-nous partir de là, ou est-ce impossible ? C’est-à-dire que nous avons exercé la pensée toute notre vie. La pensée est devenue la chose la plus importante dans notre vie, et je sens que c’est précisément la raison même de la corruption. Est-ce cela le blocage, le facteur qui empêche ce merveilleux fleurissement de l’être humain ? Si cela est le facteur, alors y a-t-il une possibilité de perception qui n’a rien à voir avec le temps ni avec la pensée ? Comprenez-vous ce que je dis ? Je réalise, non seulement intellectuellement, mais réellement, que la pensée est la source de toute laideur, de toute immoralité, d’un sens de dégénérescence. Est-ce que je le vois réellement, est-ce que je le sens dans mon sang ? Si oui, ma question suivante est : puisque la pensée est fragmentée, divisée, limitée, existe-t-il une perception qui soit entière ? Est-ce cela le blocage ?
J.U. : Mon esprit a été formé à la discipline de la séquence. Donc, il n’y a aucune possibilité de dire : est-ce possible ? Soit ce n’est pas ainsi.
K : Mon esprit a été formé à la séquence de pensée-pensée qui est la logique. Mon cerveau est conditionné au schéma cause-effet.
J.U. : Je suis d’accord que la pensée n’est pas complète.
K : Dès que vous convenez que la pensée est incomplète, tout ce que fait la pensée est incomplet. Tout ce que fait la pensée doit créer de la souffrance, des méfaits, de l’angoisse, des conflits.
A.P. : La pensée ne peut vous amener qu’à un certain point. Elle ne peut avancer que jusqu’à un certain point.
J.U. : Nous avons certains autres instruments, d’autres processus, mais vous semblez les écarter. Vous dissolvez tout ce que nous avons acquis. Supposons que nous ayons une maladie : vous ne pouvez pas la guérir, aucune intervention extérieure ne le peut. Nous devons nous libérer nous-mêmes de la maladie. Nous devons donc découvrir un instrument qui peut ouvrir la porte entre la maladie et la bonne santé. Cette porte n’est autre que la pensée qui, en un instant, brise l’emprise du faux, et dans cette rupture même, une autre illusion ou irréalité peut émerger. La pensée brise cela également, et de cette façon, elle nie encore et encore le faux. Il existe un processus de dissolution de la pensée et la pensée elle-même l’accepte et poursuit sa négation. Ainsi la nature même de la pensée est de percevoir qu’elle peut se dissoudre elle-même.
Tout le processus de la pensée est discrimination. Elle quitte une chose au moment où elle découvre qu’elle est fausse. Mais ce qui l’a perçue comme fausse est aussi la pensée.
K : Bien sûr.
J.U. : Par conséquent, le processus de perception utilise toujours l’instrument de la pensée.
K : Vous dites que la perception est encore de la pensée. Nous disons quelque chose de différent : qu’il existe une perception qui n’est pas du temps ni de la pensée.
R.M.P. : Nous voulons connaître votre position plus clairement. Veuillez développer.
K : Tout d’abord, nous connaissons la perception ordinaire de la pensée : discriminer, évaluer, construire et détruire, se mouvoir dans toutes les activités humaines de choix, de liberté, d’obéissance, d’autorité, et ainsi de suite. C’est le mouvement de la pensée qui perçoit. Nous demandons — et n’affirmons pas — s’il existe une perception qui n’est pas de la pensée ?
P.J. : Je me demande souvent quelle est la valeur d’une telle question. Vous voyez, vous posez une question, vous dites qu’aucune réponse n’est possible.
K : Non.
P.J. : Une réponse est-elle possible ?
K : Oui. Nous connaissons la nature de la pensée. La pensée discerne, distingue, choisit ; la pensée crée la structure. Il y a un mouvement de la pensée dans la perception pour distinguer entre le vrai et le faux, le mal et le bien, la haine et le bon. Nous savons cela, et comme nous l’avons dit, c’est lié au temps. Maintenant, devons-nous rester là, ce qui signifie : rester dans un conflit perpétuel ? Alors, vous demandez : existe-t-il une enquête qui nous mènera à un état de non-conflit ? Ce qui signifie quoi ? Existe-t-il une perception qui ne soit pas issue du savoir, le savoir étant expérience, mémoire, pensée, action ? Je demande : existe-t-il une action qui ne soit pas basée sur le souvenir, le souvenir étant le passé ? Existe-t-il une perception totalement dénuée du passé ? Voulez-vous enquêter avec moi dans cette direction ? Je le sais, et je réalise que cela implique un conflit éternel.
A.P. : Ce processus de pensée, dans le champ de cause et effet, n’a aucun moyen d’échapper à la réaction en chaîne. Ce n’est que servitude. Par conséquent, en l’observant, nous lâchons prise ici et maintenant. Ensuite, nous posons la question : existe-t-il une perception qui n’est pas liée au passé, qui n’est pas impliquée dans le passé, le passé étant tout ce que nous avons fait et ce à quoi nous nous sommes attachés ?
K : C’est une question rationnelle à poser : cela peut-il prendre fin ? Ce n’est pas une question illogique.
A.P. : Parce que nous avons appris par expérience que penser à travers le prisme de la cause et de l’effet ne peut pas nous libérer de la roue de la souffrance.
J.U. : Quel que soit l’instrument que nous avions, vous l’avez brisé. Avant qu’une maladie ne nous atteigne, vous l’avez supprimée, ce qui signifie que, avant que la maladie ne nous saisisse, elle est écartée. L’homme malade continuera à vivre. Par conséquent, lorsqu’il veut être libéré de la maladie, il est nécessaire de lui indiquer un processus par lequel il y parvient. Même après avoir renoncé à la chaîne de cause-effet, il faut lui montrer sa futilité. J’accepte qu’il soit difficile de le faire.
A.P. : Non. Ce que vous dites revient à affirmer que nous ne pouvons pas nous libérer de la roue du temps.
J.U. : Non, ce n’est pas ce que je dis. Cause et effet sont un mouvement dans le temps, et si vous dites qu’à la fin de cela il reste encore un « processus », cela doit être une forme d’activité mentale. Quelle qu’elle soit, la question est : peut-on laisser le patient mourir avant que la maladie soit guérie ? J’accepte le fait que la chaîne cause-effet est incomplète. Je comprends aussi que tant que nous ne pouvons pas la briser, ce dilemme ne peut être résolu. Mais la question est très simple : le patient doit être rétabli, pas autorisé à mourir. La maladie doit être guérie sans tuer le patient.
K : Si vous dites que la vie est conflit, alors vous restez où vous êtes.
P.J. : La métaphore qu’utilise Upadhyayaji est qu’il comprend tout le mouvement du conflit dans le temps et en voit l’inadéquation. Mais l’homme malade, l’homme qui souffre et veut être guéri, ne peut pas se tuer avant d’être guéri. Ce que vous demandez, c’est qu’il se tue.
K : Vous construisez un argument qui est intenable.
P.J. : Il peut l’exprimer différemment. N’oubliez pas non plus que le conflit est le « Je ». En fin de compte, la société et tout le reste peuvent disparaître. En fin de compte, il s’agit du « Je ». Toute expérience, toute recherche, tourne autour de ce qui est pensé, attrapé dans le temps en tant que conflit.
K : Donc, le « Je » est conflit.
P.J. : Je le vois de façon abstraite.
K : Non, pas de façon abstraite. C’est ainsi.
P.J. : Peut-être que c’est cela, au final, qui nous arrête…
K : Soyons très simples. Je reconnais que le conflit est ma vie. Le conflit, c’est « moi ».
A.P. : Après avoir accepté la futilité de la cause et de l’effet, ce qui reste, c’est l’identification à un certain réflexe habituel. Cette identification se brise-t-elle ou non ? Si elle ne se brise pas, alors notre dialogue ne se situe qu’au niveau théorique.
K : N’introduisez pas plus de mots. Quand vous dites que le conflit prend fin, le « moi » prend fin ; là est le blocage.
P.J. : Je connais le conflit.
K : Vous ne le connaissez pas. Vous ne pouvez pas le connaître.
P.J. : Comment pouvez-vous dire cela ?
K : Ce n’est qu’une théorie. Réalisez-vous réellement que vous êtes le conflit ? Est-ce que je réalise dans mon sang, dans mon cœur, au plus profond de moi, que je suis le conflit, ou est-ce juste une idée à laquelle j’essaie de me conformer ?
J.U. : Si vous acceptez que la chaîne de causalité inclue l’impact du temps, de l’espace et des circonstances, nous devons reconnaître que c’est un problème majeur. C’est comme une roue, et tout mouvement de cette roue ne va pas résoudre le problème. Nous acceptons cela par la logique et l’expérience. Ce que j’essayais d’expliquer par la comparaison, c’est qu’un processus doit rester dans cette roue de la souffrance. Si la maladie n’existe pas, et si la roue de la souffrance n’existe pas, un principe vital doit quand même subsister.
A.P. : Le processus est continuité.
J.U. : Alors, qu’est-ce que c’est ? Est-ce immuable ?
A.P. : Quand la perception et l’action ne sont pas liées au passé, alors il y a cessation de la continuité.
K : Je sais seulement que ma vie est une série de conflits jusqu’à ma mort. L’homme peut-il l’admettre ? C’est notre vie, et vous venez me dire, devriez-vous continuer à faire cela ? Découvrez s’il existe une manière différente de regarder, d’agir, qui ne contienne pas cela. C’est la continuité, c’est tout ce que je dis. Ensuite, je suis un homme raisonnable, un homme réfléchit, et je dis, dois-je continuer ainsi ? Vous venez me dire qu’il existe une manière différente qui n’est pas celle-là et il dit qu’il va me la montrer.
J.U. : J’accepte que ce cercle de continuité dans lequel je me déplace ne nous mène nulle part. Je suis d’accord avec vous jusque-là. Là où il s’agit d’expérience, je clarifie ma position avec l’aide d’un exemple. Mais vous coupez l’herbe sous le pied de cet exemple en disant que je dois abandonner la continuité. Si la continuité est coupée, la question elle-même disparaît. Alors comment puis-je accepter la proposition selon laquelle je dois renoncer totalement à la continuité ?
A.P. : Il faut donc laisser tomber les exemples ou les comparaisons. Abandonnez tous les ancrages du passé.
J.U. : Si j’abandonne la comparaison, cela ne finit pas ; à moins qu’il n’y ait une fin, comment pourrait-il y avoir un nouveau commencement ?
K : Qui dit cela ?
A.P. : Vous avez dit que ceci est le temps ; vous avez dit nier le temps.
R.B. : Ce que Upadhyayaji dit, c’est ceci : La vie est conflit, temps, pensée. Il accepte qu’ils doivent disparaître.
K : Je ne demande pas que quoi que ce soit disparaisse.
J.U. : Si cela disparaît, alors quelle est la connexion entre cela et ce qui doit être ?
K : Je ne parle pas de connexion. Je suis un homme qui souffre, en conflit, dans le désespoir, et je dis que cela fait soixante ans que je suis dans cette situation. S’il vous plaît, montrez-moi une manière différente de vivre. Accepteriez-vous ce fait très simple ? Si vous l’acceptez, alors la question suivante est : existe-t-il une manière de regarder ou d’observer la vie sans faire appel au passé, d’agir sans l’opération de la pensée qui est le souvenir ? Je vais le découvrir. Qu’est-ce que la perception ? J’ai perçu la vie comme un conflit ; c’est tout ce que je sais. Il vient et me dit, découvrons ce qu’est la vraie perception. Je ne la connais pas, mais j’écoute ce qu’il dit. C’est important. Je n’ai pas apporté dans l’écoute mon esprit logique ; je l’écoute. Cela se passe-t-il maintenant ? L’orateur dit qu’il existe une perception sans souvenir. L’écoutez-vous ou dites-vous qu’il y a une contradiction, ce qui signifie que vous n’écoutez pas du tout. J’espère que vous l’avez saisi. Je dis, Achyutji, il existe une manière de vivre sans conflit. Va-t-il m’écouter ? Écoutez, et ne traduisez pas immédiatement en réaction — le faites-vous ?
A.P. : Lorsqu’une question est posée, lorsqu’on est confronté à un défi, il doit y avoir une écoute sans aucune réaction. C’est seulement dans un tel état qu’il n’y a aucune relation avec le passé.
K : Par conséquent, il n’y a pas de réaction, ce qui signifie quoi ? Vous voyez déjà. Vous comprenez ?
J.U. : Je n’ai pas compris l’état. Par exemple, au même moment, si l’on observe avec attention toutes les illusions, alors à la lumière de cette attention, tout le processus d’illusion est dissipé. Et ce même moment d’attention est le moment de la véritable observation. Est-ce ainsi ? Cela signifie que l’on observe « ce qui est » tel qu’il est.
P.J. : Krishnaji nous demande si nous pouvons écouter sans le passé, sans amener les projections du passé. Ce n’est qu’alors, dans une telle écoute, qu’il y a perception.
J.U. : C’est pourquoi je disais que si le moment chargé d’illusion peut être vu avec pleine attention, il devient le véritable moment de perception, car l’illusion est vue pour ce qu’elle est. Pour donner un exemple : je vois une pièce sur laquelle il y a le sceau du chakra d’Ashoka. L’autre face de la pièce est différente, mais ce sont deux faces de la même pièce. La vision, la perception qui était saisie dans le passé, est-elle la même perception ?
K : Non. Maintenant, monsieur, vous êtes un grand spécialiste du bouddhisme. Vous savez et vous avez beaucoup lu sur le bouddhisme ; vous savez ce que le Bouddha a dit, toutes les subtilités de l’analyse bouddhiste, de l’exploration, des structures extraordinaires. Maintenant, si le Bouddha venait à vous et vous disait, « Écoutez », l’écouteriez-vous ? S’il vous plaît, ne riez pas ; c’est beaucoup trop sérieux. Monsieur, répondez à ma question : si le Bouddha venait vers vous aujourd’hui, maintenant, assis là devant vous, et disait : « S’il vous plaît, monsieur, écoutez », l’écouteriez-vous ? Et il vous dit : « Si vous m’écoutez, c’est votre transformation ». Écoutez simplement. Cette écoute est l’écoute de la vérité. Vous ne pouvez pas discuter avec le Bouddha.
J.U. : Cette pure attention est le Bouddha et cette attention est l’action, qui elle-même est le Bouddha. C’est pourquoi je vous ai donné l’exemple de la pièce, qui a un sceau d’un côté et un autre sceau de l’autre côté.
K : L’écouteriez-vous ? Si le Bouddha me parlait, je lui dirais : « Monsieur, je vous écoute parce que je vous aime. Je ne veux aller nulle part, car je vois que ce que vous dites est vrai, et je vous aime. » C’est tout. Cela a tout transformé.
A.P. : Lorsque je suis conscient que c’est la parole du Bouddha, c’est la vérité. Cette vérité efface toute autre impression.
K : Personne ne l’a écouté ; c’est pourquoi il y a le bouddhisme.
J.U. : Il n’y a pas de Bouddha ; il n’y a pas à parler du Bouddha. Il n’y a que l’écoute et dans l’écoute juste, l’essence de cette sagesse qui transforme est là. Le mot Bouddha ou la parole du Bouddha n’est pas la vérité. Le Bouddha n’est pas la vérité. Cette attention elle-même est le Bouddha. Le Bouddha n’est pas une personne ; il n’est pas un avatara et il n’y a pas une chose telle que la parole du Bouddha. L’attention est la seule réalité. Dans cette attention, il y a perception pure. C’est prajna, l’intelligence ; c’est la connaissance. Ce moment qui était entouré par le passé, ce moment lui-même, sous le faisceau de l’attention, devient le moment de la perception.
K : Maintenant, écoutez-moi simplement. Il y a un conflit. Un homme comme moi arrive. Il dit, il y a une manière de vivre sans connaissance. N’argumentez pas. Écoutez simplement — écoutez sans connaissance, ce qui signifie sans l’opération de la pensée.
A.P. : Ce moment d’attention est totalement sans relation avec le processus de pensée, avec la causalité.
K : Je sais que ma vie est un conflit. Et je dis, existe-t-il une manière de regarder, d’écouter, de voir, qui n’ait aucune relation avec la connaissance ? Je dis qu’il y en a une. Et la question suivante est, comme le cerveau est plein de connaissances, comment un tel cerveau peut-il comprendre cette déclaration ? Je dis que le cerveau ne peut pas répondre à cette question. Le cerveau est habitué au conflit, il en est accoutumé, et vous lui posez une nouvelle question. Alors le cerveau est en révolte ; il ne peut pas y répondre.
J.U. : Je veux savoir cela. La question que vous avez posée est ma question. Vous l’avez posée avec clarté.
K : L’orateur dit, ne soyez pas en révolte, écoutez. Essayez d’écouter sans le mouvement de la pensée, ce qui signifie, pouvez–vous voir quelque chose sans nommer ? Nommer est le mouvement de la pensée. Ensuite, découvrez quel est l’état du cerveau lorsqu’il n’a pas utilisé le mot en voyant, le mot qui est le mouvement de la pensée. Faites-le.
R.M.P. : C’est très important.
A.P. : votre perception est cela.
J.U. : C’est vrai.
P.J. : La vérité est de voir l’incapacité du cerveau.
K : Ma vie entière a changé. Par conséquent, il y a un processus d’apprentissage totalement différent qui se déroule, qui est création.
P.J. : Si cela est en soi le processus d’apprentissage, alors c’est la créativité.
K : Je réalise que ma vie est erronée. Personne n’a besoin de le souligner ; c’est ainsi. C’est un fait et vous venez et me dites que vous pouvez faire quelque chose instantanément. Je ne vous crois pas. Je sens que cela ne pourra jamais se produire. Vous venez et me dites que toute cette lutte, cette manière monstrueuse de vivre, peut prendre fin immédiatement. Mon cerveau dit, désolé, vous êtes fou, je ne vous crois pas. Mais K dit, regardez, je vais vous le montrer étape par étape. Vous pouvez être Dieu, vous pouvez être le Bouddha, mais je ne vous crois pas. Et K vous dit, écoutez, prenez du temps, dans le sens, ayez de la patience. La patience n’est pas le temps. L’impatience est le temps. La patience n’a pas de temps.
S.P. : Qu’est-ce que la patience qui n’est pas le temps ?
K : J’ai dit que la vie est un conflit. Je viens et vous dis qu’il y a une fin au conflit et le cerveau résiste. Je dis laissez-le résister, mais continuez à m’écouter, ne rajoutez pas plus de résistance. Écoutez simplement, avancez. Ne restez pas dans la résistance. Regardez votre résistance et continuez d’avancer — c’est ça, la patience. Connaître la résistance et avancer, c’est cela, la patience. Alors il dit, ne réagissez pas, mais écoutez le fait que votre cerveau est un réseau de mots et vous ne pouvez rien voir de nouveau si vous utilisez tout le temps des mots, des mots et encore des mots. Alors, pouvez-vous regarder quelque chose, votre femme, l’arbre, le ciel, le nuage, sans un seul mot ? Ne dites pas que c’est un nuage. Regardez simplement. Lorsque vous regardez ainsi, que se passe-t-il dans le cerveau ?
A.P. : Notre compréhension, notre compréhension totale, est verbale. Lorsque je vois cela, je mets le mot de côté. Ce que je vois maintenant est non-verbal. Que devient alors la connaissance accumulée ?
K : Que se passe-t-il réellement, et non pas théoriquement, lorsque vous regardez sans le mot ? Le mot est le symbole, la mémoire, la connaissance et tout cela.
A.P. : Ce n’est qu’une perception. Lorsque j’observe quelque chose, en mettant de côté la connaissance verbale et regardant ce qui est non-verbal, quelle est la réaction de l’esprit ? Il sent que toute son existence est menacée.
K : Observez-le en vous-même. Que se passe-t-il ? Il est dans un état de choc, il chancelle. Alors, soyez patient. Regardez-le chanceler, c’est ça, la patience. Regardez le cerveau dans un état de choc et soyez avec lui. Tandis que vous l’observez, le cerveau se calme. Ensuite, regardez avec ce cerveau calme les choses, observez. C’est ça, l’apprentissage.
A.P. : Upadhyayaji, K dit que lorsque l’instabilité de l’esprit est vue et observée, lorsque vous voyez que c’est sa nature, alors cet état disparaît.
K : Est-ce que cela s’est produit ? Le lien est brisé. La chaîne est rompue. C’est l’épreuve. Alors, monsieur, poursuivons. Il y a une écoute, il y a une vision et il y a un apprentissage, sans la connaissance. Que se passe-t-il alors ? Qu’est-ce que l’apprentissage ? Y a-t-il quoi que ce soit à apprendre ? Ce qui signifie que vous avez effacé tout votre moi. Je me demande si vous le voyez. Parce que le moi est la connaissance. Le moi est fait d’expérience, de connaissance, de pensée, de mémoire ; mémoire, pensée, action — c’est le cycle. Maintenant, est-ce que cela s’est produit ? Si cela ne s’est pas produit, recommençons. C’est ça, la patience. Cette patience n’a pas de temps. L’impatience, elle, a du temps.
J.U. : Qu’est-ce qui sortira de cette observation, de cette écoute ? Cet état continuera-t-il, ou quelque chose en sortira-t-il qui transformera le monde ?
K : Le monde, c’est moi, le monde est le moi, le monde est les différents mois. Ce moi, c’est moi. Maintenant, que se passe-t-il lorsque cela se produit, réellement, et non théoriquement ? Tout d’abord, il y a une énorme énergie, une énergie illimitée, non une énergie créée par la pensée, l’énergie qui naît de cette connaissance ; il y a un type d’énergie totalement différent, qui agit ensuite. Cette énergie est compassion, amour. Puis cet amour et cette compassion sont l’intelligence et cette intelligence agit.
A.P. : Cette action n’a pas de racines dans le « je ».
K : Non, non. Sa question est, si cela se produit réellement, qu’elle est l’étape suivante ? Que se passe-t-il ? Ce qui se passe réellement, c’est qu’il a cette énergie qui est compassion, amour et intelligence. Cette intelligence agit dans la vie. Lorsque le moi n’est pas, l’« autre » est. L’« autre » est compassion, amour et cette énergie énorme et sans limite. Cette intelligence agit. Et cette intelligence naturellement n’est ni la vôtre ni la mienne.
Madras
16 janvier 1981