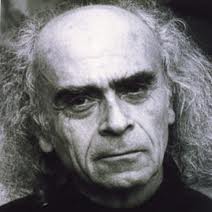(Revue Question De. No 57. Mai-Juin 1984)
Il fut un temps où tout récit d’origine populaire était considéré comme sous-production de l’esprit humain, divertissement à l’usage des arriérés mentaux, rêverie tout juste propre à faire peur aux enfants ou à faire passer d’interminables veillées d’hiver. Le Romantisme, par l’intérêt qu’il suscita autour du phénomène individuel par rapport à l’universel prêché par les systèmes classiques, inversa le jugement, parfois jusqu’aux limites de la niaiserie. Mais là encore, même si l’on reconnaissait dans les récits d’origine populaire, folklorique comme on commençait à dire, l’expression originale d’un peuple ou d’une certaine forme de civilisation, il ne serait venu à personne l’idée d’y chercher autre chose qu’une formulation mineure et secondaire de la littérature. En fait, tous ceux qui se sont intéressés au folklore, dès le XIXe siècle, se sont essentiellement bornés à la forme que celui-ci revêtait, et ils ont laissé de côté sa signification réelle, persuadés qu’ils étaient que son importance était toute relative. On s’ingénia ainsi à opérer des classements, des étiquetages, d’ailleurs fort utiles, mais qui relevaient de la simple muséologie. On fit des comparaisons entre les folklores des différents pays, mais ces comparaisons visaient d’abord à mettre en lumière l’indéniable supériorité d’une culture officielle, livresque, académique, qui, dans une certaine mesure, avait pu bénéficier d’un apport plus ou moins direct de la tradition populaire. En somme, les érudits de chef-lieu de canton qui avaient passé leur vie à collecter des récits populaires n’étaient que des amateurs éclairés, et leur travail n’était qu’un complément d’information pour la connaissance de la nature humaine.
IMPOSSIBLE D’EXPLIQUER
C’est d’ailleurs dans cette optique que les anthropologues de l’époque 1900 utilisèrent l’immense moisson de contes, de récits et de poèmes qui était à leur disposition. Cela ne fit que renforcer leur théorie de la « mentalité primitive » si chère à Lévy-Bruhl et aux fondateurs de la sociologie moderne. L’accent était mis d’emblée sur le caractère social de ces récits, témoignages incomparables de collectivités sinon primitives, du moins « en voie de développement ». Et comme la Psychanalyse n’a fait que se greffer sur la sociologie, les premières tentatives de Freud, tout en ouvrant des portes obstinément closes depuis des siècles, ont gardé un caractère hyper-rationaliste : il s’agissait avant tout de démontrer l’historicité des contes populaires, à la seule différence que l’histoire des contes est une histoire fantasmatique et non réelle dans les faits. Freud se nourrit de Frazer, mais s’il prétend démontrer la vie prodigieuse de l’inconscient, il s’ingénie à doter celui-ci d’une rationalité à toute épreuve : jamais la logique n’a été plus vénérée que dans l’œuvre de Freud, ce que n’ont pas suffisamment vu ses détracteurs, apparemment les plus rationnels de tous les savants de l’époque. Et lorsque Jung a dévié du schéma-type mis en place par Freud, celui-ci l’a désavoué, ce qui est bien caractéristique du non-engagement du père de la Psychanalyse dans les domaines interdits de ce qu’on appelle, faussement d’ailleurs, l’irrationnel. Car l’irrationnel n’est pas une situation, n’est pas un état, encore moins un dogme : c’est simplement un jugement provisoire de l’esprit constatant l’impossibilité d’expliquer un fait, quelle que soit l’origine de celui-ci, réelle ou fantasmatique. Mais quoi qu’il en soit, par le passage de l’étude synchronique des contes à leur étude diachronique, sur le modèle des études de la Linguistique, on en est venu à considérer que tout récit de tradition populaire orale recèle des schémas de connaissances qui remontent parfois dans la nuit des temps. C’est cela qui est important. C’est ce qui fait que le conte populaire ne peut plus désormais être confiné dans un rôle de simple divertissement.
LE CONTE VÉHICULE
Une œuvre dite « folklorique », c’est-à-dire appartenant à une « sagesse populaire », un récit d’aventures plus ou moins fantastiques ou merveilleuses, un chant d’amour ou de mort, une invocation guerrière ou magique, ces manifestations de l’art verbal instinctif et collectif ne peuvent vivre que sous forme de nombreuses variantes qui, finalement, leur confèrent leur spécificité. Le folklore est polystadial : chaque chant, chaque récit doit conserver différentes couches historiques qui, par la tradition folklorique elle-même, s’ajoutent les unes aux autres pour former une véritable Somme, incluant toutes les innovations dans des structures déterminées et assez stables. Dans ces conditions, il est vain de rechercher la date de composition d’un conte : le conte est indatable par nature, et seule sa transcription peut prendre place dans une chronologie.
Car le langage, ce qui inclut nécessairement l’art verbal des conteurs, est avant tout, comme l’ont mis en évidence Lévi-Strauss et les Structuralistes, un véhicule de significations. Ce serait d’ailleurs une erreur de croire qu’il s’agit seulement de significations rationnelles à l’échelle scientifique. Avec son intuition étonnante, Jean-Jacques Rousseau, dans son curieux et passionnant Discours sur l’origine des langues, lance cette affirmation que l’on a toujours fait « du langage des premiers hommes des langages de géomètres », alors que « nous voyons que ce furent des langues de poètes ». Et Rousseau formule un postulat fondamental : « Le langage figuré fut le premier à naître, le sens propre fut trouvé le dernier. » L’anthropologie semble donner raison à Rousseau : Les premiers hommes n’avaient nul besoin de parler quand il s’agissait d’augmenter la puissance d’un bras par 1’acquisition d’un caillou destiné à frapper de loin l’animal qu’il eût été dangereux d’affronter de près. Le geste a eu tout de suite un but utilitaire, immédiat, un but de survie. Cette survie étant atteinte, c’est-à-dire une fois satisfaite la triade des besoins fondamentaux de l’humanité (se nourrir, se protéger et procréer), une place pouvait être donnée aux rapports entre les êtres, rapports de haine ou d’amour, d’indifférence ou de curiosité. Là est l’origine du langage passionnel, qui n’est pas nécessaire à la survie immédiate, mais qui devient la marque spécifique de l’animal humain. Et comme le dit Benjamin Péret dans son Anthologie des mythes, contes et légendes populaires d’Amérique, « la pensée poétique apparaît dès l’aurore de l’humanité, d’abord sous la forme du langage, plus tard sous l’aspect du mythe qui préfigure la science, la philosophie, et constitue à la fois le premier état de la poésie et l’axe autour duquel elle continue de tourner à une vitesse indéfiniment accélérée ». Car si, selon Rousseau, ce sont les besoins qui ont provoqué le geste, ce sont les passions (au sens de phénomènes psycho-affectifs) qui ont provoqué le langage. Et un langage, pour être accessible à tous, a besoin d’être codifié : d’où la naissance du mythe, nœud primordial autour duquel s’articule toute expression.
L’APPARITION DES RITES
Or l’aspect poétique, qui est, en dernière analyse, celui du langage primitif, démontre le pouvoir créateur de ce langage. Poésie étant synonyme de création, on est bien obligé de constater que l’être humain, après avoir satisfait ses besoins essentiels, immédiats, a essayé d’influer sur son environnement. Se heurtant sans cesse à une nature hostile, il l’a combattue ou il l’a domestiquée. Mais à partir du moment où son action immédiate a buté contre l’obstacle inéluctable de la mort, le mythe s’est constitué pour aller au-delà du visible, au-delà du naturel, ou tout au moins de ce qui était considéré comme naturel. Le mythe est en réalité la codification précise d’une tentative pour échapper au destin humain qui est de mourir. De là la naissance des religions, ou de la métaphysique. De là l’apparition des rites qui, à l’origine, proposaient une alliance entre la Nature et l’Homme, alliance privilégiée par laquelle se dessinait une harmonie, une remise en cause fondamentale de la vie sur un plan déjà idéologique.
Or, ces rites, il fallait bien les conserver, les transmettre. C’est alors que le récit s’est fait véhicule de traditions. Le tout est de savoir le contenu de ces traditions, et de vérifier si elles sont authentiques. Comme nous n’avons pas les moyens techniques pour le faire, cette vérification ne peut être qu’hypothétique. La seule certitude est que le langage, parvenu à une forme élaborée de récit, transmet quelque chose. Le conte populaire, tel qu’il est actuellement, même dans ses aspects les plus contradictoires ou les plus altérés, est, selon toute vraisemblance, ce qui nous reste d’une lointaine « sagesse ». À nous de décoder le message qu’il véhicule.
MAGIE OU RELIGION ?
De toute évidence, le souci des soi-disant primitifs a été de transmettre à leurs descendants des recettes : pour mieux vivre, et aussi pour mieux mourir. Les anthropologues se sont essoufflés à essayer de savoir si les premières manifestations humaines contre le destin subi avaient été du domaine magique ou du domaine religieux. Les tenants du scientisme, tel qu’on le concevait jusqu’au milieu du XXe siècle, affirmaient que les pratiques magiques avaient précédé toute organisation religieuse, par conséquent tout dogme et toute conception théologique abstraite. L’animisme a fait la joie des étudiants en Histoire des Religions. Freud n’a pas manqué de sauter à pieds joints dans cette barque qui faisait pourtant eau de toutes parts, car cette proposition rationnelle n’explique rien. De l’autre côté, les partisans de la Tradition ont affirmé la prédominance de la Révélation, dogmatique ou mystique, supposant une divinité qui dévoile aux êtres humains les grandes lignes d’un projet dont ceux-ci sont supposés être les artisans. Cette conception n’explique rien non plus, puisque se retrancher derrière un Dieu qui parle ne constitue pas une preuve. En fait, il semble bien que ces deux positions extrêmes ne tiennent pas compte du facteur humain lui-même : un long balbutiement à la recherche de réalités profondes. Ces réalités ne sont certainement pas apparues d’un coup. Mais elles n’ont pas attendu un soi-disant âge de raison de l’humanité pour apparaître derrière les brouillards de la superstition. Il s’agit d’une fausse querelle, encore plus absurde que celle de l’œuf et de la poule. Ne considérer qu’un seul aspect des choses n’a jamais permis de reconstituer une totalité, même si Cuvier prétendait le contraire en dessinant ses monstres préhistoriques : car Cuvier avait des éléments de comparaisons, et l’analogie peut être considérée à bon droit comme le raisonnement anti-scientifique le plus utile à la Science.
Un simple regard sur n’importe quelle religion peut nous convaincre : les éléments magiques ne sont pas absents de la religion, même si celle-ci s’en défend avec énergie. La messe catholique est un rituel de magie, et de nombreuses traces en sont restées dans les assemblées protestantes les plus hostiles à la « superstition », ne serait-ce que la prière commune, ou les cantiques. Chercher à savoir d’où viennent ces relents de magie, s’ils ont été empruntés à des religions antérieures, c’est une autre affaire, et bien secondaire dans le sujet qui nous occupe. L’essentiel est de considérer la magie et la religion (au sens actuel du terme, et qui désigne les grandes religions établies) comme deux aspects d’une même réalité. À ce compte, le caractère antinomique se résorbe, et tout récit populaire qui véhicule une tradition est aussi respectable qu’un livre fondamental comme la Bible ou le Qoran.
Car tout conte populaire intègre des données d’observation concernant la lutte de l’individu contre le Destin. En fait, il s’agit presque toujours d’une transgression d’interdits. Le héros du conte populaire défie le temps, défie la société, défie la mort. Il lui arrive même de défier Dieu. Cet aspect blasphématoire n’est d’ailleurs ressenti comme tel que dans le cadre qui est le nôtre, c’est-à-dire celui d’une religiosité teintée d’un christianisme passif, entièrement voué à l’obéissance d’un Dieu tout puissant. Il en a été différemment dans d’autres sociétés, même des sociétés qui affirmaient leur christianisme, comme l’Irlande de l’âge des Saints. On nous raconte que saint Patrick jeûnait contre Dieu afin d’obtenir de celui-ci des faveurs qu’il s’obstinait à refuser. D’autres saints irlandais ont fait de même, et il n’y a pas de raison de douter des témoignages de leurs pieux biographes : ils ne faisaient que remettre au goût du jour une vieille coutume celtique païenne, à la fois juridique et magique, grâce à laquelle le faible pouvait avoir raison du fort lorsqu’il était certain de son bon droit. Dans ces conditions, où se trouve le fossé qui sépare la magie de la religion ?
LE PIVOT
Le pivot du conte populaire se résume toujours en une transgression, qu’elle soit volontaire, ou qu’elle soit inconsciente. L’un des types les plus répandus de récits merveilleux concerne les aventures d’un jeune homme, ou plutôt un jeune garçon, qui quitte sa famille très pauvre pour chercher fortune dans le vaste monde. Généralement, c’est le troisième fils, le plus jeune, et il suit exactement le même chemin qu’ont suivi ses deux aînés. Mais ceux-ci sont ou revenus sans avoir réussi, ou morts victimes de maléfices, ou prisonniers d’un enchantement, ou encore perdus dans un monde ressemblant à l’île des Rieurs de l’Odyssée. Et, au cours du récit, on apprend que leur échec est dû au fait qu’ils n’ont pas voulu, ou qu’ils n’ont pas su, transgresser certains interdits.
LA TRANSGRESSION ET…
Le plus jeune part donc sur la route, sans un sou, ou bien avec une bourse modeste que lui a remise son père ou sa mère. Une première épreuve se présente : une vieille femme lui demande de l’aider. Il accepte, et en récompense, il reçoit un objet magique, ou simplement un conseil, une direction à prendre. Il na pas conscience de la valeur du don, pas plus qu’il n’a agi dans un but intéressé en aidant la vieille femme. Mais désormais, il va être confronté à de nouvelles épreuves, parfois périlleuses, et il ne pourra réussir à les surmonter que parce qu’il a l’objet magique, ou parce qu’il peut appeler à son secours la personne qu’il a aidée. La signification est on ne peut plus claire : la rencontre avec la vieille femme était la première étape d’une initiation, et comme dans toute initiation – c’est-à-dire « commencement » –, chaque élément est indispensable. Ses frères ayant raté la première marche, ils n’ont pu gravir l’escalier. Lui, il le peut. On dit toujours que c’est le premier pas qui coûte le plus. La sagesse populaire prétend ainsi qu’une simple entrée dans un système de référence peut permettre l’accomplissement du périple dans sa totalité, compte-tenu des autres épreuves qui ne manquent pas d’apparaître. Et quand ces épreuves sont accomplies, le héros épouse généralement la princesse d’un étrange pays, princesse à laquelle il n’a pas droit, puisqu’il n’est qu’un roturier de la pire espèce, ce qui est surprenant quand on considère le caractère conservateur de la société rurale dont le conte est le témoignage. Ce caractère conservateur fait que chacun doit rester à sa place : les rois entre eux, les paysans entre eux. Mais il y a transgression. Peu importe que le héros se soit distingué par sa valeur, son intelligence ou son habileté : s’il parvient à la royauté, c’est bien par une sorte d’usurpation. Cette usurpation, il l’a pourtant cherchée inconsciemment. Et il la doit à des pouvoirs magiques qu’on lui a donnés ou dont il s’est emparé par une autre transgression. Et il ne pouvait en être autrement, car une transgression d’interdit entraîne fatalement une transgression d’un autre interdit : l’exemple fameux du héros irlandais Cûchulainn en est une preuve absolue. À partir du moment où il est obligé de manger du chien, ce qui constitue pour lui un interdit majeur (son nom contient le mot « chien »), il est amené par un jeu subtil provoqué par ses ennemis, à transgresser tous les interdits qui lui sont propres, jusqu’à sa mort. Certes, cet exemple va dans le sens de la déchéance, dans un sens négatif. Mais le héros de conte populaire n’est pas mieux loti. Transgressant un premier interdit, il est amené à en transgresser d’autres, jusqu’à son triomphe, son apogée. Alors commence la série des interdits négatifs, et malheur à lui s’il lui arrive d’en transgresser un seul, car il « commencerait » la chaîne de sa déchéance. Plus que jamais, tout est dans tout, et réciproquement, comme aurait dit Alphonse Allais qui était loin d’être innocent.
… L’USURPATION
Usurpation, transgression. Ce sont des synonymes de dépassement. Toute magie est dépassement puisqu’elle est lutte contre les frontières d’un réel imposé par la nature. Le héros du conte populaire, d’une façon ou d’une autre, est amené au stade de ce dépassement. S’il franchit la première frontière, on peut être assuré qu’il franchira les autres. Et rien ne lui sera impossible, ce qui évidemment donnera au récit cette allure merveilleuse et surnaturelle qui demeure la caractéristique essentielle du conte. Plus rien ne peut être comme avant. Plus rien n’est définitif : le héros s’embarque pour une navigation certes périlleuse, mais qui doit déboucher sur l’apparition de l’île merveilleuse, l’île des Pommiers, la Terre des Fées, où tout s’accomplit selon des normes irrationnelles, parce que non conformes au quotidien. L’irrationnel est transgression. C’est un mode opératoire qui donne à l’impétrant la possibilité de reculer au maximum les limites que la nature lui a imposées. Libre à chacun de nous de voir dans ces aventures de simples projections de l’esprit, une recherche désespérée d’un Paradis perdu qui serait, selon les lois de la Psychanalyse, la réminiscence de l’état utérin, ou selon les hypothèses de Mircéa Eliade, le retour aux temps primitifs, les temps de l’Age d’Or, moment des origines où les antinomies ne sont pas encore discernables. Le fait est certain : par une action particulière, en vertu de « pouvoirs » mystérieusement appris au cours de la quête, le héros a gagné le moyen de parvenir à l’extase. Cela est de la magie.
UN RITUEL NARRATIF
De même que les récits épiques, ou mythologiques, des anciennes civilisations nous livrent les éléments d’un rituel à composantes magico-religieuses, les contes populaires sont vraisemblablement les versions narratisées de pratiques cérémonielles. Les aventures du jeune héros pauvre qui, à la suite de diverses épreuves, parvient à épouser la fille du roi, sont en réalité identiques à la quête du jeune Perceval, « Perceval le Niais », lorsqu’il se lance sur le chemin du « Château des Merveilles », autrement dit le Graal. Les armes miraculeuses qui ne manquent jamais leur but, le chaudron inépuisable, la trompe avec laquelle on peut appeler l’être surnaturel secourable, le manteau d’invisibilité, le fruit de vérité, la baguette magique, la parole miraculeuse, tout cela appartient au héros qui a su franchir la première étape, la plus importante puisqu’elle conditionne toutes les autres. Grâce à cet outil merveilleux, le héros saura trouver la sortie du labyrinthe dans lequel il se trouve engagé. Ce sont donc incontestablement des symboles, des points de repère, encore qu’il faille s’interroger sur le sens du mot « symbole ». L’objet n’est en fait que l’aspect visible, concret, d’une démarche d’ordre spirituel, un peu comme la manipulation d’un alchimiste n’est que le prolongement matériel d’un concept vécu par l’opérateur. Il en est de même pour la « parole », la formule que le héros doit prononcer pour que s’accomplisse le miracle, c’est-à-dire la chose inexplicable et admirable qui fera de lui un triomphateur.
Nous sommes évidemment en pleine magie. Le héros est un opérateur qui, grâce à des « secrets », peut influer sur le destin. Il est le manipulateur qui dérange un ordre du monde fixé de façon immuable et qui se révèle tout à coup parfaitement muable. La Science contemporaine énonce des hypothèses semblables quant au rôle de l’ADN dans les phénomènes biologiques : la cellule vivante serait programmée, mais il existerait dans chaque cellule une part de liberté, c’est-à-dire de possibilité de mutation. Au lieu d’un déterminisme rigoureux qui semble l’héritage des fatalismes religieux de l’ancien temps, la Science contemporaine préconise l’Indécidable, le référant étant immuable et le référé parfaitement capable de modifier le contenu de sa propre programmation. Comprenne qui pourra, mais le héros du conte populaire, tout en n’ayant fait aucune étude de biologie ou de physique nucléaire, est à même de modifier la trajectoire qui avait été fixée pour lui. Il était pauvre, destiné à croupir dans sa médiocrité, tout juste bon à accomplir son devoir de reproduction. Et voilà qu’un beau jour, il abolit le temps, l’espace, les normes, voilà qu’il détruit les forces des ténèbres, qu’il lutte contre les oppressions, qu’il renverse les données de la morale et de la légitimité, voilà qu’il fait apparaître des énergies nouvelles, permettant ainsi au monde de se régénérer par lui et à travers lui. Serait-il le démiurge ?
Le problème est là. Le héros de conte populaire en bouleversant un ordre apparent des choses, agit comme un démiurge mythique, comme un enchanteur Merlin provoquant le destin et le néantisant. Il est sorcier. D’ailleurs, bien souvent, dans ce type de conte, le héros est aidé par un être extraordinaire, fée, sorcière ou sorcier, apparaissant sous forme humaine ou sous forme animale, vieille femme édentée et hideuse qui se révèle bientôt être une radieuse princesse, géant ou nain, ombre évanescente ou voix dans la nuit. D’après le contexte, il est certain que ce personnage adjuvant n’est que le double inconscient du héros. Cela tendrait à démontrer que tout est contenu dans l’esprit humain et qu’aucun maître n’a à apprendre quoi que ce soit à un disciple, sinon à faire surgir de la zone ombreuse ce qui ne demande qu’à être mis en pleine lumière.
ÉVOQUER DES FORCES
Car au fond, le magicien n’a d’autre pouvoir que celui d’évoquer des forces qui existent à l’état latent dans la conscience – ou plutôt l’inconscience – du sujet. Le magicien n’est qu’un accoucheur. Il n’est jamais créateur. Il est le catalyseur des forces en présence. Il ne participe aucunement à la métamorphose qui ne concerne que le héros. Mais sans lui, cette métamorphose ne se ferait pas. Ainsi en est-il du chaman. Ainsi en devait-il être du druide. Ainsi en est-il du « sorcier » ou du personnage féerique des contes populaires : il n’est jamais le héros, mais tout en restant dans l’ombre, il manipule les ficelles d’un subtil jeu dans lequel s’effectue la mutation du monde. Encore une fois, il faut affirmer que toutes ces transformations qu’apporte le conte dans une société rurale éminemment conservatrice, sont autant de transgressions qui conduisent à une évolution en profondeur des esprits et de la matière même du conflit. Car le conflit est permanent entre l’être et la nature qui l’enserre. L’être ne peut sortir de sa gangue qu’en brisant celle-ci. D’où le merveilleux, et dans une dimension plus profane, le fantastique, qui est son substitut rationalisé. On a beau dire que de telles aventures se sont déroulées dans des temps passés, dans un illo tempore des origines, personne n’est dupe : de telles merveilles pourraient apparaître dans notre monde contemporain. Mais avons-nous suffisamment de force pour les susciter ? Et existe-t-il des magiciens capables de les provoquer ?
FANTASME OU RÉALITÉ ?
La référence a un illo tempore est pratique dans le sens où se déculpabilise ainsi l’esprit humain face à la Science et à la rationalité de la civilisation dans laquelle il se manifeste. Mais à y réfléchir, cette référence n’est qu’un prétexte, et de mauvais goût. Le symbole, dont on met en évidence la permanence et la force potentielle ne serait-il alors qu’un masque dont on affuble des réalités autrement agissantes et autrement convaincantes ? D’abord, le symbole est un moyen terme, interjeté entre deux éléments contradictoires. Ensuite, le symbole est polysémique, ce qui fait peut-être son charme poétique, mais qui contribue à le rendre parfois inaccessible si l’on ne possède pas la clef de l’énigme. Un conte populaire, bourré de symboles, est aussi incompréhensible qu’une thèse ontologique employant un jargon de spécialistes chevronnés. Pourtant, le symbole n’est qu’une image, une simple image ayant toutes les vertus du concret et toutes les nuances de l’incertitude.
On peut se poser une question essentielle : le symbole traduit-il un fantasme inhérent à la nature humaine, parfaitement universel et répandu dans le monde entier, comme l’histoire d’Œdipe tendrait à nous le faire croire, ou est-il la transcription codée d’une expérience individuelle présentée comme mémorable et exemplaire ?
La réponse à cette question est primordiale. Car si le symbole est un fantasme, le conte qui le véhicule n’est qu’une histoire à dormir debout, seulement révélatrice des désirs inassouvis de l’être humain à la recherche du Paradis perdu – ou futur. Alors, on peut affirmer sans risque d’erreur que le conte n’a aucune valeur magique et qu’il ne peut servir en rien à notre recherche passionnée d’un Graal, quelle que soit la nature de celui-ci. Le conte ne serait qu’un amusement, comme on l’a cru pendant tant de siècles. Le conte est le miroir de l’âme, sans plus.
Mais si le conte véhicule une série d’expériences individuelles mémorisées sous forme de constat codé, donc sous forme de symboles repérables et déchiffrables sous le manteau des fioritures poétiques, sa vertu – au sens étymologique – s’en trouve singulièrement réhabilitée. Alors, le Christ, sortant de son tombeau, et surtout de son linceul sans le déplier, comme semblent le prouver les savantes études faites sur le saint Suaire de Turin, devient une réalité à laquelle on ne peut échapper. Cependant, le récit de sa résurrection, rempli de merveilleux incompréhensible, bourré de symboles plus ou moins accessibles, est à l ‘image d’un conte populaire dont il a toutes les caractéristiques.
Le merveilleux ainsi mis en cause ne serait-il que la mémorisation d’un fait authentique, si incroyable qu’on en a fait un symbole ? Mircéa Eliade a dit quelque part que « si les symboles ne sont pas des symboles, il faut chercher très souvent leur origine au niveau de ce qu’on appelle le surnaturel ». Or le « Surnaturel », c’est tout simplement de l’irrationnel. Où est la limite entre les faits réels irrationnels, c’est-à-dire qui ne s’expliquent pas – actuellement – par la raison, et les faits surnaturels dont les contes populaires se font les témoins. L’œuvre entière de Mircéa Eliade est consacrée à l’étude des symboles, mais le célèbre « historien des religions » n’est rien moins qu’ambigu lorsqu’il essaye de définir le symbole par rapport à des faits primaires qui sont dus à l’expérience individuelle. Il suffit de s’intéresser au Chamanisme vu à travers Eliade pour se convaincre de cette ambiguïté.
LA TRANSE
Quand un chaman accomplit le « voyage », soit pour découvrir ce qu’il y a dans l’Autre Monde, soit pour ramener de cet Autre Monde l’âme d’un malade ou d’un fou, il entre en transe. Après être sorti de cette transe, le chaman prétend avoir « fait le voyage ». Et il décrit ce voyage sous forme de récit. Le conte populaire ne serait-il pas la transcription de ce récit, revu et corrigé par ce qu’on appelle la « sagesse populaire ». Or le chaman est un magicien, comme l’était le druide, la plupart du temps transcrit en latin par le terme magus. Le mage, le sorcier, le devin sont des spécialisations sacerdotales qui nous conduisent des religions établies aux superstitions de villages. Mais le rapport est indéniable. En langue gaélique d’Irlande, le mot drui, « druide », est devenu, par évolution, draoi à l’heure actuelle. Et il signifie « sorcier ». La sagesse populaire sait très bien que le sorcier est le successeur des druides. Elle sait également que le prêtre catholique « fait des tours de physique », et que si un prêtre ne fait pas ces tours de physique, ce n’est pas un bon prêtre. Cette sagesse populaire, ce « folklore », sait aussi que les contes sont les évangiles du peuple [1]. Sinon, il y a bien longtemps qu’elle aurait renoncé à les transmettre aux générations futures. Ce n’est pas pour rien que les conteurs populaires prennent soin de préciser les lieux de l’action qu’ils décrivent, les mécanismes du merveilleux et les résultats qui s’opèrent. Et ils ajoutent généralement qu’ils en étaient les témoins. Pourquoi mentiraient-ils ?
MAGIE SPÉCULATIVE OU OPÉRATOIRE ?
Car toutes les histoires rapportées dans les contes sont considérées comme vraies. Elles sont en somme « paroles d’évangile » et le doute n’est pas permis à leur propos. Une analyse interne rigoureuse nous ferait d’ailleurs apparaître que toutes ces histoires se déroulent selon une logique implacable, une logique qui est propre à l’univers du conte. Et, de même que les Épîtres de saint Paul sont l’aspect théorique, spéculatif, de la religion chrétienne primitive, tandis que les Évangiles en sont l’aspect concret, incarné, opératoire, les contes populaires sont les Évangiles de la magie tandis que le « grand » ou le « petit Albert », ainsi que « l’Agrippa » en sont les Épîtres. C’est au magicien d’interpréter et d’utiliser l’Agrippa, toujours difficile d’accès pour le commun des mortels. Les images contenues dans les récits sont d’une transmission et d’une compréhension plus aisées : elles s’adressent à la sensibilité. Et elles sont les images de la vérité. Libre à nous de croire ou de ne pas croire, et surtout d’opérer la subtile distinction entre ce qui est vrai et ce qui est réel, distinction que ne pose jamais l’auditeur d’un conte, pas plus d’ailleurs que celui de l’Évangile du jour. Il ne reste plus au conteur que de sous-entendre, à la fin de son récit, des paroles du genre « faites comme lui », et la similitude entre le conte et l’Évangile est parfaite.
C’est en ce sens que le conte populaire a été volontairement déprécié et calomnié : il représente assurément une « contre-culture », et les tenants de l’orthodoxie avaient toutes les raisons de s’en méfier. Mais lorsque la qualification d’enfantillage ne suffisait plus ou que la référence à un illo tempore était trop vague, il fallait lui donner une connotation inquiétante, d’où l’apparition d’une morale ajoutée, toujours conformiste dans ses conclusions, et le rôle imparti à des êtres classés comme diaboliques. Dès que les composantes magiques émergent quelque part, la religion officielle les nie, ou les dénature. C’est un problème de fond, puisque la religion prétend soumettre l’homme à l’ordre divin tandis que la magie propose à l’homme de modifier, en bien comme en mal, cet ordre divin. Mais le héros de conte populaire ne se soumet jamais passivement à l’ordre divin : même si, ayant réussi ses épreuves, il atteint un stade de conformité avec cet ordre, celui-ci n’est jamais comme avant, et le héros est responsable de cette mutation. Le conte populaire permet à l’être humain, dissimulé derrière le héros, de modifier un système que la religion lui proposait comme immuable.
LE CHARME
C’est donc une véritable magie opératoire qui est à l’honneur dans la plupart des récits de la tradition populaire. À vrai dire, il y a même une « comptabilisation » des moyens à utiliser, puisque compte et conte proviennent tous deux de la même souche, autrement dit le verbe latin computare, mot dans lequel référence formelle est faite à la pensée, au calcul, au déroulement d’opérations. L’accent est mis sur l’action humaine, en accord avec le proverbe bien connu : « aide-toi, le Ciel t’aidera. »
Car la magie est action humaine, alors que le fait religieux suppose une action divine. Contrairement à ce qu’on pense généralement, l’acte magique ne consiste pas à réveiller des forces invisibles, mais à les utiliser à son profit. En dernier ressort, c’est l’opérateur, donc l’homme – et dans notre sujet le héros du conte – qui est le deus ex machina. Et si on a vu, à bon droit, certaines pratiques chamaniques dans les contes populaires européens, on peut aussi y discerner la croyance fondamentale des Celtes, à savoir la puissance de l’être humain, puissance théoriquement sans limite puisque effet immédiat de la volonté. C’est aussi le Libre-Arbitre absolu, qui a constitué, aux premiers temps du Christianisme, la doctrine pélagienne. Celle-ci, c’est incontestable, s’est forgée dans un creuset qui n’était rien moins que celtique : le druide, c’est-à-dire le représentant de la classe sacerdotale, a tout pouvoir, non seulement sur les êtres, mais sur les choses. Et il fait obéir la nature, il la transforme, il l’utilise. Il est peut-être périlleux d’affirmer que les contes populaires recèlent des éléments druidiques, cela, nous n’en avons aucune preuve formelle, mais il est vraisemblable de le supposer.
Or le druidisme, d’après ce qu’on peut en savoir, est non seulement une religion solidement établie, un système de philosophie et une institution, mais encore une magie à la fois spéculative et opératoire. Ce n’est pas par hasard si le mot druide est traduit, chez les auteurs latins, par le mot magus. Il n’y a pas à s’étonner de voir le héros d’un conte populaire se servir d’une épée qui ne manque jamais son coup, ou d’une serviette qui procure abondance de nourriture et de boisson, ou d’une formule qui permet de changer d’aspect. On en voit bien d’autres dans les récits épiques irlandais ou gallois, qui sont le miroir de l’état antérieur de la tradition celtique. Quand le « dieu » Gwyddion, pour sauver les guerriers bretons du désastre, les « enchante » sous forme d’arbres [2], il accomplit un acte de magie. Les réminiscences de cet acte magique se retrouvent dans le Macbeth de Shakespeare, et on en reconnaît une explication rationalisée dans un célèbre passage de Tite-Live, quand un consul romain et son armée sont victimes de l’étrange chute des arbres d’une forêt. S’il y a de la magie, même déguisée et historicisée, dans des textes considérés comme des documents, pourquoi ne pas reconnaître cette magie dans des récits d’aventures merveilleuses ?
Il reste que le conte, par lui-même, possède sa propre valeur magique. Il en est ainsi pour toute œuvre d’art, pour tout poème qui, avant d’être un objet littéraire, est incantation, charme. Bien des commentateurs ont dit être « charmés » par les contes de l’ancien temps. N’est-ce pas un aveu ? »
_____________________________________________________________
1 C’est dans cet esprit que Claude Seignolle a pu intituler un de ses ouvrages « les Évangiles du Diable », le personnage du Diable étant une sorte de symbole, ou même d’allégorie, désignant l’acte de transgression.
2 J. Markale, les grands Bardes gallois, éd. Picollec, 1981, p. 74-81.