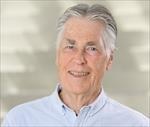La vie est souvent vécue comme une histoire exigeante et continue. Mais avec un peu de pratique, un nouvel espace s’ouvre pour une présence paisible.
Les programmes corps-esprit connaissent leur heure de gloire. Les essais contrôlés montrant les avantages pour la santé de techniques, telles que la réduction du stress basée sur la pleine conscience, le yoga, le tai-chi, les mantras et leurs variantes ont gagné une place respectable dans la médecine conventionnelle. Les études montrent une réduction rapide et durable de l’inquiétude et du stress, de l’anxiété, de la dépression, des douleurs chroniques et des comportements addictifs dans un large éventail de groupes démographiques. Les praticiens font également état d’une amélioration de la qualité de vie lorsque ces techniques sont utilisées en complément de traitements pour des maladies, telles que l’asthme, le syndrome du côlon irritable, les maladies cardiovasculaires et le cancer. Des analyses sophistiquées et des techniques d’imagerie montrent également des changements biologiques et structurels positifs accompagnant ces programmes. De plus, l’obligation de se rendre sur place, qui limitait autrefois leur accessibilité, est aujourd’hui allégée par la disponibilité en ligne.
Un avantage supplémentaire est que les techniques corps-esprit responsabilisent les personnes confrontées à des problèmes de santé, une attente souvent rare pour les malades. En effet, on suppose généralement que c’est au système de santé de les guérir. Mais même si le prestataire de soins recommande des changements à apporter pour améliorer notre santé et notre bien-être, il reconnaît qu’il est peu probable que nous les suivions systématiquement. Vous vous sentez anxieux ? Prenez ces pilules. Cette passivité semble convenir à la plupart d’entre nous, même si nous nous plaignons des délais et des résultats.
Les programmes corps-esprit renversent cette logique. Les traitements, si on peut les appeler ainsi, exigent un engagement actif : devenir curieux de nos comportements quotidiens et de nos réactions face à ceux que nous aimons, à la nourriture, à l’inconfort et envers la façon dont nous réagissons aux changements de nos symptômes. Il y a là un peu d’éthique libertaire : c’est votre esprit et votre corps, et vous êtes souvent le mieux placé pour les comprendre et les adapter. Ce type d’intérêt est essentiel pour réduire la détresse et la douleur, et pour se sentir plus en contrôle des symptômes.
Mais le stress, l’inquiétude chronique et la douleur — et non une maladie diagnostiquée — sont ce qui amène la plupart des gens à suivre ces formations. Le fait de savoir que le rythme du cortisol peut changer ou que l’insula — le centre du cerveau qui perçoit l’état interne du corps — pourrait devenir plus sensible peut justifier le fait de se présenter à ces formations. Pourtant, ce n’est pas ce genre de connaissances qui apporte la tranquillité d’esprit. Ce qui le fait, c’est de devenir conscient des processus qui nous empêchent d’être à l’aise. C’est là que commencent l’intuition et le changement.
C’est aussi ce qui rend le travail holistique. Non pas parce qu’il évoque le mystique, mais parce qu’il repose sur la reconnaissance que l’esprit et le corps ne sont pas des systèmes séparés, mais un réseau intimement entrelacé. Le cerveau, par exemple, est relié au reste du corps par des boucles constantes de signaux neuronaux, hormonaux et immunitaires. Mais nos instruments ne peuvent pas saisir pleinement ces boucles. Nous divisons donc l’organisme et étudions ce qui est disponible et mesurable. Ce n’est pas un défaut de la science, c’est une caractéristique. Mais elle façonne notre approche et les questions que nous posons, et elle nous incite à troquer l’ancien clivage corps-esprit contre un nouveau clivage corps-cerveau.
Bien qu’elle présente de grands avantages, la perspective scientifique détourne l’intérêt et la curiosité de l’expérience vécue. Pour combler ce fossé, nous avons besoin de plus que de cartes de circuits — nous devons comprendre quelque chose de ce que le système a évolué pour accomplir. C’est dans cet esprit que je vais partager ce que j’ai appris sur le système de fonctionnement de l’esprit au cours de 50 ans de pratique corps-esprit et de 20 ans d’observation et d’écoute des participants à mes cours et à mes essais cliniques, en lien avec l’anxiété d’être humain. C’est ma meilleure tentative pour décrire les processus mentaux par défaut qui nous rendent enclins à nous inquiéter en premier lieu — et comment ces programmes de pleine conscience nous aident à reconnaître et à modifier en douceur les processus par défaut qui alimentent la détresse quotidienne.
L’entraînement corps-esprit est un examen phénoménologique de notre vie interne afin de mieux la comprendre et la réguler
En effet, bien que les activités corps-esprit, telles que la méditation, le yoga, la relaxation ou la prière puissent sembler différentes, j’ai constaté qu’elles apportent des processus psychologiques communs au problème de la détresse mentale.
Qu’est-ce que ces programmes entraînent au juste dans l’esprit et le corps ? Il s’agit en fait d’une sorte de recherche phénoménologique que chaque pratiquant mène sur lui-même. Nous nous comprenons nous-mêmes dans le monde de tous les jours à travers notre vie mentale, et la formation corps-esprit est une recherche intérieure, un examen phénoménologique de notre vie interne pour mieux la comprendre et la réguler.
La formation commence par la curiosité et la prise de conscience de nos pensées, sentiments et sensations de tous les jours, de sorte que nous sommes à la fois dans l’expérience et en train de l’observer de près. Ce faisant, nous commençons à reconnaître des éléments de notre expérience si familiers qu’ils nous sont devenus invisibles, alors même qu’ils façonnent notre manière de percevoir le monde.
C’est la base. La reconnaissance apporte à la fois une connaissance immédiate et une capacité de contrôle. Et chacun va aussi loin que cela lui convient. Lorsqu’on leur demande en quoi cette pratique les aide, les réponses varient d’une personne à l’autre : Elle m’aide à me détendre, à écouter et à me sentir plus résistant face à l’incertitude et/ou à la douleur.
Alors, que se passe-t-il vraiment ? C’est une question de psychologie. La méditation consiste à prendre le temps d’observer son expérience intérieure. Les traditions diffèrent quant à la meilleure façon de procéder, mais il s’agit essentiellement d’être témoin des pensées, des sensations et des sentiments qui s’unissent pour former le récit qui préoccupe normalement l’attention. C’est une simple déconstruction qui déplace l’intérêt des histoires et de leur charge émotionnelle vers les éléments qui charge. Au lieu d’être emporté par le courant, on commence à s’intéresser à l’eau.
Vous commencez à reconnaître que les pensées et les sentiments sont des événements, qu’ils vont et viennent. Et dans cette reconnaissance, quelque chose change : non pas les pensées elles-mêmes, mais la relation que vous entretenez avec elles. Elles commencent à perdre leur emprise sur l’attention. Et dans ce relâchement, un espace s’ouvre — pour la stabilité, pour la perspective et, parfois, pour l’immobilité et la paix.
La familiarité même de notre esprit et de notre corps peut rendre toute tentative d’objectivité difficile. C’est pourquoi nous parlons de pratique. Les pensées banales sont facilement reconnues comme telles, mais les pensées chargées demandent plus de patience, car elles retiennent notre attention de façon répétée. Néanmoins, l’intérêt commence progressivement à se déplacer de leur contenu vers l’acte d’observation, comme lorsqu’on regarde passer la circulation. Ce simple déplacement apporte sa propre forme de soulagement et, pour beaucoup, c’est suffisant.
Observer son corps-esprit de cette manière permet également de mieux comprendre l’évolution de son système d’exploitation. Vous remarquez que, bien que vous ayez décidé de vous concentrer sur votre respiration, votre attention revient sans cesse à la voix dans votre tête. Celle que nous appelons généralement « je ». Vous pouvez également remarquer que la voix se préoccupe régulièrement des mêmes thèmes : la famille et les amis, la santé, le travail, le sexe et l’argent — ainsi que les personnes et les circonstances qui peuvent les soutenir ou les menacer.
Le fait de se préoccuper de ce qui pourrait mal tourner entraîne un niveau d’excitation chroniquement élevé et nuit à notre santé
En effet, cette voix persistante n’est pas aléatoire, elle est délibérée. L’esprit humain a évolué pour simuler des scénarios, anticiper les résultats et résoudre les problèmes avant qu’ils ne se produisent. Cette capacité étonnante à imaginer et à communiquer des passés et des futurs complexes — où nos besoins physiques et sociaux sont satisfaits — fut un triomphe de l’évolution. La prise de conscience des cognitions a pu permettre des plans toujours plus complexes : pour la chasse, le raid, le commerce, la sécurité, les alliés loyaux, l’empathie et la conscience de l’inévitabilité de la mort.
Pour les hominidés vulnérables, la planification et la révision constituaient la priorité évolutive. De même, les besoins de relation, de statut et de contrôle maintiennent une narration semi-vigilante pendant une grande partie de la journée, rendant nos corps tendus et mal à l’aise. Alors qu’une vie saine et pleine de sens dépend de la capacité à relever les défis et à saisir les opportunités qu’offre la planification, le fait de se préoccuper de ce qui pourrait mal tourner laisse l’excitation chroniquement élevée et nuit à notre santé.
Bien entendu, nous ne venons pas au monde préoccupés et inquiets de la sorte. Nous arrivons en tant que petites créatures sensorielles, curieuses et éveillées aux merveilles du toucher, du goût, de l’ouïe, de la vue, du mouvement et de leurs tonalités agréables ou désagréables. En nous frayant un chemin dans le délicat labyrinthe social, le passé et l’avenir se sont imperceptiblement mêlés à la pensée et au langage ; le fait de nommer et d’évaluer nous a permis de décrire nos besoins et nos impressions aux autres. Et comme nos projets doivent s’accorder avec le monde extérieur, nous sommes dès le départ des créatures empiriques, lançant de la nourriture depuis notre chaise haute, curieux de voir ce qui arrive à la fois à la nourriture et aux personnes qui nous entourent.
Ce récit cognitif émergent devient d’une manière indiscernable tissé à la perception, filtrant le monde sensoriel à travers ses espoirs, ses comparaisons, ses jugements et ses déceptions. Il devient progressivement un élément central du développement de notre sens de soi : l’histoire de « moi », qui je suis. Lorsqu’elle est au plus bas, je le suis aussi.
Impuissants à contrôler les pensées gênantes, nous recherchons des expériences qui détournent notre attention de ces dernières. Un repas, par exemple, est suffisamment agréable pour rediriger l’attention vers les sensations et le soulagement rapide de la tension qui s’ensuit. L’inconvénient est que beaucoup de ces stratégies ont des conséquences néfastes sur la santé ou la vie sociale.
Ces pensées vagabondes sont liées à un réseau dans le cerveau appelé « réseau du mode par défaut (default mode network) » (DMN). Ce réseau est le plus actif lorsque notre attention vagabonde, produisant des rêveries, des souvenirs et des conversations imaginaires. Son activité diminue lorsque nous sommes occupés à une tâche spécifique. Les gens rapportent aussi se sentir plus heureux à ces moments-là ; rappelez-vous ces moments de fluidité, où votre attention était absorbée sans effort par ce que vous étiez en train de faire.
Parfois, ce vagabondage est créatif ou apaisant. Mais il tourne aussi en boucle autour de thèmes autoréférentiels — ce que les autres pensent de nous, ce qui s’est mal passé, ce qui pourrait se passer ensuite. Lorsqu’il est trop actif, il peut alimenter l’anxiété et la rumination. C’est pourquoi les gens déclarent souvent se sentir plus heureux lorsque leur attention est moins autoréférentielle et totalement absorbée par les exigences d’une tâche. Dans ces moments de fluidité, on est absorbé sans effort par ce que l’on fait et le temps semble se dissoudre.
Les pratiques méditatives entraînent ce type d’attention. Avec la répétition, elles relâchent la préoccupation par défaut de l’attention pour le bavardage mental, laissant la conscience quotidienne plus ouverte à ce monde sensoriel oublié depuis longtemps.
Pour y parvenir, il faut souvent commencer par une étape simple : remarquer ce sur quoi on porte son attention. La plupart du temps, c’est ce récit interne — la voix dans votre tête, qui vous raconte des histoires ou vous fait des commentaires. La pratique consiste d’abord à remarquer cette voix et à rediriger doucement votre attention vers quelque chose de neutre sur le plan émotionnel.
La respiration est un choix courant. Plus précisément, les sensations dans la poitrine ou le ventre qui montent et descendent à chaque respiration. Il n’y a rien de mystique là-dedans — c’est simplement pratique. Ce sur quoi vous portez attention détermine votre niveau d’excitation, et la respiration est toujours neutre sur le plan émotionnel, toujours disponible et facile à ressentir. Essayez pendant une minute : portez votre attention sur les sensations de votre respiration. Vous n’avez pas besoin de modifier ou de réguler votre respiration, mais simplement de voir ce qui se passe lorsque votre attention passe du bruit des pensées à ces sensations corporelles. La directive peut sembler simple, mais vous remarquerez que l’attention ne reste pas là. Au contraire, elle revient par défaut à ce récit plus primitif, celui qui sert à satisfaire les besoins. Mais si vous persistez doucement, ces sensations respiratoires neutres remplacent le récit plus vigilant de l’attention, et votre esprit et votre corps commencent naturellement à lâcher prise.
Si vous trouvez cela utile, vous pouvez aller un peu plus loin.
La méditation tire parti d’une simple déconstruction : notre expérience quotidienne est constituée de pensées, de sensations corporelles et de la tonalité des sentiments qui les accompagnent — à quel point ils sont agréables ou désagréables. Alors qu’elles sont normalement entremêlées, la pratique de la méditation nous permet de les séparer et de les observer chacune séparément.
Au lieu de lutter contre le monologue, vous commencez à reconnaître les liens qui façonnent nos rythmes et nos déprimes
Une technique pour y parvenir consiste à les étiqueter mentalement. Lorsque quelque chose se présente à votre conscience, vous pouvez le nommer silencieusement. Par exemple, « pensée » pour une pensée, « tension » ou « fraîcheur » pour une sensation, « agréable » ou « désagréable » pour leur tonalité. Ce que nous appelons habituellement des émotions, telles que la tristesse ou la colère, sont abordées de la même manière : comme des suites composées de pensées, de sensations et de sentiments. Les étiquettes que nous utilisons n’ont pas besoin d’être exactes. Le simple fait de passer ainsi de l’expérience globale à ces fils distincts à l’intérieur de ce flux vous donne un point d’appui dans ce qui semble souvent n’être qu’un brouillard homogène.
Ce petit changement — passer de l’attention portée au contenu à l’attention portée au type d’événement dont il s’agit — peut interrompre la force d’attraction émotionnelle de l’histoire. Cela aide à commencer à reconnaître qu’il s’agit d’événements mentaux se produisant dans la conscience, et non de la totalité de ce que nous sommes.
Ces simples changements réinitialisent le système d’excitation. Au lieu de lutter contre le monologue, vous commencez à reconnaître les connexions rapides, habituellement passées inaperçues, qui façonnent nos rythmes et nos déprimes. L’attention n’étant plus automatiquement absorbée par le discours interne, les niveaux d’anxiété et de stress diminuent naturellement et nos sens moins filtrés sont à nouveau à l’écoute de l’immédiateté de la vie.
S’asseoir seul de cette manière peut sembler étrange pour une espèce aussi inlassablement sociale que la nôtre. Mais, comme pour le fait de tendre l’autre joue, le bouddhisme encourage également ce qui n’est pas instinctif. Lorsque nous détournons notre attention de sa fixation habituelle par défaut sur des passés construits et des futurs imaginés, nous commençons à reconnaître la nature construite d’une grande partie de ce que nous vivons comme étant nous-mêmes.
Ce que nous observons n’est pas le fruit du hasard, c’est la nature, structurée pour assurer la survie des primates tribaux. L’ampleur et la complexité de ces impératifs fantômes émergeant de la biologie furent une véritable nouveauté dans la nature et ont changé notre rapport au monde.
Les besoins imbriqués et enchevêtrés que ces processus servent résonnent à travers les commérages, l’art, la littérature, la politique et l’histoire. Et parce que nous ne pouvons pas nous souvenir d’une vie sans eux, ils deviennent l’eau mentale dans laquelle nous nageons — inaperçue, mais qui façonne tout.
Ces reconnaissances peuvent révéler des vérités au-delà de ces structures quotidiennes : le sentiment d’une identité fixe, l’idée d’un début et d’une fin, que nous aurions pu agir différemment, l’impression que nos pensées existent en dehors de la nature. Nous voyons aussi que sa fonction basée sur les besoins rend le récit intérieur naturellement égocentrique. Dans ces aperçus, nous commençons à voir — clairement, tranquillement, et peut-être pour la première fois.
Pour les psychologues et autres praticiens, la recherche corps-esprit commence souvent par une expérience personnelle. Tout comme la douleur et le stress amènent la plupart des clients et des patients à ces programmes, des défis personnels similaires motivent au départ la plupart des cliniciens et des scientifiques qui utilisent ou étudient ces techniques. La plupart du temps, nous ne l’avons pas appris au cours de notre formation clinique. En trouvant un bénéfice personnel, certains ont commencé à l’intégrer dans leur travail clinique. Quelques-uns, curieux de savoir comment cela fonctionne, ont lancé des projets de recherche qui ont commencé à produire les résultats des essais cliniques.
Les premières explorations s’inscrivaient souvent dans le contexte de la tradition spirituelle dans laquelle s’inscrivait l’activité. Les origines de ces recherches se trouvent principalement dans les traditions contemplatives asiatiques qui étudient la nature du soi.
Comme beaucoup d’autres, je suis arrivé à ce travail non pas par la théorie, mais par la nécessité. Je n’ai pas assisté à la remise de mon diplôme de doctorat. J’étais au lit, déprimé. Ayant grandi dans l’obscurité, j’avais réussi à entrer à l’université grâce à la chance et à la volonté de la Nouvelle-Zélande, dans les années 1960, d’offrir de secondes chances. Maintenant que j’avais obtenu une sorte d’imprimatur et que je commençais à travailler dans le domaine de la psychologie universitaire, mon état intérieur témoignait du peu de valeur réelle que j’avais à transmettre.
J’aurais dû suivre une thérapie. Mais nous étions au début des années 1970 et les psychédéliques promettaient une illumination rapide. La perspective d’un soulagement de toutes les souffrances sans avoir à creuser dans la terre était plus que séduisante, et je m’y suis mis de bon cœur. Mais un voyage cauchemardesque sous LSD qui s’est terminé aux urgences m’a fait envisager des approches plus douces, plus « orientales ». Cela m’a conduit à parcourir l’Asie et les États-Unis pendant deux décennies pour étudier et pratiquer les trois principales traditions bouddhistes, la pratique contemplative de l’Advaïta et le yoga.
Ce n’est pas la méditation qui m’a finalement aidée à panser mes blessures les plus profondes, mais la thérapie
La qualité de l’enseignement que j’ai trouvé variait énormément. Certains enseignants semblaient à peine moins confus que moi ; les pires étaient des charlatans et des destructeurs de vies. Mais je suis tombé sur quelques exemples, dont la générosité et la sagesse m’ont aidé à déballer les couches. Et quelque chose a commencé à changer. Les crises de panique que j’avais traversées en sueur depuis ce mauvais trip au LSD ont cessé. La rumination a été remplacée par une curiosité plus ouverte et une légèreté du corps et de l’esprit.
Mais la méditation n’est pas une panacée. Elle ne pouvait pas ramener les personnes que j’avais perdues ni réparer la confusion et la douleur d’une enfance passée dans l’obscurité. Croyez-moi, j’ai essayé. Ce n’est pas la méditation qui m’a finalement aidé à panser ces blessures profondes, mais la thérapie. La thérapie m’a permis d’exposer et de démêler les conflits inhérents à ce récit que je vivais encore sans le savoir, en faisant apparaître les lacunes et les contradictions afin qu’elles puissent relâcher leur emprise sur l’attention. Cela m’a également aidé à reconnaître que, même dans ses moments les plus désordonnés, le récit mental avait toujours essayé de m’aider, comme un ami bien intentionné qui n’a pas toujours raison, mais qui n’arrête jamais de se manifester.
La méditation ne convient pas à tout le monde. L’introspection n’est pas naturelle pour beaucoup d’entre nous, surtout dans une culture qui privilégie l’action à la réflexion. Si l’on ajoute à cela les représentations parfois exotiques ou ésotériques de pratiques méditatives, telles que le yoga, le tai-chi et d’autres, il est facile de comprendre pourquoi certaines personnes les considèrent comme trop « marginales ». Mais même pour ceux qui sont ouverts, la prudence peut s’avérer importante, en particulier pour les personnes dont l’état mental est fragile. Se tourner vers l’intérieur peut faire remonter à la surface des souvenirs douloureux ou un débordement émotionnel qui peut être difficile à gérer sans soutien.
Dépouiller ainsi la pleine conscience jusqu’à ses bras et ses jambes mentales, à ses mécanismes de base, peut sembler un peu froid. Certains préfèrent intégrer la poésie de la transcendance et les principes éthiques du bouddhisme dans leurs instructions de méditation. Mais les cliniciens ont besoin d’un cadre conceptuel à partir duquel ils peuvent adapter les principes corps-esprit aux circonstances et au tempérament de chaque patient. En tant que praticien, c’est le genre de cadre que j’aurais aimé recevoir il y a cinq décennies.
Il s’agit peut-être du cadre clinique, mais ce qui se passe dans la pratique est tout à fait différent. On peut considérer qu’il s’agit d’une approche de l’ineffable par le cerveau droit. Même un peu de pratique révèle quelque chose de plus profond : la conscience silencieuse et spacieuse dans laquelle nos pensées et nos histoires surgissent, les qualités transcendantes de la présence silencieuse dans laquelle le récit apparaît. C’est ce que certains appellent l’éternel présent — le point immobile et reconnaissant du monde qui tourne, où seule la poésie peut convenir. Mais c’est un thème pour une autre fois.
James Carmody est professeur de sciences de la santé des populations et de médecine à l’école de médecine Chan de l’université du Massachusetts, à Worcester, où il mène des recherches et enseigne les processus corps-esprit en médecine clinique. Il a été thérapeute, instructeur du programme du stress fondé sur la pleine conscience (Mindfulness-Based Stress Reduction) et directeur de recherche pour le Center for Mindfulness.
Texte original publié le 7 août 2025 : https://aeon.co/essays/we-live-inside-minds-always-planning-scanning-and-narrating