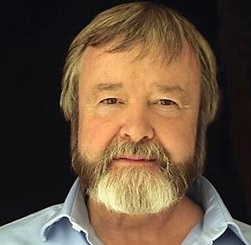Toute notre culture a été déformée par la croyance que nous aurions atteint une sorte de sagesse qui n’a jamais existé dans le passé ; une invention des dernières décennies. C’est une position tout à fait irrationnelle.
« Nous avons systématiquement mal compris la nature de la réalité », écrit Iain McGilchrist dans The Matter with things: Our Brains, Our Delusions, and the Unmaking of the World.
Faisant suite à son ouvrage de référence The Master And His Emissary, ce livre est une tentative du célèbre érudit de « transmettre une vision du monde radicalement différente de celle qui domine largement en Occident depuis au moins trois cent cinquante ans — certains diraient même depuis deux mille ans ». Non seulement nous avons mal compris la nature de la réalité, affirme McGilchrist, mais nous avons, à notre détriment, « choisis d’ignorer, ou de réduire au silence, la minorité de voix qui en a eu l’intuition et qui a constamment soutenu que c’était le cas ». Il est urgent de « transformer à la fois notre façon de penser le monde et l’idée que nous nous faisons de nous-mêmes », conclut-il.
Psychiatre, chercheur en neurosciences, philosophe et spécialiste de la littérature, le Dr McGilchrist est une espèce rare — un intellectuel très sophistiqué, souvent exigeant, qui a su pénétrer au cœur même de la culture dominante. Parmi ses correspondants, on trouve des collègues neurologues, mais aussi « un nettoyeur de laboratoire et un chauffeur de camion longue distance en Australie » — un témoignage éloquent de la vaste portée de son message.
J’interroge McGilchrist sur sa mise en garde sévère à l’égard du monde universitaire qui compromet la vérité, sur l’importance cruciale du contexte, sur la différence fondamentale entre le style parental de la mère et du père, sur notre dépendance à l’égard de la confiance, sur les raisons pour lesquelles l’hémisphère droit « est le plus important des deux », sur l’impact négatif de l’éloignement de la nature, sur la manière dont la tradition permet la croissance, ainsi que sur sur la spiritualité et la défense des choses qui comptent.
______________________
Hannah Gal : Vous avez réussi à faire quelque chose d’assez remarquable : être très visible dans les médias grand public. C’est tout à fait étonnant, car ce dont vous parlez est très complexe et très pointu.
Iain McGilchrist : Oui, pour une raison ou une autre, cela parle à tout le monde. Parmi mes correspondants, j’ai évidemment des neurologues, des psychologues et des philosophes, mais j’ai aussi des hommes politiques, un nettoyeur d’Oxford et un chauffeur de camion sur longue distance en Australie, il semble donc que je dise quelque chose qui touche à peu près tout le monde.
HG : J’ai interviewé Paul Taylor qui a quitté le monde universitaire très déçu, frustré par le fait que les étudiants ne lisaient pas, ou pas au-delà d’un certain nombre de mots.
IM : Ce n’est pas seulement dans certaines facultés, c’est un peu partout. On me dit que même dans les cours de littérature anglaise à l’université, les attentes des professeurs sont beaucoup plus limitées qu’auparavant, que les gens n’ont plus la patience de lire un long roman ou quelque chose de ce genre.
HG : Votre nom e a été mentionné concernant les normes universitaires — ce n’est pas seulement le fait qu’elles ne se concentrent que sur un seul sujet, c’est aussi la norme réelle de ce qui est attendu des étudiants, la qualité de recherche est souvent inférieure à la norme.
IM : Je pense que plusieurs choses se produisent dans les universités. L’une d’entre elles est la diminution de la capacité d’attention et de concentration soutenues ; une autre est l’abaissement des normes — et plusieurs facteurs y contribuent. Les jeunes quittent l’école et arrivent à l’université sans être préparés aux exigences qu’ils auraient dû respecter dans le passé, de sorte que les professeurs déclarent qu’ils doivent recommencer à faire du travail scolaire avec leurs étudiants. Lorsqu’ils obtiennent leur diplôme, ils ne dépassent pas beaucoup le niveau qu’on aurait attendu d’eux en fin de lycée auparavant.
Je pense qu’il y a un autre aspect. Autrefois, on s’attendait à ce qu’une personne étudie sa discipline dans le cadre d’une éducation générale, de sorte qu’elle ne l’étudie pas dans le vide, mais qu’elle puisse la voir en relation avec d’autres éléments qu’elle avait appris et avec lesquelles elle était capable de faire le lien. C’est moins courant aujourd’hui.
Et puis il y a ce que l’on appelle souvent les cours d’étude sur les « griefs », c’est-à-dire des cours qui examinent effectivement tout sujet à travers le prisme simpliste d’une question liée à la race, au sexe, à l’orientation sexuelle, etc.
J’ai récemment donné une conférence à Oxford intitulée Dominus Illuminatio Mea. Dominus Illuminatio Mea (« Dieu est ma lumière ») est la devise de l’Université d’Oxford. J’ai soutenu que les universités se trouvent aujourd’hui dans une situation très dangereuse parce qu’elles ont accepté un affaiblissement de l’idée même de vérité. Le problème a commencé, je pense, à l’époque où j’étais étudiant de premier cycle. Les théories dominantes étaient alors le marxisme et le déconstructionnisme.
Cela signifiait que dans le domaine que j’étudiais à l’époque — la littérature — les gens évitaient de répondre à l’œuvre d’art unique et la soumettaient plutôt à un examen idéologique. Dans le cas du déconstructionnisme, ils considéraient que l’intention de l’auteur n’était pas importante ; il n’y avait aucun moyen de distinguer entre ce que vous pensiez que cela signifiait et ce qui était faux. Le processus a commencé là, mais il s’est maintenant étendu vers une foule de cours d’études sur les griefs dans les sciences humaines.
Et maintenant, aussi incroyable que cela puisse paraître, même dans le domaine scientifique, il commence à être admis que des travaux produisant des conclusions scientifiquement irréfutables ne seront pas publiés s’ils ne s’alignent pas sur le discours culturel dominant. Ceux qui poursuivent de telles recherches seront punis ; ils seront exclus et ne seront pas promus. Ils n’obtiendront pas de financement et leur travail, aussi solide soit-il, sera qualifié de pseudoscience. « Pseudoscience » : c’est un petit coup de pied que l’on peut donner à tout ce qui ne plaît pas. Mais la science très faible, la science qui n’a que peu de preuves et qui n’est pas reproduite, sera acceptée tant qu’elle confirmera le discours actuel.
Le fait est qu’au lieu de chercher la vérité, nous cherchons à confirmer les préjugés que nous avons déjà, alors que tout l’intérêt de l’éducation est précisément de vous permettre de voir au-delà de vos préoccupations et d’être capable de comprendre une image plus large, à la fois dans le temps et dans l’espace.
Nous avons perdu tout sens de l’histoire. Si les enfants reçoivent un enseignement en histoire, celui-ci a tendance à être doctrinaire, suggérant que nous savons aujourd’hui beaucoup mieux que les gens du passé qui avaient « toutes ces idées absurdes ». En réalité, il y a là une sagesse qui a été perdue, et avec elle une capacité à voir ce que nous examinons dans un contexte aussi large que possible.
HG : Nous tournons actuellement un documentaire avec le Dr Warren Farrell. J’ai découvert une étude qui m’a vraiment troublé, dont le résultat était l’affirmation audacieuse que le fait de grandir dans un foyer monoparental n’a pas d’effet négatif sur les enfants. Cela fait maintenant plus de deux ans que je m’entretiens avec le Dr Farrell, qui étudie la privation de père depuis plusieurs décennies, et il a encore des questions à poser. Mais quelqu’un arrive et pose quelques questions à des enfants, et sur cette base, les gens lisent maintenant le titre « La science confirme désormais que les enfants n’ont pas besoin de père ».
IM : Ce phénomène est multiplié plusieurs fois par la façon dont les médias traitent les histoires et la façon dont ces choses passent dans la culture populaire. Ainsi, une étude peut produire des résultats différents de ceux d’autres études qui ont été constamment reproduites ; mais, tant qu’elle confirme ce que les gens veulent entendre, elle devient l’étude de référence, et la masse de preuves qui la contredisent est tout simplement ignorée.
HG : Selon Warren, les télomères des garçons privés de père sont plus courts que ceux des garçons ayant un père, ce qui signifie qu’ils auront une espérance de vie plus courte. Ai-je bien compris ?
IM : Tout d’abord, oui, ces choses sont vraies ; mais en un sens, elles sont des indicateurs d’autre chose de plus important et de plus réel, qui est la capacité à supporter le stress.
Le télomère est une zone située à l’extrémité d’un chromosome, comme un capuchon qui protège les extrémités du chromosome contre une lecture erronée de séquences brisées. Ces capuchons ont donc une fonction spécifique. Mais ils se raccourcissent ou s’érodent avec l’âge, ce qui est tout à fait normal ; et lorsqu’elles sont très érodées, la cellule cesse de se reproduire. Il est possible d’inverser ce phénomène, car il existe une enzyme appelée télomérase qui permet de relancer la croissance. Cependant, cette enzyme est également présente dans les cellules cancéreuses, ce qui explique pourquoi les cellules cancéreuses continuent à se reproduire, alors que le corps sait que ses propres cellules, celles qui fonctionnent correctement, doivent cesser de se reproduire à un certain moment. Donc, pour faire court, ce que cela nous apprend, c’est que les enfants, et en particulier les garçons, dont le père est absent (il y a de nombreux facteurs possibles, mais c’est l’un d’entre eux) sont plus stressés et plus susceptibles de souffrir de lésions dues au stress. En grandissant, ils se montrent moins capables de faire face à des situations difficiles : ils ne savent pas comment les affronter ni comment les surmonter. Au lieu de cela, ils peuvent manifester une sorte d’imprudence, ou un comportement violent, pour dissimuler leur sentiment de vulnérabilité.
D’ailleurs, il n’y a pas qu’à l’adolescence que les pères sont importants. Nous sommes des êtres biologiques et le sexe n’est pas qu’une construction sociale : au cours de la première année de sa vie, un bébé a besoin de sa mère. Cela peut déplaire aux femmes qui ont décidé que leur carrière était plus importante et qui renoncent donc à passer du temps avec leur enfant : c’est pourtant un fait. L’avenir de l’humanité dépend de l’éducation des enfants pour qu’ils deviennent des adultes stables et fonctionnels, sans quoi notre civilisation est condamnée ; les femmes jouent un rôle absolument central à cet égard, elles sont la clé du développement d’un enfant en adulte fonctionnel.
Nous savons que les bébés préfèrent leur mère à toute autre femme, mais ils préfèrent certainement les femmes aux hommes au cours de la première année de vie. Pendant cette période, la mère et l’enfant doivent négocier une séparation. À la naissance, et pendant les premiers mois, l’enfant ne peut se séparer de sa mère, il se perçoit comme fusionné avec elle ; mais au fur et à mesure qu’il apprend, il s’aperçoit qu’il y a en fait une séparation et que le rôle de la mère est de négocier cette séparation de manière à ce que l’enfant ne se sente ni menacé ni abandonné, tout en sachant que l’amour inconditionnel de la mère est toujours là, malgré le fait qu’il est une personne indépendante. Ce processus se joue au cours de la première année de vie.
Au cours de la deuxième année de vie, le père devient très important, car les tout-petits, au fur et à mesure qu’ils se développent, commencent à être rebelles, à dire « non » ; ils commencent à vouloir faire ce qu’ils veulent. C’est important et normal, mais ils ont besoin d’un père qui fixe des limites. Les pères sont généralement plus efficaces à fixer des limites d’une manière compréhensible pour l’enfant ; il est très difficile pour la mère d’être à la fois cet être nourricier et celui qui fixe les limites. C’est possible, mais c’est difficile. Les hommes semblent être conçus, en quelque sorte, pour maintenir l’ordre. C’est l’un des problèmes des enfants sans père, les garçons en particulier.
Mais pour les enfants — en particulier les garçons —, il y a tellement de problèmes à surmonter aujourd’hui. Tout dans notre culture actuelle leur dit que quelque chose ne va pas chez eux, qu’il y a une soi-disant masculinité toxique ; et bien sûr, je ne conteste pas qu’il puisse y avoir une sorte d’exagération inappropriée de certaines qualités masculines, mais cela ne fait pas des qualités masculines en elles-mêmes une mauvaise chose. Les garçons et les filles doivent apprendre différentes façons d’être, et c’est la danse de la vie, cela fait partie de la joie de vivre.
Quand je regarde en arrière — j’ai maintenant 70 ans — la génération qui me semble avoir négocié les mariages les plus heureux est celle qui est en train de disparaître. Je ne dis pas que tout était parfait ou mieux dans le passé, mais ils semblaient capables de trouver un équilibre : chacun avait son rôle, ses défauts, et ils se respectaient mutuellement. Cela fonctionnait. Aujourd’hui, nous sommes intolérants envers tout ce qui n’est pas une sorte de rêve, où l’autre personne devrait répondre à tous nos attentes et besoins. Mais la vie n’est pas comme ça ! Rechercher uniquement à se faire plaisir est probablement le pire conseil que l’on puisse donner, bien que ce soit celui qui prévaut dans une grande partie de notre culture.
HG : Warren dit que toute vertu poussée à l’extrême devient un vice – il le dit à propos du féminisme.
IM : Je suis d’accord. Il s’agit d’un point très fondamental et très important. Quelque chose semble bénéfique dans un contexte donné et est effectivement nécessaire, mais en vouloir toujours plus n’est pas forcément mieux. On atteint un certain point, mais ensuite on se rapproche d’un autre extrême ; ironiquement, cet extrême nous ramène parfois à l’endroit même dont on essayait de s’éloigner. Par exemple, une certaine liberté, un certain type de liberté calibrée et disciplinée, est extrêmement importante ; mais si l’on supprime toutes les règles et les limites d’une société, on obtient le chaos — et la fin du chaos, c’est la tyrannie. C’est ainsi que, dans le vide créé par le chaos, apparaît un régime véritablement toxique qui rétablira l’ordre : et les gens l’adopteront parce qu’ils ont tout perdu à cause de l’érosion d’un juste équilibre entre la responsabilité et la liberté, entre les privilèges et les devoirs.
HG : C’est tellement vrai. Lorsque vous avez parlé à Jordan Peterson de l’anorexie, je crois, vous avez abordé la question des TOC (trouble obsessionnel-compulsif) — comment certaines choses qui ne vont pas dans notre comportement et dans la société en général peuvent être attribuées à certains dysfonctionnements du cerveau — quelque chose dans le cerveau ne fonctionne pas comme il le devrait et cela modifie notre vision des choses ?
IM : J’ai écrit au moins deux livres sur le cerveau et la culture, mais ce que je m’efforce de dire, c’est qu’il existe une relation réciproque entre le cerveau et la culture. Ce serait erroné de penser que je considère le cerveau comme le moteur ou la cause de tout dans ce contexte. Ce qui se passe, c’est que lorsqu’une culture change, elle a un impact sur la manière dont nous utilisons notre cerveau ; et, en retour, la manière dont nous utilisons notre cerveau influence la culture. OAinsi, un cercle vicieux peut s’installer : une boucle de rétroaction positive, dans laquelle un changement ne contribuera pas à corriger la tendance actuelle, mais au contraire à l’intensifier.
Par exemple, je pense qu’au cours de la période allant d’environ 600 ans avant J.-C. à aujourd’hui, la culture occidentale a répété à trois reprises un certain schéma. Dans Le Maître et son émissaire, je suggère que ce schéma a été suivi par les civilisations grecque et romaine jusqu’à leur effondrement final. Ce schéma commence par une merveilleuse collaboration productive et harmonieuse entre les deux hémisphères, en s’appuyant sur leurs forces respectives ; mais progressivement et inéluctablement, cela devient de plus en plus dominé par la vision du monde de l’hémisphère gauche, et ce n’est alors qu’une question de temps avant que la civilisation ne tombe en ruine.
Dans notre monde moderne, au début de la Renaissance, il y avait une merveilleuse collaboration entre le point de vue rationaliste de l’hémisphère gauche et la position plus subtile, plus imaginative et en fait plus intelligente de l’hémisphère droit. Les deux sont nécessaires, mais l’hémisphère droit est le plus important des deux, car il perçoit davantage, et devrait toujours avoir un droit de regard sur l’hémisphère gauche.
Depuis les Lumières, nous avons progressé dans un monde où nous avons perdu le contact avec ce que l’hémisphère droit connaît, avec sa sagesse et sa compréhension, une compréhension qui devrait faire partie intégrante de notre vie et qui nous serait très précieuse aujourd’hui. À sa place, nous avons externalisé la vision du monde de l’hémisphère gauche dans notre environnement, de sorte que partout où nous regardons, cette vision renforce en nous notre biais en faveur de l’hémisphère gauche. Il en résulte une boucle de rétroaction positive qui s’intensifie, entraînant une propagation de ce que l’on pourrait appeler, pour faire court, des tendances autistiques, à la fois chez les enfants et dans la culture en général.
Je dois dire qu’à mon avis, l’autisme n’est pas une entité simple et unique. L’hémisphère gauche ne comprend effectivement que le sens explicite, alors que l’hémisphère droit comprend surtout le sens implicite. Une autre différence connexe est que l’hémisphère droit comprend la signification du contexte et que les choses changent lorsque le contexte change, alors que l’hémisphère gauche pense que tout ce qui existe dans un contexte est identique dans n’importe quel autre contexte. Pour donner un exemple évident, de nombreux Occidentaux semblent penser qu’il n’y a qu’une seule « bonne » voie à suivre pour une société et, en conséquence, l’Occident a imposé aux autres cultures des conditions qu’elles doivent respecter en échange d’une aide. Dans certains cas, nous avons même soutenu une guerre pour remplacer une culture qui n’était plus approuvée de notre point de vue, même si cette culture était stable depuis des siècles. Certes, elle n’est pas la nôtre, elle ne correspond pas à nos conceptions régaliennes, mais nous n’avons pas le droit d’imposer notre mode de pensée à une autre culture, en particulier au vu du chaos que nous avons créé dans la nôtre.
HG : Les parents d’enfants autistes essaient souvent de les protéger en leur décrivant tous les scénarios possibles — ce qu’il faut faire dans toutes les éventualités, mais c’est une tâche impossible. Diriez-vous qu’il y a une déficience de l’hémisphère droit chez les autistes ?
IM : Oui, les psychiatres parlent de ce qu’on appelle le spectre schizoautistique. La schizophrénie et l’autisme sont des maladies clairement distinctes, mais ce terme souligne qu’elles partagent néanmoins de nombreuses caractéristiques. Il s’agit en partie de l’incapacité à comprendre l’implicite, à appréhender tout ce qui n’est pas certain, et la tendance à codifier, opérationnaliser, mécaniser sa vie afin de contrôler toutes les éventualités. C’est la paranoïa de l’hémisphère gauche, si l’on peut dire : les personnes qui ont cette façon de penser sont en fait des paranoïaques au sens large.
Je ne veux pas dire qu’elles ont nécessairement des délires paranoïaques, par exemple que leurs voisins complotent pour les tuer, mais je veux dire qu’elles ont une attitude anxieuse à l’égard des choses qui échappent à leur contrôle. Bien sûr, comme on l’apprend rapidement dans la vie, on ne contrôle pas grand-chose, à commencer par le lieu de naissance, l’identité des parents, l’intelligence, la taille, la beauté, l’éducation — rien de tout cela n’est sous notre contrôle. Il faut donc s’y habituer, et le secret de la sagesse est d’apprendre à utiliser ce que l’on a et à suivre le courant, au lieu d’essayer sans cesse de changer les choses et de se rebeller contre ce qui nous a été donné.
Je suis taoïste, et dans le taoïsme, l’idée est que tout fait partie d’un flux sage et que la personne sage s’adapte à ce flux : y résister et aller à contre-courant ne mène à rien. Cela ne signifie pas que votre avenir n’est pas libre, puisque ce que vous en faites dépend de vous ; mais il y a certaines choses que vous pouvez ressentir ; je peux aller là et les choses s’ouvrent à moi, il y a des possibilités, alors que si je continue dans cette direction, je finis par être malheureux.
Il y a eu un grand scandale en Grande-Bretagne, et probablement partout en Occident, à propos des enfants encouragés à croire qu’ils pourraient appartenir au sexe opposé. Cela était autrefois un problème très rare. En tant que psychiatre, je me suis occupé de deux personnes qui avaient un tel problème et j’ai pu les aider. Je pense qu’elles avaient raison de dire qu’elles n’étaient probablement pas en mesure de vivre confortablement dans le sexe qui leur avait été assigné biologiquement. Mais je n’aurai jamais imaginé que cela se transformerait en un problème général où les enfants sont amenés à se sentir incertains de leur sexe. J’ai un très bon ami neuroscientifique en Espagne ; il m’a raconté que ses filles de 7 et 11 ans sont revenues de l’école avec des dessins d’un garçon et d’une fille et qu’elles devaient placer le pénis sur la fille et trouver la place du vagin sur le garçon.
Il n’est pas étonnant que les taux de maladies mentales augmentent. Ce n’est pas bon pour les garçons, ce n’est pas bon pour les filles. Ils ont perdu toute certitude sur ce qu’ils devraient être, on leur dit qu’ils devraient pouvoir faire tout ce qu’ils veulent, et c’est une très mauvaise recette pour le bonheur.
Il existe ce qu’on appelle le « paradoxe du choix », qui montre qu’il est très bon d’avoir un peu de choix, mais que le fait d’avoir beaucoup de choix est source de détresse. Les gens n’arrivent pas à prendre de décision, ils se remettent constamment en question, pensent qu’ils ont pris la mauvaise décision, et finissent insatisfaits du choix qu’ils ont fait.
HG : C’est un processus inévitable, plus nous nous éloignons de la survie, plus nous nous rapprochons de la confusion et de la manipulation absurdes qui ont un effet néfaste sur notre bien-être, et c’est précisément ce que représente cette situation. Personnellement, je considère que c’est l’une des choses les plus cruelles qui aient jamais frappé l’humanité. Je ne peux pas croire que les gens ne défilent pas dans les rues, que les parents ne se déchaînent pas contre les enseignants. Là où j’habite, il y a eu un cas où les parents ont agi, les enfants revenaient avec tellement de matériel de ce type que même les parents qui ne se souciaient pas le moins du monde de ce sujet, qui n’y étaient pas sensibilisés, sont devenus furieux, car cela devenait tellement extrême. Un autre aspect est ce que Thomas Sowell dit à propos des enseignants en général — au lieu d’enseigner les matières principales, ils sont devenus des activistes sociaux.
IM : Toute notre culture a été faussée par la croyance que nous avons atteint une sorte de sagesse qui n’a jamais existé dans le passé ; et c’est juste quelque chose que nous avons inventé au cours des dernières décennies. C’est une position totalement irrationnelle. Dieu sait que ce n’est pas sage, mais, quelle que soit cette sagesse, doit-on l’imposer à tout le monde ? Aujourd’hui, toute personne travaillant dans une université, une école, un hôpital, la police ou l’armée est soumise à un programme d’endoctrinement assez semblable à celui que les régimes totalitaires avaient l’habitude d’imposer à leur population. C’est une forme de lavage de cerveau. Cela revient à dire que toutes les intuitions sont fausses ; or, les gens ont des intuitions et savent par expérience qu’elles sont en contradiction avec la théorie qu’on leur enseigne. Cela génère de l’anxiété, le sentiment d’être puni si l’on ne suit pas cette théorie, mais en même temps, on ne croit pas vraiment que ce que l’on nous enseigne soit la seule bonne façon de penser, et l’on se retrouve dans une situation intolérable.
Cela entraîne également de nombreux problèmes pratiques. Beaucoup de jeunes se détournent aujourd’hui des professions libérales parce qu’ils ne veulent pas être soumis au contrôle bureaucratique écrasant d’un système qui ne s’intéresse pas vraiment à la question de savoir s’ils sont de bons enseignants, chercheurs ou médecins : ce qui compte, c’est de savoir si leur travail est conforme ou non à certains principes, si les cases ont été cochées. Les gens qui m’ont enseigné auraient préféré renoncer à leur carrière plutôt que d’accepter ce genre d’absurdité. La manière dont nous étions éduqués visait précisément à nous préserver de ce genre d’endoctrinement — pour examiner les choses, les remettre en question, demander où sont les preuves de cela. Et bien sûr, plus la proposition que vous essayez d’imposer aux gens est ridicule, moins vous pouvez vous permettre de tolérer la moindre dissidence ; ainsi, l’une des raisons pour lesquelles nous ne sommes même pas autorisés à remettre en question les choses qui sont dites au sujet de certains groupes « protégés » est que si nous commencions à les remettre en question, nous nous rendrions compte que ces idées sont largement sans fondement.
HG : Oui, et cela a un impact sur notre liberté d’expression parce que si vous commencez à tordre votre vérité pour ainsi dire, à faire des compromis sur ce que vous dites ou ne dites pas, vous n’êtes plus honnête. Vous n’avez pas le choix, vous êtes acculé et cela compromet l’honnêteté au sein de la société dans son ensemble, tout devient compromis.
IM : Absolument. Et si je puis me permettre, je pense que l’impact de ce phénomène est largement sous-estimé. On ne peut pas faire confiance aux gens si l’on pense qu’ils ne disent pas la vérité, et la confiance est ce dont une société dépend absolument. Un ancien empereur chinois disait que pour prospérer, une société a besoin de trois choses : des armes, de la nourriture et de la confiance. Si vous ne pouvez pas avoir les trois, débarrassez-vous des armes ; si vous ne pouvez pas en avoir deux, privez-vous de nourriture ; mais la seule chose que vous ne devez jamais, au grand jamais, perdre, c’est la confiance.
La société repose sur la confiance. Nous ne sommes pas heureux lorsque nous ne pouvons pas faire confiance, et la confiance et la vérité sont des mots qui viennent de la même racine ; vous ne pouvez pas faire confiance à une société qui n’est pas honnête. Notre grande perte de confiance actuelle conduit à l’agression et à la confrontation : cette guerre entre les sexes, cette guerre entre les races, n’existait pas dans la même mesure lorsque j’étais enfant. Nous n’avons jamais pensé qu’un ami noir était nécessairement différent de nous. Nous n’avons jamais pensé que les hommes et les femmes devaient être opposés les uns aux autres. Mais maintenant, nous avons ces guerres : les hommes ne font plus confiance aux femmes et les femmes ne font plus confiance aux hommes ; et au lieu d’une relation facile avec quelqu’un d’une autre race ou d’une autre culture, la chose est devenue presque impossible à gérer, de peur de dire quelque chose qui offense. Cette situation n’est pas saine.
HG : Oui, et tout cela est inventé — dans le documentaire que j’ai mentionné, nous suivons la transition de Warren d’une féministe dans les années 60, lorsqu’il était membre de la National Organisation for Women et collègue de Gloria Steinem. À la base, le féminisme est une idéologie marxiste où il y a un oppresseur et un opprimé.
IM : Exactement. C’est une tragédie parce que la société est maintenant divisée en groupes dont l’un est oppresseur et l’autre opprimé. Ce qui est encore plus tragique, c’est que, si vous voulez vraiment savoir qui est victime de discrimination, ce sont les hommes blancs, qui représentent encore une très grande partie de la population de ce pays. Ils sont de moins en moins nombreux à vouloir s’exposer aux cris, aux insultes et à l’idée qu’ils ne valent rien : ils ne veulent donc pas aller à l’université. On leur dit d’emblée « vous n’entrerez pas dans une bonne université parce que vous êtes un homme blanc » ; ils sont donc complètement découragés dès le départ, et souvent, plutôt que de se présenter à l’université pour être rejetés au profit de quelqu’un qui n’est pas nécessairement plus intelligent ou mieux éduqué, mais qui coche simplement les cases requises, ils décident de se passer de l’université. Les universités sont en train de se tuer à la tâche. Les universités manquent de fonds, et avoir un département DEI (Diversité, Égalité, Inclusion) est très coûteux. Les soi-disant consultants en DEI sont employés à des salaires parfois plus élevés que les professeurs ou les médecins consultants dans les institutions qu’ils sont censés superviser. Plus généralement, les gestionnaires disent à des personnes qui ont des années d’expérience, voire une vie entière d’expérience et de compétences dans leur travail, ce qu’elles doivent faire. C’est assurément une situation insensée. Ensuite, parce que les coûts ne cessent d’augmenter, ils recrutent à l’étranger des personnes dont la principale qualification n’est pas leur intelligence, mais simplement le fait qu’elles peuvent payer de grosses sommes d’argent pour venir dans une université autrefois prestigieuse telle qu’Oxford.
HG : Vous avez écrit que parce que cela est guidé par l’idéologie, lorsque les gens regardent un texte, ils y voient de l’idéologie plutôt que de l’histoire.
IM : Oui, de l’idéologie plutôt que la connaissance. Cela renverse la direction de l’éducation, qui est censée élargir nos horizons, et non les rétrécir. Si vous regardez le passé avec une vision idéologique, vous trouverez le « patriarcat » partout, mais vous passerez à côté de tout le reste. Vous avez mentionné dans votre note que le contexte est très important et je crois qu’il est extrêmement important parce que les choses ne sont ce qu’elles sont que dans le contexte dans lequel elles apparaissent. Nous pensons que le monde est constitué d’éléments hors contexte, comme si on assemblait une machine — une pièce, une autre pièce et encore une autre ; mais en réalité, tout est ce qu’il est — cette pièce, ce fragment que vous avez localisé n’est en fait ce qu’il est que grâce au réseau de connexions et de relations dans lequel il existe.
Je crois qu’il n’y a pas de choses séparées du contexte qui les a créées et, par conséquent, les relations sont plus importantes que les choses elles-mêmes. Si vous imaginez une toile, vous pouvez y remarquer quelque chose et vous vous focalisez dessus en disant « il y a une chose, je peux la voir ». Mais cette chose n’est ce qu’elle est qu’en raison du réseau de connexions dans lequel elle existe.
Nous sortons constamment les choses de leur contexte. Il y a plusieurs contextes très importants que nous négligeons. L’un d’entre eux est le contexte historique. Je ne crois pas que nous soyons des individus atomiques qui surgissent soudainement dans le monde pour faire ce qu’ils veulent ; nous faisons partie d’un courant, d’un flux, et ce flux est continu. Il était là avant notre naissance, il continuera après notre mort ; nous en sortons et nous y contribuons au cours de notre vie, puis nous y retournons. Ce contexte est aujourd’hui absent parce que nous ne jugeons plus qu’il est important d’enseigner aux enfants l’histoire de leur civilisation.
Lorsque j’étais à l’école, nous apprenions les Grecs et les Romains, nous devions apprendre la pensée médiévale, la Renaissance, les Lumières, le romantisme, etc. afin de comprendre où nous en sommes ; pour que les idées que nous avons ne viennent pas de nulle part, mais que nous sachions quelque chose sur ce qui s’est passé dans l’histoire lorsque les gens pensaient ainsi.
Le contexte de l’incarnation est en train de s’éroder. Nous ne sommes pas des machines électroniques qui « chargent » et « téléchargent » des pensées, qui possèdent des « banques de données », etc. Nous sommes des êtres de chair et de sang et, ce qui nous permet de ressentir, d’éprouver des émotions, d’entretenir des relations profondes avec le monde et les autres, c’est ce que l’on ne trouve pas dans les données techniques. Pourtant et de plus en plus nous sommes encouragés à ne regarder que les données techniques, les mots sur la page, sans chercher à comprendre le reste.
Parfois, ce qui n’est pas dit est plus important que ce qui est dit. Cela est particulièrement vrai pour les choses vraiment profondes et importantes : la poésie, la musique, l’art, les mythes, les récits, les rituels et, surtout, la manière dont nous nous comprenons en tant qu’espèce par rapport à la nature et au cosmos dans son ensemble. Ces éléments ne peuvent pas être exprimés dans le langage d’un manuel de lave-vaisselle : technique : ils doivent être transmis de manière indirecte, implicite. Par conséquent, si vous ne voyez que l’explicite, vous manquez presque tout.
J’ai commencé par étudier la littérature à Oxford, et ce qui m’a frappé, c’est que l’œuvre d’art était implicite. Dès que vous rendez le sens d’un poème explicite, celui-ci semble trivial, mais dans son contexte, il est profondément important. Lorsque vous lisez un poème, il vous transmet beaucoup, beaucoup de choses ; mais une « traduction » de celui-ci dans un autre contexte ne vous dit presque rien.
L’importance du contexte social nous échappe également. C’est l’une des façons dont nous nous épanouissons. Nous savons que l’un des principaux facteurs de bonheur pour la plupart des gens est le sentiment d’appartenir à un groupe social dans lequel ils peuvent faire confiance aux autres, partager des valeurs et une vie commune. Cela ne procure non seulement un épanouissement émotionnel, mais aussi une santé psychique et physique.
J’en parle à la fin de Le maître et son émissaire. Il y a un endroit appelé Roseto, une communauté très unie d’immigrés italiens en Pennsylvanie. La raison pour laquelle les habitants de cet endroit semblaient jouir d’une si bonne santé, intriguait les chercheurs en sciences sociales. Ils fumaient et consommaient plus d’alcool que la moyenne, ne faisaient pas attention à leur poids, faisaient moins d’exercice que la norme, mais restaient en meilleure santé que la norme. Le secret, c’est qu’en tant que communauté italienne largement cohérente, ils partageaient leurs maisons, leurs repas et leurs cultes, ce qui a eu un impact sur leur santé physique, mais aussi, bien sûr, sur leur santé mentale et sur leur capacité à faire confiance aux autres, et donc à coopérer. Nous sommes nés pour cela, mais nous l’avons négligé.
Un autre contexte qui nous échappe est également très important : celui de la nature. Jusqu’en 1800, presque tout le monde vivait en contact étroit avec la nature, et même dans les villes, il y avait beaucoup d’espaces verts. Mais au cours des 200 dernières années, de plus en plus de personnes ont été déracinés des communautés où leurs ancêtres vivaient depuis des milliers d’années, emmenées dans des villes pour vivre dans des bidonvilles, où elles sont vraiment pauvres pour la première fois, et aliénées du monde de la nature.
De nombreuses recherches montrent que l’immersion dans la nature, même le fait d’être paisiblement seul et de prêter attention à la nature pendant une heure ou deux plusieurs fois par semaine, est tout aussi importante que n’importe quelle autre activité. Cela améliore votre acuité cognitive, si c’est important pour vous ; cela vous rend plus heureux, moins enclin à la dépression et à l’agressivité ; et cela améliore également votre santé physique.
Je ne pense pas que la nature soit là pour faire baisser ma tension artérielle — c’est une façon de penser utilitariste, typique de notre mode de vie actuel — mais c’est quelque chose qui est bien plus grand que nous, dont nous sommes issus. Nous sommes nés de la nature, et non de l’environnement, un mot qui suggère quelque chose autour de nous à gérer — il pourrait y avoir un « département » de l’environnement, comme c’est d’ailleurs le cas dans ce pays ; mais la nature, qui signifie littéralement quelque chose d’où nous sommes nés et où nous retournerons à notre mort.
Le troisième grand contexte qui nous échappe est le monde du sacré et du spirituel. J’ai été pris par surprise lorsque j’ai écrit The Matter of Things. Je savais que les effets de la nature étaient très bien étudiés et je connaissais les effets de la cohésion sociale, mais je ne connaissais pas les effets d’une vie spirituelle.
Par curiosité, j’ai décidé de faire des recherches pour savoir si une vie spirituelle avait un impact sur l’épanouissement. Les preuves sont indéniables : c’est ce qui a le plus grand impact de tous. Peu importe de quelle manière ou avec qui, mais le fait de vénérer, d’avoir le sentiment de quelque chose de plus grand et de fondamental qui induit en nous un sentiment d’émerveillement et d’humilité, un sens du sacré et du divin, a un effet colossal sur notre capacité à nous épanouir. Nous sommes devenus arrogants, nous pensons tout savoir, nous pensons tout comprendre, mais en fait notre savoir n’est qu’une goutte d’eau et notre ignorance un océan, comme l’a dit William James.
Donc, oui à votre idée que le contexte est très important. Je dis parfois que le contexte est tout, et je le pense vraiment, car rien n’est ce qu’il est sans contexte.
HG : L’aspect de la spiritualité et de la confiance est fascinant. Jordan Peterson a posé une question intéressante : pourquoi est-il important que nous ayons des relations sociales avec les autres ? Il y a de nombreuses raisons, mais une que je n’avais jamais envisagée est que l’interaction agit comme une boussole, nous aide à nous « positionner ». Lorsque nous parlons aux autres, lorsque nous nous déplaçons autour d’eux, lorsqu’ils se déplacent autour de nous, sans même y penser, nous nous repositionnons en quelque sorte. Si vous êtes seul et qu’il n’y a jamais de « retour » d’autrui, comment savez-vous où est votre place ? Comment savez-vous si ce que vous pensez résonne ou est absurde ? C’est si crucial que, pour punir quelqu’un, nous l’isolons, nous le privons de compagnie.
IM : Oui, nous sommes des êtres qui existent grâce à des liens. Mais je crois que tout existe à travers des connexions : les relations sont fondamentales. Si vous vouliez rendre les gens vraiment malheureux, vous les isoleriez socialement, comme vous le dites, vous les couperiez du monde naturel, vous leur feriez croire qu’avoir une orientation spirituelle est puéril ou réservé aux gens sans éducation. Puis vous les amèneriez finalement à douter de leur propre existence corporelle, à penser qu’ils peuvent inverser la nature et en faire ce qu’ils veulent, et être quand même heureux. Si vous vouliez vraiment rendre un peuple suicidairement déprimé, c’est exactement ce que vous feriez ; et c’est la société que nous avons aujourd’hui en Occident.
Je ne savais pas grand-chose de la foi juive jusqu’à il y a 10 ou 15 ans. Je me suis toujours intéressé à la théologie, mais principalement à la théologie chrétienne et aux religions orientales (zen, bouddhisme, taoïsme). Mais l’un de mes collègues, un théologien chrétien, a commencé à me parler de la Kabbale, et ce fut le début d’une longue recherche. À maintes reprises, j’ai découvert dans la kabbale des résonances avec des idées qui j’avais tirées de la philosophie et des neurosciences pendant plus de 30 ans. À plusieurs reprises, je me suis dit qu’il y avait là quelque chose de très important sur notre nature, compris intuitivement dans la Kabbale et maintenant confirmé par la science.
J’ai trouvé ce type de résonance dans d’autres traditions à travers le monde, mais la Kabbale en particulier a eu une grande influence sur moi, et j’en parle dans The Matter With Things.
HG : Vous avez un don incroyable — celui d’articuler tout cela avec une telle clarté. Je pense que cela peut expliquer pourquoi vous avez réussi à toucher le grand public.
IM : Je ne sais pas exactement comment cela s’est produit, mais beaucoup de gens semblent y répondre. Deux choses reviennent souvent dans leurs commentaires : « Quand j’ai découvert votre travail pour la première fois, j’ai été époustouflé » et aussi « Je vois maintenant le monde d’une nouvelle manière, et je ne peux plus le voir de la même façon qu’avant. Je vois tout à travers une nouvelle perspective ». Parfois, ils ajoutent : « Ce que vous dites, je le savais déjà d’une certaine manière, intuitivement, mais je n’avais aucun moyen de le mettre en mots, et vous m’avez aidé à le mettre en mots ».
HG : En ce qui concerne ce mépris de l’histoire, ce rejet de tout ce qui nous a précédés, cette façon ignorante de considérer l’ensemble de l’histoire comme une seule entité — tout ce qui nous a précédés est vieux et sans intérêt — ils ne voient pas le continuum dont vous parliez tout à l’heure.
IM : Cette façon de penser n’est pas seulement nuisible, mais aussi hautement irrationnelle. Pourquoi tous ces gens qui ont vécu des vies beaucoup plus intenses que la nôtre — non pas à distance, à travers des machines et des objets, mais en contact réel avec la nature — et qui ont enduré des guerres, et tout le reste, pourquoi leurs idées sur l’existence seraient-elles méprisables ? Pourquoi serait-il préférable que je fonde tout ce que je sais sur ma minuscule expérience individuelle plutôt que sur l’ensemble de la sagesse qui nous a été transmise en tant que tradition ?
La tradition n’est pas une chose à rejeter, elle est une source vivante de sagesse. Les gens pensent que la tradition est une sorte de fossilisation, mais en fait, la tradition est le seul moyen d’opérer un changement — c’est tout le contraire. Sans tradition, on ne sait pas comment changer ; une tradition n’est jamais statique. Je ne peux citer aucune période des 2 000 dernières années en Occident où la pensée a été statique pendant longtemps ; les choses se passaient et changeaient, mais toujours dans le cadre d’une tradition.
La différence entre avoir une tradition et ne pas en avoir est la suivante. Nous sommes comme une plante, et une plante a besoin de grandir, elle peut pousser le long d’un mur, ou ailleurs ; mais si vous voulez qu’elle aille quelque part, vous n’allez pas la couper à la racine et la coller là où vous voulez, vous allez lui permettre d’aller là en l’entraînant. Elle ira toujours dans une direction nouvelle.
De la même manière, une tradition est un flux vivant qui est la clé d’un changement organique. Le problème est que nous avons perdu ce sens du changement organique. Au lieu de cela, nous pensons de manière mécaniste, et c’est une grave erreur : nous disons « coupez tout », ou « théoriquement, ceci est juste, donc appliquons-le ». Et puis, bien sûr, la plante, une fois coupée, se dessèche ; et rapidement la civilisation s’effondre. Je crois que notre civilisation est aujourd’hui très proche de l’effondrement.
HG : Cela me rappelle la citation de Gustav Mahler : « La tradition n’est pas la vénération des cendres, mais la préservation du feu ». Si vous croyez, comme vous venez de le décrire, que vous pouvez simplement « couper la plante à la racine » — si vous laissez le feu s’éteindre, vous ne serez pas en mesure de le rallumer. Nous avons parlé précédemment du fait que les enfants ne sont pas préparés à la vie, qu’ils manquent de compétences et de résilience — ce à quoi on aboutit, comme le dit Thomas Sowell à propos de la chute de l’Empire romain, c’est que nous regardons les cendres et les ruines sans avoir les outils pour reconstruire.
IM : Oui, j’ai de la chance ou de la malchance à cet égard, selon le point de vue que l’on adopte. Mais je suppose que tout ce que je fais, c’est rassembler des connaissances dans un certain nombre de domaines différents — histoire, philosophie, littérature, sciences. C’était la norme autrefois, mais la raison probable pour laquelle les gens prêtent attention à ce que je dis, c’est que je suis l’une des dernières personnes à avoir eu la chance de bénéficier de ce type d’éducation. Je suis chanceux de ce côté, ou on pourrait dire que je suis malchanceux de vivre à cette époque.
Je pense que notre culture s’est féminisée. Je crois que dans le passé, il y avait un réel besoin d’équilibre ; et quand j’étais jeune homme, je me disais féministe. Je trouvais cela absolument merveilleux, parce qu’il y avait de nombreuses façons de penser et de nombreuses valeurs traditionnellement associées aux femmes qui étaient sous-représentées dans la culture de l’après-guerre, et je pensais qu’il serait merveilleux de les voir s’épanouir. Rapidement, cependant, il s’est avéré que ce qui était traditionnellement féminin a été décrié et que, dans le même temps, tout ce qui était traditionnellement masculin était simultanément imposé aux femmes et dénigré.
Or, pour vivre dans le monde, les femmes étaient obligées d’avoir une carrière et de s’occuper des enfants, ou elles devaient décider de renoncer à avoir des enfants ou à avoir une carrière ; mais de toute façon, dans cette situation, elles étaient obligées de devenir plus masculines, dans le sens où leurs attitudes, leurs dispositions devenaient plus masculines.
Ainsi, alors que nous aurions pu célébrer la préservation et la perpétuation des valeurs et des points de vue qui ont traditionnellement été ceux des femmes, ce qui s’est réellement produit, c’est que les femmes les ont abandonnés et ont adopté une position masculine, tout en désignant les valeurs masculines comme étant le problème. C’est une position incohérente.
La féminisation de la culture : nous préférons la non-confrontation à la confrontation, mais parfois la confrontation est nécessaire. Je suis moi-même une personne non conflictuelle : Je ne suis peut-être pas un homme typique. Mais je sais qu’il y a des moments où il est très important de dire « non, ceci n’est pas bien, il y a une limite qui a été franchie ici » ; et nous savons que les femmes sont beaucoup plus tolérantes vis-à-vis de ce que je pense être une culture pathologique du wokisme, en raison d’un désir mal placé de ne pas offenser qui que ce soit. La société a besoin d’une certaine cohésion et elle est en train de perdre cette cohésion.
J’insiste une fois de plus sur le fait que je suis favorable à ce que la culture s’inspire de la sagesse des femmes, mais l’obsession de « sécuritaire » — l’aversion pour tout risque aujourd’hui — paralyse la société et est en fait devenue un danger en soi. Les « espaces sécurisés » et tout le reste : eh bien, écoutez, si vous allez à l’université, vous devez grandir. Ce dont nous avons besoin, c’est d’avoir des conversations dans lesquelles nous nous défions mutuellement, et où nous disons « Je ne pense pas comme ça, mais je respecte votre position : maintenant, dites-moi pourquoi vous pensez ainsi ». Nous devons avoir de véritables conversations. Mais si vous essayez d’avoir ces conversations maintenant, le processus est bloqué et des protestations ont lieu. C’est la mort d’une université, et je pense que dans un sens plus large, c’est la mort d’une culture.
Notre vie est organisée de manière à minimiser les risques. Mais lorsque vous minimisez les risques, vous minimisez également les réalisations. Les civilisations sont construites par des personnes qui sont prêtes à être courageuses, à être aventureuses ; or, nous sommes devenus paresseux et privilégiés. Nous pensons qu’il est de notre droit de bénéficier d’une civilisation sans y contribuer, sans endurer les difficultés qui vont de pair avec la préservation d’une civilisation : défendre les choses qui comptent.
______________
Hannah Gal a notamment écrit pour Quillette, The Critic, The SpectatorUS, UnHerd, Creative Review, The Guardian (Art&Design) et The Jerusalem Post. Les articles d’Hannah ont été gentiment retweetés et partagés par Jordan Peterson, Douglas Murray, Warren Farrell, Sebastian Gorka, Will Knowland et Christina Hoff Sommers, entre autres. Gal est une réalisatrice de documentaires plusieurs fois récompensée.
Texte original : https://channelmcgilchrist.com/context-is-everything-because-nothing-is-what-it-is-without-a-context-by-hannah-gal/