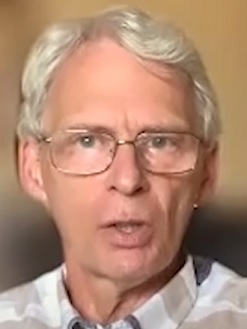David Edwards, corédacteur en chef de Media Lens, vient de publier son premier livre en solo depuis 27 ans, A Short Book About Ego and the Remedy of Meditation (Un petit livre sur l’ego et le remède de la méditation). Ce juillet, Media Lens entre dans sa 25e année d’existence.
___________
Introduction, les 25 ans de Media Lens : La Machine et le « Cavalier de l’Apocalypse »
Notre expérience au cours du dernier quart de siècle est bien résumée par une publication sur X associant deux couvertures spectaculaires du magazine Time. La première, parue la semaine dernière, montre une affiche du dirigeant iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, dont la moitié du visage est arrachée, remplacée par les mots : « LE NOUVEAU MOYEN-ORIENT ». La seconde, de mars 2003, montre une affiche du dirigeant irakien Saddam Hussein, dont la moitié du visage est effacée par un peintre blanchisseur, à côté de ces mots : « LA VIE APRÈS SADDAM ».
Même diabolisation, même réflexe belliciste, même désir de « changement de régime » — Un jour sans fin, mais sans éveil spirituel.
Sur X, le journaliste Neil Clark a commenté : « C’est profondément déprimant qu’après les “ADM irakiennes” il y a 22 ans, on rejoue exactement la même mascarade proguerre, avec une seule lettre changée — un “K” remplacé par un “N”. »
Si vous avez de la chance ! La semaine dernière, Sam Kiley, rédacteur en chef des affaires internationales pour The Independent, a écrit : « L’Amérique devrait-elle revenir au business du changement de régime — qui a horriblement échoué en Irak [sic] et en Afghanistan, laissant les deux nations ruinées, gangrenées par l’extrémisme… »
Nous avons commenté : « C’est peut-être juste nous, mais nous trouvons significatif — et laid — que Sam Kiley et ses rédacteurs aient commis cette petite erreur… »
Kiley a écarté notre critique d’un revers de la main : « Non, c’est une coquille. Merci d’avoir repéré ce que j’aurais dû ».
Mais ce n’était pas juste une coquille. L’article de Kiley contenait cette propagande à la sauce guerre d’Irak : « Le pari des États-Unis est que le gouvernement iranien nourrit encore le rêve d’anéantir Israël et que à moins qu’il n’accepte un programme d’inspection nucléaire totalement intrusif 24h/24 et 7j/7, on ne pourra jamais lui faire confiance pour ne pas remonter sur un cheval de l’Apocalypse ».
Est-ce vraiment le « rêve » de l’Iran ? Un rapport du Pentagone de 2014 ne semblait pas le penser : « La doctrine militaire iranienne est défensive. Elle vise à dissuader une attaque, survivre à une première frappe, riposter contre l’agresseur et forcer une solution diplomatique aux hostilités, tout en évitant toute concession menaçant ses intérêts fondamentaux ».
Noam Chomsky l’a souvent rappelé : « Je ne pense pas qu’un analyste stratégique sérieux — je n’en ai en tout cas jamais vu — pense qu’il existe un risque que l’Iran utilise une arme nucléaire. Ce serait un suicide total ».
Quant à la confiance, l’Iran respectait pleinement l’accord de 2015 intitulé Plan d’action global commun (PAGC) — c’est Trump qui a sabordé l’accord et qui ne méritait pas la confiance. En dehors de l’imagination fébrile de Kiley, rien ne prouve que l’Iran ait jamais monté un « cheval de l’Apocalypse ».
Après l’attaque américaine contre les installations nucléaires iraniennes le 22 juin, une section du fil d’actualité en direct de la BBC portait ce titre : « En quoi la situation en Iran est-elle comparable aux événements en Irak ? » La question a été posée au rédacteur en chef des affaires internationales, John Simpson, qui a répondu : « Je pense que c’est un cas différent ».
Simpson a poursuivi, mais, chose remarquable, ce fut sa seule réponse à la question mise en titre.
On a eu droit à une autre tranche de comédie noire quand la BBC a demandé au ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, si l’attaque américaine était légale. La réponse de Lammy : « Nous n’avons pas été impliqués ».
Littéralement, c’est la seule chose que Lammy a dite, répétée plusieurs fois. On a l’impression que c’était hier que nous citions cette réplique de Laurel et Hardy en août 2003 :
Mme Hardy : « Et comment va Mme Laurel ? »
Stanley : « Oh, très bien, merci. »
Mme Hardy : « J’aimerais la rencontrer un jour. »
Stanley : « Moi non plus ». (Laurel et Hardy, Chickens Come Home, 1931)
Depuis un quart de siècle, nous documentons le triste défilé des guerres occidentales et des guerres par procuration en Serbie, en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie, en Ukraine, à Gaza et maintenant en Iran. Nous avons documenté le discrédit systématique des critiques de ces guerres — des figures comme Noam Chomsky, Edward Herman, John Pilger, Robert Fisk, Howard Zinn, Edward Snowden, Julian Assange et Jeremy Corbyn. Derrière et au-dessus de tout cela, nous avons documenté la dévastation de l’atmosphère et de la biosphère dont dépendent nos vies.
Ce qui ressort clairement, c’est l’image d’une Machine militaro-industrielle-médiatique implacable, qui sélectionne automatiquement les politiciens, cadres d’entreprise et journalistes prêts à subordonner l’humain et la planète au profit. Toute personne essayant autre chose est ciblée pour être éliminée du système ou détruite. Toute personne gênante — qu’il s’agisse d’un journaliste honnête ou d’un enfant palestinien luttant pour survivre — devient une cible légitime. La Machine place le profit au-dessus de tout principe éthique — même les qualités humaines les plus précieuses, comme l’amour et la compassion, sont perçues comme des menaces à abattre. Voilà la réalité cauchemardesque et dystopique à laquelle nous sommes confrontés.
Bien que la Machine fonctionne comme un automate autorégulé selon une « logique » interne psychopathique, ce n’est en réalité pas une machine du tout. C’est un ensemble d’êtres humains travaillant ensemble pour faire de la Machine une réalité de facto. Ce sont les êtres humains qui se l’infligent eux-mêmes.
Ce n’est pas un hasard si cette Machine avide, insatiable et impitoyable ressemble tant à l’ego humain insatiable et impitoyable. La Machine est un système politique et économique, mais elle repose sur une profonde maladie psychologique et spirituelle.
Nous devons comprendre l’ego — d’abord, et surtout, en nous-mêmes. Si nous parvenons à voir au travers de ses illusions, nous pourrons dévoiler un antidote efficace à cette Machine génocidaire et biocide. Le désert croissant que nous voyons dans le monde autour de nous est la manifestation de cœurs humains dévastés par l’ego. C’est la raison d’être de ce livre Un petit livre sur l’ego, écrit en une époque de guerre perpétuelle.
À lire sur le blog le premier chapitre de ce livre : Le cercle des miroirs de l’ego — Partie 1 & Partie 2
Texte original publié le 24 juin 2025: https://www.medialens.org/2025/a-short-book-about-ego-and-the-remedy-of-meditation-an-extract/
_______________________________
Interview de David Edwards par Stanley Betts
 Stanley Betts est un talentueux vidéaste et monteur de 23 ans. Sa vidéo, Pourquoi Pascal avait raison — Les bienfaits de la solitude, a été vue 1,3 million de fois sur YouTube. Stan a commencé le podcasting avec une interview rafraîchissante de son père, le dramaturge Torben Betts, intitulée Les conseils de mon père pour survivre à la vingtaine. L’idée a été évoquée qu’il m’interviewe (DE) sur des thèmes similaires. Finalement, les questions se sont rapidement concentrées sur mon intérêt pour la méditation et comment j’ai quitté ma carrière en entreprise dans ma vingtaine.
Stanley Betts est un talentueux vidéaste et monteur de 23 ans. Sa vidéo, Pourquoi Pascal avait raison — Les bienfaits de la solitude, a été vue 1,3 million de fois sur YouTube. Stan a commencé le podcasting avec une interview rafraîchissante de son père, le dramaturge Torben Betts, intitulée Les conseils de mon père pour survivre à la vingtaine. L’idée a été évoquée qu’il m’interviewe (DE) sur des thèmes similaires. Finalement, les questions se sont rapidement concentrées sur mon intérêt pour la méditation et comment j’ai quitté ma carrière en entreprise dans ma vingtaine.
Ci-dessous, un extrait édité pour plus de clarté, suivi d’un lien vers le podcast. Un second épisode abordera Media Lens et mon livre, A Short Book About Ego and the Remedy of Meditation (Mantra Books, juin 2025).
Le Robot En Chair Et En Os Change D’Avis
Stanley Betts (SB) : Et à quel moment as-tu découvert la méditation et son utilité ? Était-ce dans ta vingtaine ?
David Edwards (DE) : Oui, c’était dans les années 1980, pendant ma vingtaine. J’ai commencé à lire sur le taoïsme, le Tao Te King, des livres d’Alan Watts, dont je sais que tu es un grand fan.
SB : Mais comment es-tu même arrivé à lire le Tao Te King ? Tu l’as trouvé par hasard en librairie ou un ami te l’a offert ?
DE : À l’université, j’ai lu Jean-Jacques Rousseau… Son argument était que si l’on est en harmonie avec la nature, en vivant de manière naturelle, on trouve une bonté et une félicité impossibles à atteindre dans notre société. Dans Les Rêveries du promeneur solitaire, il offre un véritable guide de pleine conscience. Il disait que le problème des hommes et des femmes modernes est que nous ne sommes jamais dans le moment présent. Nous sommes coincés dans ce qu’il appelait la « prévoyance » — nous anticipons, obsédés par un futur qui n’arrivera peut-être jamais. Nous ne sommes jamais vraiment ici. En lisant cela — son association du bonheur avec la nature et un rythme de vie naturel —, cela a résonné avec mon expérience. Même si je ne la comprenais pas encore, cela faisait sens. Je sentais qu’il y avait là quelque chose.
Puis, en vivant en Suède, j’ai trouvé dans une librairie d’occasion Amour et connaissance d’Alan Watts, où il parlait du zen. Dès le premier paragraphe, il évoquait l’harmonie avec le monde naturel. Et donc, j’ai tout de suite eu le sentiment qu’il y avait là quelque chose de réel. Après cette lecture, c’était parti — j’étais lancé. Je ne comprenais pas le zen, je n’avais aucune idée de ce dont parlait Watts, mais je pressentais une vérité. J’ai persévéré obstinément dans cette voie, et cela continue depuis.
SB : Et quand tu as découvert tout ça, était-ce en même temps que ton travail dans cette boîte ? Tu bossais sur une ligne téléphonique, c’est ça ?
DE : Oui. Je travaillais dans télévente pour une entreprise américaine vendant des accessoires informatiques à White City, Londres. Je faisais 1h15 de métro aller-retour chaque jour. Nous étions une dizaine ou une quinzaine dans un bureau, répondant à des appels pour des commandes livrées le jour même. Une version primitive d’Amazon.
SB : D’accord.
DE : Il y avait des lumières rouges et bleues au plafond. Si le téléphone sonnait plus de cinq fois, le bleu clignotait. Au-delà de dix fois, le rouge s’allumait, et les gens de la comptabilité et des ventes devaient se précipiter pour répondre. Donc, je passais mes journées à saisir des commandes. C’était affreux. Les collègues étaient sympas, mais le travail était automatique et fastidieux.
J’ai commencé à lire Le Tao de la physique de Fritjof Capra. Puis son livre Le Temps du changement m’a marqué. Écrit en 1982, il prédisait un virage de la civilisation humaine, abandonnant l’économie fossile pour les énergies renouvelables. On attend toujours ce « tournant » !
Je lisais ces livres sur le taoïsme et des philosophies alternatives, tout en étant un robot en chair et en os dans cette entreprise. C’était un énorme conflit intérieur, parce que ces deux mondes n’avaient rien à voir… On me demandait : « Pourquoi tu lis ces trucs ? » Ma famille disait : « C’est de la folie ! Pourquoi tu lis des choses sur le taoïsme ? » Un jour, j’ai quitté la télévente pour aller chez British Telecom dans le West End. Je gérais une équipe de 12 personnes, souvent deux fois mon âge — j’avais 25 ans. Aucune expérience en management ou télécoms. J’étais complètement largué.
En même temps, j’ai commencé à lire Erich Fromm, que j’adorais. J’ai tout dévoré d’Alan Watts, Christmas Humphreys, Teddy Goldsmith, Jonathan Porritt. Et je me disais : « Ce travail me stresse, gérer toutes ces personnes, et cette passion pour les idées alternatives n’aide pas — je suis déchiré. Je fais mon travail avec une main attachée dans le dos ».
Un jour, j’ai carrément jeté mes livres — sur le taoïsme, Watts, Humphreys. Je les ai cachés, même balancé certains. je me suis retourné contre tout ça. Mais ça n’a pas duré : ce monde de l’entreprise était trop ennuyeux.
Puis vint le tournant écologique. En 1988, James Hansen, un scientifique de la NASA, a alerté l’ONU sur l’urgence climatique. J’ai plongé dans la politique verte, milité avec les Amis de la Terre à Londres. On manifestait déguisés en machines à laver basse consommation. — photos à l’appui, d’ailleurs, c’est hyper gênant ! Tout le monde nous prenait pour des fous. Si aujourd’hui on vous trouve bizarre pour ça, imaginez en 1989 !
Tout a vraiment basculé quand j’ai lu le livre de Joseph Campbell, Le Héros aux mille et un visages. Il écrivait : si vous placez quelque chose de mort au cœur de votre vie, vous vivrez cette mort. Donc, par exemple, si tu mets l’argent au centre de ta vie — comme je l’avais fait — tu vivras une forme de mort intérieure. tu avances dans cette voie, plus tu ressens ce vide. Tu crois traverser une phase pour atteindre le bonheur, mais, en fait, tu trouves juste encore plus de vide, avec plus de responsabilités et plus de stress.
Il faut mettre quelque chose de vivant au cœur de ta vie. Et c’est quoi, ce quelque chose ? Campbell disait : « Suivez votre félicité ». ce qui peut sembler un peu kitsch. Mais ce qu’il voulait dire, c’est : trouve ce qui ne t’apporte pas seulement du plaisir, mais un épanouissement profond, une telle joie que tu serais prêt à le faire pendant dix ans, gratuitement, sans aucune récompense.
Tu es prêt à consacrer dix ans de ta vie, ou le temps qu’il faut, à faire cela, et ta récompense, c’est l’activité elle-même ; tu ne te préoccupes pas du résultat. Tu ne penses surtout pas à l’argent. Tu ne penses pas à la gloire ou au statut — tu fais ça parce que tu aimes ça. Moi, j’adorais écrire des histoires. J’adorais écrire des réflexions, des pensées philosophiques. J’en faisais déjà beaucoup à l’université. J’aime écrire, et j’aime lire sur le mysticisme, sur le fait de suivre sa félicité.
À ce moment-là, j’étais responsable marketing dans un cabinet de conseil en gestion en périphérie de Londres. Un jour, j’ai eu une dispute avec le président de la boîte, qui m’a lancé : « David, si tu ne sais pas ça, tu ne devrais même pas être assis là ! » Et je me suis dit : « Bon sang… » C’était profondément insultant, humiliant.
C’était un bel après-midi ensoleillé, un vendredi, le 12 juillet 1991. J’avais 29 ans. J’ai déposé ma lettre de démission et je suis rentré à pied chez moi. C’est la meilleure décision que j’aie jamais prise. Et je me suis dit : « OK, je vais écrire ». J’ai dit à un ami : « Je vais devenir écrivain ! » Il m’a répondu : « Non, non, non ! Soit tu es écrivain, soit tu ne l’es pas. On ne devient pas écrivain, on vit en tant qu’écrivain. Sois écrivain ! N’essaie pas de le devenir, sinon tu n’y arriveras jamais ». C’était un conseil génial. Je crois que j’avais 3 000 £ sur mon compte, et j’ai passé les dix années suivantes à écrire des centaines de pages d’histoires et d’articles, et à tout lire. Joseph Campbell conseillait de lire les auteurs qu’on aime, puis de lire ceux qu’ils aiment eux-mêmes. C’est comme ça qu’on élargit son champ d’intérêt et qu’on va toujours plus loin.
Et en fait, pendant dix ans, avant de fonder Media Lens avec David Cromwell, j’ai juste écrit, sans avoir d’argent de côté, en enseignant l’anglais peut-être trois heures par jour. Quand j’avais assez d’argent, je passais au chômage et je continuais à écrire — quand j’avais plus d’élèves, je donnais un peu plus de cours. Ça a duré comme ça pendant dix ans. Et c’était fantastique, parce que passer d’un job d’entreprise stressant — où je gérais des gens, sous pression constante — à enseigner l’anglais à des ados thaïlandais pendant trois heures par jour, puis rentrer chez moi pour lire et écrire ce que je voulais, c’était le paradis. C’était le paradis, et l’argent ne m’a jamais manqué.
Tu dois placer quelque chose que tu aimes vraiment au cœur de ta vie. C’est ce que je disais plus tôt — tu ne peux pas mettre quelqu’un d’autre au centre de ta vie ; tu dois trouver ce centre en toi-même, le suivre et le suivre encore, sans penser aux résultats. Je sais que les gens détestent quand je dis ça — j’ai fait une alerte médias à ce sujet — j’ai reçu un retour de bâton de la part de journalistes disant que j’étais un parfait abruti. J’adore ça ! C’est un de mes articles préférés. Ils m’ont traité de « gros naze », parce que j’avais tweeté qu’il faut écrire ce qu’on aime et le donner gratuitement, sans penser à gagner de l’argent. Ils ont dit : « Tu encourages les gens à se faire exploiter ». Je pense qu’ils croyaient que j’étais un rédacteur en chef qui voulait exploiter les jeunes talents — ils n’avaient rien compris.
Mais si tu fais juste ce que tu aimes, sans but précis, c’est comme ça que tu trouves ta félicité, et c’est comme ça que ta vie devient vivante. Et ce sentiment d’être vivant vaut tellement — bien plus que d’avoir plein d’argent, une grosse voiture, ou, peu importe, une grande maison. Pour moi, en tout cas, c’est la bonne voie à suivre.
SB : Ouais. La philosophie de mon père, c’est de réduire au maximum ses dépenses, de vivre aussi simplement que possible, pour avoir plus de temps pour faire ce qu’on aime. Parce que plus tu as de responsabilités — les loyers élevés, tout ça — plus tu restes coincé dans le métro-boulot-dodo.
DE : Thoreau fabriquait des paniers qu’il vendait pour gagner de l’argent, et il disait : « Au lieu d’étudier comment rendre mes paniers attrayants pour les vendre, j’ai préféré étudier comment éviter d’avoir besoin de les vendre ». Je trouve ça génial. C’est exactement ce que j’ai fait. J’ai essayé de vivre très simplement ; je vivais dans une petite chambre à Bournemouth, tu vois. Bien sûr, ça devient beaucoup plus compliqué dès qu’on est en couple. Dieu sait ce que c’est pour ton père ; c’est un truc extrêmement complexe. Mais quand on est seul, c’est beaucoup plus facile.
SB : Et, tu sais, avec tes collègues, est-ce que tu sentais chez eux la même insatisfaction, l’envie de partir ? Détestaient-ils aussi leur travail ? Et sais-tu si certains sont encore dans ce boulot ou dans quelque chose de similaire ?
DE : Je ne sais pas. Je crois que tout le monde se plaint toujours de son boulot, non ? Tout le monde se plaint de tout, mais je ne pense pas qu’ils ressentaient l’envie de fuir comme moi. Pendant tout le temps où j’ai vécu à Londres — j’y suis resté cinq ans, dans ma vingtaine, avec une vie sociale géniale, plein d’amis, des sorties — c’est étrange avec le recul, parce que de l’extérieur, ça avait l’air d’une vie très sympa. Mais moi, j’étais juste désespéré de fuir ce problème de travail. Je ne comprenais pas qu’avoir quelqu’un qui me disait chaque jour quoi faire, devoir être dans un bureau précis de neuf à dix-huit heures, deux cents jours par an, avec seulement quatre semaines de congés… C’était une manière de vivre affreuse. Je ne pouvais pas l’accepter.
Mais je ne pense pas que beaucoup de gens avaient cette envie de s’évader. Je pense que leur plan, c’était de traverser tout ça pour finir par obtenir la liberté. C’est probablement ce que la plupart des gens font. Donc, ils rêvaient de promotions, de gagner plus d’argent, de déménager dans une jolie maison en banlieue, ou peut-être d’obtenir un poste plus confortable, plus élevé. Mais oui, je connais des gens qui — c’est incroyable — tu te souviens de cette entreprise d’accessoires informatiques ? Un ami à moi fait toujours ce genre de boulot, depuis quarante ans, et ça me sidère. Et mes supérieurs à l’époque font encore ce genre de travail. Et la vie passe très vite. Je veux dire, de 0 à 30 ans, ça semble durer une éternité, mais de 30 à 60, ça passe à toute vitesse. Et si tu gâches ces trente années dans un travail que tu n’aimes pas… Tu vois, moi, à 63 ans, je sens à quel point le regret est une force puissante quand on vieillit. C’est très facile de regarder en arrière et de se dire : « Oh mon dieu ! Qu’est-ce que j’ai fait de ces trente années ? » Donc, les gens doivent faire très attention à ça. On ne veut pas se retrouver à 60 ans et se dire : « Waouh, trente années gaspillées !?
SB : Ouais. Ça m’arrive parfois d’avoir ce genre d’« angoisse de lit de mort ». Tu vois, je m’imagine allongé sur mon lit de mort en train de penser : « Pourquoi j’ai fait ça ? Pourquoi je n’ai pas fait ça ? » Et mon problème, c’est que je remets toujours en question mes décisions, ce qui n’est pas idéal, parce qu’il faut juste prendre une décision et s’y tenir. Par exemple, je vais bientôt emménager dans un appartement, quitter ma maison. C’est un gros changement. Et je vais habiter avec un ami, quelqu’un que je connais depuis toujours. Mais tu vois, c’est une grande décision. Choisir la ville, choisir avec qui partager l’appartement… Donc oui, j’y vais un peu à l’instinct, tu vois, comme toi, quand tu as quitté ton boulot pour écrire. Je me demande comment tu as su ce qu’était ta « félicité » ? Écrire ? Tu l’as découvert avec le temps ou il y a eu un moment d’inspiration où tu t’es dit : « Oh, mon dieu, c’est moi ! C’est ce que je veux faire ». ?
DE : J’ai de grosses réserves sur Ernest Hemingway — le fait qu’il tuait des animaux, qu’il tirait sur des oiseaux juste pour le plaisir. Mais si tu lis son histoire Un endroit propre et bien éclairé — je crois que c’était sa préférée — moi, je l’adore. Elle est très courte, très simple, mais on sent qu’il ressentait une félicité en l’écrivant. On la sent. C’est comme une méditation — il est là. Il est totalement en paix avec ce qu’il écrit, et c’est rempli de félicité.
Et pour moi, très tôt, en écrivant mes petites histoires, mes premières observations, mes premiers récits — surtout de la fiction, en fait — je plongeais profondément dans mes émotions. Si tu écris avec la tête, ça ne fonctionne pas. Mais si tu écris avec tes émotions, que tu touches à des sentiments forts — l’amour, la tristesse, le regret, la nostalgie, ou peu importe — si tu es vraiment dans ton ressenti, il y a comme une résonance que tu peux capter. Et si tu restes dedans, tu peux la transmettre sur la page. Si tu communiques avec la tête, tu touches les gens au niveau de la tête. Mais si tu écris avec le cœur, tu touches les gens au niveau du cœur. Et pour moi, c’est ça, la félicité. Je veux dire, je sentais que c’était une activité belle, méditative.
Et c’est aussi vrai pour l’écriture politique. Parfois, j’écris avec la tête, et ça ne donne rien ; c’est sans vie, mécanique, ennuyeux. Mais si je ressens ce que j’écris, si j’écris avec passion ou compassion — par exemple sur la souffrance à Gaza en ce moment. J’ai récemment écrit un article sur un petit enfant en train de mourir de faim — et si tu écris avec le cœur à propos de ça, même en ajoutant plein de faits et de chiffres, ça reste une forme de méditation, et on peut le sentir. Je ressens la félicité et l’amour en écrivant. Et tu vois, je pense que, quand c’est bien fait, les lecteurs le ressentent aussi.
Donc, pour moi, il y a deux choses : d’abord, tu ressens la félicité en écrivant. Et puis, si tu écris quelque chose d’utile… en réalité, tout ce que j’ai écrit m’a aidé d’une manière ou d’une autre. Tu vois, si j’ai lu Joseph Campbell disant « suis ta félicité, fais ce que tu aimes », ça m’a énormément aidé. C’est ça, la félicité. Et si j’écris là-dessus d’une manière qui est fidèle à ce que je ressens, et que ça aide d’autres personnes, alors c’est merveilleux aussi. Par exemple, mon premier livre, Free to be Human — l’idée, c’était simplement de dire à des gens qui avaient vécu ce que j’ai vécu dans ma vingtaine : « Si vous ressentez du désespoir, comprenez que ce désespoir repose sur une vision du réel qui a été fabriquée pour vous par des intérêts qui ne veulent pas votre bien ». Donc je disais : « Le désespoir que vous ressentez repose sur une version du monde qui n’est pas réelle, pas vraie ». Et tout l’objectif, c’était juste de dire : « Vous avez déjà douté de tout — maintenant, doutez aussi de votre désespoir ! »
Mais c’est ce que j’ai ressenti en lisant Noam Chomsky, Joseph Campbell, tous ces penseurs… Howard Zinn, Edward Herman. J’ai compris que, oui, cette version du monde qu’on nous présente comme la réalité — qui semble être une impasse, une idée selon laquelle la vie est désespérante, terrible — en fait, elle est totalement fausse, fabriquée.
Donc c’est ce que j’ai toujours essayé de faire : si quelque chose m’a aidé, et que je sais très clairement que ça m’a aidé, une partie de moi pense automatiquement : « D’accord, comment puis-je aider les autres avec ça ? Est-ce que je peux l’écrire d’une manière qui aide les gens ? » Si je peux, tant mieux ! Pour moi, c’est merveilleux d’essayer de transmettre ça. Ça peut être n’importe quelle leçon que j’ai moi-même apprise, mais c’est souvent des choses que j’ai lues venant de grands penseurs ou de mystiques. Et pour moi, c’est ça qui est si merveilleux — écrire sur ces choses que j’aime, que je trouve intéressantes, et qui, je pense, peuvent vraiment aider.
DE et SB
(Retrouvez l’intégralité du podcast [ici].)
Texte original publié le 12 juin 2025: https://www.medialens.org/2025/how-to-ditch-a-corporate-career-stanley-betts-interviews-david-edwards/