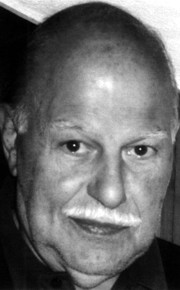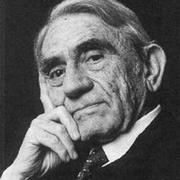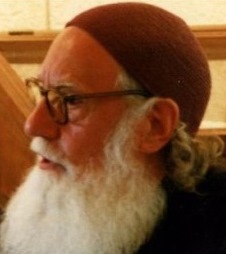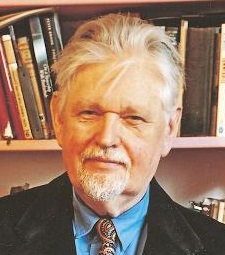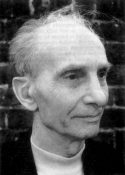Si Gurdjieff n’a jamais prétendu être soufi, il a soutenu qu’il enseignait, à sa manière, ce que les derviches enseignent. À première vue, il n’en est rien, dans un contexte non seulement muet sur l’islam, mais a-religieux. Dans le travail, néanmoins, des traces d’influence se dessinent : comment pourrait-il en aller autrement ? Les « exercices », les « mouvements » constituent Gurdjieff en « maître de danse », à la Rumi. Mais des techniques respiratoires et gestuelles analogues existent dans le christianisme oriental et dans le chamanisme, dont l’islam et le christianisme des pays de Gurdjieff ont subi l’influence, quand ils ne se sont pas seulement rencontré avec lui. Il paraît que certains traits spécifiques, d’ailleurs accessoires, des rites derviches reviennent dans le travail de Gurdjieff. Une influence soufie est certaine, d’autres aussi, probablement plus faibles, la réinvention ne l’est pas moins. Je n’ose plus avant…