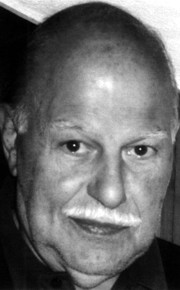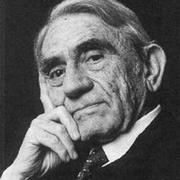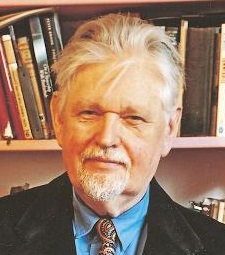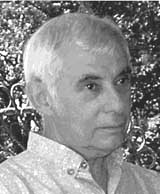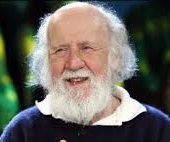Sans doute ne peut-on blâmer des tentatives de bonne foi – quoique à l’évidence prématurées – pour n’avoir pas réussi à relever un défi presque impossible, celui de transmettre, hors de son terrain propre, l’essence métaphysique d’un enseignement qui a pour fin, comme pour origine, la « réalisation » des potentialités de l’être et de ses « pouvoirs correspondants de manifestation ». Mais comment, par ailleurs, ne pas savoir que toute naïveté, toute prétention, dans ce domaine, risque fatalement d’exposer les autres aux pires méprises, de provoquer inconsciemment plus de mal que de bien…
Michel de Salzmann : Les miettes du festin