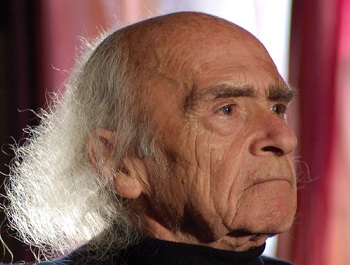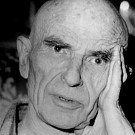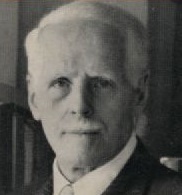Vimala Thakar : La méditation
Mes amis, je voudrais partager avec vous quelque chose au sujet de la méditation, la méditation comme chemin de vie, comme manière alternative de vivre, comme dimension alternative de la conscience. Celui qui a observé et étudié les besoins physiques, la structure physique, et qui s’organise pour les satisfaire convenablement et sainement, peut poursuivre en […]