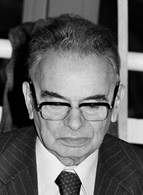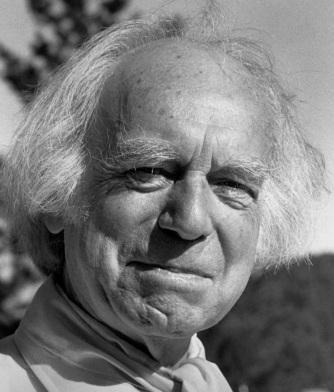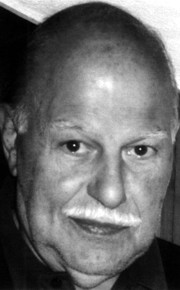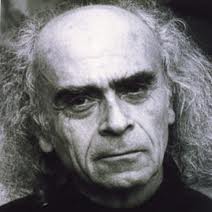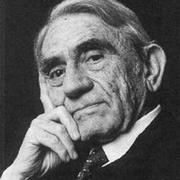Passent les jours et les semaines. Passent les mois et les années. Les siècles et les millénaires peuvent passer de même. Cela est en nous. Et cela est la vérité. Extérieurement, comme une pluie ruisselant sur nos traits, les brouillant, les effaçant, nous empêchant d’y voir clair, les événements peuvent se succéder. Nous pouvons être précipités dans le torrent des passions, emportés par le vent de l’Histoire, disparaître dans les déserts d’époques sans vie ou dans les abysses de temps muets où se préparent les ères nouvelles, nous pouvons être prisonniers de toute cette quasi invincible apparence, entichés de ce presque inexpugnable visage des choses, cela existe : envers et contre tout, il y a en nous cette fleur de feu que nous avons vue un jour et qui ne cesse de s’épanouir, cette flamme d’or qui ne cesse de grandir et se nourrit de notre obscurité même, de notre confusion, de notre ignorance et fait de notre forme l’athanor où la Nuit se dénude et se transmue en Jour et où, lentement, l’expérience du Temps se change en la légende de l’Éternité.